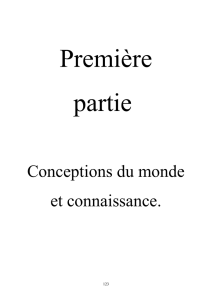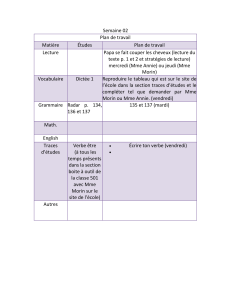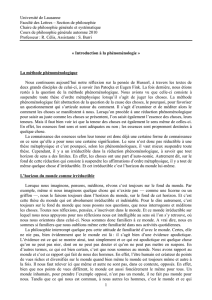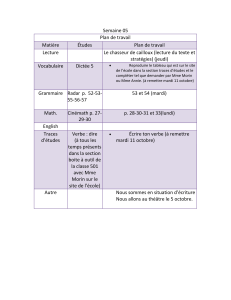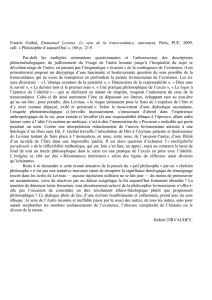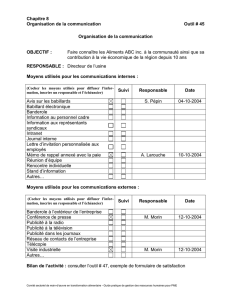Conceptions du monde et connaissance.

123
Première
partie
Conceptions du monde
et connaissance.

124
Chapitre 1
Le paradigme occidental battu en brèche par la science elle-même.
I- Vers une nouvelle alliance, une nouvelle représentation de l’univers.
1- La science positiviste : un monde métaphysique, une connaissance hors de la vie.
Classiquement la connaissance du monde vrai dans les sciences positivistes se caractérise par
la recherche de l’essence et de la transcendance. Il y a nécessité de dépasser les apparences et la
diversité pour définir des lois générales et universelles, des vérités ultimes qui régissent le monde
éternel et conservatif afin de rechercher un ordre pré-établi et d’envisager des causes dans un passé
déjà là comme chez les précurseurs de la science moderne (Descartes, Leibniz) ou d’envisager les
causes comme ce qui permet de prévoir (Laplace). Pour cela, la science doit discriminer dans la nature
ce qui est supposé correspondre à une réalité objective et ce qui est réputé illusoire parce que lié à
notre propre subjectivité. « La science doit être comme capable de découvrir la vérité globale de la
nature », (Prigogine, Stengers, 1986, 81) ce qui en constitue l’essence (idem, 75).
Pour établir les lois qui gouvernent la nature, la science a dû éliminer le temps comme variable et le
réduire à un temps « trajectoire, celui de nos montres, extérieur à l’organisme et à toute chose
naturelle’ »(…). « La diversité qualitative des changements est réduite à l’écoulement homogène et
éternel d’un temps unique, mesure mais aussi raison de tout processus» (Prigogine, Stengers,
1986,106)
La connaissance correspondante découpe le réel compliqué en éléments simples afin de
chercher derrière l’apparence les éléments constitutifs qui permettront d’expliquer ce réel et d’agir sur
lui. La science classique a la conviction que le microcosme est simple (Prigogine, Stengers, 1986, 39).
Le tout ne peut se connaître que par la connaissance des éléments simples qui le constitue et grâce à la
démarche analytique réductionniste qui en permet la distinction. Il faut avec le déterminisme
Laplacien, résumé le plus abouti de la science classique, exclure de l’univers la possibilité « de
niveaux d’organisation qualitativement différents », concevoir que «chaque niveau y est réductible
sans reste à celui, ultime, des particules en mouvement » et « refuser aux parties de l’univers la
moindre autonomie à l’égard du tout » (K Pomian, 1990, 14).
La science repose sur l’idée que l’homme peut connaître objectivement la nature et qu’il y a
coïncidence entre son intelligence et le réel. Ainsi, « La physique1 met la nature en demeure de se
1 Modèle paradigmatique de la science positiviste du XIX et d’une grosse première moitié du XXè.

125
montrer comme un complexe calculable et prédictible de forces que l’expérimentation est commise à
interroger, afin que l’on sache si la nature ainsi mise en demeure répond à l’appel ». «Le noyau de la
logique classique identitaire (Aristote) a armé la vision d’un monde cohérent entièrement accessible à
la pensée » et participée à une « conception du monde qui se fonde sur deux postulats rationalisateurs :
coïncidence entre l’intelligibilité logico- mathématique et les structures de la rationalité objective et
principe de raison suffisante qui donne à tout ce qui est une raison d’exister » (Morin, 1991, 226). Elle
est fondée sur la croyance en une intelligence, un esprit et une connaissance qui eux sont libérés du
déterminisme. Le dieu du déterminisme est celui d’une intelligence posée comme un idéal que
l’histoire va contribuer à atteindre. L’intelligence humaine, tout comme le dieu régulateur de la raison
pure de Kant, doit tendre à s’approcher de la vérité et à réaliser ce qui, dans l’homme, est proprement
humain et dont procède de sa supériorité sur les animaux. (K Pomian,1991, 15). La science rationnelle
est pour A Comte, l’aboutissement du développement de la connaissance.
L’esprit humain et donc la connaissance relèvent ainsi « d’une finalité immanente, leur état
présent étant à chaque fois induit par la visée d’un état postérieur, voir d’un état final hors d’atteinte ».
« Identifié à l’intelligence, le sujet connaissant est extérieur à l’objet et même à l’univers, parce qu’il
participe de l’esprit humain, du royaume des fins» (K Pomian,1991, 15-16). L’intelligence et le
royaume de la raison peuvent voir le jour, supplanter Dieu et déterminer la visée de la science afin de
libérer l’homme du déterminisme que pourtant elle étudie et qui a cours dans la nature. Dans la plus
pure tradition dualiste, l’esprit garde sa dimension de chose pensante séparée du matériel, sa propriété
principale, l’intelligence, détermine la visée idéelle, la connaissance devient le moyen de réaliser, dans
un développement jamais terminé, l’avènement de l’homme à la place de Dieu et signe la possibilité
d’un humanisme. Même dans ses développements les plus matérialistes comme dans l’étude du
fonctionnement du Système Nerveux pour expliquer l’esprit (mind)2 et le développement des capacités
cognitives, l’intelligence en tant que conscience se place en extériorité et présuppose ce qu’elle étudie
(cf. le débat JP Changeux, P Ricœur, 1998), se pose comme non déterminée si ce n’est non
déterministe. En présupposant une intelligence capable de s’auto étudier de l’extérieur, elle continue
de poursuivre l’idéal d’une connaissance et d’une intelligence qui se prend pour Dieu, en contradiction
avec le théorème de l’incomplétude et d’indécidabilité logique de Gödel et la logique de Tarski3.
Même la neurophilosophie, jusque dans ses développements connexionnistes, qui défend une
idéologie naturaliste liée à un matérialisme réductionniste et appartient au mouvement du positivisme
logique (B Andrieu, 1998), bien qu’elle s’en défende, est sur la visée d’une intelligence comme
aboutissement ultime4.
3 Et non pas l’esprit au sens immatériel de l’âme.
3 K Gödel : th de l’incomplétude et indécidabilité logique les systèmes formalisés complexes ne peuvent trouver en eux-
mêmes la preuve de leur validité ;
A Tarski: un système sémantique ne peut s’expliquer totalement lui-même.
4 Même si cette intelligence est une émergence due à la complexité du système, à son organisation hiérarchique émergente
des interactions entre les composants, au rôle du bruit, même si elle est posée comme une fin, de fait, c’est bien elle qui
apparaît en bout de chaîne, donnant à l’homme un pouvoir et donc des devoirs pour guider et s’occuper du monde.

126
Pourtant, L’intelligence scientifique ne peut comprendre la durée, le temps durée5 propre au
déroulement de la vie vers la mort, un temps ayant une valeur, un sens, voire une essence. Elle le
ramène à une succession d’états instantanés reliés par une loi déterministe . Or « le temps est invention
ou il n’est rien du tout », (Bergson, 1959, 784) « la vie progresse et dure » (idem, 538). Le « temps
durée » est le temps interne qui pourrait pour les êtres vivants se rapprocher de l’âge biologique. Pour
l’organisme considéré de son point de vue et de ses constituants, il est donc ce qui fait sens tout en
rapprochant d’un équilibre ultime qui présente à la fois du déterminisme et de l’incertitude en fonction
des manières dont les partitions de la vie seront jouées par le sujet. « Le changement pur, la durée
réelle, est chose spirituelle, ou imprégnée de spiritualité. L’intuition est ce qui atteint l’esprit, la durée,
le changement pur » (Bergson p 1274, cité par Prigogine, Stengers, 1986, 154-155). L’intelligence, du
fait de son mode de pensée analytique ne peut rien saisir de cette progression sauf à immobiliser et
découper. En se coupant du « temps durée », elle se sépare de l’homme et le situe en dehors de la
nature. Par son mode de conscience analytique, séquentiel et linéaire du sujet spectateur, la théorie
devient un contenant pour les faits. L’en dedans est une fiction qui est pensée de l’extérieur, de l’en
dehors. L’unité de l’expérience est le produit d’une unification. L’unité est unification, assemblage
synthétique, et résulte d’une synthèse organisée. La totalité et l’unité de l’expérience sont le résultat
d’une construction intellectuelle, d’une approche quantitative du réel. La science classique et le mode
de pensée technologique qui la caractérise cherchent l’unité dans la multiplicité pour produire du
général, construisent une unité qui est une unification. La science reconstruit un monde à partir de
constructions de l’esprit sur ce monde dans lequel il vit.
Le questionnement sur la connaissance du monde vrai est finalement une prise de position
ontologique à la fois sur le réel, sur la nature et sur l’intelligence, mais aussi sur la place de l’homme,
ce qu’il est. La recherche d’une explication ultime, d’une essence derrière l’apparence ne peut
déboucher que sur 3 explications : l’existence d’un Dieu organisateur, une matière ou une substance
organisée traversée par des « forces », des « énergies », des « informations » explicatrices des
transformations, un esprit de connaissance capable de connaître le monde matériel ou au contraire
origine du monde et constructeur d’une représentation de celui-ci seule connaissable. Cette
connaissance trouve son origine et permet de résoudre l’angoisse cartésienne qui traverse toutes les
philosophies occidentales à la recherche de fondements : soit notre connaissance possède un
fondement fixe et stable, un point d’où elle part, où elle s’établit et repose soit c’est l’obscurité, le
chaos. Ce fondement est soit intérieur, dans l’esprit, soit extérieur dans le monde qui l’entoure. Soit il
existe un Soi unique, indépendant, cohérent à partir duquel nous appréhendons le monde, soit le réel
est donné, objectif et le sujet se le représente. Soit il faut chercher ce Soi, soit il faut comprendre
comment l’homme se représente le monde objectif et étudier ce monde objectif. Ainsi la pensée
5 Distinction proposée par J Ardoino lors d’une conférence non publiée à propos du temps scolaire et du difficile sens du
temps espace de l’emploi du temps.

127
occidentale oscille continuellement entre matérialisme et idéalisme, à la recherche continuelle d’un
fondement au- delà du monde phénoménal.
La science tente de résoudre cette question du monde en imposant l’idée « d’un
homomorphisme parfait entre langage formalisé, logique mathématique d’une part, et, d’autre part, la
nature, l’univers. Ainsi s’affirme une absolutisation onto-logique : la logique déductive/ identitaire
correspond à la vraie réalité, à l’essence même du réel, elle en est l’expression et le révélateur » (E
Morin, 1991, 178). Avec le déterminisme dont les controverses « permettent de mettre en évidence les
failles et les soubassements même du système des savoirs » (K Pomian, 1991, 58) et sa rupture avec le
temps, « elle dessine une fracture entre les philosophies à aspiration scientifique, en général
déterministes, et les philosophies du temps, parfois fascinées par le destin » (idem, 54).
Même quand elle tente de résoudre cette question, grâce à la conceptualisation de trois mondes
(Popper) - le monde 1 physique, le monde 2 psychique et le monde 3, produit des deux autres,
« susceptible de générer sa propre autonomie partielle » (G Lerbet, 1995, 52) grâce à « une pleine
conscience du moi » (Poppers, cité par G Lerbet, 1995) -, il s’agit bien toujours de chercher la vérité
d’une réalité, de poursuivre une réalité accessible mais objective et construite, vérité et réalité
produites par une conscience objective et indépendante. « La vérité de la réalité est celle de l’esprit
humain, démiurgique, qui peut espérer grandir en conscience absolue. » (G Lerbet, 1995, 53). Ce
troisième monde n’est pas une interface agissante mais bien un moyen de penser les deux autres à
partir d’un homme et de sa conscience posée sui généris.
Les sciences se sont ainsi fermées sur elles-mêmes. « Depuis Descartes, nous pensons contre
nature, assurés que notre mission est de la dominer, la maîtriser, la conquérir », en accord en cela avec
« Le christianisme qui est la religion d’un homme dont la mort surnaturelle échappe au destin commun
des créatures vivantes » et avec « l’humanisme qui est la philosophie d’un homme dont la vie sur-
naturelle échappe à ce destin : il est sujet dans un monde d’objets, souverain dans un monde de
sujets » (E Morin, 1973, 20). La science produit une « vision mécaniste, matérialiste, déterministe »
qui « satisfait en fait des aspirations religieuses : besoin de certitude, volonté d’inscrire dans le monde
lui-même la perfection et l’harmonie perdues avec l’expulsion de Dieu » (Morin, 1991, 226).
Le monde est expliqué soit par les choses elles-mêmes en opposition aux apparences, soit par
l’esprit immatériel de l’homme à l’intelligence non-déterministe mis à la place de dieu. Le monde est
celui de la matière ou celui de l’esprit. Sa connaissance porte sur l’au- delà de la nature, sur l’au- delà
du monde tel qu’il nous est donné. Elle est possible grâce à un esprit souverain qui ne prend pour vrai
que ce qu’il est capable de raisonner indépendamment du temps, du vécu, du ressenti, au- delà des
apparences, au- delà de l’homme et de son monde, en dehors de ce monde et face à lui. La
connaissance est obligatoirement en extériorité et en face des choses étudiées.
Le monde de la science positiviste en détrônant Dieu pour l’homme est un monde
métaphysique dont la connaissance laisse l’homme face à lui-même, du fait de la rupture entre l’être et
l’avoir, à la recherche continuelle de son être, démiurge perdu face à la nature, sans réponse quant au
soi, au Soi, qu’il doit inventer et assumer, responsable de la nature. C’est un monde méta physique au
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%