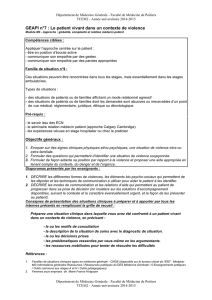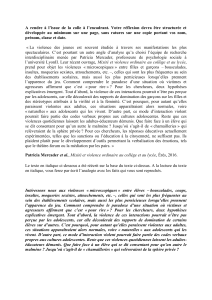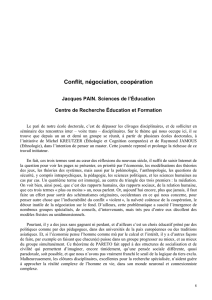les facteurs explicatifs de la violence politique

Le workshop de Nice s’est déroulé sur deux jours pleins, faisant in-
tervenir 18 chercheurs, sociologues, politistes et historiens, venant
de France mais aussi d’Espagne, d’Italie, de Grande-Bretagne, de
Hollande et d’Allemagne. Consacré à la violence politique, il s’est
structuré autour de cinq grands thèmes : les émeutes et manifesta-
tions contre l’État ; les violences entre groupes sociaux et intercom-
munautaires ; les violences terroristes internes ; les groupes poli-
tiques violents et enn les violences d’État.
On présentera dans ce compte rendu les grandes conclusions ana-
lytiques en évitant un résumé des interventions pour privilégier les
synergies conclusives des différents papiers.
LES FACTEURS EXPLICATIFS
DE LA VIOLENCE POLITIQUE
Xa v i e r Cr e t t i e z
n°32
Juin 2009
Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe. CRIMPREV Project. Coordination Action of the 6th PCRD, nanced by the European Commission. Contract n° 028300.
Starting date : 1st July 2006. Duration : 6 months. Project coordinating by CNRS – Centre National de la Recherche Scientique. Website : www.crimprev.eu. E-mail : contact@crimprev.eu

2
C’est principalement autour des facteurs explicatifs de survenance
de la violence politique que se retrouvent tous les intervenants. C’est
cette dimension qui guidera ici notre réexion.
Qu’il s’agisse des violences ethniques, raciales, idéologiques ou so-
ciales, qu’elles soient contre l’État ou entre communautés, mues par
des ambitions politiques, économiques ou simplement identitaires,
les chercheurs réunis à Nice se sont tous interrogés sur les raisons
à la fois de l’émergence de ces violences mais aussi de leur péren-
nité.
On découpera l’analyse en trois niveaux en distinguant un niveau
macro, faisant intervenir les ressorts larges de l’émergence de la
violence (économiques, culturels, institutionnels), un niveau mezzo
interrogeant les facteurs situationnels, communicationnels et organi-
sationnels qui inuent sur le déclenchement et la continuité des vio-
lences, et enn, un niveau micro, centré sur la dimension à la fois
psychologique et cognitive du rapport à la violence.
Si ces trois niveaux sont présentés ici successivement, la prétention
explicative des phénomènes de violence politique force à les confon-
dre de façon sûrement inégale selon le type de violence à l’œuvre,
mais en prenant systématiquement en compte cette focale tryptique.
Opérer ainsi revient à s’inscrire dans les encouragements de Donatel-
la della Porta qui appelait, dans son intervention, au rapprochement
des approches disciplinaires entre la sociologie de l’action collective
et les analyses sur la violence politique.
I - l e n I v e a u m a c r o
1 - Les facteurs structurels
La quasi-totalité des intervenants ont souligné le poids déterminant
des facteurs structurels lourds dans le déclenchement des violences
que celles-ci soient de type émeutières, désorganisées ou plus construites au-
tour de mots d’ordre idéologiques précis. Si ces moteurs de l’action
semblent évidents (la violence est une ressource de pauvres), il de-
meure important de les rappeler à l’heure où l’analyse sociologique,
se confondant avec une injonction idéologique à la responsabilisation,
préfère parfois insister sur des facteurs plus interactionnistes. Laurent
Mucchielli ou Dave Waddington ont montré le poids déterminant
des facteurs économiques comme le niveau de chômage, l’habitat
déshérité ou le niveau de pauvreté au sein des quartiers émeutiers
en France depuis le début des années 1980 (30% de chômage dans
les quartiers lyonnais ou d’Île-de-France pour les émeutes rituelles
des années 1980 et 1990). En Grande-Bretagne, la concurrence pour
les emplois après le déclin de l’industrie textile et le sentiment d’une
politique préférentielle pour certaines couches de la population ont pu
avoir un effet déclencheur fort dans les phénomènes émeutiers. Si en
France les émeutes de 2005 perdent leur caractère localisé, comme
le souligne Laurent Mucchielli, avec plus de 300 villes touchées à

3
des degrés très divers, la dimension économique demeure avec le
constat renforcé des effets de la déscolarisation des jeunes qui là
aussi touche fortement les quartiers populaires. Dans son étude sur
le supportérisme violent, Dominique Bodin montre bien également
le poids des origines populaires des hooligans, utilisant la violence
comme « expression d’une frustration sociale de la part de jeunes
déshérités, en situation de crise économique grave ».
Au delà de l’économie, la question démographique a également son
importance. Élise Féron a pu montrer le rôle important du différen-
tiel démographique entre communautés suscitant, en Ulster, mais on
pourrait dire la même chose aux frontières de l’Europe en Bosnie
ou au Kosovo, des sentiments de peur vis-à-vis de l’autre dénoncé
comme menaçant car envahissant. La pression démographique dans
certaines familles originaires d’Afrique sub-saharienne en France,
couplée avec l’absence de ressources économiques et un habitat de
petite taille, conduit également les jeunes enfants mâles à occuper
l’espace de la rue, favorisant des phénomènes de bande où la sociali-
sation à la violence peut être importante.
2 - Les facteurs culturels
De nombreux participants au colloque ont insisté sur les facteurs cul-
turels qui alimentent les phénomènes de violence politique. Lorsque
l’on parle de facteurs culturels, il faut plus penser aux produits des
cultures professionnelles ou locales qu’à une trame historico-cul-
turelle qui déterminerait les actes des violents. C’est ainsi que Xavier
Crettiez refuse toute explication sur la violence politique en Corse
en terme d’héritage historique, faisant de la violence à prétention in-
dépendantiste, le reet contemporain d’une tradition de banditisme
politique ou la réactivation du rejet des troupes françaises au XVIIIe
siècle. Si la violence politique en Corse peut bien sûr compter sur
une culture locale qui fait grand cas du port des armes, des logiques
d’honneur et du phénomène clanique, sa pérennité s’explique avant
tout par l’imposition contemporaine d’une culture de la violence
devenue un mode naturalisé d’expression politique dans une île qui
depuis trente ans à connu près de 10 000 attentats à l’explosif.
Parmi les facteurs culturels, de nombreux intervenants ont souligné
les effets en termes de socialisation à la violence au sein de groupes
plus ou moins fermés qui développent une culture de la force et de
la confrontation, à la fois physique et verbale. Si Crettiez le souligne
à propos des nationalistes corses, dont plus rien ne les distingue des
forces politiques institutionnelles de l’île, si ce n’est le maintien
d’une violence devenue facteur d’identité, Élise Féron ou Alfonso
Perez Agote afrment les mêmes conclusions concernant l’Ulster ou
le Pays Basque. En Euskadi, Agote montre bien le rôle socialisa-
teur de pratiques culturelles comme le poteo (la tournée des bars)
qui va se radicaliser ces dernières années en ne fréquentant que des
bars nationalistes : l’enfermement de toute une jeunesse basque dans

4
un univers culturel marqué par la glorication des actions d’ETA
(lecture de la presse nationaliste, fréquentation des clubs sportifs
nationalistes, dîner dans les restaurants nationalistes…) fonde une
culture de la violence qui la légitime et la naturalise. Dans un tout
autre univers qui est celui des supporters de football, Bodin, explique
le développement d’une culture de l’affrontement parfois très vio-
lente qui se superpose au déroulement du jeu sportif et l’accompagne
(logique du douzième homme qui se bat avec son équipe). Cette cul-
ture de l’affrontement prend souvent une tournure violente à l’image
de l’utilisation des symboles des horreurs totalitaires faite par les sup-
porters des clubs hollandais, provoquant leurs adversaires au moyen
d’insultes antisémites. Les combats de rue post-match parachèvent
cette emprise de la violence.
Didier Lapeyronnie, dans son analyse des violences antisémites
dans le dix-neuvième arrondissement de Paris (à forte densité de
population de confession juive) insiste également sur la culture de
la violence qui habille les comportements des jeunes issus pour la
plupart de l’immigration magrébine. La violence antisémite est devenue
selon Lapeyronnie tellement inscrite dans le quotidien de ces jeunes
qu’elle n’est plus ressentie comme telle et devient un trait culturel.
L’expression maintes fois entendue selon le sociologue « ton stylo fait
le feuj » (« ton stylo ne marche pas ») est révélatrice de cette culture
de la haine. L’injure raciste fonde plus qu’un climat, elle fabrique un
ordre social localisé qui, en banalisant l’offense, légitime des actes
violents, souvent pas même perçus comme tels. Dave Waddington
parlera également de la culture du « gangsta rap », très en vogue
dans les banlieues des grandes villes anglaises comme Londres ou
Liverpool, qui inue fortement sur les comportements des jeunes en
distillant une culture de la force, de la masculinité exacerbée et de la
violence de rue.
C’est enn du côté policier que les effets de la culture profession-
nelle peuvent être ressentis. Waddington insiste, comme de nom-
breux sociologues français de la police (Monjardet, par exemple),
sur l’important turn over des personnels nommés dans les quartiers
défavorisés qui empêche toute connaissance de l’autre et toute cul-
ture commune. Olivier Fillieule quant à lui encourage à prendre en
compte les cultures policières propres qui conduisent les forces de
maintien de l’ordre à développer de l’empathie ou à l’inverse de
l’hostilité pour tel ou tel groupe en fonction de représentations col-
lectives liées à l’origine sociale des forces de l’ordre. C’est ainsi
que les agriculteurs ou artisans manifestants sont toujours mieux ap-
préhendés – et régulés – par les CRS ou gendarmes mobiles français
(souvent issus des mêmes milieux), que les jeunes des banlieues ou
les étudiants parisiens.

5
3 - Les facteurs institutionnels
La violence est aussi fortement dépendante du cadre institution-
nel qui la rend possible ou l’accepte ainsi que des structures
d’opportunités.
Jérôme Heurteau, dans son analyse de la violence en Roumanie, in-
siste ainsi sur la période de la transition qui ouvre des opportunités
favorables à certains groupes politiques ou sociaux dans leur con-
quête du pouvoir ou leur volonté de maintien au pouvoir. L’utilisation
par le pouvoir politique des mineurs roumains, très bien organisés et
encadrés par des structures syndicales proches de l’ancien régime,
va donner lieu à des manifestations très violentes en faveur du pou-
voir post-communiste dirigé dans les années 1990 par Ion Iliescu. En
1990, 1991 et 1999, les manifestations de mineurs mettront un terme
aux protestations de l’opposition devant l’inaction réformatrice du
gouvernement post-communiste à l’époque dominé par d’anciens
responsables communistes. L’activisme des mineurs deviendra une
forme de régulation par la violence des oppositions tellement nor-
malisée qu’il prendra un nom : les minériades.
Plus généralement, l’ensemble des chercheurs ont mis l’accent sur
les facteurs institutionnels pour comprendre la violence, analysant,
soit les formes mêmes du régime (générant en général un blocage
à l’action institutionnelle et donc un encouragement à la violence),
soit l’importance de la couverture médiatique, du type de police mo-
bilisé ou du rapport aux élites.
Xavier Crettiez a montré dans la lignée des travaux de Jean-Louis
Briquet, que la violence politique en Corse était ainsi moins le fait
d’une hostilité à l’État français que d’un refus d’un système politique
fermé désigné dans l’île sous l’appellation de clanisme. En rendant
impossible toute expression politique hors des structures claniques,
les grandes familles corses vont susciter une contestation de leur au-
torité par des groupes actifs économiquement et socialement mais
tenus à l’écart du pouvoir décisionnel : la violence va être un moyen
d’en appeler à l’État pour briser l’emprise clanique dans l’île et per-
mettre la représentation politique des nationalistes.
De la même façon, Anne Marijnen insiste également, dans la lignée
des travaux de Nathalie Duclos sur le monde paysan, sur le poids
des médias et les liens construits depuis l’après-guerre entre le pou-
voir politique et administratif français et les syndicats agricoles dans
la diminution des violences paysannes lors de ces quarante dern-
ières années. Alors que les jacqueries paysannes représentaient une
tradition française extrêmement violente, le corporatisme qui liera
syndicats et État gaullien dans la dénition des politiques publiques
alimentaires en France va rendre difcile la contestation violente de
l’État et remplacer les jacqueries traditionnelles par des manifesta-
tions usant d’une violence plus symbolique que réelle. La couverture
médiatique des actions collectives contribuera plus encore à pacier
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%