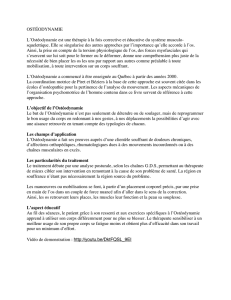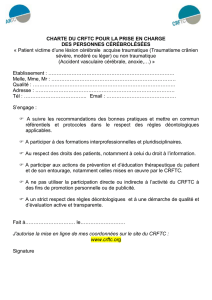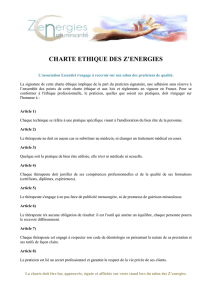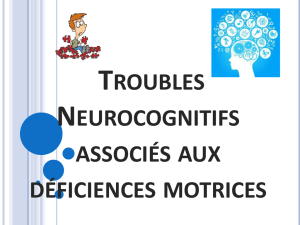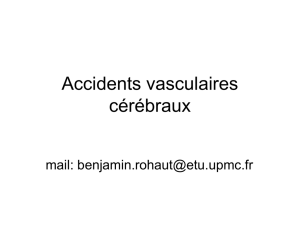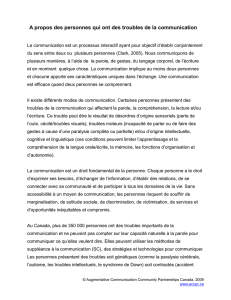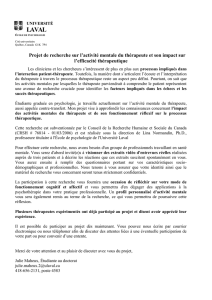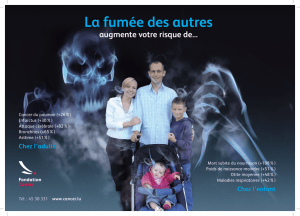des voies nouvelles de prise en charge des

!0&ß&ORMATION
ESßJOURNmESßD´mTUDE
0!2)3ßßßß
Bonjour. Je remercie les organisateurs de m’avoir invitée
pour vous parler d’un sujet qui me tient à cœur et qui
résulte d’une longue réflexion que nous menons avec
un groupe de travail qui a déjà mis en place des séminaires à
la Salpêtrière et à Necker, sur un sujet un peu difficile et par-
fois controversé. C’est un travail de clinicienne concernée par
des questions pratiques qui se cache derrière ce titre un peu
ambitieux.
Tout d’abord, je remercie infiniment Mme Barthélémy et Mme
Mazeau d’avoir avancé le travail ce matin, car ce que je vais vous
dire est en droite ligne avec ce qu’elles ont déjà énoncé.
Michèle Mazeau disait : « Les apports des neurosciences nous ont
amené tellement de connaissances, notamment dans le domaine
de la cognition sociale, que nous devons reconsidérer nos appro-
ches cliniques ». Ces apports font que les modèles que nous
avons appris s’avèrent insuffisants. Si leur validité scientifique
est prouvée, comment passe-t-on d’une dimension neuroscien-
tifique à l’application clinique ? Il existe un fossé important
entre la théorie et la clinique, qui nous pousse à changer de
paradigmes.
Actuellement, nous travaillons essentiellement en référence à des
modèles tridimensionnels de nos interventions, notamment
thérapeutiques. Le modèle psychanalytique postule un équipe-
ment neurobiologique invariant des enfants ou des personnes
dont on s’occupe. Au sommet du triangle, il y a l’enfant avec
son comportement, ses modalités d’attachement, ses représen-
tations ; de l’autre côté, il y a les parents, avec leurs représenta-
tions de leur enfant ; enfin la troisième dimension concerne les
interactions entre l’enfant et les parents. On pourrait reproduire
le même triangle avec les systèmes cognitivo-comportementalistes,
mais c’est la dimension intrapsychique qui y est invariante. Vous
avez toujours l’enfant avec son comportement, son tempérament
et ses symptômes, les parents avec leurs représentations et leur
comportement et enfin, le système parent enfant.
Avec les apports des neurosciences, nous devons reconsidérer
ce modèle pour passer à des
modèles polydimensionnels
du
cadre des interventions thérapeutiques. Dans ces modèles, il
faut ajouter en plus des dimensions énoncées,
l’équipement
neurobiologique de l’enfant
, parfois perturbé, et
les repré-
sentations du thérapeute
. Nous devons changer nos manières
de faire à l’éclairage de ces deux autres pôles. Je propose donc
la double lecture, inscrite dans un modèle neuro-psychanaly-
tique. Ce modèle n’est pas une nouvelle discipline, mais une
tentative de coordonner, d’articuler deux corpus théoriques
différents : le premier neuropsychologique, scientifique, etc.,
l’autre psycho dynamique.
Ce modèle est avant tout applicable à des patients avec des
lésions cérébrales, dont je m’occupe à l’hôpital Necker, mais
cette façon de penser est exportable à bien d’autres difficultés :
le polyhandicap en général, les troubles développementaux,
l’autisme, les troubles envahissants du développement, les
maladies psychiatriques dont la schizophrénie, et beaucoup
d’autres pathologies où la question du débat étiologique entre
organo et psychogenèse reste d’actualité. Je pense au récent
débat sur les troubles des conduites.
La double lecture signifie que nous pouvons lire un symptôme
ou une production syndromique sur le plan neuropsychologique
et psycho dynamique. Nous pouvons ajouter de nombreuses
autres lectures : psychiatrique, sociologique, etc. Cette double
lecture, neuro et psycho dynamique est proposée d’une double
manière. Une première lecture top-down, en référence aux
modèles descendants
, concerne la manière dont un problème
neurologique ou neurodéveloppemental va se répercuter sur les
relations qu’un enfant ou un adulte a avec son entourage. À
l’inverse, l’effet bottom-up, ou
l’effet ascendant
, concerne la
manière dont des difficultés sur le plan relationnel ou environ-
nemental vont avoir en retour un effet sur le cerveau au travers
de la plasticité cérébrale. Je fais référence aux publications sur les
effets du trauma, du dysfonctionnement interactif, des carences,
des maladies chroniques sur la structure cérébrale.
#%44%ß-!.)È2%ß$%ß6/)2ß0%2-%4ß$%ß$b'!'%2ßß
$)&&b2%.43ß.)6%!58ß$´).4%26%.4)/.
Dans le modèle top-down, l’équipement neurobiologique
interagit sur les trois dimensions de l’enfant, du parent et de
!##/-0!'.%2ß,%3ß42/5",%3ßß
$%ß,!ß#/--5.)#!4)/.
.EUROSCIENCESßETßPSYCHANALYSEßßß
DESßVOIESßNOUVELLESßDEßPRISEßENßCHARGEßß
DESßTROUBLESßDEßLAßCOMMUNICATIONß
,ISAß/533
0mDOPSYCHIATREßPSYCHOTHmRAPEUTEß(xPITALß.ECKERß#ENTREßDEß2ESSOURCESß!UTISMEß)LEDE&RANCEß0ARIS
02 Actes 2007 p67-128.indd 93 15/06/07 11:44:41

!0&ß&ORMATION
ESßJOURNmESßD´mTUDE
0!2)3ßßßß
!0&ß&ORMATION
ESßJOURNmESßD´mTUDE
0!2)3ßßßß
l’interaction. Inversement, dans le modèle bottom-up, les effets
ascendants par intervention sur l’enfant, le parent ou la dyade
pourraient avoir un effet sur la structuration du cerveau et les
connexions synaptiques de l’enfant. Nous pouvons ainsi déter-
miner les différents niveaux d’intervention thérapeutique en
fonction de ce modèle. Nous pouvons proposer de la rééduca-
tion au niveau de l’équipement neurobiologique, de la gui-
dance en ce qui concerne l’interaction parent enfant, des
psychothérapies en ce qui concerne les représentations de
l’enfant et des parents. N’oublions pas le niveau du théra-
peute et de ses représentations ; l’intervention consiste en une
formation et supervision.
La clinique dont je vais vous parler concerne des patients que
j’ai commencé à voir parce que les neurologues les envoyaient
aux psychiatres en disant : « ces traumatisés crâniens ont des
troubles de la communication, on n’y comprend rien, occupez-vous
en » et les psychiatres les renvoyaient aux neurologues en disant
« ils ont une lésion cérébrale, ce n’est pas pour nous ». Aussi, nous
nous sommes mis avec un certain nombre de cliniciens à les
recevoir. Nous avons pris notre boîte à outils, sans en trouver
de parfaitement adaptés et avons donc bricolé des modèles
d’où sont issues les propositions présentées aujourd’hui.
,´ATTEINTEßCmRmBRALEßESTELLEßUNEßINDICATIONß
OUßUNEßCONTREINDICATIONßDEßPSYCHOTHmRAPIEß
Les patients adultes avec atteinte cérébrale ont souvent des
troubles de la mémoire et de l’attention, des troubles du lan-
gage, une pauvreté du monde interne, une perte de l’initiative,
une perte du fonctionnement réflexif ; autant de contre-indi-
cations de psychothérapie psychanalytique. Plutôt que de
considérer ces troubles comme une contre-indication, nous
disons au contraire qu’ils sont la cible du traitement. Nous
proposons donc une forme de « rééducation de la relation et des
troubles de la communication ».
)NTmRoTßDEßLAßDOUBLEßLECTURE
Le premier est de lire les symptômes et d’intervenir diffé-
remment dans certains syndromes.
Un même symptôme peut être lu, ou comme l’altération d’une
fonction, ou comme une défense. Un de mes patients amné-
sique m’appelait systématiquement du nom de ma collègue.
Qu’en penser ? Est-ce un trouble mnésique, ou un lapsus, ou
quelque chose de l’expression de sa dimension intrapsychique ?
Si je lui dis « écoutez, je m’appelle Mme Ouss » et que c’était la
trace d’un investissement particulier sur moi, il va me dire « je
sais que vous vous appelez Mme Ouss ». Et si je lui interprète
alors que c’est une amnésie, il va me dire « de quoi elle me
parle » ?
L'intérêt est donc que
l'intervention thérapeutique va
dépendre de la lecture qui en est faite
. Vous n’interprétez pas
quand c’est une amnésie et vous ne corrigez pas l’amnésie
quand c’est un événement psychique. Nous allons donc met-
tre en place des psychothérapies très particulières qui vont
prendre en compte et les troubles neuropsychologiques et la
dynamique psychique de manière complémentariste.
Le cas d’une patiente atteinte d’une agnosie visuelle peut nous
permettre d’illustrer ceci.
Cette patiente a tout d’abord eu une souffrance néonatale avec
atteinte pariéto-occipitale, des aires de l’intégration visuelle.
Elle a présenté une agnosie visuelle consécutive. Elle présente
à trois ans et demi un second épisode sous la forme d’un
accident vasculaire probablement lié à une malformation
artérioveineuse. Elle subit une résection d’une partie du lobe
temporal droit et, probablement à cette époque mais peut-être
l’avait-elle déjà avant, elle présente une prosopagnosie (trouble
de la reconnaissance des visages). Troisième épisode : à l’ado-
lescence, elle fait un épisode que les psychiatres diagnostiquent
comme un trouble psychotique, elle est mise sous neurolepti-
ques et prise en charge dans un hôpital de jour.
Elle explique qu’elle voit le monde en morceaux. Selon une
lecture psychiatrique, elle est morcelée, donc psychotique. Si
l’on propose une lecture psycho dynamique, on peut dire
qu’elle a des difficultés de représentation. La lecture neuro-
psychologique repère l’agnosie visuelle. De la même manière,
nous pouvons lire la psychose comme une organisation défen-
sive de la puberté. En effet, elle a une incapacité de se repré-
senter son corps. À la puberté, tous les repères corporels
qu’elle s’était construits ont volé en éclats, et c’est à ce
moment-là qu’elle décompense. Nous pouvons aussi lier cela
à un dysfonctionnement cérébral. De la même manière, nous
pouvons relire le délire diagnostiqué par les psychiatres,
comme une capacité associative et des productions imaginati-
ves extraordinairement riches, ou sur le plan neuropsycholo-
gique des troubles de l’imagerie mentale. Ainsi sa désinhibi-
tion, sa logorrhée, ses troubles maniaques, traités comme tels,
peuvent être entendus comme des défenses comportementales ou
comme des troubles de la régulation émotionnelle en lien avec ses
troubles temporaux. Il en est de même pour son syndrome
dépressif, ses angoisses, ses particularités comportementales.
Au bout d’un an de thérapie, cette patiente va beaucoup
mieux. La lecture différente de ses troubles neurologiques et
de son monde interne lui a peut-être permis de se positionner
comme sujet, et d’aller mieux aussi sur un plan cognitif.
La deuxième fonction de la double lecture est de postuler
les effets d’une psychothérapie sur la plasticité cérébrale.
Michèle Mazeau a parlé des neurones miroirs et des représen-
tations partagées : quand vous faites une action, quand vous
la voyez faire ou quand vous la simulez mentalement, ce sont
les mêmes réseaux neuronaux qui sont activés. Or faire une
psychothérapie, c’est simuler, éprouver, imaginer, associer ;
faire des actes de parole, des actes de pensée, des actes d’ima-
gination. Reprenons le concept de frayage développé par Freud :
une stimulation laisse une trace synaptique dans les zones
activées. Une activation semblable ultérieure aura tendance à
02 Actes 2007 p67-128.indd 94 15/06/07 11:44:42

!0&ß&ORMATION
ESßJOURNmESßD´mTUDE
0!2)3ßßßß
!0&ß&ORMATION
ESßJOURNmESßD´mTUDE
0!2)3ßßßß
utiliser les mêmes voies synaptiques, jusqu’à ce que la répéti-
tion laisse une trace organisée ; par analogie, le promeneur
dans la campagne aura tendance à emprunter un chemin déjà
tracé par d’autres et l’agrandira. Les interventions psychothé-
rapeutiques, en mettant en jeu les circuits neuronaux de l’in-
teraction, ne permettraient-ils pas que des zones cérébrales qui
ne sont pas activées en raison de troubles neurologiques se
mettent en marche ? Nous pourrions faire l’hypothèse qu’il est
possible de prévenir l’inscription cérébrale d’un dysfonction-
nement interactif en stimulant cette interaction.
Prenons le cas des bébés porteurs du syndrome de West (épi-
lepsie précoce apparaissant dans la première année de vie) qui
présentent dans 10 à 30 % des cas des troubles graves de la
communication de type autistique. Ces enfants présentent
souvent des foyers occipitaux, et de probables agnosies visuelles.
Du fait de leurs troubles du tonus, neurovisuels, des spasmes,
des difficultés liées aux médicaments, ils ont une interaction
particulière : ils ont un tonus altéré, sont peu interactifs, fati-
gués. Ces bébés et leurs parents ont beaucoup de mal à intera-
gir, parce que les bébés sont peu disponibles et les parents
désemparés ou épuisés. On peut penser que ce n’est pas seule-
ment la lésion cérébrale qui provoque ces troubles autistiques.
Les conséquences de la lésion cérébrale sur l’interaction
feraient que les circuits neuronaux de l’interaction ne sont pas
activés et deviennent par conséquent cérébralement peu actifs.
L’implication clinique est importante. Il serait souhaitable de
travailler très précocement cette interaction dans les CAMSP
ou dans nos consultations en aidant les parents, non pas parce
qu’ils ne sont pas compétents, mais parce que leur bébé n’est
pas dans un schéma d’interaction usuel.
,%3ß42/5",%3ß$%ß,!ß#/--5.)#!4)/.ßß
#(%:ß,%3ß0!4)%.43ß!$5,4%3ß!6%#ß,b3)/.ß#b2b"2!,%
Les patients traumatisés crâniens avec troubles fronto-tempo-
raux présentent souvent un frein associatif, un manque de
flexibilité et de cohérence dans leur discours, des troubles
pragmatiques de la communication…
Le pari est de soigner ces troubles de la communication par la
communication, ce qui peut apparaître comme un paradoxe.
Voyons ce qui se passe entre un patient et un psychanalyste
lors d’une séance. Il existe entre eux trois niveaux de commu-
nication :
-
la communication informative :
ce qu’ils vont se construire
comme monde commun ;
-
la communication interactive :
ce qui se passe dans la com-
munication ou l’interaction présente ;
-
la communication d’insight,
ou communication des repré-
sentations selon des lois associatives, en processus primaires ;
elle est particulière à la situation analytique.
Comment cette communication va passer d’un inconscient à
un autre ? Il existe peu d’indicateurs pour le savoir, hormis
l’associativité et les représentations du thérapeute, c’est-à-dire
ce qui, de manière inconsciente, va lui faire penser à telle
chose quand le patient lui dit cela ou quand il ne dit rien.
Avec les patients traumatisés crâniens, ces trois types de com-
munications sont marqués par les troubles cognitifs que nous
avons évoqués. Le patient et l’analyste ne partagent pas les
mêmes inférences. Lorsque je demande à un patient « comment
avez-vous dormi ? », il me répond « en pyjama ». Ce n’est pas la
réponse que vous attendez. Cela veut dire que vous ne partagez
pas les mêmes inférences, mais cependant nous faisons le pari
que le travail sur les formations inconscientes reste possible.
Il existe trois niveaux chez le psychanalyste permettant d’ap-
préhender ce qui se passe dans la tête du patient.
- Sur le plan conscient, il a ce que Daniel Widlocher appelle
la
co-pensée
, c’est-à-dire les inférences, construites par l’ap-
pareil cognitif.
- Sur le plan inconscient, il existe le
contre-transfert
propre-
ment dit. Ce contre-transfert se caractérise par trois niveaux :
l’associativité, c’est-à-dire la manière dont les pensées s’agen-
cent l’une avec l’autre ; ce qui appartient à l’analyste : son
histoire, son monde interne, sa formation théorique, etc. ;
enfin la part de réalité, que l’on oublie très souvent : la mala-
die, le trauma crânien…
- Enfin, un troisième niveau, avec les personnes qui ne parlent
pas ou qui ont des troubles sévères de la communication :
c’est la
co-présence
. Relève-t-elle de l’empathie, de l’inaction ?
Les indices et éprouvés corporels (bâillements, endormisse-
ment, gargouillis…) ou émotionnels sont des indicateurs très
précieux, formes de représentations métaphoriques, corpo-
relles : « j’ai les boules », « les bras m’en tombent… »
Avec les patients traumatisés crâniens, contre-transfert et co-
pensée vont être marqués par les troubles cognitifs des patients,
qui se répercutent sur vous : il a des blancs, vous avez des blancs ;
vous avez dû mal à associer parce qu’il a dû mal à associer ; vos
inférences sont pauvres. Cela se communique, peut-être par le
système des neurones miroirs. Plutôt que de vous dire que vous
êtes un mauvais thérapeute, dites-vous que ce sont des indica-
teurs extrêmement précieux sur la manière dont marche l’appa-
reil à penser de ce patient, et notamment pour différencier la
valeur d’un symptôme. Est-ce une expression pulsionnelle, une
défense ou un symptôme organique, selon le fait que vous allez
sentir chez vous à tel moment plutôt des difficultés dans votre
associativité, c’est-à-dire la qualité de votre capacité à penser, ou
au niveau de votre co-pensée : selon ce que vous allez construire
comme contenus de pensée, inférences, ou au niveau de la co-
présence : selon le fait que vous allez plutôt penser en images,
en gargouillis, en métaphores corporelles ? Cela va vous permet-
tre à tel moment de travailler plus sur le trouble cognitif ou,
plutôt, sur une dimension intrapsychique.
Un patient de trente ans présente une schizophrénie après un
trauma crânien. Lors d’une séance, il ne dit rien pendant dix
minutes, et je lui dis :
02 Actes 2007 p67-128.indd 95 15/06/07 11:44:43

!0&ß&ORMATION
ESßJOURNmESßD´mTUDE
0!2)3ßßßß
!0&ß&ORMATION
ESßJOURNmESßD´mTUDE
0!2)3ßßßß
- « Han, han ? »
Il me dit :
- « Je réfléchis ».
- « À quoi ? ».
- « Rien, c’est personnel ».
- « Han, han ? »
- « Pas intéressant ».
- « Personnel ? ».
- « À propos de mes gants »
Il y a deux solutions. Soit vous vous dites : « il se moque de moi
et il pense à ses gants », soit vous vous dites qu’il ne pense à rien
parce qu’il n’a rien dans sa tête. À ce moment-là, je n’ai pas fait
d’associations (ex : il veut me toucher avec des gants, etc.), j’ai
vu ses véritables gants, alors qu’il n’en avait pas. J’ai eu une
représentation de chose, pas une métaphore, pas une représen-
tation, mais un objet réel qui me renseignait sur la grande
difficulté de ce patient, à ce moment-là, de penser en méta-
phore ou en représentation.
Nous proposons une contextualisation de la relation inter-
subjective. C’est le thérapeute qui va faire l’effort de s’adap-
ter au patient et non l’inverse. C’est lui qui va construire des
inférences. Il s’agit d’offrir au patient un cadre avec lequel il
n’est pas du tout habitué. Le gain cognitif consécutif consi-
dérable va lui permettre de libérer de l’énergie psychique, de
mobiliser sa cognition pour penser à propos de ce qu’il est,
ce qu’il veut, où il en est. Il faut essayer d’introduire une
cohérence dynamique et lui permettre de se repérer dans le
monde implicite que les autres attendent de lui. La question
est de savoir si ce gain est exportable, ou pas, en dehors de la
situation clinique.
Le thérapeute est une sorte de « prothèse cognitive ». Bollas disait
que les thérapeutes sont des « objets transformationnels : perce-
voir, mémoriser, anticiper » - fonctions cognitives -, c’est ce que
fait le psychanalyste. Il prête sa cognition à ses patients.
Travailler sur un matériel cognitif va révéler le fonctionnement
intrapsychique. Inversement, travailler sur la dimension intra-
psychique, améliore sur le plan cognitif. Les interprétations sont
à utiliser avec prudence, de manière très ciblée ; elles mobilisent
un mécanisme cognitif qui déconcerte les patients. Il s’agit de
travailler plus au niveau de ce que Kandel appelle l’inconscient
procédural – pas l’inconscient refoulé des psychanalystes, mais
ce qui n’est pas conscient en terme de processus cognitifs.
0/52ß#/.#,52%ßßß
#/--%.4ß!24)#5,%2ß#%3ß#!$2%3ß
On peut proposer trois modèles : holistique – tout est dans
tout – ; dualiste : il existe un champ pour les psychanalystes,
un autre pour les neuro-cognitivistes ; enfin, un troisième, le
complémentarisme
.
Ce concept a été développé par Devereux. Ce n’est pas une
théorie mais une généralisation méthodologique, qui n’exclut
aucune méthode ou théorie valable mais les coordonne. Il
évoque le principe d’indéterministe emprunté à la physique
des quanta ; vous ne pouvez pas déterminer avec autant de
précision la vitesse et le moment d’un électron. Plus vous vous
approchez de la caractérisation de l’un, plus vous vous éloignez
de l’autre. Vous pouvez avoir les deux mesures, mais pas en
même temps. Cela nécessite deux discours obligatoires, non
simultanés et complémentaires qui sont tenus grâce au décen-
trage qui permet de prendre successivement deux places diffé-
rentes par rapport à l’objet sans les réduire l’une à l’autre et
sans les confondre. Cette position complémentariste va trans-
former le fait brut en une donnée qui va relever de l’une ou
l’autre des sciences.
Nous devons nous laisser déformer par d’autres modèles sans
perdre de vue leur hétérogénéité fondamentale. Il ne s’agit pas
de demander à un psychanalyste d’être un neuroscientifique,
et inversement. De même que Freud s’est laissé déformer par
la neurophysiologie ou Lacan par le structuralisme, il s’agit de
se laisser imprégner, de dialoguer entre nos modèles sur des
objets cliniques précis comme la trace, l’attention, l’imitation,
l’empathie, etc. et conceptualiser les liens entre nos modèles.
Devons-nous faire marcher notre créativité ou nos fonctions
exécutives ? Je vous laisse le choix…
Merci.
02 Actes 2007 p67-128.indd 96 15/06/07 11:44:44
1
/
4
100%