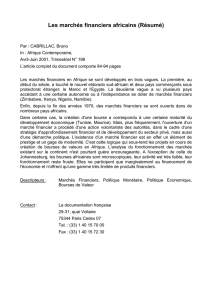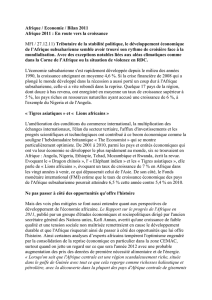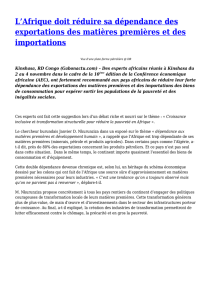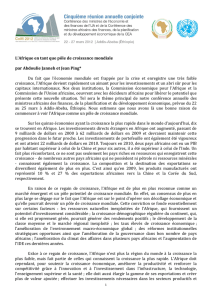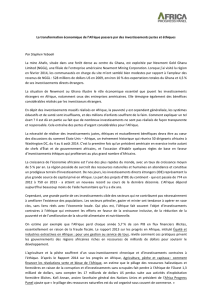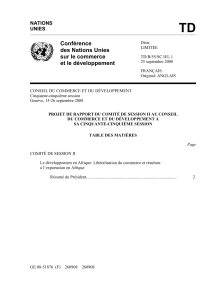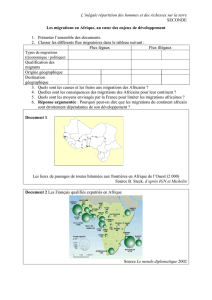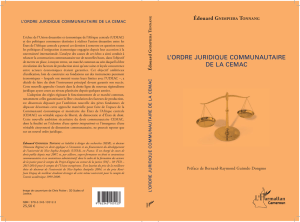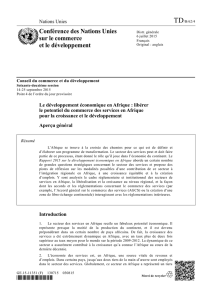Document

L’integration régionale des pays africains : une requête légitime ou une quête illusoire ?
L’approche institutionnelle de la CEMAC.
……………………………….
Par Rodolphe GOZEGBA DE BOMBEMBE, chercheur en théologie politique et dogmatique à la Faculté de Théologie
Évangélique de Bangui (FATEB), République centrafricaine ; Coordonateur National de la Fondation Chrétienne de
Réconciliation pour la Paix Nationale, en sigle « FCRPN »
E. mail : gozegbarodolphe@yahoo.fr
Résumé :
Mon propos est d’interroger la pertinence et la fécondité du concept d’intégration
régionale en Afrique. Ma thèse est que de nombreux chercheurs africains ne thématisent pas
la question du transfert du concept d’intégration régionale dans l’horizon structurant de
l’Afrique. De mon point de vue, il y a nécessité de corriger les déficiences épistémologiques
et les limites méthodologiques qui affectent l’application indistincte du concept d’intégration
régionale aux Etats africains et aux divers registres de leurs systèmes politiques. C’est ce que
je vais illustrer en examinant les principaux travaux des chercheurs africains qui plaident pour
l’intégration régionale des pays africains en général et de la CEMAC en particulier. En
conclusion, j’esquisserai comment, dans le cadre de la CEMAC, en quelle direction la reprise
de cette question d’intégration régionale pourrait s’orienter et quels modèles institutionnels
pourraient rendre effectifs les processus pris en compte dans la réalité à laquelle ce concept
est appliqué pour le développement intégral des pays africains.
Mots-clefs : intégration régionale, pays africains, requête légitime, quête illusoire,
institution de la CEMAC.
Introduction
L’intégration régionale est devenue l’un des concepts les plus en vogue depuis le
milieu des années 90, non seulement dans le milieu des sciences sociales, mais aussi aux yeux
de l’opinion publique. Le terme est constamment utilisé dans les discours politiques, et le plus
souvent pour justifier ou soutenir des restructurations dans le domaine public et le retrait de
l’État dans certains secteurs d’activités économiques. Dans le monde des affaires, on se réfère
souvent à l’intégration régionale pour expliquer la nécessité de rationaliser les activités de
l’entreprise et pour justifier les vagues de fusions-acquisitions sur le plan international. Pour
l’Afrique finalement, l’intégration régionale rime avec pertes d’emplois, exploitation des
travailleurs par les grandes entreprises et hausse des inégalités. Mais à quelle réalité le
concept de l’intégration régionale s’applique-t-il ?
L’objectif de cette étude est de répondre à la double question portant sur l’avenir du
continent africain et la possibilité d’une certaine configuration dans un monde culturellement,
économiquement, et politiquement diversifié et j’avance l’hypothèse que l’intégration
régionale fait partie de l’essence de l’être humain et cette socialité n’existe et n’est possible
qu’en étant toujours déjà structurée objectivement de quelque façon. Cette structuration
objective forme ce que la théologie appelle le vivre ensemble.
L'approche privilégiée est qualitative et de type empirico-inductive. Elle a été
déployée à partir des questions suivantes : Quelles sont les différentes conceptions des notions
de l’intégration régionale ? Aussi, et surtout, qu'est-ce qui fait que ces conceptions sont
construites différemment ? Précisément, ces différences peuvent-elles s'expliquer par les
postures épistémologiques et/ou les positions théoriques et/ou la approches méthodologiques
et/ou les recherches ethnographiques des auteurs ? Est-ce que la politique de l’intégration
régionale pourrait être un nouveau cadre de référence pour le développement des pays
africains ? Pour comprendre ces questions, nous allons d’abord examiner les principaux
travaux des chercheurs africains qui plaident pour l’intégration régionale des pays africains en

général et de la CEMAC en particulier. En conclusion, nous esquisserons comment, dans le
cadre de la CEMAC, en quelle direction la reprise de cette question d’intégration régionale
pourrait s’orienter et quels modèles institutionnels pourraient rendre effectifs les processus
pris en compte dans la réalité à laquelle ce concept est appliqué pour le développement
intégral des pays africains.
I. Une mise en perspective de l’intégration régionale africaine
Ce terme recouvre des sens multiples, il est doté d’une forte connotation idéologique,
il évolue, se construit en permanence et fait référence à des choses différentes selon les
disciplines qui l’abordent. Tenter de définir un concept aussi large et usité que celui de
l’intégration régionale n’est donc pas chose aisée.
Nous allons essayer ici d’aborder ce thème de manière assez large, sans chercher à
définir précisément ce que tout le monde entend par l’intégration régionale. Nous nous
restreindrons à un tour d’horizon, non exhaustif, des perceptions, commentaires et analyses
les plus fréquemment rencontrés de ce phénomène.
1. D’où provient ce concept et quels phénomènes décrit-il ?
Le concept intégration régionale est défini au terme de « regroupement, plus ou moins
formalisé au plan institutionnel, de plusieurs États appartenant à une aire géographique
délimitée, à des fins de coopération économique et/ou politique à long terme.
1
» C’est un
concept qui a émergé il y a environ 24 ans aujourd’hui pour décrire des évènements et
phénomènes nouveaux de par leur ampleur. Parmi les ouvrages nouveaux qui viennent d’être
sortis, il est fait mention d’une liste de faits ou d’évènements décrivant ce que l’on peut
appeler l’intégration régionale. On assiste donc depuis 24 ans à : Les États (conception
volontariste) à l'intégration par le marché (conception libérale), l'intégration liée aux règles
(conception institutionnelle), l'intégration suscitée par les acteurs en position asymétrique et
liée à des dynamiques territoriales (conception territoriale) et l'intégration politique.
2. La conception volontariste de l'intégration
Selon la conception volontariste, l'intégration régionale est un processus de
déconnexion qui vise à protéger les économies de la mondialisation. Elle suppose une
protection, des politiques d'aménagement du territoire, la construction d'un système productif
plus ou moins déconnecter du système de prix mondiaux. Le cadre d'analyse est celui de
sociétés dépendantes, extraverties et désarticulées qui ne peuvent construire leur industrie
dans le cadre national. L'intégration régionale vise alors à réduire l'extraversion, à accroître
les capacités de coalition, à créer un marché, à compenser les déséquilibres territoriaux. Les
principaux instruments renvoient à l'économie administrée, à la forte protection des industries
régionales. Cette conception a été longtemps défendue par les organisations du Sud telle la
CEPAL ou la CEA (plan de Lagos, 1980). Ce plan visait à éviter les duplications, à élaborer
des industries lourdes industrialisantes, à lever les goulets d'étranglement telles que les
infrastructures.
3. La conception libérale de l'intégration
Selon la conception libérale, l'intégration commerciale est assimilée à la libéralisation
des échanges et des facteurs de production ; elle est analysée au regard de l'intégration
mondiale. La théorie statique met en relief les créations et détours de trafic et l'optimum de
second rang. La théorie dynamique met en relief la concurrence, les économies d'échelle et les
changements de termes de l'échange. Intégrer, c'est réduire les distorsions des politiques
nationales et déplacer les frontières nationales en se rapprochant du marché international.
1
Franck Petiteville, « Les processus d'intégration régionale, vecteurs de structuration du système international?»,
dans http://id.erudit.org/iderudit/703774ar , p512.

4. La conception industrielle et territoriale de l'intégration
Selon la conception industrielle et territoriale, l'intégration productive est la résultante de
relations d'internalisation au sein des firmes transnationales ou des réseaux. Elle est assurée
par les conglomérats déployant leurs stratégies dans un espace régional. Elle conduit à une
division régionale du travail. La coopération sectorielle s'appuie sur des projets mis en place
par des acteurs ayant des intérêts convergents : exploitation de ressources en commun, lutte
contre la désertification ou la protection de l'environnement, régulation aérienne, observatoire
économique régional, corridors ou triangles de croissance. L'analyse de l'intégration se fait en
privilégiant les stratégies d'acteurs dans un univers de concurrence imparfaite et d'espace non-
homogène.
5. La conception géographique de l'intégration
Selon la conception géographique, l'intégration se caractérise par des effets
d'agglomération et de polarisation. D'un côté, il y a réduction des distances et, a priori,
réduction du rôle de la proximité géographique en liaison avec les révolutions technologiques
et le poids des échanges immatériels. Mais, de l'autre, on observe le rôle des territoires
créateurs d'effets d'agglomération. Pour que des territoires aient entre eux des échanges, il faut
des systèmes productifs permettant une taille de marché et des produits diversifiés (et donc
une complémentarité entre des effets d'agglomération). Mais il faut qu'il existe des
infrastructures d'interconnections physiques ou transactionnelles (réseaux) et donc un capital
spatial. Celles-ci conduisent généralement plutôt à des effets de diffusion ou de contagion de
la croissance en réduisant les coûts de transport, en favorisant les transferts de technologies ou
en baissant les coûts de transaction. Cette diffusion peut se faire par le commerce extérieur
(transfert international de droits de propriété des marchandises), par les investissements
directs (transfert de droits de propriété des entreprises), par les coordinations non marchandes
(internalisation au sein des firmes ou des réseaux « ethniques ») ; les dynamiques de
spécialisation territoriale l'emportent alors sur les effets d'agglomération.
6. La conception institutionnaliste de l'intégration
Selon la conception institutionnaliste, l'intégration est la mise en place d'un système
commun de règles de la part des pouvoirs publics en relation avec les acteurs privés. Les
institutions sont des systèmes d'attente permettant la convergence des anticipations des agents.
Elles stabilisent et sécurisent l'environnement, permettant la crédibilité. L'intégration par les
règles concerne ainsi, dans l'UEMOA, l'harmonisation des fiscalités, un droit social régional,
un droit des affaires, des lois uniques d'assurance. Les conséquences attendues des accords
régionaux concernent l'ancrage des politiques favorisant leur prévisibilité et l'attractivité des
capitaux et de technologie. L'ancrage des politiques économiques réduit les risques de
réversibilité. La crédibilité est liée à la dilution des préférences (en isolant les instance de
contrôle et de pouvoir judiciaire des lobbies nationaux) et à la création institutionnelle (de
Melo, 1993). Les accords de libre-échange n'ont pas toutefois nécessairement des effets
d'attractivité des capitaux. D'une part, ces effets se diluent avec le nombre d'accords, d'autre
part, ils sont souvent contrecarrés par les conséquences négatives liées à la libéralisation
commerciale et des changes. Ainsi, les zones attractives d'Afrique subsaharienne (l'Afrique
australe) ou d'Asie de l'Est (la Chine) ont-elles maintenu des contrôles de change et des
mesures protectionnistes.
7. La conception politique ou diplomatique de l'intégration
Selon une conception politique ou diplomatique, l'intégration régionale se traduit par
des transferts de souveraineté et par des objectifs de prévention des conflits. Les convergences
d'intérêts économiques sont une manière de dépasser les rivalités et antagonismes politiques.
Les transferts de souveraineté et la production de biens publics à des niveaux régionaux sont

une réponse au débordement des États dans un contexte de mondialisation (exemple création
d'une monnaie régionale). Les processus de désintégration régionale renvoient à des facteurs
socio-politiques de désintégration nationale et de décomposition des États, à des crises
économiques et financières donnant la priorité aux objectifs nationaux ou à des
environnements internationaux conduisant à des ouvertures erga omnes et à des politiques se
faisant aux dépens des accords régionaux.
L'intégration régionale est donc un phénomène pluridimensionnel mais que la théorie
traditionnelle de l'intégration développée par BALASSA B. (1962) englobe. Il considère
l'intégration à la fois comme une situation et comme un processus. Considérée comme
une situation, l'intégration désigne l'absence de toutes discriminations entre les économies
nationales. En tant que processus, L'intégration régionale est un ensemble de mesures
destinées à supprimer les discriminations entre les unités économiques, appartenant à
différents pays en vue de l'intensification des échanges. Ce processus s'effectue en différentes
étapes et montre que les Accords d'Intégration Régionale (AIR) peuvent rassembler des pays
selon des modalités variées. Sans prétendre couvrir la totalité des arrangements concevables,
il est possible de donner une typologie simplifiée de ces accords.
II. Les enjeux de l'intégration pour la CEMAC
Mon hypothèse ici est que les gouvernements des pays de la CEMAC n’ont pas choisi
cette clause par souci de garantir la liberté individuelle, mais plutôt parce qu’elle répondait
mieux à leurs conquêtes politiques. En effet, pour les pays de cette sous-région qui souffrent
de la relative exiguïté de leurs marchés intérieurs, l'approche régionale, par l'organisation d'un
marché sans frontières avec sa masse critique de consommateurs potentiels, concourt à
accroître l'attractivité de la sous-région pour les investisseurs étrangers. Elle permet également
d'additionner les ressources pour la réalisation d'infrastructures viables et, plus généralement,
de projets communs. En outre, l'intégration régionale revêt une dimension politique. Elle
constitue de nos jours un facteur indéniable de paix entre les pays de la Sous-région CEMAC.
Elle est également un facteur multiplicateur de puissance, permettant à nos Etats membres de
faire valoir les intérêts de la sous-région avec plus d'assurance et plus de force dans le concert
des nations.
Cependant, il est à relever qu'en Afrique Centrale, la séquence de l'intégration
régionale est originale. On sait que dès le lancement officiel des activités de la CEMAC le 25
juin 1999 en Guinée Équatoriale, les États membres se sont fixés comme objectif majeur de
construire un marché commun compétitif et concurrentiel, basé sur la libre circulation des
biens et des personnes, en vue de se doter d'une meilleure capacité de création de richesse et
d'insertion dans l'économie mondiale. En dépit des progrès réalisés, force est de constater que
la libre circulation des biens et des personnes est très peu effective. Cette défaillance met en
évidence un bilan mitigé qui se traduit par la non réalisation des objectifs fixés par la nouvelle
institution sous-régionale et la faiblesse de l'esprit communautaire. De même, l'existence des
velléités protectionnistes et les dysfonctionnements du mécanisme de financement ont
considérablement réduits l'ampleur des projets intégrateurs. Les observateurs du processus
d'intégration sous-régionale en Afrique Centrale ont tendance à indexer l'absence de volonté
politique pour expliquer les retards accusés. Loin de réfuter cette thèse, ces dernières années,
la CEMAC a pris des engagements forts pour rendre effective la liberté de circulation des
biens et des personnes. Cependant, il existe des pesanteurs qui s'imposent à la volonté
politique des États membres de la CEMAC et entravent de ce fait l'effort consacré à la libre
circulation. Concrètement, ces obstacles sont d'ordre structurel et se manifestent par un déficit
de bonne gouvernance dans un contexte de corruption généralisé. Ces entraves sont également
liées à la conjoncture qui a contribué soit à fragiliser les États de l'Afrique Centrale soit à

favoriser les rivalités et querelles au sein de la communauté. En outre, des facteurs socio-
anthropologiques contribuent à retarder la dynamique d'intégration sous-régionale.
III. Les implications de l’utilisation et du processus de l’intégration régionale ?
Un certain nombre de conséquences ou d’implications peuvent être observé suite à
l’expansion du phénomène de l’intégration régionale. On assiste à une délégitimation et à une
fragilisation de l’Etat. Le système de l’intégration régionale engendre également une
redéfinition des frontières entre sphères publique et privée et l’émergence de tensions entre
droits sociaux nationaux et droits des affaires. Les conséquences probables de ce type de
tensions sont la modification des obligations ou devoirs de l’État envers ses citoyens et donc
la possible redéfinition de l’intérêt commun et de la citoyenneté. Les vecteurs de l’intégration
régionale identifiés – les firmes multinationales ainsi que les institutions financières
internationales – encouragent l’application de stratégies de croissance favorisant une
intégration au marché mondial. Ce faisant, ce sont des formes particulières de l’organisation
sociale qui sont promues. Formes qui laissent la part belle à l’entreprise privée. Ce type
d’insertion dans l’économie mondiale pose un certain nombre de problèmes. Elle risque
notamment de remettre en cause les systèmes de transferts de revenus qui ont existé au niveau
national (ainsi que l’ensemble des droits économiques et sociaux institués au niveau national
et qui risquent de pâtir d’un vide juridique supranational).
L’intégration régionale affecte en effet le contenu des droits nationaux ou étatiques.
Son influence s’étend au delà de l’économique en touchant les dimensions sociale et
politique. La mondialisation touche ceux qui s’y insèrent ainsi que ceux qui vivent en marge
d’elle. Elle limite les choix en matière de politique publique et macro-économique (les
investissements fluctuant d’un pays à l’autre selon les avantages que procurent les différentes
politiques nationales). Elle favorise la mobilité du capital et de la main d’oeuvre, avantage la
lutte contre la pauvreté mais risque de saper la stabilité sociale et produire l’extrême pauvreté,
en ruinant les liens de parenté et en affaiblissant le soutien collectif. S’il doit en être
autrement, l’État devra encadrer l’intégration régionale, défendre les acquis, les droits,
réglementer pour limiter les risques et répartir équitablement les bénéfices de l’intégration
régionale. Sa tâche, bien que réduite par la délégation forcée d’une partie de ses pouvoirs,
resterait considérable car il est le dernier rempart protégeant les normes sociales.
Mon propos ici n’est pas une revendication pour bannir la politique de l’intégration
régionale de manière aveugle, mais de nous poser la question de savoir si la problématique de
l’intégration ne devrait pas être abordée dans un point de vue purement africain.
IV. En guise des perspectives
1. La crise du développement en Afrique
Ma thèse ici c’est que face à l’intégration régionale, l’Afrique en général et les pays de
la CEMAC particulièrement, doit tenir compte de ses objectifs les plus urgents : accélérer la
croissance et le développement, et éradiquer la pauvreté, qui est non seulement largement
répandue, mais aussi extrême dans certains pays. À l’aube du XXIe siècle, la pauvreté
demeure le problème le plus pressant de l’Afrique et la croissance économique est la
condition sine qua non de son éradication. Les pays africains doivent donc réaliser aussi vite
que possible une croissance soutenue et rapide.
L’Afrique doit se poser plusieurs questions à propos de l’intégration régionale.
Premièrement, après avoir échappé aux pires répercussions de la crise asiatique, l’Afrique
doit-elle quand même participer à l’intégration régionale ? Peut-elle rester à l’écart des
changements qui bouleversent l’économie mondiale ? Deuxièmement, quels sont les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%