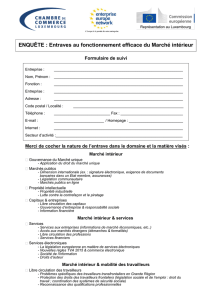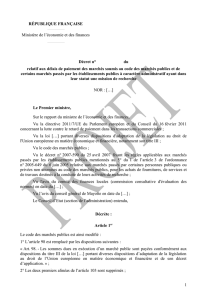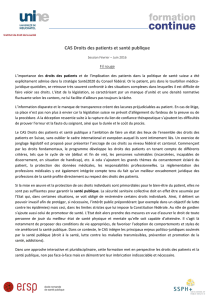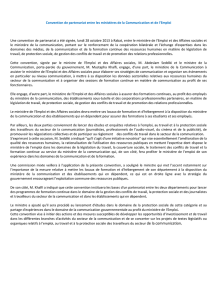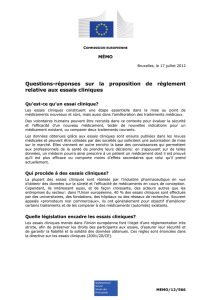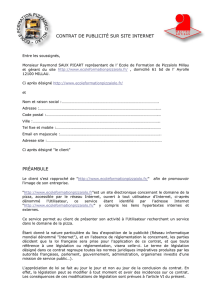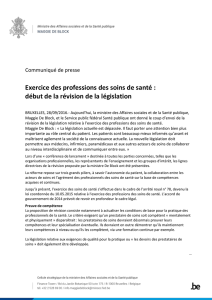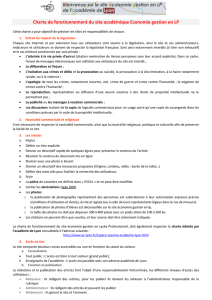Du bon usage de la législation dans la promotion de la santé et la

Du bon usage de la législation dans la promotion
de la santé et la prévention!:
expérience et appréciation d’un médecin de santé publique
Jean Martin!*
* Le Dr Jean Martin est médecin cantonal du Canton de Vaud, Suisse, et Privat-docent
et agrégé à la Faculté de Médecine de l’Université de Lausanne.
Jean Martin, “!Du bon usage de la législation dans la promotion de la santé et la prévention!:
expérience et appréciation d’un médecin de santé publique!”, RILS, 49, 1!: 177-202. [N° spécial
La législation sanitaire à l’aube du XXIe siècle, Genève, OMS, 1998, XVII-289!p.]
Remerciements – Ce document est mis en ligne avec l’aimable autorisation de l’OMS et de Madame Geneviève Pinet, Chef
du Service de Législation sanitaire.
******
La prévention!: besoins et potentiel —!Itinéraire personnel
Après des études et des stages cliniques en Suisse, j’ai découvert la médecine des pays
défavorisés!1. J’ai vu que la limitation des moyens exerce une forte pression sur ce que l’on peut
faire et ce qu’il faut faire et ai compris l’importance déterminante de l’environnement dans ses
dimensions tant physiques que biologiques, socioculturelles, politiques ou économiques. Marqué
par une impression de “tonneau des Danaïdes” devant des situations pathologiques, souvent
avancées et se manifestant de manière itérative, on réalise le besoin d’agir au niveau collectif
d’une part (perspective de santé publique) et de façon préventive d’autre part, à l’endroit de
problèmes qui semblent relativement simples quant à leurs causes et aux moyens d’y remédier.
Même si l’expérience montre que des solutions rationnelles à nos yeux ne sont pas aisément
acceptées ou comprises par ceux qui ont d’autres cadres de référence, il reste que la prévention,
notamment par l’assainissement, la fourniture d’eau potable, les vaccinations, l’amélioration de la
nutrition, l’éducation pour la santé et la planification familiale, est un champ prioritaire pour les
raisons suivantes!: elle est porteuse de progrès sensibles et idéalement rapides!; son coût est
généralement modeste, alors que la prise en charge thérapeutique des situations graves, voire
dépassées, est onéreuse, y compris pour les patients et leurs proches!; son côté pédagogique est
attrayant et constructif et l’objectif d’autonomisation des personnes dans la gestion de leur vie et
de leur santé est particulièrement pertinent.
Après avoir travaillé dans un hôpital de brousse de l’Amazonie péruvienne de 1968 à 1970,
une année passée dans une école de santé publique aux États-Unis m’a permis de prendre du
recul par rapport à cette expérience de terrain et de mieux saisir les complexités des attitudes et
pratiques. J’ai compris qu’aucun comportement, aussi irrationnel et nuisible soit-il, n’est dénué
de sens!; il a toujours une raison d’être et répond à un besoin ou à une règle. La problématique
des motifs et des circonstances qui font que “l’autre” peut se méfier de nous a donné lieu à des
débats. Il faut être attentif aux enjeux éthiques de la volonté de faire le bien des gens contre leur
gré (ou de vouloir la santé des gens malgré eux) et garder un recul critique. Cependant, les
modalités d’action proposées par la médecine et la santé publique sont prometteuses. Les
bénéfices attendus sembleraient parfois excuser que l’on “insiste” auprès des populations
intéressées. Deux exemples!: devant les morts nombreuses, “stupides” pourrait-on dire, dues au
1 Martin J., Médecin cantonal!: pourquoi, comment, pour quoi. In!: Pour la santé publique. Lausanne, Éditions
Réalités sociale, 1987, p.!231 à 238

Jean Martin, Du bon usage de la législation dans la promotion de la santé et la prévention... 2
tétanos du nouveau-né, on ne peut qu’être perturbé et se dire qu’une prise en charge même un
peu autoritaire et des mesures préventives prises “d’office” seraient une bonne chose au vu de la
simplicité des techniques de prévention (vaccination antitétanique de la femme enceinte!; section
hygiénique et pansement propre du cordon ombilical). Devant l’épuisement physiologique de
mères vivant, sans maîtrise sur leur propre vie personnelle et sexuelle, des grossesses répétées et
devant la mortalité élevée de leurs enfants, la volonté d’améliorer la situation fait songer à des
programmes incitatifs d’espacement et de prévention des naissances afin d’éviter ces drames et
ces dommages. Il y a là des questions éthiques d’importance, étant entendu que les droits des
personnes doivent être respectés.
Revenus en Suisse en 1976, j’ai collaboré à de multiples activités relevant de la prévention,
notamment dans le domaine de la santé scolaire avec la formation depuis le milieu des années 80,
dans le Canton de Vaud, des animateurs de santé (enseignants chargés d’encourager et de mener
des activités d’éducation sanitaire et la mise en œuvre d’équipes interdisciplinaires de santé dans
les écoles!2.
Depuis trois décennies, nous devons faire face aux problèmes liés à l’usage de drogues
illicites et à la toxicomanie, lesquels posent des questions complexes (bien plus complexes que ne
le disent certaines argumentations simplistes empreintes d’idéologie) et dont tous s’accordent à
admettre que les causes sont multifactorielles et relativement non spécifiques, à mettre en rapport
avec le contexte de vie dans l’enfance et l’adolescence et avec les perturbations et traumatismes
qui peuvent marquer ces périodes. Il est illusoire d’espérer une prévention efficace par la simple
description rationnelle des effets nuisibles des drogues et ce d’autant moins si on se laisse aller à
une “diabolisation” des produits tendant à faire croire qu’ils sont tout le problème, ce qui est
incomplet et incorrect mais n’enlève rien au fait que les substances à effets psychotropes, licites
ou illicites, représentent de graves préoccupations de santé et qu’il faut lutter contre ces usages.
Après 1981, il y a eu la constellation des questions liées au sida, qui a d’abord constitué une
énigme médicale à propos de quelques cas isolés, puis est réellement venu à l’ordre du jour des
pouvoirs publics vers 1985, quand on a réalisé que, physiquement, psychologiquement ou
socialement, l’infection à VIH était l’affaire de tous et de chacun. La prévention y est
particulièrement cruciale puisque nous ne disposons toujours pas d’un vaccin ou de traitements
curatifs.
La prévention!: au nom de quelles valeurs!?
Les observations scientifiques et pratiques ont permis de mieux déterminer les enjeux et
risques liés à la prévention et les justes milieux à trouver. On s’est distancé des démarches
autoritaires jugées légitimes, voire indispensables, il y a peu encore. Le tableau!1 en annexe
présente les valeurs principales qui peuvent fonder une démarche préventive (colonne de gauche),
assorties de la justification y relative (colonne du milieu) et des risques de déséquilibre ou
dérapage (colonne de droite). Plusieurs remarques sont indiquées. Ainsi, en ce qui concerne la
santé de la famille, notamment les mauvais traitements, l’arbitrage est difficile entre la retenue
(traditionnelle!: ainsi, le pater familias romain a droit de vie et de mort comme il l’entend
(“!charbonnier est maître chez soi!”) et les situations pitoyables illustrant que mieux eût valu en
temps opportun “!se mêler de ce qui ne nous regarde pas!”. Cela demande quotidiennement des
décisions ardues.
La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (1986)
Adoptée en novembre 1986 dans le cadre d’une conférence coparrainée par l’OMS, Santé et
Bien-être social, Canada (le ministère canadien de la santé et du bien-être social) et l’Association
2 Fontana E. & Nicod P.A. Prévention et santé dans les écoles vaudoises. Lausanne, Éditions Réalités
sociales, 1996.

Jean Martin, Du bon usage de la législation dans la promotion de la santé et la prévention... 3
canadienne de Santé publique, la Charte d’Ottawa!3 constitue une référence importante pour ceux
qui, dans le monde, se préoccupent de promotion et de prévention. Elle illustre une approche
moderne, soulignant l’importance de l’environnement (milieu de vie) dans ses divers aspects, ainsi
que les rôles respectifs des pouvoirs publics, de la collectivité, des professionnels de la santé et des
services de santé. Il convient d’en mentionner les extraits suivants!:
“!La promotion de la santé exige, en fait, l’action coordonnée de tous les intéressés!:
gouvernements, secteur de la santé et autres secteurs sociaux et économiques, organisations non
gouvernementales et bénévoles, autorités locales, industries et médias. Quel que soit leur milieu, les
gens sont amenés à intervenir, en tant qu’individus, ou à titre de membres d’une famille ou d’une
communauté. Les groupes professionnels et sociaux, tout comme les personnels de santé, sont,
quant à eux, particulièrement responsables de la médiation entre les intérêts divergents qui se
manifestent dans la société à l’égard de la santé.
[…]
La promotion de la santé va bien au-delà des simples soins de santé. Elle inscrit la santé à
l’ordre du jour des responsables politiques de tous les secteurs et à tous les niveaux, en les incitant
à prendre conscience des conséquences de leurs décisions sur la santé et en les amenant à admettre
leur responsabilité à cet égard.
La politique de promotion de la santé associe des approches différentes, mais
complémentaires!; mesures législatives, financières et fiscales et changements organisationnels,
notamment.
[…]
Par-delà son mandat qui consiste à offrir des services cliniques et curatifs, le secteur de la
santé doit s’orienter de plus en plus dans le sens de la promotion de la santé.
[…]
Les participants à la Conférence s’engagent!:
•à se lancer dans le combat afin de promouvoir des politiques pour la santé et à plaider en
faveur d’un engagement politique clair en faveur de la santé et de l’équité dans tous les
secteurs!;
•à lutter contre les pressions exercées en faveur de produits dangereux, de la déplétion des
ressources, de conditions et de cadres de vie malsains et d’une alimentation déséquilibrée!; à
appeler également l’attention sur les questions de santé publique, par exemple, par la
pollution, les dangers d’ordre professionnel, l’habitat et les peuplements!;
•à combler les écarts de niveau de santé dans les sociétés et à lutter contre les inégalités dues
aux règles et aux pratiques de ces sociétés!;
•à reconnaître que les individus constituent la principale ressource de santé, ainsi que les
soutenir et à leur donner les moyens de demeurer en bonne santé, ainsi que leurs familles et
leurs amis, par des moyens financiers et autres, et à accepter la communauté comme principal
porte-parole en matière de santé, de conditions de vie et de bien-être!;
•à réorienter les services de santé et leurs ressources au profit de la promotion de la santé!; à
partager leur pouvoir avec d’autres secteurs, d’autres disciplines et, plus important encore,
avec la population elle-même!;
•à reconnaître que la santé et son maintien constituent un investissement social et un défi
majeur!; et à traiter le problème général que posent les modes de vie sur le plan de
l’écologie!”.
En rapport avec cette charte, il est approprié de donner encore une notation historique!: À
propos du droit à la santé, à un moment où ce concept n’était pas encore d’usage courant,
Sigerist, historien de la médecine, suggère en 1941 qu’un élément essentiel manquait dans
l’optique quelque peu dirigiste adoptée par les partisans des mouvements de santé publique au
XVIIIe siècle, à savoir le désir conscient de chacun d’une amélioration de sa santé, ce qui était
alors un but purement et simplement inaccessible. Ce n’est que plus d’un siècle plus tard que
cette notion a été incorporée par l’OMS en 1981 dans la Stratégie mondiale de la santé pour tous
d’ici l’an 2000!4 dans les termes suivants!: “!Tout être humain a le droit et le devoir de participer
individuellement et collectivement à la planification et à la mise en œuvre des soins de santé qui
3 Organisation mondiale de la Santé. Promotion Santé —!Charte d’Ottawa, Division de la Promotion de la
Santé, de l’Éducation et de la Communication pour la Santé, Unité de l’Éducation sanitaire et de la Promotion de
la Santé. Genève, OMS, Document WHO/HPR/HEP95.1.
4 Organisation Mondiale de la Santé. Stratégie mondiale de la santé pour tous d’ici l’an 2000. Genève, OMS,
1981, p.!33.

Jean Martin, Du bon usage de la législation dans la promotion de la santé et la prévention... 4
lui sont destinés. La participation de la collectivité à la construction de son propre avenir aussi
bien dans le domaine de la santé que dans le domaine socio-économique, et notamment la
participation massive des femmes, des hommes et des jeunes, est donc un facteur clef dans la
stratégie!”!5.
Prévention et législation!: bases pertinentes
Comme dans les autres domaines de l’action sanitaire et sociale, la législation a un rôle
important à jouer en matière de prévention et de promotion de la santé. À cet égard, il convient de
bien percevoir les différents stades et modalités d’action de la prévention (dans la suite du texte,
“prévention” s’entend en général de la prévention et de la promotion de la santé) afin d’analyser
dans chaque cas si une législation est souhaitable et de quel type elle doit être. Il y a lieu
également d’étudier à quel niveau l’action législative est la plus pertinente, en particulier dans un
système politique décentralisé. Dans certains cas, des dispositions normatives prises au sommet
sont nécessaires, dans d’autres, un texte-cadre permettant une adaptation souple en fonction des
caractéristiques locales est préférable. L’un des éléments essentiels à prendre en considération est
que la plupart des troubles de santé ont des causes multiples (“étiologie multifactorielle”), au
niveau de la personne, de la famille et de la collectivité. La question fondamentale est souvent de
savoir si l’amélioration de la situation requiert une réglementation dans le domaine de la santé ou
s’il s’agit plutôt de promouvoir une législation dans d’autres domaines de la vie socio-
économique. On peut rappeler la formule percutante suivante!: “!Nous avons besoin non tant
d’une politique de santé publique que d’une politique publique saine!”.
Différents stades de la prévention
Une action préventive peut être primaire (par l’élimination a priori des facteurs constituant
une source de maladie ou d’accident, ce qui nécessite évidemment de connaître les causes ou
facteurs du problème), secondaire (dans le but de dépister l’affection à un stade précoce
symptomatique, avec la condition que le traitement précoce soit plus efficace et si possible plus
aisé qu’à une phase plus avancée) ou tertiaire (à savoir la réadaptation dans le but de réduire au
minimum les séquelles d’une maladie ou d’un accident (cet aspect de la prévention ne sera pas
traité ici)).
Différentes modalités
Il est essentiel d’avoir conscience que, pour un problème donné et à un stade donné, on peut
généralement envisager un éventail de possibilité plus ou moins autoritaire (normatives), où le rôle
de la législation et des pouvoirs publics sera plus ou moins grand, et plus ou moins actives pour
l’individu ou le groupe, où leurs propres facultés de compréhension et de choix seront plus ou
moins sollicitées. On ne peut pas dire pour autant que les modalités dites actives soient forcément
toujours meilleures. Dans certains cas, les mesures normatives (appelées aussi “passives”, du point
de vue de l’individu) sont très appropriées, efficaces et économiques, telles les vaccinations,
l’iodation et la fluoration du sel ou de l’eau ou l’interdiction de mettre dans le commerce des
produits usuels dangereux. Dans d’autres cas, notamment ceux qui sont en rapport avec des
consommations ou d’autres comportements “d’agrément”, l’accent doit être mis sur les actions
des registres informatif, éducatif et persuasif qui tiennent adéquatement compte de la liberté
fondamentale des individus.
Les difficultés de la prévention
On peut s’étonner de ce que la prévention, dans certains domaines, ne rencontre pas une
adhésion concrète plus vigoureuse de la part de la population ou des décideurs, mais ceci
s’explique par les raisons suivantes!: en matière préventive, il n’est souvent pas possible de donner
5 Fluss S.S. International public health law!: an overview. In!: Detels R et al., réd. Oxford Textbook of Public
Health. 3e édition, Oxford et New York, Oxford University Press, 1997, vol. 1, p.!371 à 390 (376 et 377).

Jean Martin, Du bon usage de la législation dans la promotion de la santé et la prévention... 5
des assurances catégoriques quant à la protection obtenue!; les effets positifs de la prévention
s’observent à long terme, ses conséquences favorables étant peu évidentes au premier abord!;
l’étiologie multifactorielle de la plupart des maladies rend nécessaire une action intersectorielle et
multisectorielle, ce qui n’est pas chose aisée même pour un décideur qui doit convaincre un ou
plusieurs de ses collègues d’agir également dans leurs propres domaines.
Place de la législation dans différentes situations
Protection de la santé
Les mesures envisagées sous ce terme ressortissent à la prévention primaire que nous
appelons “passive”. Il s’agit surtout de protéger les individus contre les risques sur lesquels ils ne
peuvent avoir qu’une influence limitée et qu’ils ne peuvent maîtriser par eux-mêmes. Ainsi,
l’article!29 de la Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique du Canton de Vaud!6 dit!: “!L’État
prend ou encourage les mesures de prévention propres à maintenir et à améliorer la santé de la
population. Il le fait en particulier lorsque l’individu, la famille ou la commune ne peuvent agir
eux-mêmes avec efficacité!”. Cela touche aux problèmes de l’aménagement de l’environnement
vital d’une manière très générale, à savoir!: la pollution physique et chimique, y compris la
radioactivité et le bruit!; l’urbanisme et le maintien des espaces naturels!; les aspects
environnementaux de la prévention des accidents!; le contrôle de la production industrielle
(s’entendant tant des modalités de production que de la qualité et de l’innocuité de ce qui est
produit)!; la législation réglementant la fabrication de produits dont l’usage est potentiellement
néfaste, ainsi que la publicité et les modes de commercialisation y relatifs (y compris la taxation)!;
les mesures classiques du type hygiène collective, assainissement, qualité des logements,
vaccination et contrôle de la qualité de l’eau et des denrées alimentaires. L’action
gouvernementale, notamment par la voie législative, est spécialement appropriée dans ce domaine.
De plus, elle peut souvent s’exercer de manière relativement centralisée.
Prévention primaire active (Promotion de la santé)
Il s’agit de toutes les mesures d’encouragement à modifier les attitudes défavorables à la
santé et à adopter des comportements plus sains. Cela vaut pour la façon de s’alimenter, la
consommation de diverses substances, l’exercice physique, la sexualité et la conduite dans la
circulation automobile. Les professionnels de la santé, puis les hommes politiques (parmi les
documents précurseurs à cet égard, voir références!7/!8/!9/! 10) ont pris conscience que,
particulièrement dans les pays industrialisés, des progrès supplémentaires concernant l’état de
santé de la collectivité devraient passer par de telles transformations des habitudes. On peut
s’interroger ici sur le rôle de la législation. S’agissant de décisions que chacun fait journellement
sur sa façon de vivre et qui ne se décrètent pas, il est difficile de légiférer directement. Aussi
néfaste que soient centaines pratiques usuelles de nos contemporains, le principe de la liberté de
détermination individuelle doit être préservé. Néanmoins, des actes gouvernementaux peuvent très
utilement contribuer à un progrès, par les prises de position des autorités sur une politique globale
de prévention ou des thèmes particuliers et par l’allocation des moyens nécessaires, dans le secteur
public ou par subvention d’initiatives privées.
6 Voir Recueil international de Législation sanitaire (R.I.L.S.), 36(4)!:1007-1015 (1985).
7 Lalonde M. Nouvelle perspective de la santé des Canadiens. Ottawa, Ministère de la Santé et du Bien-Etre
social, 1974.
8 Département of Health and social Security (royaume Uni). Prevention and Health!: Everybody’s business.
Londres, H.M. Stationery Office, 1976
9 U.S. Department of Health. Healthy People — The surgeon General’s Report on Health Promotion and
Disease Preention. 2 volumes. Washington, DC, U.S. Government Printing Office, 1979, DHEW (PHS)
publications, n°s!79-55071 et 79-55071-A.
10 Ministère de la Santé (France). Propositions pour une politique de prévention. Rapport du Ministre de la
Santé. Paris, la Documentation française, 1982.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%