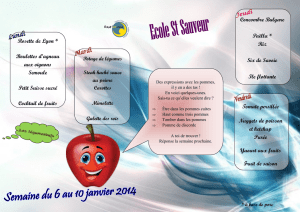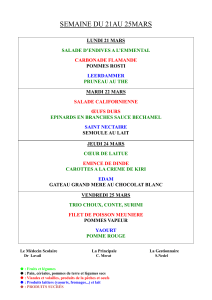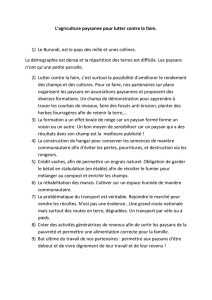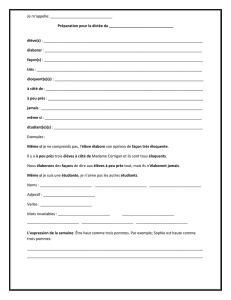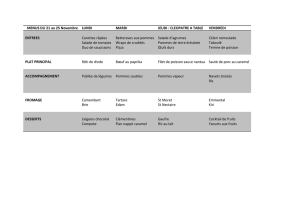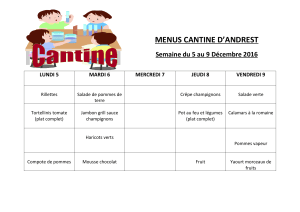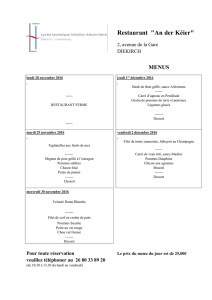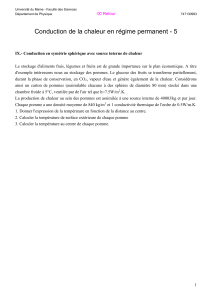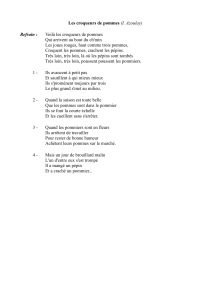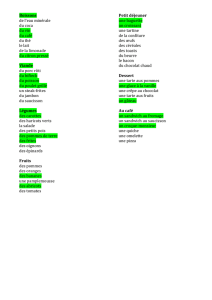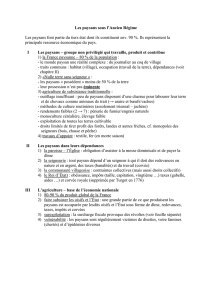Métissages culturels et économiques dans le monde

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006
343
Métissages culturels et économiques dans le
monde rural roumain post-communiste
Pour dépasser les clivages théoriques : culture/économie,
capitalisme/socialisme, économie domestique/économie
de marché
Cultural and economic crossbreeding in post-communist rural
Romania
Beyond the culture/economics, capitalism/socialism, home market/market
economy divides
Anda Becut
Centre de Recherche dans le Domaine de la Culture
Bucarest, Roumanie
Résumé
Mon analyse s’inscrit à l’intersection des anciens débats : culture versus
économie, capitalisme versus socialisme, économie de marché versus
économie domestique. Je ne me propose pas de faire une incursion longue
dans l’histoire de ces débats, mais je veux accentuer les idées qui
soutiennent mon point de vue.
Dans un premier temps, je veux préciser que cette analyse est le résultat
des réflexions sur l’état actuel du monde rural roumain qui se confronte
avec beaucoup de difficultés, dans son processus d’adaptation, aux
pratiques économiques spécifiques à une économie de marché. Les
difficultés sont liées spécialement aux politiques gouvernementales qui
appliquent le modèle occidental des politiques agricoles, sans tenir compte
de la spécificité culturelle et économique du monde rural roumain.
Deuxièmement, je veux souligner que cette analyse est le résultat d’une
étude de cas sur les pratiques économiques et sociales des paysans qui
produisent et vendent les pommes dans un des grands marchés de
Bucarest, le Marché Obor, et essaient de s’adapter aux changements de la
période de transition.
Mots-clés : Monde rural roumain, marché de la pomme, changement
économique

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006
344
Abstract
This analysis lies at the cross-roads of former debates: culture versus
economics, capitalism versus socialism, market economy versus home
market. Without going into the history of these debates at length, the ideas
supporting my viewpoint are emphasized.
First it is specified that this analysis is the outcome of reflections about the
current state of rural Romania which, in its adaptation process, is struggling
to cope with economic practices specific to a market economy. The
difficulties are specially related to governmental policies that apply the
western model of agricultural policies regardless of the cultural and
economic specificities of rural Romania. Secondly, it is emphasized that
this analysis is the result of a case study of the economic and social
practices of farmers growing and selling apples on Bucarest’s Obor market,
and try to adapt to changes in times of transition.
Key-words: Romanian rural world, apple’s market, economic change
Introduction
Dans le monde rural roumain, on ne peut pas parler des stratégies économiques ou d’un
esprit d’entrepreneur en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits
agricoles. Plus proche de la réalité est l’affirmation de l’existence de quelques pratiques
économiques de production et d’échange qui combinent diverses attitudes dans les
nouvelles situations. Les pratiques économiques sont le résultat de l’adaptation des
maisonnées paysannes aux situations de risque et d’incertitude de la période de transition.
Dans ce contexte, le manque d’un système de crédits agricoles avantageux a déterminé la
présence des paysans sur le marché comme une solution pour obtenir un grand profit dans
une période courte. De même, le manque d’un système organisé de collecte et de transport
des produits agricoles a déterminé l’apparition d’une catégorie nouvelle de commerçants,
les vendeurs intermédiaires, et d’un nouveau marché, le marché locale. Aussi, le manque de
confiance dans le système bancaire et des informations correctes en ce qui concerne
l’intégration dans l’Union Européenne ont déterminé « le blocage » de capital dans des
constructions et des terrains.
Dans le monde rural roumain post-communiste, il y a des métissages culturels et
économiques qui sont le résultat de la transition post-socialiste. Les paysans roumains
mélangent les pratiques économiques capitalistes avec celles du système économique
socialiste qui se superposent à leur tour aux pratiques économiques traditionnelles. On
combine aussi des pratiques formelles et informelles, ce qui justifie mon choix de ne pas
parler d’une économie informelle et encore moins d’une économie de marché.
Je considère qu’il s’agit dans ce cas de comportements économiques spécifiques à un
certain type d’économie, l’économie domestique, qui combine les mécanismes et les
relations économiques dans la situation d’une transition à l’économie de marché. Il s’agit
de la relation entre la maisonnée et le marché ou, dans certaines situations des métissages,
des relations économiques spécifiques à l’économie informelle ou à l’économie de marché.

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006
345
1. Cadre théorique
L’unité de base dans l’économie domestique roumaine est la maisonnée. Les pratiques
économiques et sociales des paysans roumains sont fortement liées à la maisonnée et aux
valeurs associées à la famille et à la communauté dont ils font partie. Le rôle actuel de la
maisonnée dans le monde rural roumain porte l’empreinte des changements politiques,
sociaux et économiques. Plusieurs analyses du rôle de la production et de la consommation
alimentaire domestique dans l’Est européen ont caractérisé les pratiques domestiques
comme des réponses rationnelles dans une situation austère (Smith, 2003 p.234).
Dans ces analyses, les pratiques domestiques sont considérées comme des « stratégies pour
survivre » dans la situation d’un collapse de l’économie formelle. Je trouve qu’il y a une
confusion à la base de ces analyses car les critères n’en sont pas les mêmes. Le critère de la
rationalité et le concept de stratégie sont ceux de l’économie capitaliste. Mais dans le cas
d’une économie domestique on ne peut pas parler de stratégies, il s’agit seulement des
pratiques économiques. La rationalité de ces pratiques est liée à d’autres valeurs, comme la
famille et la communauté.
Depuis Adam Smith, le concept de l’intérêt personnel domine la discipline moderne de
l’économie. Dans les différentes démarches, le principal débat porte sur la question de la
motivation : l’intérêt personnel ou la disposition naturelle pour coopérer et former les
groupes et les communautés.
Je ne me propose pas de faire une longue incursion dans le débat économie versus culture.
Mais quelques précisions ont été nécessaires pour fixer le cadre théorique de mon étude de
cas. Un autre débat théorique peut apporter des arguments pour compléter l’image du
monde rural roumain. Il s’agit du débat économie capitaliste versus économie socialiste.
L’histoire de la production et de la commercialisation des produits agricoles représente un
argument qui explique les réalités économiques et sociales post-socialistes. Dans mon étude
de cas, les paysans ont eu une forte expérience du marché depuis la période communiste et
cette expérience a influencé leurs pratiques économiques présentes.
Pendant le communisme la maisonnée et les activités domestiques ont eu un rôle de
résistance contre l’intrusion du politique au niveau des affaires privées. Ainsi, les activités
informelles ont été chargées d’une forte légitimation morale, même après la chute du
régime communiste. Adrian Smith considère cette valorisation de l’informel comme un
exemple de la « culture de l’ambivalence », fort liée à la rejection du système soviétique.
La réponse des gens à un système politique arbitraire, illégitime et immoral a été le refuge
dans le domestique et la pratique des activités économiques autour de la maisonnée.
Dans mon étude de cas, les paysans ne respectent pas les règles de transport et de
commercialisation de pommes. Les paysans donnent encore le pot-de-vin aux policiers pour
échapper aux taxes de transport ; les vendeurs « graissent la pâte » aux personnes qui
travaillent dans l’Administration du Marché ou aux personnes qui travaillent dans la Police
Financière pour échapper aux différents contraventions. Ces pratiques étaient utilisées sous
le régime communiste et continuent encore, après quinze ans d’économie de marché.
Une autre exemple est celui de l’utilisation d’une stratégie pour arranger les produits qui
transgressent non seulement les normes éthiques de ce que l’économie classique appelle la
concurrence non loyale mais aussi les normes internes du fonctionnement administratif des

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006
346
marchés, en se situant sous l’incidence des contreventions contravention, est l’utilisation de
l’espace excédentaire. Il y a des vendeurs qui assument le risque de se faire sanctionner,
(cela dépend de « l’indulgence » des fonctionnaires de la Police Financière et des « dons »
qu’ils sont disposés à leur donner). Du point de vue des vendeurs cela représente une
pratique légitime, dans la situation où ils considèrent les taxes imposées par
l’Administration du Marché comme des taxes injustes et immorales.
Au niveau de la communauté, la résistance anti-politique et anti-communiste se manifeste à
travers les relations interpersonnelles. L’échange réciproque de biens et de travail et les
pratiques de la production d’aliments dans le village roumain actuel ont des racines dans la
période communiste mais aussi pré communiste. Dans ce contexte, le modèle de
l’économie capitaliste prend des formes hybrides qui combinent les deux types
d’économies. Voici donc pourquoi je considère qu’il est presque impossible d’expliquer les
faits économiques qui se manifestent à présent dans le monde rural roumain
Susana Narotzky (Smith, 2003, p.11) considère l’intention de définir « l’économie » en
terme de capitalisme comme un acte de domination de la culture Occidentale. La position
de la maisonnée à l’extérieur des relations du marché et à l’intérieur de l’espace non
capitaliste peut être expliquée par la valorisation des relations sociales au niveau de la
communauté.
La différence entre les pratiques spécifiques à l’économie socialiste et à l’économie
capitaliste ne doit pas être pensée en termes radicaux, mais il faut la traiter en termes de
diversités économique et culturelle. « To theorize capitalism itself as different from itself is
to multiply (infinitely) the possibilities of economic alterity; noncapitalism is released from
its singularity and subjection and becomes potentially visible as a differentiated multiplicity
of economic forms. At the same time, capitalism is repositioned in a discourse of economic
plurality. This move destabilizes it as presumptively or inherently hegemonic system,
subverting its naturalized dominance of representing it as one among many forms of
economy, one whose hegemony must be theorized rather than presupposed. » (Smith, 2003,
p. 237).
Au-delà du débat capitalisme versus socialisme se trouve la distinction entre l’économie de
marché et l’économie domestique. Quoique la forme domestique des activités économiques
ait existé pendant le communisme, elle a été une exception par rapport à la dimension
actuelle des pratiques domestiques dans le monde rural roumain.
L’existence des coopératives agricoles pendant le communisme et leur disparition après la
chute du régime explique le grade différent de manifestation des activités domestiques. On
peut donc parler à présent d’une économie domestique, située à l’intersection des secteurs
formel et informel, basée spécialement sur l’unité de la maisonnée et sur les relations
sociales au niveau de la communauté. Ce type d’économie combine des pratiques diverses ;
quelques-unes sont dérivées des relations contractuelles spécifiques au capitalisme, d’autres
viennent des relations « pre-moderne » et prennent plutôt la forme du troc et d’échange
réciproque du travail.
Dans les états Est-européens, le troc et la réciprocité sont de différentes formes
d’équivalence qui représentent différentes conceptions culturelles, en ce qui concerne la
valeur dans chaque système économique. « The significance of these practices then is such
that, although somewhat « mundane » and “everyday”, they provide the necessity to open

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006
347
our conceptions of “economy” to the diverse array of constitutive practices which embody
variant class processes – some capitalist, others feudal and others possibly communal”
(Creed, 2000, p. 246).
Dans mon étude de cas, les paysans balancent entre deux espaces : la communauté et les
marchés. Ces deux univers ont leurs propres règles, leurs propres types des relations et
leurs propres caractéristiques. Stephen Gudeman attribue à chacun de ces univers un certain
type d’économie : au premier correspond une économie locale, spécifique et constituée à
travers les relations sociales, le deuxième entraîne une économie impersonnelle, globale et
même séparée du contexte social (Gudeman, 2001, p. 361).
Pour l’économie domestique, les valeurs qui comptent sont la famille et la communauté.
L’appartenance à une communauté ou à une groupe est très forte mais les paysans
combinent aussi ces valeurs avec celles spécifiques à l’économie de marché : le profit, la
concurrence, l’investissement. Je crois qu’il est important de voir la manière dont ces
valeurs se combinent et les comportements qui dérivent de ce métissage.
En adoptant une interprétation en termes de « réponses naturelles » des individus aux
stimuli extérieurs, ma recherche se construit sur l’idée d’un aspect axiologique spécifique
de l’action humaine, le rôle de culture étant déterminant pour l’explication des raisons qui
sont à la base du choix entre plusieurs variantes d’action. Les valeurs qui sont utilisées à
travers différents modèles culturels expliquent les désirs, les opinions, les attitudes et les
comportements des individus.
Il s’agit du concept de rationalité axiologique utilisé par Max Weber (1998, p. 143), distinct
de celui de la rationalité instrumentale. J’ai choisi d’utiliser le concept de rationalité
axiologique tel qu’il est défini par Raymond Boudon (Boudon, 2003, p. 54), afin
d’expliquer les différentes attitudes adoptées vis-à-vis de la marchandise.
Pour Raymond Boudon la rationalité axiologique représente un système de raisons non
instrumentales. « Le cas de la rationalité axiologique est donc traité ici comme parallèle à
celui de la rationalité cognitive : dans le premier cas, le système de raisons fondant la
conviction comporte au moins une proposition normative, condition nécessaire pour que la
conclusion puisse être elle-même de caractère normatif ; dans le second, le système de
raisons ne comporte aucune proposition normative… Il n’existe pas de critères généraux
permettant d’affirmer qu’un système quelconque de raisons est valide, qu’il garantit une
conclusion de type : “ X vrai, faux, légitime, illégitime, bon mauvais ”. La vérité, la justice
et les autres valeurs seraient affaire de conventions ; elles relèveraient de l’arbitraire
culturel » (Boudon, 2003, p. 61).
J’ai considéré le marché comme locus de rencontre des différentes communautés qui
échangent, non seulement des objets, mais aussi des valeurs culturelles. De ce point de vue,
le marché et les activités commerciales impliquent des évaluations culturelles en termes
moraux. Le marché représente un champ de lutte pour le pouvoir ou les évaluations morales
concernant les agents et les relations d’échange sont la conséquence des processus de
contestation (Dilley, 1992, p.73).
Les évaluations morales d’échange et de commerce sont les résultats des changements
politiques et économiques. Dans le cas de ma recherche, la chute du communisme et la
transition à l’économie de marché ont déterminé un changement d’attitude de la part des
producteurs et des vendeurs de pommes par rapport au marché et aux relations qui
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%