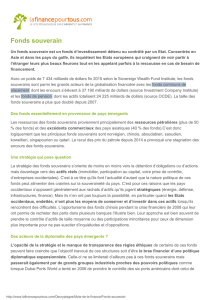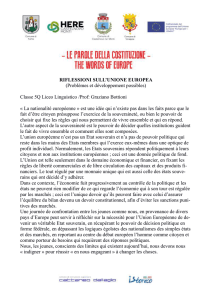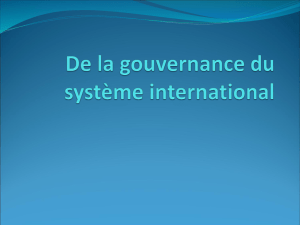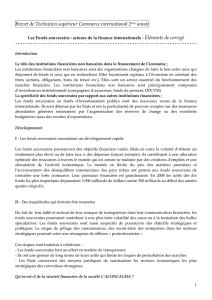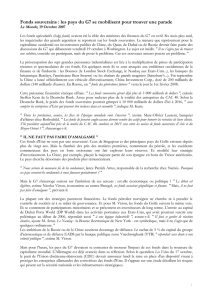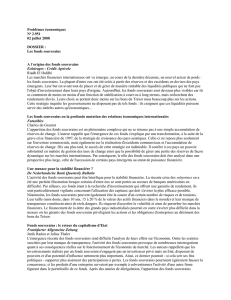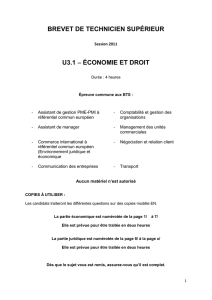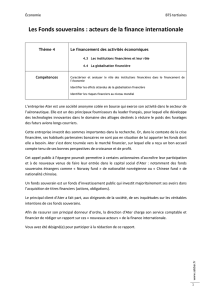LD 78 malaisie

Les fonds souverains d’investissement
Faut-il craindre les nouveaux sumos
de la finance mondiale ?
Par M. Philippe-Henri Latimier, Ph.D.
Consultant international en réforme des marchés de capitaux & Professeur d’Ingénierie Financière
Selon l’antienne désormais bien connue des
marchés, la globalisation financière a engendré la
suppression des frontières nationales des capi-
taux ainsi que le décloisonnement des marchés financiers.
Les fonds souverains d’investissement dont la création
des plus anciens comme le Kuwait Investment Board,
remonte à plus de cinquante ans, participent au quotidien
au phénomène de globalisation financière et au boulever-
sement des rapports de force entre les pays occidentaux
et ceux qui aujourd’hui les financent.
Paradoxalement, le grand public semble en découvrir
l’existence depuis peu et avec à tout le moins une certaine
circonspection.
Il est vrai qu’avec quelque 3 000 milliards de dollars
d’actifs sous gestion à ce jour et plus de 10 000 mil-
liards à l’échéance 2013, selon les estimations du FMI, il
est assuré de dire que les grands fonds souverains d’inves-
tissement du Moyen-Orient, de Singapour, de Chine, de
Norvège, de Russie et quelques fonds régionaux comme
ceux de l’Alaska ou de l’Alberta (Canada) ont les moyens
d’agir sur l’économie mondiale et les marchés de capitaux
de manière architectonique.
Pour comprendre le débat actuel, il faut commencer
par admettre qu’il existe une relation de nature quasi sym-
biotique entre le capitalisme privé et le capitalisme d’état
tant il est vrai que la globalisation financière a diffusé la
puissance économique des fonds d’investissement à la
planète toute entière.
Pour le dire autrement, forts de l’équivalent de près de
2% de détention du total du marché mondial des valeurs
mobilières et des dépôts bancaires, les fonds d’investisse-
ment souverains qui, désormais, représentent une manne
financière d’une puissance deux fois supérieure à celle des
« hedge funds » et des « equity funds » réunis, constituent
potentiellement la réponse technique à la pluralité des
phénomènes économiques.
C’est à dire, les phénomènes liés aux dérives du sys-
tème capitaliste régulièrement en proie aux crises de liqui-
dités à l’instar de la crise des « subprimes », et ceux liés
aux errements du sous-développement économique
plongé dans l’immobilisme de régimes assis sur la misère,
cette longue mèche d’un monde explosif.
Compte tenu des philippiques actuels s’agissant du
rôle des fonds, dont la frappe financière - comme d’aucuns
aiment à le penser n’ a d’égal que leur opacité- un dialogue
sérieux avec leurs états propriétaires, ne saurait faire
l’impasse sur la question des raisons de leur activisme.
Pour que le débat puisse dépasser la spéculation théo-
rique, il conviendrait que les fonds souverains s’interdi-
sent de faire montre d’ambitions géopolitiques affirmées,
en se rendant par exemple directement actionnaires de
sociétés emblématiques dans les secteurs sensibles voire
stratégiques, avec l’arrière pensée ou non d’ailleurs, d’y
exercer une influence politique.
Ces déplacements possibles de la tectonique écono-
mique font à l’évidence peur comme vient de le traduire
la réaction de l’opinion publique américaine en apprenant
la toute récente acquisition de la tour Chrysler à New York
par ADIA (Abu Dhabi Investment Authority ).
En outre, certains observateurs ne manquent pas de
relever que l’ancrage actionnarial des fonds souverains
étrangers en occident s’effectue globalement dans un
contexte d’absence totale de réciprocité jugée inadmissible.
Face à la montée en puissance des fonds sous contrôle
étranger, dont l’augmentation rapide du nombre et de la
taille reflète la croissance des avoirs en devises liés princi-
palement aux gains sur les marchés des matières pre-
mières ou à leurs interventions massives sur les marché
des changes, voire dans certains cas aux recettes budgé-
taires, cette inquiétude s’est récemment invitée au cœur
du débat économique dans plusieurs pays du G8.
Le G8 s’étant saisi du sujet, a demandé dès le mois
d’octobre 2007 au FMI et à l’OCDE, notamment, de défi-
nir un corpus de bonnes pratiques à destination des fonds
souverains eux-mêmes, mais également des pays qui
recevront leurs investissements, au premier rang
desquels figurent ceux dont la faiblesse structurelle du
taux d’épargne nationale pourrait créer une dépendance
excessive à l’égard des capitaux venus de l’étranger.
Sans préjuger ici des intentions de ces fonds souverains
et de leur stratégie, le débat actuel rappelle à bien des
égards celui des années 1970 s’agissant du recyclage des
pétrodollars et les risques associés.
N’a t-on pas déjà souvent entendu dire que l’intervention
des fonds souverains stimulait l’inflation des actifs, qu’il
s’agisse des biens immobiliers ou des actions des sociétés
cotées en bourse, sans toutefois renforcer automatiquement
le potentiel de production des pays récipiendaires ?
N’a t-on également jamais entendu dire qu’avec l’aug-
mentation persistante du prix du baril de pétrole qui vient
de franchir 150 dollars et la hausse durable du prix des
matières premières, cela risquait d’offrir aux fonds souve-
rains de nouveaux champs d’action possibles en matière de
choix d’investissement, jusqu’à une date encore récente
majoritairement investis en titres représentatifs de la dette
souveraine de pays occidentaux comme la France ?
Sans tricher avec les faits, les fonds souverains jouent
déjà un rôle déterminant dans l’économie contemporaine
et pourraient apparaître comme le vecteur surpuissant de
la propagation du modèle ultra-libéral dans le contexte de
globalisation financière qui est le notre.
Comme pièce maîtresse de l’architecture financière
mondiale, il apparaît plus qu’opportun et souhaitable de
les « encadrer » de sorte que tous les opérateurs assument
le plus pleinement possible les conséquences de leurs
décisions à l’intérieur de relations que l’on veut croire
mutuellement bénéfiques et constructives.
Une typologie des fonds souverains permet à ce stade
d’éclairer le débat sur les risques implicites.
Sans prétendre à l’exhaustivité on retiendra quatre catégories :
- La première catégorie se voit constituée des fonds souve-
rains occidentaux, comme ceux de la Norvège ou du
Analyse
LA LETTRE DIPLOMATIQUE n°82
130

THE DIPLOMATIC LETTER n°82
131
Canada, qui globalement obéissent à des règles strictes
en matière d’investissement. A titre d’exemple, le fonds
de pension du gouvernement norvégien, le Norwegian
Pension Fund, chargé de gérer la manne pétrolière du
pays, n’investit jamais qu’à la marge dans le capital des
sociétés.Et quoiqu’il en soit, jamais au delà de 10%, ce
qui limite de fait son rôle à celui d’investisseur institu-
tionnel.Pour autant, ce fond vient d’annoncer son inten-
tion de porter de 40% à 60% la part contributive des
actions dans son portefeuille.
Et d’étudier, désormais la possibilité d’investir dans des
fonds spéculatifs (hedge funds) et d’investissement
(private equity ).
On notera ici que ce mastodonte qui pèse quelque 390
milliards de dollars est déjà le deuxième fonds actionnaire
de l’indice CAC 40, et à ce titre, le premier étranger.
Les experts s’accordent à dire que le Norwegian
Pension Fund devrait peser près de 500 milliards de
dollars en 2009.
Autre exemple éloquent, celui du Alaska Permanent
Reserve Fund aux Etats-Unis qui détient des participa-
tions significatives dans le capital de multinationales telles
GE, Exxon, Microsoft, Google, Procter & Gamble.
On aura compris que ces fonds participent au dévelop-
pement économique de leur pays d’origine en protégeant
leur économie de la volatilité des cours des matières pre-
mières, par le truchement d’un arbitrage permanent entre
le risque et le rendement attendu des portefeuilles.
- La deuxième catégorie rassemble les fonds souverains
des pays pétroliers du Moyen-Orient, dont l’influence
géopolitique reste encore toutefois limitée. Leur straté-
gie d’investissement répond majoritairement à une obli-
gation de lissage dans le temps des revenus du pétrole ou
d’amortissement des fluctuations du prix des ressources
énergétiques ou des matières premières qu’ils exploi-
tent. La stabilisation du système financier international
est au cœur de leurs priorités, sachant que cours du dol-
lar et cours du pétrole sont comme chacun sait inverse-
ment corrélés. C’est dans cet esprit que l’ADIA (Abu
Dhabi Investment Authority) qui gère plus de 800 mil-
liards de dollars est intervenu dans la recapitalisation de
Citigroup, pour éponger les pertes de cette prestigieuse
banque américaine liées à la crise des « subprimes ».
- La troisième catégorie regroupe les fonds souverains
détenus par des pays à volonté hégémonique, comme la
Chine et la Russie. S’agissant de la Chine, il s’agit d’acqué-
rir des savoir-faire ou des technologies nouvelles ou
éprouvées. C’est ainsi que la CIC (China Investment
Corporation) qui pèse plus de 200 milliards de dollars
vient d’acquérir 9,9% du capital de la très célèbre banque
d’affaires américaine Morgan Stanley et 1,6 % du capital
du groupe Total. Avant la crise des « subprimes », le
même fonds avait déjà pris un « ticket » de 3 milliards de
dollars dans Blackstone, un fond d’acquisition à effet de
levier (LBO) : une façon de diversifier le placement des
1 650 milliards de dollars de réserves de change du pays.
- La quatrième catégorie regroupe les fonds souverains
créés pour réinvestir les excédents budgétaires ou le pro-
duit des privatisations. La SGIC (Singapore Government
Investment Corporation) qui gère quelque 330 milliards
de dollars ou la KIA (Kuwait Investment Authority) qui,
avec ses 250 milliards de dollars, détient depuis des
années déjà 8 % environ du capital de Daimler, s’effor-
cent de répartir minutieusement leurs avoirs sur de
longues périodes et mobilisent quand c’est nécessaire
leurs réserves étrangères inutilisées.
On notera ici que Temasek (Singapour) détient
quant à lui une participation de l’ordre de 2 milliards
dans le capital de Barclays et 24% du capital de China
Eastern Airlines.
Depuis quelque temps, il ne se passe pas de jours ou
presque sans que la presse se fasse l’écho de grandes
manœuvres de recapitalisation au sein de grands établis-
sements bancaires. En effet, l’injection massive de capi-
taux par différents fonds souverains dans plusieurs
institutions financières emblématiques des zones OCDE
et nord-américaine a indiscutablement d’abord inquiété
l’opinion publique. Pour finir, elle a eu un effet stabilisa-
teur extrêmement salutaire, à un moment ou les préteurs
se faisaient aussi rares que l’arlésienne… et que le pessi-
misme régnait sur les marchés. Ce phénomène, pas
forcément rassurant s’il n’est pas contrôlé, éclaire d’un
jour nouveau l’histoire économique du monde.
Il a le pouvoir, en effet, d’en transformer profondément
la géographie, d’ou naturellement les inquiétudes qui tien-
nent à une gouvernance plus ou moins transparente des
fonds, à leurs stratégies d’investissement dont les objectifs
ne sont pas toujours publics et à l’ampleur de leur puissance
financière susceptible de menacer les intérêts économiques
primordiaux des pays récipiendaires lorsque les investisse-
ments réalisés n’obéissent à aucune logique économique.
A ce jour, on dénombre une quarantaine de fonds
souverains principaux et une trentaine, plus modestes qui
détiennent environ 500 milliards de dollars d’actifs. A la
liste des fonds précités, il conviendra bientôt d’ajouter les
petits nouveaux tels celui de la République algérienne qui
devrait encaisser quelque 80 milliards de recettes
pétrolières en 2008. Et celui du Venezuela, aussi !
Dubai et sa place financière, ou le nombre de chantiers immobiliers
mobilise la plus forte concentration de grues au monde. Construit par
la société Nakheel, le Palm Jumeirah est la plus grande île conçue
par l’homme accueillant un vaste complexe hôtellier et immobilier.
© THE7THART

Analyse
LA LETTRE DIPLOMATIQUE n°82
132
Rappelons ici que les fonds d’investissement publics
répondent à trois critères1:
- ils sont possédés ou contrôlés par un gouvernement
national.
- ils gèrent des actifs financiers dans une logique de
long terme.
- leur politique d’investissement vise à atteindre des
objectifs macroéconomiques précis, comme l’épargne
intergénérationnelle, la diversification du PIB natio-
nal ou le lissage de l’activité.
Ils ont, à ce stade, déjà injecté des liquidités consi-
dérables dans nos économies européennes. Et leurs
plus récentes interventions ont contribuées, à l’évi-
dence, à stabiliser les marchés financiers. Soulignons
qu’à ce jour, l’expérience de l’OCDE en matière de
fonds souverains, qui prévoit de publier sur la question
un rapport au printemps 2009, les fait d’ores et déjà
apparaître comme un élément positif.2
Si l’OCDE cherche de son coté à définir les meil-
leures pratiques pour les pays destinataires des fonds
souverains, en mettant en exergue quatre principes fon-
damentaux à savoir la non discrimination, la transpa-
rence, la proportionnalité des réglementations et la res-
ponsabilité, le FMI, pour sa part, élabore actuellement
un code de déontologie des fonds souverains, en coopé-
ration avec leurs détenteurs dont la vocation est de
répondre aux préoccupations liées au risque de voir les
opérations transfrontalières de certains fonds perturber
le fonctionnement normal des économies de marché.
Enfin, la Commission européenne a proposé en
février 2008 que les dirigeants européens adoptent
une stratégie commune visant à exiger des fonds
d’avantage de transparence, de prévisibilité et d’obli-
gations de rendre des comptes.
Pour conclure, gageons d’abord que les fonds souve-
rains d’investissement aillent résolument à la rencontre
d’un capitalisme aussi éthique que vertueux dans leur
volonté de promouvoir leurs investissements en se gar-
dant bien d’induire tout risque de dysfonctionnement
ou de réaction excessive et imprévisible des marchés,
anomalies qui seraient au fond de peu d’importance si
elles n’affectaient pas l’économie réelle au travers la
volatilité financière et la stabilité macroéconomique.
Gageons ensuite, afin d’éviter de désigner les fonds sou-
verains à la vindicte populaire, que ceux-ci s’interdisent de
manipuler les marchés ou de basculer dans un mimétisme
aveugle qui bien que consubstantiel à la vie des marchés,
en est aussi un facteur premier de leur volatilité.
Au législateur donc de mettre en place les textes
nécessaires pour encadrer l’activisme des investisseurs
souverains, si l’on veut éviter une démarche de simple
rejet ou dénigrement de leur rôle.Que le leitmotiv général
soit de faciliter la participation des fonds à un ordre inter-
national stable.
Et aux politiques, aussi, de faire en sorte de créer des
enthousiasmes et des synergies autour de leur présence et
d’en faire un atout essentiel dans le développement har-
monieux des valeurs que porte le système capitaliste dans
le contexte international de turbulences et de dissensions
que nous traversons et ce, au regard notamment du par-
tage odieusement inégal et déstabilisant de la rente écono-
mique que constitue les ressources énergétiques.
Je souhaite, pour ma part, réaffirmer ici ma convic-
tion que les fonds constituent un enjeu fondamental
du développement économique et social à l’échelle
planétaire au service desquels leur action bienfaisante
toute entière doit être destinée.
Tout indique que l’économie de marché en général et
en France en particulier a besoin des fonds souverains.
Un examen plus attentif encore révèle que l’économie de
marché et la France ont également besoin concomitam-
ment de bonne gouvernance et, en l’occurrence, de dispo-
sitifs de régulation adaptés pour accompagner le courant
d’investissements des fonds souverains afin d’éviter tout
désordre, tout risque, toute menace qui pourraient avoir
un retentissement systémique.
Ceci étant posé, la France doit rester ouverte aux
investissements étrangers, car l’économie française,
plus que jamais pliée au principe de réalité ne saurait
flotter à coté du réel, et cependant survivre.
Et à nos yeux le protectionnisme quand il est excessif
n’est jamais un bon outil politique. L’objectif est donc, sans
ignorer ni les turpides ni les excès éventuels des investis-
seurs souverains, de pouvoir bientôt leur décerner des lau-
riers ! Les fonds souverains ne sont pas le si « grand
méchant loup » posté à nos portes que la rumeur du café
du commerce voudrait colporter, et ce d’autant moins
qu’ils peuvent représenter un afflux important de capi-
taux frais nécessaires au développement de grands projets
industriels ou à la restructuration financière de groupes
insuffisamment capitalisés pour envisager de prospérer
sur leurs mérites propres.
Au final, il est bien difficile de ne pas admettre que la
France, compte tenu de l’expertise de ses « champions
», à tout à gagner à un rapprochement réfléchi avec les
gouvernements propriétaires des fonds souverains au
regard des besoins en infrastructure des pays qui les
hébergent, et notamment au Moyen-Orient.3Rendez-
vous est donc pris, car maintenant que les acteurs sont
en place et le modus operandi des fonds souverains en
phase de clarification, le spectacle à l’intérieur du nou-
vel ordre économique mondial qui se dessine sous nos
yeux va (vraiment) … commencer !... ◗❘
1 - Rapport sur les Fonds Souverains établi par M. Alain
Demarolle, Inspecteur des Finances, à la demande de
Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Economie et des
Finances, mai 2008.
2 - Rapport du Comité de l’investissement de l’OCDE sur les
« fonds souverains et les politiques des pays d’accueil »,
4 avril 2008.
3 - Rapport d’information n°33, « Le nouvel âge d’or des fonds
souverains au Moyen-Orient », Commission des Finances
du Sénat, 17 octobre 2007.
La manne pétrolière majoritairement à l'origine
de la capacité d'investissement des fonds
souverain. Ici le projet E11 exploité par la
compagnie pétrolière Shell, dans le gisement
de Sarawak en Malaisie.
© Shell
1
/
3
100%