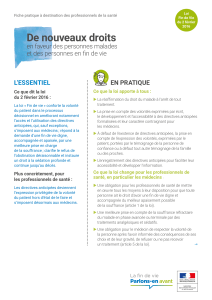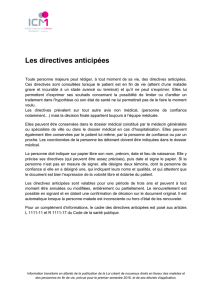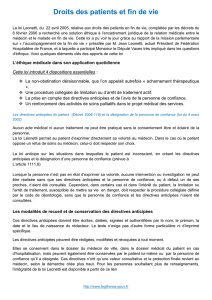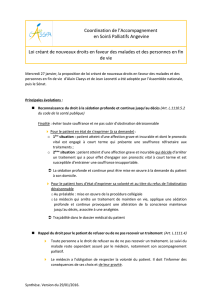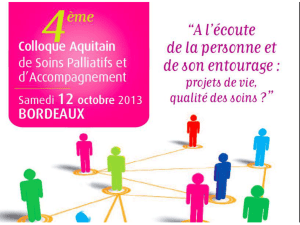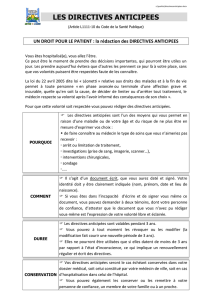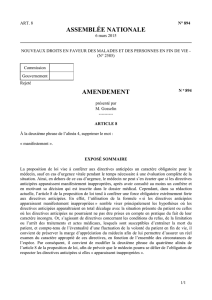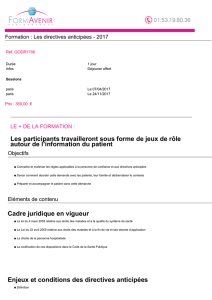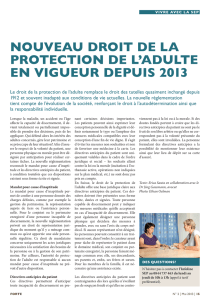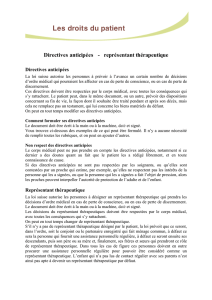Directives anticipées : pour une meilleure qualité de la fin de vie ?

LAENNEC N°3/2014 12 rue d’Assas 75006 Paris
www.revue-laennec.fr
Directives anticipées :
pour une meilleure
qualité de la fin de vie ?
Les débats récents autour
de l’« affaire Vincent Lambert »
ont brutalement réintroduit dans
l’actualité la question des directives
anticipées, non sans confusion
ni malentendus. Mais en quoi
consiste réellement le dispositif
prévu par la loi Leonetti ?
Quels peuvent en être les bénéfices
pour le patient, mais aussi les limites ?
Et quelles évolutions envisager
pour une meilleure approche
de la fin de vie en France ?
Analyse
Pascale Vinant
Responsable Unité Fonctionnelle
de médecine palliative
CHU Cochin, AP-HP – Paris
Carole Bouleuc
Responsable du Pôle Soins Palliatifs
Institut Curie – Paris
Éthique

Éthique
LAENNEC N°3/2014
44
(1)
Ce principe figurait déjà,
depuis longtemps, dans le code
de la santé publique et le code
de déontologie médicale.
La confusion est grande dans les débats actuels autour
des directives anticipées. L’imprécision des termes n’y est
pas étrangère : les « directives » n’en sont pas puisqu’elles
n’ont aucune valeur opposable ; leur caractère « anticipé »
laisse arbitrairement de côté la question de la prédictibilité de
nos souhaits face à la situation future, inédite et tragique, de
notre fin de vie ; enfin, le caractère approximatif des indica-
tions fournies par la loi du 22 avril 2005 quant à leur contenu
montre combien l’élaboration d’une définition circonstanciée
(inexistante à ce jour) se révèle complexe.
S’agit-il pour autant d’une mesure légale inefficiente – un dis-
positif artificiel dont l’ambition affichée serait de promouvoir
l’autonomie de la personne, mais sans réelle efficacité ? Ou bien
sommes-nous dans une phase d’appropriation progressive de
ce dispositif qui, parce qu’il s’inscrit dans une profonde évolu-
tion de la relation médecin-malade, nécessite formation et ap-
prentissage pour les professionnels et les usagers des soins ?
Après avoir présenté le dispositif juridique lui-même, nous
tenterons d’évaluer les directives anticipées – leurs bienfaits,
leurs limites, les différents risques qu’elles recouvrent – avant
d’envisager les évolutions souhaitables.
Le dispositif juridique
En France, les directives anticipées ont un statut légal
depuis la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits
des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti ». Elles s’ins-
crivent dans une évolution du droit médical qui renforce
les droits et l’autonomie des patients. Ce dispositif existe
dans de nombreux pays.
La loi du 2 mars 2002, dite « loi Kouchner », rappelle le prin-
cipe fondateur du consentement aux soins (1) et introduit
le droit du patient à l’information médicale dont dispose le
médecin – en particulier pronostique – indépendamment de
l’obtention d’un consentement. Elle évoque néanmoins le
devoir du médecin de prendre en compte la vulnérabilité du
patient dans la délivrance de l’information médicale. Elle
instaure aussi un droit à la désignation d’une « personne de
confiance », qui peut accompagner le patient tout au long de
son parcours pour l’aider dans sa prise de décision.

Éthique
LAENNEC N°3/2014
45
(2)
Article L. 1111-11 du code
de la santé publique.
(3)
Commission de réflexion sur la
fin de vie en France, Penser soli-
dairement la fin de vie, Rapport
à François Hollande, Président
de la République française,
18 décembre 2012.
http://www.elysee.fr/
communiques-de-presse/
article/rapport-de-la-commission
-de-reflexion-sur-la-fin-de-vie-
en-france/
La loi Leonetti, quant à elle, stipule que « toute personne
majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas
où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces
directives anticipées indiquent les souhaits de la personne
relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limi-
tation ou l’arrêt de traitement ». Le texte ne prévoit pas
d’associer la personne de confiance à l’élaboration des
directives anticipées.
Le dispositif prévu par la loi (2) est résumé dans l’encadré p. 46.
Les bénéfices du dispositif des directives
anticipées
Affirmer l’importance de la fin de vie
Le premier bénéfice du dispositif des directives antici-
pées est de souligner l’importance de la fin de vie. De fait, la
mort et la période de vie plus ou moins longue qui la précède
sont largement esquivées, refoulées, par nos sociétés occi-
dentales dites modernes. Parallèlement, la fin de vie tend à
être hyper-médicalisée et se déroule la plupart du temps à
l’hôpital, sans pour autant bénéficier de soins d’accompa-
gnement. La loi Leonetti s’est inscrite dans ce contexte de
médicalisation du mourir, avec une médecine centrée quasi
exclusivement sur les aspects curatifs et l’absence d’anti -
cipation de la fin de vie. Elle visait à stopper cette spirale in-
fernale vers une fin de vie à la fois volée et violente.
Dans un rapport publié en 2012, sept ans après la loi,
le Professeur Didier Sicard déplore encore cette absence
d’anticipation et la grande fréquence de décès, aux urgences,
de personnes dont la mort était prévisible : « On a cru au
pouvoir de la médecine comme on peut croire en Dieu. On
a oublié de penser sa propre finitude, au sens de la condition
humaine : naître et mourir. » (3)
La loi Leonetti mériterait d’être davantage portée à la connais-
sance du grand public, pour contribuer au développement
d’une « éducation à la mort » permettant à chacun de mieux
intégrer le risque mortel inhérent à notre humanité ; alors il
deviendrait possible de débattre sur les conditions de vie et
la place dans notre société des personnes atteintes de mala-
dies graves ou handicapantes, ou des personnes en fin de vie.

Éthique
LAENNEC N°3/2014
46
Directives anticipées : le dispositif
Conditions de validité :
- les directives anticipées sont établies moins de 3 ans avant l’état
d’inconscience de la personne ;
- elles sont rédigées sur un document écrit, daté et signé par leur
auteur, dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et
lieu de naissance ;
- une attestation médicale peut y être associée, constatant que leur
auteur est en état d’exprimer librement sa volonté et que le médecin
lui a délivré toutes les informations appropriées ;
- elles peuvent à tout moment être, soit modifiées partiellement ou
totalement, soit révoquées sans formalités ;
- leur durée de validité est de trois ans ;
- elles sont renouvelables par simple décision de confirmation signée
par leur auteur sur le document ;
- toute modification intervenue dans le respect de ces conditions
vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans.
Conditions de conservation et d’accessibilité :
- c’est au patient de faire connaître ses directives anticipées ;
- elles peuvent être conservées dans le dossier constitué par un méde-
cin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant de la personne ou d'un
autre médecin choisi par elle, ou dans le dossier médical hospitalier ;
- elles peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-
ci à la personne de confiance ou, à défaut, à un membre de sa fa-
mille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées
de la personne qui en est détentrice sont mentionnées dans le dos-
sier, sur indication de leur auteur.
Conditions d’applications :
- lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, ses
directives anticipées sont consultées avant la limitation ou l’arrêt de
traitement susceptible de mettre sa vie en danger, dans le cadre de la
procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale ;
- le médecin est tenu d’engager la procédure collégiale au vu des
directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs
de celles-ci ;
- lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection
grave et incurable et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné
une personne de confiance, l’avis de cette dernière prévaut sur tout
autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans
les décisions d’investigations, d’intervention ou de traitement prises
par le médecin.

Éthique
LAENNEC N°3/2014
47
(4)
Pennec S, Monnier A, Pontone S,
Aubry R “End-of-life medical
decisions in France: a death
certificate follow-up survey
5 years after the 2005 act of
parliament on patients’ rights
and end of life”, BMC Palliative
care, 2012; 11: 25.
Reconnaître l’importance du respect des souhaits du patient
La capacité d’anticipation vis-à-vis de la fin de vie n’est pas
une pure création juridique déconnectée des réalités hu-
maines. De nombreux patients, se sachant atteints d’une
maladie grave, incurable et mortelle à plus moins brève
échéance, adoptent des comportements particuliers leur
permettant de faire face à la fin de leur vie. Certains pren-
nent des dispositions personnelles, prévoient l’organisation
de leurs obsèques. D’autres désirent transmettre à leurs
proches des recommandations ou des souvenirs. D’autres
encore se proposent de réaliser un projet personnel qui leur
tient à cœur…
Le législateur a transposé cette capacité à prendre des dis-
positions ou à exprimer des volontés de nature privée et
intime dans le cadre médical. De fait, la question de la
volonté du patient est un élément central du processus dé-
cisionnel dans un modèle de relation médecin-malade où le
paternalisme n’est plus la référence. Mais cette place plus
grande attribuée au principe d’autonomie induit naturel-
lement la question du respect de la volonté du patient
lorsque celui-ci ne peut plus communiquer. Un autre
champ s’ouvre alors : celui de la volonté par anticipation
qui met en jeu la capacité d’une personne à énoncer – pour
une situation future plus ou moins connue – des volontés,
voire des décisions sur telle ou telle option thérapeutique
en situation de fin de vie.
Souligner l’impact des décisions de limitations de traitement
dans le processus de fin de vie
Selon une étude publiée dans BMC Palliative care (4), la fin
de vie est prévisible en France pour 83 % des patients ; 82 %
d’entre eux auront à prendre des décisions relatives à leur
santé : poursuite ou arrêt de traitements curatifs, traite-
ments de support (alimentation artificielle, transfusion san-
guine…), transfert en réanimation, moyens de soulagement
de la souffrance, lieu de soin. La médecine permet aujour-
d’hui à de nombreux patients atteints de maladies chro-
niques, graves et mortelles, de connaître une espérance de
vie prolongée grâce à divers traitement spécifiques ou de
support – ni futiles ni disproportionnés. La qualité de vie
ainsi obtenue est très variable mais le patient en est seul
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%