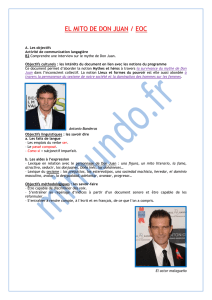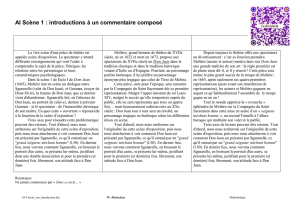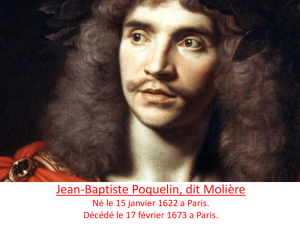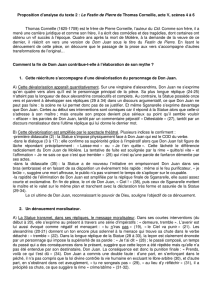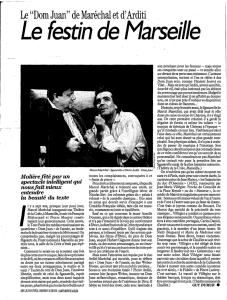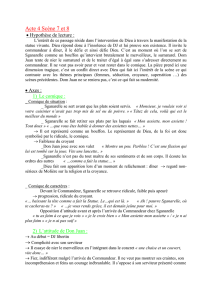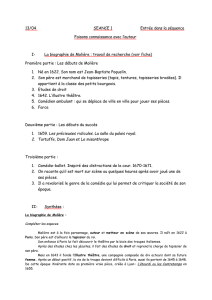DJ-baroque

Première
Dom Juan, la nuit des Rois et le baroque
Le mouvement baroque s’étend de la deuxième moitié du XVI’ siècle à la première moitié du XVII’
siècle. Dom Juan a été écrit en 1665 par Molière que l’on classe traditionnellement dans les écrivains du
classicisme. Nous allons montrer ici que la pièce comporte cependant de nombreux éléments baroques, qui
permettent le rapprochement avec le théâtre de Shakespeare.
Le mélange des registres.
La diversité baroque s'oppose à l'unité du théâtre classique qui est représenté par la tragédie d'une part, et la
comédie d'autre part : elles sont nettement différenciées, et selon la règle des trois unités, l'action unique qui
les caractérise doit se dérouler en vingt-quatre heures et en un seul lieu.
En l'occurrence, Molière intitule sa pièce comédie, mais il y mêle différents registres ; Elvire, par exemple, a la
dimension d'une héroïne de tragédie : elle appartient à la noblesse, elle inspire aux spectateurs un sentiment de
pitié mêlé d'admiration, elle est la victime impuissante des contradictions entre ses sentiments et ses obligations
religieuses, elle doit se soumettre à la fatalité que lui impose un mari irrémédiablement infidèle et impie. Don
Louis, quant à lui, ressemble aux pères que l'on rencontre dans les tragi-comédies : il est à la fois intransigeant
et généreux (comme Don Diègue dans Le Cid de Corneille).
De nombreuses scènes ont une tonalité comique mais traite de sujets graves!: on peut songer par exemple à la
démonstration ridicule de Sganarelle qui prouve l’existence de Dieu en III, 1.
Dans la nuit de rois, le mélange des registres est aussi présent comme nous l’avons vu: comique, lyrique, parfois
pathétique, fantastique...
Non-respect des règles du théâtre classique.
Par ailleurs, Molière exploite la liberté et la diversité du théâtre baroque lorsqu'il étale la durée de sa pièce sur
plus d'une journée (un jour entier plus la soirée du lendemain), plusieurs lieux, et ne respecte pas l'unité
d'action : l'intrigue de Dom Juan est formée d'une série de rencontres et d'événements souvent fortuits. Au
premier acte, Don Juan est poursuivi par Done Elvire ; au second acte, le libertin, après un naufrage, courtise
deux paysannes, et le thème de la poursuite est seulement repris dans la dernière scène de l'acte ; l'affaire
entre Elvire et Don Juan occupe deux scènes sur cinq dans le troisième acte, une scène sur huit dans le
quatrième acte et une scène sur six dans le cinquième acte. Quant à la rencontre avec la statue du
Commandeur, elle se situe seulement au troisième acte, et ne présente aucun rapport avec l'abandon d'Elvire.
(Attention: Shakespeare est antérieur et étranger à l’établissement de ses règles.)
Le spectaculaire.
Pour les décors et les costumes de Dom Juan, Molière s'inspire également de la mise en scène baroque qui
recherche l'ornement et la magnificence. Ainsi, chaque scène de la pièce se situe dans un cadre qui doit éblouir
le spectateur. Un programme publié après 1665 nous permet de relever les termes qui soulignent la splendeur
de ces décors :
Premier acte : l'ouverture du théâtre se fait par un magnifique jardin.
Deuxième acte : le théâtre de mer et de rochers succède au superbe palais du premier acte.
Troisième acte : un bois.
Quatrième acte : chambre aussi superbe qu'on puisse voir.
Cinquième acte : théâtre de statues à perte de vue.
Les costumes du protagoniste et de son serviteur sont en harmonie avec la féerie de ces décors. Ainsi l'habit
de Sganarelle s'inspire du costume de Scaramouche, mais le noir qui caractérise le vêtement du valet italien est
remplacé par un tissu de couleur flamme. Don Juan est vêtu comme un prince : à l'acte l, scène 2, les propos de
Sganarelle nous permettent d'apprécier l'importance que son maître accorde à la parure : « Pensez-vous que
pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien
doré, et des rubans couleur de feu [...] vous en soyez plus habile homme ? » À l'acte II, scène l, Pierrot dit à
Madame Potter-Daniau – année scolaire 2014-2015

Première
Charlotte en parlant du libertin : « Il faut que ce soit queuque gros, gros Monsieur, car il a du dor à son habit
tout depis le haut jusqu'en bas. »
Le changement de costume de certains personnages est à plusieurs reprises indiqué ou suggéré. Par exemple,
au début de l'acte III, Molière précise que Don Juan est maintenant en habit de campagne (costume de voyage),
et que Sganarelle est déguisé en médecin, et on peut supposer qu'à l'acte IV, Don Juan, de retour chez lui, porte
une tenue d'intérieur, et Sganarelle des vêtements de valet. À l'acte l, scène 3, Elvire apparaît en costume de
voyage, et à l'acte IV, scène 6, elle se voile pour rendre visite à Don Juan.
(Dans La nuit des rois le caractère spectaculaire naît surtout du mouvement, des changements de lieux, de la
complexité de l’intrigue, des déguisements, et de la révélation finale)
La métamorphose - L'illusion – le fantastique.
Les trucages produits par la machinerie, les effets d'ombre et de lumière, tous les procédés qui donnent aux
spectateurs l'illusion que le réel et le surnaturel se confondent, sont également des éléments baroques.
Ainsi, à l'acte III, scène 5, nous pénétrons avec Sganarelle dans le tombeau du Commandeur que Don Juan tua
en duel quelques mois plus tôt; à deux reprises, la statue qui représente le mort baisse la tête pour répondre à
l'invitation à dîner de Don Juan : « Demande-lui s'il veut venir souper avec moi!» dit le libertin en s'adressant à
son valet. « Ce serait être fou que d'aller parler à une statue!»répond Sganarelle. « Fais ce que je te dis!»
ajoute Don Juan. Sganarelle exécute l'ordre de son maître et l'homme de pierre acquiesce d'un signe de tête.
Dès la découverte de la statue, Sganarelle avait déjà noté: « Il jette des regards sur nous qui me feraient peur, si
j'étais tout seul.!»
La scène mêle le surnaturel à une plaisanterie : Don Juan se promène et il invite une statue à souper ; le
spectateur assiste en même temps que le libertin à la métamorphose de la statue ; l'illusion est renforcée par
l'atmosphère macabre du tombeau ; l'homme de pierre se transforme, il bouge, mais en même temps, c'est un
mort qui s'anime, qui ressuscite. Plus tard, à l'acte IV, scène 8, cette triple dimension baroque -métamorphose,
illusion, confusion totale entre l'imaginaire et la réalité- sera renforcée : la statue du Commandeur viendra dîner
chez Don Juan ; elle entrera dans la maison, marchera, parlera, repartira.
Enfin, à l'acte V, scène 6, la statue apparaît, parle, serre la main de Don Juan, et disparaît avec le libertin ;
l'intervention finale de la machinerie donne à la mort de Don Juan un caractère magique : « Le tonnerre
tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur Don Juan ; la terre s'ouvre et l'abîme ; et il sort de grands
feux de l'endroit où il est tombé." (Molière souligne l'aspect extraordinaire du spectacle par la répétition de «
grand ").
Dès l'acte V, scène 5, cette mort est d'ailleurs annoncée par une apparition : un spectre en femme voilée
apparaît, il s'exprime vraisemblablement avec la voix d'Elvire : « Je crois connaître cette voix!» déclare Don Juan
; le spectre se transforme ensuite pour représenter le Temps avec sa faux à la main ; puis il s'envole lorsque
Don Juan veut le frapper avec son épée.
(Dans La nuit de rois, le fantastique est beaucoup moins présent. Il n’y a aucun événement surnaturel. Mais le
thème de l’illusion est très exploité à travers notamment les jeux de masques et de changements d’identité.)
Le comédien Don Juan - l'hypocrite.
L'art baroque est également une vision théâtrale de la vie : toute démarche banale se transforme en geste de
parade, en acte d'ostentation, en situation spectaculaire. Ainsi Don Juan est un personnage baroque, car
parallèlement à sa dimension scénique spécifique (c'est un rôle qui est interprété sur scène par un acteur), il se
comporte à l'intérieur de la pièce de Molière comme le metteur en scène des autres personnages, ou comme
un comédien qui interprète un numéro de sa composition par exemple quand il fait l’hypocrite à l'acte V,
scènes 1 et 3. On retrouve ici la problématique baroque du theatrum mundi!: cette idée que la vie est une
illusion et que les hommes tiennent des rôles. Le vertige que provoque ces «!mises en scène!» qui se
superposent rend bien compte des interrogations baroques sur la fugacité de la vérité. On retrouve cette
dimension dans la nuit des rois.
Madame Potter-Daniau – année scolaire 2014-2015
1
/
2
100%