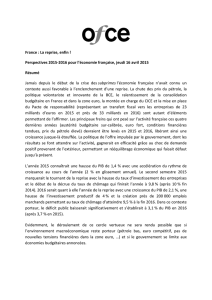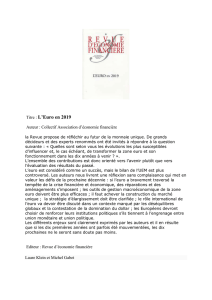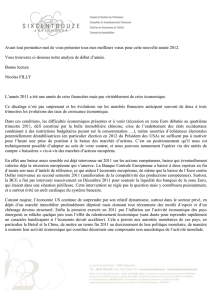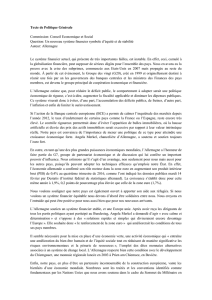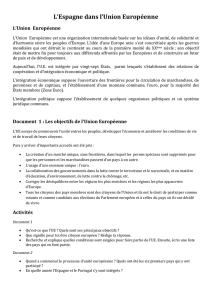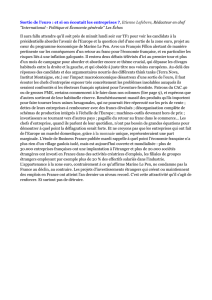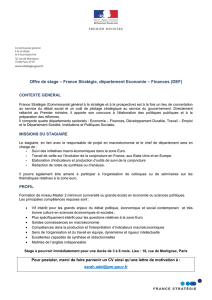Pourquoi l`Allemagne ne veut pas mutualiser la dette

Pourquoi l’Allemagne ne veut pas mutualiser la dette Européenne, et pourquoi
la France ne devrait pas le vouloir non plus.
par Hans-Werner Sinn*
Munich
26 Juillet 2012
La zone euro connaît actuellement une crise des plus sévères, et il n’est pas évident que tous
ses membres puissent s’y maintenir. Néanmoins, j’espère sincèrement voir l’euro perdurer,
car c’est un élément très important du projet de paix européen. Tout comme la France,
l’Allemagne est certes disposée à sacrifier une part significative de sa richesse pour préserver
la zone euro. Cependant, les sommes qu’on lui demande de mettre à disposition ne peuvent
être démesurées. Je crains parfois que hors de l’Allemagne, et entre autres en France, certains
ignorent les faits, le poids et les risques déjà assumés par la France et l’Allemagne. Cet article
tente de présenter aux lecteurs français les raisons pour lesquelles l’Allemagne est réticente à
l’élargissement des projets de mutualisation de la dette, à des niveaux tels que proposés par
François Hollande et d’autres représentants de l’UE. C’est aussi une mise en garde sur le fait
que le Président Hollande pourrait ne pas avoir pleinement informé les Français quant aux
risques encourus.
Pour convaincre l’Allemagne d’ouvrir les cordons de la bourse et de participer au sauvetage
des pays de l’Europe du sud, on a tenté d’argumenter un devoir moral, prétendant que
l’Allemagne était le principal bénéficiaire de l’euro. Cependant, cette assertion est un mythe
qui déforme la réalité. En effet, l’Allemagne a subi sa propre crise de l’euro car l’euro a
éliminé le risque de change pour ses partenaires de la zone et a dévié l’épargne allemande
vers d’autres pays européens, transitant souvent par la France, alimentant une longue
expansion inflationniste qui a eu pour conséquence l’élévation des niveaux de vie, des
salaires et des prix au-delà de l’équilibre fondamental.
Durant les années précédant la crise, deux-tiers de l’épargne allemande ont été exportés à
l’étranger et seul un tiers a été investi au pays alors que la reconstruction de l’Allemagne de
l’est nécessitait un gros effort d’investissement. Pendant de nombreuses années, l’Allemagne
a eu le taux d’investissement net le plus faible des pays de l’OCDE, et le taux de croissance
le plus bas d’Europe. De 1995, date où l’euro a été annoncé au sommet de Madrid, à 2007,
date où la crise américaine a commencé à s’étendre aux pays européens, le PIB par tête
allemand était tombé de la deuxième à la huitième place parmi les pays maintenant membres
de la zone Euro, alors même que l’immigration cessait et que le flux migratoire s’inversait. Il

aura fallu attendre une période récente, après le début de la crise, pour que l’Allemagne
retrouve à nouveau la septième place.
Le chômage massif qui résultait alors de la sortie des capitaux et culminait en 2005 a poussé
le gouvernement Schröder à mener des réformes sociales douloureuses qui ont privé des
millions de chômeurs allemands de leurs allocations, et Schröder de son poste à la
chancellerie.
Il est souvent mal compris que l’effondrement causé par la sortie des capitaux a donné
naissance à l’excédent de la balance courante pour lequel l’Allemagne est enviée, puisque par
définition une sortie nette de capitaux est identique à un surplus de la balance courante. C’est
la règle du capitalisme : si les capitaux quittent un pays A pour un pays B, le pays A connaît
un effondrement alors que B connaît un boom. Au pays B, les importations augmentent avec
l’accroissement des revenus, alors que la hausse des revenus mine la compétitivité de
l’industrie exportatrice. En revanche, au pays A, les importations chutent pendant que la
hausse du chômage ralentit la progression des salaires, stimulant les exportations.
L’Allemagne a souffert à l’instar du pays A, et les pays de l’Europe du sud ont joui d’une
situation similaire au pays B, bénéficiant d’un afflux de crédit. Peut-être que ceci peut aider à
expliquer pourquoi l’Allemagne est réticente à accepter les projets de mutualisation de la
dette. Avoir dû souffrir de ne pas avoir les capitaux pour créer des emplois chez eux, puis se
voir obligés de supporter en partie les pertes associées aux titres toxiques émis par les pays
du sud de l’Europe que détiennent les investisseurs internationaux : c’est un peu trop
demander aux Allemands pour qu’ils continuent à s’enthousiasmer pour l’euro.
Il est vrai que l’Allemagne a obtenu de meilleurs résultats en 2010 et 2011, l’épargne n’osant
plus quitter le pays. Après des années de stagnation dans le secteur de la construction et des
prix de l’immobilier en déclin, le pays a connu une amélioration provoquée par un boom de
l’investissement du même type que celui que les pays de la périphérie européenne avaient
connu quelques années auparavant, à la différence près qu’il s’agissait de son propre argent
plutôt que de celui d’épargnants d’autres pays. En revanche, deux années de succès modéré
ne sont pas grand-chose après dix ans de stagnation. En termes de croissance, depuis le
sommet de Madrid en 1995 à 2011, le taux de croissance allemand a été le deuxième plus
faible de tous les pays de la zone euro.

Cela ne signifie pas non plus que je veuille rejeter l’idée d’une mutualisation des risques au
sein de la zone Euro. Au contraire, je recommande fortement la création des États-Unis
d’Europe à l’image du modèle américain.
En revanche, pour y parvenir, les pays de la zone Euro doivent en premier lieu former une
seule et même nation, car seule une nation peut garantir à ceux qui donnent aujourd’hui d’être
eux-mêmes aidés s’ils venaient à être dans le besoin dans une centaine d’années. Une telle
nation nécessite une constitution, une superstructure légale commune, le monopole du
pouvoir pour assurer le respect de la loi et une armée commune pour la défense vers
l’extérieur. Sans une nation véritable, rien ne peut contrer les forces centrifuges que les
systèmes de redistribution produisent, forces qui mèneraient inévitablement à des éruptions
politiques promptes à menacer la stabilité du continent.
L’Union Européenne a joui d’une longue période de stabilité en s’abstenant de mettre en
place des politiques de redistribution interrégionales à grande échelle. Cette période prendra
fin si nous redistribuons les revenus ou la dette sans fonder des États-Unis d’Europe.
Malheureusement, aucune des conditions préalables à la constitution d’une nation ne sont
présentes en Europe aujourd’hui, et ne le seront pas dans un futur proche, du fait de la
réticence des pays de la zone euro, et surtout de la France, à abandonner en partie leur
souveraineté nationale.
Cependant, même une nation européenne ne devrait pas mutualiser la dette, leçon tirée de
l’expérience américaine au 19ème siècle, rien que cela.
Lorsque le secrétaire d’État au trésor, Alexander Hamilton, a mutualisé la dette de guerre des
états en 1792, il a renforcé l’attente d’une autre mutualisation ultérieure, ce qui a mené les
états à emprunter au-delà de leur capacité. Des tensions politiques s’ensuivirent dans les
premières décennies du 19ème siècle, lesquelles ont sévèrement menacé la stabilité de la
jeune nation.
Il a fallu que huit états fassent faillite dans les années 1830 et 1840 pour que les Etats-Unis
cessent de mutualiser leur dette, disposition qui perdure de nos jours. Personne ne suggère de
sauver la Californie au bord de la faillite, elle est censée trouver d’elle-même une solution, et

lorsque New York a déclaré faillite en 1975, la ville a dû s’engager à verser ses revenus
futurs aux banques.
Critiquer le sauvetage en général ne signifie pas que l’Europe doive rejeter tout programme
d’aide immédiat aux pays de l’Europe du sud touchés par la crise. Alors que l’aide à éviter
une insolvabilité est dangereuse, l’aide à surmonter de brèves crises de liquidité est justifiée
et doit être fournie. Dans son dixième rapport, l’EEAG, un think-tank de dimension
internationale qui dresse chaque année un tableau de l’économie européenne, a développé un
programme détaillé pour fournir une aide de liquidité dans les deux premières années d’une
crise, comprenant défauts sélectifs, en fonction de la maturité des titres, et mutualisation des
pertes excessives qui en découlent.
Cependant, voilà cinq ans déjà que l’Europe injecte généreusement des liquidités dans les
pays non compétitifs de la zone euro. Depuis fin 2007, la Banque Centrale Européenne a
apporté son aide en transférant à l’échelle internationale des crédits de refinancement, connus
aussi sous le nom de crédits TARGET, des pays du centre de l’Europe aux pays de la
périphérie. La banque centrale allemande, à elle-seule, a dû y contribuer à hauteur de 730
milliards d’euros. La totalité des déficits des balances courantes de la Grèce et du Portugal a
été financée de cette manière.
De plus, depuis mai 2010, plus de 200 milliards d’euros en titres publiques ont été achetés par
la Banque Centrale Européenne, tandis que près de 400 milliards d’euros ont été apportés par
les programmes de sauvetage intergouvernementaux et par le FMI. Et si l’on ajoute à cela le
nouveau fond de sauvetage européen MES et l’aide promise par le FMI, on obtient un total
d’environ 2 200 milliards d’euros dont la part du lion devra être apportée par l’Allemagne.
Il est tout bonnement injuste de la part du président Obama et d’autres critiques d’enjoindre
l’Allemagne d’assumer encore plus de risque, supposant implicitement que le pays n’en a
pris aucun jusqu’ici. Si tous les fonds de sauvetage sons employés et si la Grèce, l’Irlande,
l’Italie, le Portugal et l’Espagne viennent à faillite, ne remboursent rien et quittent la zone
euro, mais que l’euro continue d’exister, l’Allemagne perdrait 771 milliards d’euros sous les
traités adoptés à ce jour. Cette somme équivaut à 30 pourcent de son PIB actuel.

Les lecteurs français devraient être conscients du fait que le risque français est également de
taille. Si l’euro survit en tant que tel malgré les faillites et les sorties des pays, la France aurait
à supporter une perte de 579 milliards d’euros ou 29 pourcent de son PIB. Les États-Unis
ont-ils déjà encouru un tel risque en aidant d’autres pays ?
Un récapitulatif des calculs est présenté dans le diagramme joint. Le détail des calculs est
consultable sur le site de l’Ifo Institute (www.ifo.de).
Les pertes potentielles seraient plus élevées si les pays en crise restaient dans la zone euro
car, en plus des crédits supplémentaires de refinancement de la BCE (mesurés par les
positions TARGET), les pays restant dans la zone Euro devraient aussi prendre en compte
que les crédits de refinancement ordinaires ne pourraient pas être honorés non plus, du fait
que les garanties des créanciers privés et publics déposées par les banques commerciales
auprès de leurs banques centrales perdraient leur valeur. Dans ce cas, les pertes pour
l’Allemagne et la France pourraient s’accroître à 811 et 610 milliards, respectivement.
Cependant, ces chiffres ne doivent pas être interprétés par le lecteur comme des prévisions.
Ils ne font que quantifier le potentiel de risque et ils font abstraction des risques non-
monétaires. Ils ne faut pas leur faire dire non plus que la France et l’Allemagne ne devraient
pas fournir d’aide en termes de liquidité. Néanmoins, il est temps de considérer les
proportions et de comprendre les montants qui sont en jeu.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%