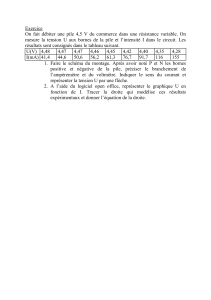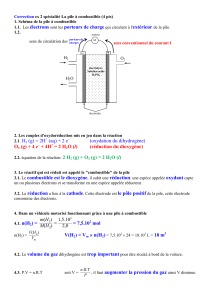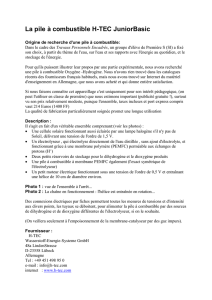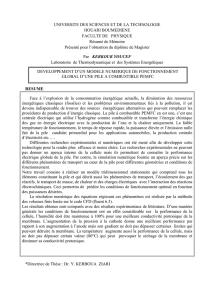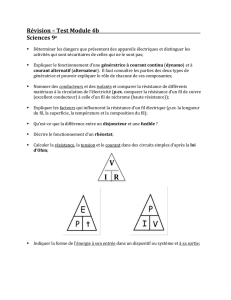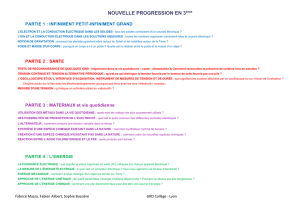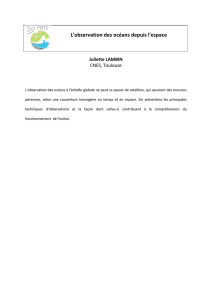TSS-01 Cours

TS - spécialité www.pichegru.net 7 septembre 2016
-1-
1
èRE
Partie : L’eau
Plan du chapitre
Rappels
Masse, volume et quantité de matière
Quelques formules de mathématiques
Oxydoréduction
Solubilité et précipitation
Rendement énergétique
Énergie et puissance
Eau et climat
Circulation océanique
Océans et CO
2
Climat et érosion
Pollution de l’eau
Principaux polluants chimiques
Surveillance
Lutte contre la pollution
L’eau et ses ressources
Production d’eau potable
Traitement des eaux
Les ressources des océans
L’eau vecteur énergétique
Principe de fonctionnement d’une pile
Pile à combustible
Production de H
2
Le H
2
comme source d’énergie
R
R
Ra
a
ap
p
pp
p
pe
e
el
l
ls
s
s
M
Ma
as
ss
se
e,
,
v
vo
ol
lu
um
me
e
e
et
t
q
qu
ua
an
nt
ti
it
té
é
d
de
e
m
ma
at
ti
iè
èr
re
e
m : la masse d’un échantillon de corps pur
M : la masse molaire d’un corps purs
n : la quantité de matière d’un corps pur
n
S
: la quantité de matière d’un soluté
V
S
: le volume d’une solution
V : le volume d’un échantillon quelconque
C : la concentration en soluté d’une solution
ρ
: la masse volumique d’un échantillon
d : la densité d’un échantillon liquide ou solide
V
M
: le volume molaire d’un gaz
Relations à savoir
m = n · M n
S
= C · V
S
m =
ρ
· V d =
ρ
/
ρ
eau
V = n · V
M
(gaz)
Q
Qu
ue
el
lq
qu
ue
es
s
f
fo
or
rm
mu
ul
le
es
s
d
de
e
m
ma
at
th
hé
ém
ma
at
ti
iq
qu
ue
es
s
Cercle et arc de cercle
Dans toutes ces formules, R est le rayon du cercle ou de la sphère.
Longueur d’un arc de cercle :
ℓ
= R·
θ
Surface d’un cercle : S = π·R
2
Surface d’une sphère : S = 4π·R
2
Volume d’une sphère : V = 4/3·π·R
3
Volume d’une forme droite quelconque
Une forme droite est une superposition verticale d’une superposition de
surfaces S qui ont toujours la même forme, sur une hauteur h.
V = S·h
O
Ox
xy
yd
do
or
ré
éd
du
uc
ct
ti
io
on
n
Couple oxydant / réducteur
Oxydant : entité capable de gagner des e
–
Réducteur : entité capable de céder des e
–
Couple rédox : noté Ox / Réd (exemple : ClO
–
/Cl
–
)
Réactions d’oxydoréduction
Oxydation : perte d’e
–
(Anode)
Réduction : gain d’e
–
(Cathode)
Demi-réaction rédox Ox + n e
–
= Réd
Pour équilibrer, on peut ajouter H
2
O et H
+
si nécessaire. Les charges
doivent également être équilibrées.
ClO
–
+ 2 e
–
+ 2 H
+
= Cl
–
+ H
2
O
Réaction d’oxydoréduction
Réaction entre un oxydant (oxyde / est réduit) et un réducteur (réduit / est
oxydé).
Oxydant + n e
–
→ Réducteur
Réducteur → Oxydant + n e
–
Équation bilan d’oxydoréduction
Associer des 2 demi-réactions : il doit y avoir autant d’e
–
dans chacune
→ il faut parfois multiplier une demi-équation par un certain facteur pour
que ce soit le cas.
S
So
ol
lu
ub
bi
il
li
it
té
é
e
et
t
p
pr
ré
éc
ci
ip
pi
it
ta
at
ti
io
on
n
La solubilité d’une espèce est la quantité de matière (ou la masse)
maximale d’une espèce chimique que l’on peut dissoudre dans un solvant
donné, à une température donnée.
La solubilité peut être très variable d’un soluté à l’autre dans un même
solvant, ou d’un solvant à l’autre, pour un même soluté :
Dans l’eau à 25 °C : s
NaCl
= 357 g·L
-1
, s
AgCl
≈ 0,5 mg·L
-1
Dans l’éthanol à 25 °C : s
NaCl
= 0,51 g·L
-1
La précipitation d’une espèce est le passage de l’état dissous à l’état
solide de cette espèce au sein du solvant.
Une précipitation peut être due à plusieurs changements de conditions :
• Diminution de la quantité de solvant (par évaporation)
• Variation du pH
• Variation de la température du mélange
• Formation de l’espèce qui précipite en quantité suffisante pour que le
seuil de solubilité soit dépassé.
R
Re
en
nd
de
em
me
en
nt
t
é
én
ne
er
rg
gé
ét
ti
iq
qu
ue
e
Le rendement énergétique d’un dispositif ou d’un procédé (pile, réaction
chimique, moteur, etc.) est défini par :
reçue intéresse nous qui produite E
E
=
η
É
Én
ne
er
rg
gi
ie
e
e
et
t
p
pu
ui
is
ss
sa
an
nc
ce
e
L’unité SI de l’énergie est le J.
Il en existe d’autres, couramment utilisées : la calorie (cal), le watt-heure
(W·h) et la tonne-équivalent-pétrole (TEP).
La puissance est un débit d’énergie (consommé ou reçue), c'est-à-dire un
nombre de joule par seconde (1 W = 1 J·s
-1
)
E
E
Ea
a
au
u
u
e
e
et
t
t
c
c
cl
l
li
i
im
m
ma
a
at
t
t
Mers ; océans ; climat ; traceurs chimiques.
Le climat de la Terre
C
Ci
ir
rc
cu
ul
la
at
ti
io
on
n
o
oc
cé
éa
an
ni
iq
qu
ue
e
Les
grands courants océaniques
contribue à diminuer les différences de
température entre les pôles et l’équateur. Ce sont des régulateurs du climat.
Leur étude est donc indispensable pour comprendre le
climat
.
Ces courants sont dus à des différences de densité des grandes masses
d’eau. La
salinité
et la
température
de l’eau de mer sont les deux facteurs
ayant une influence sur sa densité.
Pour étudier les courants marins, les océanographes utilisent des
traceurs
chimiques
. Ce sont des espèces chimiques dont la concentration peut être
déterminée.
Circulation thermohaline en aquarium
S
h
θ
ℓ
R

TS - spécialité www.pichegru.net 7 septembre 2016
-2-
Modélisation de la circulation thermohaline
Circulation thermohaline et climat
Le Gulf Stream
TP 1.1 : Détermination de la salinité d’une eau de
mer
Objectif : Déterminer la salinité d’une eau de mer
Technique(s) : Dilution, mesure de conductivité
Démarche : À partir d’une solution de chlorure de sodium de
concentration 1,0·10
-2
mol·L
-1
, on trace la droite d’étalonnage reliant la
conductivité
σ
à la concentration en chlorure de sodium c. Puis on dilue
l’eau de mer 100 fois afin d’avoir une conductivité attendue compatible
avec la droite d’étalonnage. On mesure la conductivité de l’eau de mer
diluée et on remonte à la concentration de l’eau de mer.
Exercice 1 La salinité pour surveiller les océans
Exercice 2 Traceurs océaniques
Exercice 3 L’Océan Arctique et l’Atlantique Nord
O
Oc
cé
éa
an
ns
s
e
et
t
C
CO
O
2
2
Les activités humaines rejettent une grande quantité de CO
2
(utilisation des
combustibles fossiles). Les mers et océans en absorbent environ 30 %,
ce qui contribue à diminuer l’impact de ce gaz sur le climat (effet de
serre).
La dissolution du CO
2
dans l’eau en diminue le pH. On parle de
l’acidification des océans.
CO
2
+ 2 H
2
O H
3
O
+
+ HCO
3–
Cette acidification a un impact sur l’écologie des océans, perturbant
gravement les écosystèmes.
De plus, quand la température de l’eau augmente, les gaz y sont moins
solubles. Le réchauffement climatique entraîne donc une diminution
de l’absorption du CO
2
par les océans. Ceci a pour conséquence une
aggravation de l’effet de serre.
C
Cl
li
im
ma
at
t
e
et
t
é
ér
ro
os
si
io
on
n
Érosion ; dissolution ; concrétion.
L’érosion de certains minéraux par l’eau entraîne une consommation du
CO
2
atmosphérique, diminuant sa teneur dans l’atmosphère et donc l’effet
de serre.
Exercice 4 Le cycle de l’eau et le CO
2
atmosphérique
P
P
Po
o
ol
l
ll
l
lu
u
ut
t
ti
i
io
o
on
n
n
d
d
de
e
e
l
l
l’
’
’e
e
ea
a
au
u
u
Surveillance et lutte physico-chimique contre les pollutions ; pluies
acides.
P
Pr
ri
in
nc
ci
ip
pa
au
ux
x
p
po
ol
ll
lu
ua
an
nt
ts
s
c
ch
hi
im
mi
iq
qu
ue
es
s
Nitrates et phosphates
NO
3–
et PO
43–
. Ces ions existent naturellement mais l’agriculture
intensive génèrent des apports massifs de ces ions (fertilisants). Effets
néfastes sur la santé lorsqu’ils sont présents en quantité importante dans
l’eau de consommation. Responsable de l’eutrophisation des milieux
aquatiques (développement excessifs de certaines algues due à une
abondance de nutriments, au détriment d’autres espèces).
Espèces chimiques organiques
Pesticides, médicaments, polychlorobiphényles (PCB, utilisé dans les
installations électriques jusqu’en 1987), marée noire, plastiques. Elles sont
issues de l’industrie, de l’agriculture intensive et des rejets ménagers.
Les molécules organiques biodégradables consomme généralement du O
2
lors de leur dégradation, ce qui asphyxie les espèces aquatiques. Certaines
molécules organiques sont toxiques (perturbation de la reproduction,
baisse de l’efficacité du système immunitaire ou toxicité plus aiguë
encore).
Métaux lourds
Plomb, mercure, arsenic, cuivre, zinc, cadmium... Ils sont produits par de
nombreuses activités humaines (métallurgie, incinérateur d’ordure,
activité minière). Ils sont tous très toxiques. Ils s’accumulent dans les
organismes.
Espèces acides
Ces espèces chimiques acidifie l’eau (SO
2
, NO
2
, etc). Elles sont produites
par les industries et les activités minières. La baisse du pH de l’eau
(pluies acides, lacs) a un impact sur la biodiversité, voire peut empêcher
la vie selon le degré d’acidité.
Acid Rain
Voir un TP sur dosage du dioxyde de soufre pour 2017 ? →
pas sûr de la pertinence...
S
Su
ur
rv
ve
ei
il
ll
la
an
nc
ce
e
Des normes visant à limiter la pollution sont régulièrement mises en place.
Elles sont accompagnées de contrôles nécessitant la mise au point
d’analyse et de détection des polluants.
L
Lu
ut
tt
te
e
c
co
on
nt
tr
re
e
l
la
a
p
po
ol
ll
lu
ut
ti
io
on
n
Un des objectifs de la chimie actuelle est de lutter contre la pollution. Cela
peut se faire de deux manières :
Guérir : Mise au point de traitement de décontamination d’un milieu
Prévenir : Développer des méthodes de production moins polluants (choix
des solvants, rendement des réactions, produits secondaires).
TP 1.2 : Traitement d’une pollution aux métaux
lourds
Objectif : Éliminer le manganèse contenu dans une solution de
permanganate de potassium.
Démarche : réduire les ions permanganate MnO
4–
en ions manganèse (II)
Mn
2+
, afin de pouvoir les faire précipiter en milieu basique. Filtrer le
précipité, neutraliser le filtrat avec de l’acide pour pouvoir le jeter à
l’évier.
La pollution de l’eau (C’est pas sorcier)
Exercice 5 Les algues vertes
Exercice 6 Pollution au plomb
Annales
« Eau potable ou non ? »
L
L
L’
’
’e
e
ea
a
au
u
u
e
e
et
t
t
s
s
se
e
es
s
s
r
r
re
e
es
s
ss
s
so
o
ou
u
ur
r
rc
c
ce
e
es
s
s
Production d’eau potable ; traitement des eaux.
Ressources minérales et organiques dans les océans ; hydrates de gaz.
P
Pr
ro
od
du
uc
ct
ti
io
on
n
d
d’
’e
ea
au
u
p
po
ot
ta
ab
bl
le
e
L’eau potable est tirée des eaux de surface ou des eaux souterraines.
Des normes régissent les teneurs maximales des espèces dissoutes et la
quantité de bactéries admissibles. Elle est donc traitées avant d’être
distribuée.
La dureté d’une eau dépend de sa teneur en ions calcium et magnésium.
Ces ions ne sont pas toxiques, mais une concentration élevée peut entraîner
des désagréments comme une diminution de la durée de vie des machines
à laver (formation de calcaire lorsque l’eau est chauffée ou lorsqu’elle
s’évapore).
Le traitement de l’eau avant distribution
TP 1.3 : Dureté d’une eau
Objectif : Doser les ions Ca
2+
et Mg
2+
dans une eau du robinet, pour en
déterminer sa dureté
Démarche : Déterminer la concentration d’un eau en ions Ca
2+
et Mg
2+
grâce à un dosage par l’EDTA. L’indicateur de fin de réaction est le NET.
T
Tr
ra
ai
it
te
em
me
en
nt
t
d
de
es
s
e
ea
au
ux
x
Les eaux usées sont rejetées dans la Nature, après un traitement destiné à
les dépolluer.
Quelques exemples de ces traitements bio-physico-chimiques
• Dégrillage : une filtration grossière pour éliminer les gros déchets.
• Décantation : élimine les polluants non solubles (sable, graisses, boues).
• Floculation : fait précipiter certains polluants présents à l’état de
particules de très petites dimensions, qui mettraient autrement beaucoup de
temps à décanter.
• Traitement biologique : des bactéries consomment les matières
organiques (sucres)

TS - spécialité www.pichegru.net 7 septembre 2016
-3-
L’assainissement des eaux usées
TP 1.4 : Filtration au charbon actif
Problématique : Quelle est l’efficacité du charbon actif dans la filtration
de certaines molécules ?
Démarche : Mesurer l’absorbance d’une solution de colorant alimentaire
avant et après filtration au charbon actif, dans différentes conditions.
L
Le
es
s
r
re
es
ss
so
ou
ur
rc
ce
es
s
d
de
es
s
o
oc
cé
éa
an
ns
s
Les océans constituent des réserves très importantes de ressources
minérales (métaux) et organiques (pétrole, mais aussi molécules
thérapeutiques découvertes grâce à l’étude de la flore et de la faune
marine). La majorité de ces réserves n’est pas exploitée.
Parmi ces réserves, les hydrates de méthane attisent les convoitises,
même si leur extraction est trop difficile pour être rentable actuellement.
Ces hydrates de méthane pourraient également être libérés massivement à
cause du réchauffement de l’océan, et provoquer ainsi un emballement du
climat.
Methane Hydrate (University Austin Texas)
Exercice 7 Hydrate de méthane
L
L
L’
’
’e
e
ea
a
au
u
u
v
v
ve
e
ec
c
ct
t
te
e
eu
u
ur
r
r
é
é
én
n
ne
e
er
r
rg
g
gé
é
ét
t
ti
i
iq
q
qu
u
ue
e
e
Piles à combustible
Production de dihydrogène
P
Pr
ri
in
nc
ci
ip
pe
e
d
de
e
f
fo
on
nc
ct
ti
io
on
nn
ne
em
me
en
nt
t
d
d’
’u
un
ne
e
p
pi
il
le
e
Une pile électrique, couramment appelée « pile », est un dispositif
électrochimique qui convertit l’énergie chimique en énergie électrique
grâce à une réaction chimique d’oxydoréduction.
Les réactifs ne sont pas directement en contact, mais réagissent par
échange d’électrons à travers le circuit électrique que la pile alimente. Un
pont ionique permet également l’échange de charges, de manière à
compenser le déséquilibre de charges induit par l’échange d’électrons
entre les réactifs. Toutes les piles et batteries fonctionnent sur ce principe,
sans aucune exception.
P
Pi
il
le
e
à
à
c
co
om
mb
bu
us
st
ti
ib
bl
le
e
Une pile contient une certaine quantité de réactifs. Lorsque ceux-ci ont
réagi, la pile est épuisée est doit être recyclée.
Les accumulateurs électrochimiques, appelés « batteries ou piles
rechargeables », fonctionnant grâce aux réactions électrochimiques de
leurs électrodes, qui assurent la conversion de l’énergie électrique en un
processus chimique réversible.
Une batterie est un ensemble de piles ou d’accumulateurs
électrochimiques associés de façon à avoir la tension désirée.
Une pile à combustible est une pile que l’on peut « recharger » par ajout
direct de réactifs, sous forme liquide ou gazeux. Elle a l’avantage, par
rapport à une pile rechargeable classique, de pouvoir être rechargée très
rapidement, puisqu’il suffit de refaire « le plein » de réactifs.
Fonctionnement d’une pile à combustible
P
Pr
ro
od
du
uc
ct
ti
io
on
n
d
de
e
H
H
2
2
Le dihydrogène n’existe pas sur Terre à l’état natif. Il faut le fabriquer, par
électrolyse de l’eau :
2H
2
O → 2H
2
+ O
2
Cette réaction n’est pas spontanée ! Elle nécessite un apport d’énergie.
Il existe d’autres moyens de fabriquer du H
2
, notamment par
transformation chimique de la biomasse.
Le dihydrogène est un vecteur d’énergie : il est capable de restituer une
grande partie de l’énergie qui a été nécessaire à sa production, par
combustion avec le dioxygène :
2H
2
+ O
2
→ 2H
2
O
Cette réaction est fortement exothermique.
Le dihydrogène n’est donc pas une source d’énergie primaire, puisqu’il
n’existe pas de « gisements » de dihydrogène sur Terre. Il ne peut être
qu’un moyen de la stocker.
Son avantage est que sa combustion ne produit que de l’eau. Mais il est
difficile à stocker : c’est un gaz, qui ne peut être liquéfié qu’à très haute
pression (350 bars) ou à très basse température (-250 °C).
D’autres voies que l’électrolyse de l’eau, pour la production de H
2
, sont
explorées, notamment la production par des algues monocellulaires
génétiquement modifiée, qui produiraient du H
2
à partir de l’eau par
photosynthèse.
L
Le
e
H
H
2
2
c
co
om
mm
me
e
s
so
ou
ur
rc
ce
e
d
d’
’é
én
ne
er
rg
gi
ie
e
Le dihydrogène produit de l’énergie par combustion avec le dioxygène.
Cette combustion peut être directe. Dans ce cas, le dihydrogène réagit
avec le dioxygène dans un moteur thermique « classique ».
Mais il peut également réagir avec le dioxygène dans une pile à
combustible. Le rendement énergétique est alors meilleur. Mais le
dispositif est technologiquement plus compliqué à produire, et son
fonctionnement n’est pas encore pleinement satisfaisant (durabilité du
« pont ionique »).
Production de H
2
et pile à combustible
1
/
3
100%