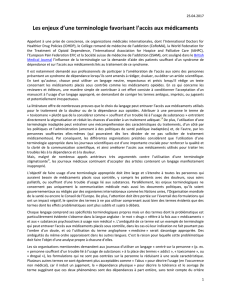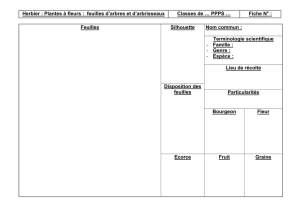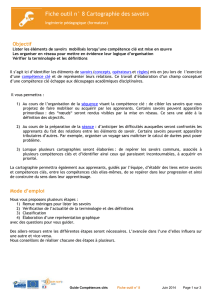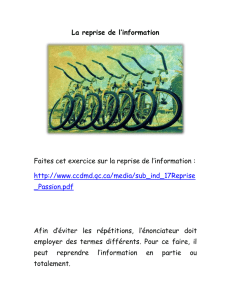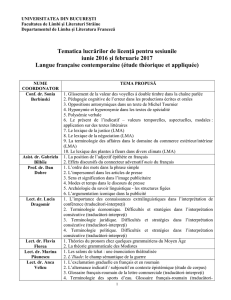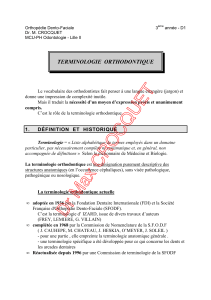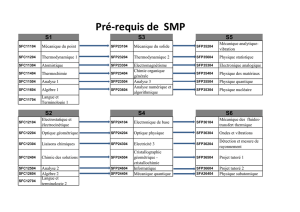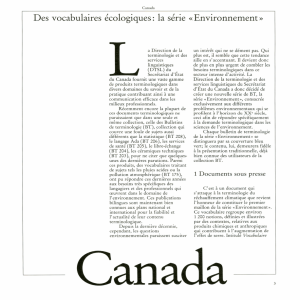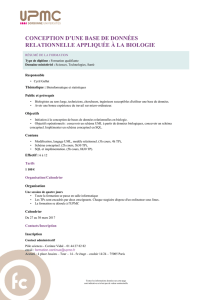La rédaction de définitions terminologiques

LA RÉDACTION DE DÉFINITIONS TERMINOLOGIQUES
La rédaction
de dénitions
terminologiques
Oce québécois
de la langue française
2009

2
Vézina, Robert
La rédaction de dénitions terminologiques / Robert Vézina... [et autres],
version abrégée et adaptée par Jean Bédard et Xavier Darras.
[Montréal] : Oce québécois de la langue française, [2009].
Comprend des réf. bibliogr.
ISBN 978-2-550-55484-4
1. Rédaction – Terminologie. 2. Art d’écrire I. Bédard, Jean. II. Darras,
Xavier. III. Oce québécois de la langue française. IV. Titre
808.02 PN 160

3
Robert Vézina, Xavier Darras, Jean Bédard et Micheline Lapointe-Giguère
Cette publication est une synthèse d’un document à
paraître de l’Oce québécois de la langue française, intitulé
La dénition terminologique : réexions, propositions et conventions
(Robert Vézina, coordonnateur, Xavier Darras, Jean Bédard
et Micheline Lapointe-Giguère).
Version abrégée et adaptée par Jean Bédard et Xavier Darras
Oce québécois de la langue française
Conventions :
1) Les mots-clés, notamment les entrées du glossaire lorsqu’elles
sont mentionnées pour la première fois, et les passages indiquant
une formulation jugée adéquate dans les exemples sont en
caractères gras.
2) Les passages jugés insatisfaisants dans les exemples
sont soulignés.
3) Les domaines d’emploi sont mentionnés entre chevrons;
lorsqu’il y a un domaine et un sous-domaine, les deux éléments
sont séparés par une barre oblique. Lorsqu’il y a plusieurs
domaines, ils sont séparés par une virgule.
4) Les termes sont en italique, les concepts, entre guillemets.
5) Les interventions des auteurs dans une citation ou un exemple
sont entre crochets.
La rédaction
de dénitions
terminologiques

4
Table des matières
Préambule .................................................................................................................... 5
I. La dénition en lexicographie et en terminologie................................. 5
II. Que dénit-on : un concept ou un terme? ............................................... 6
III. Types de dénitions .......................................................................................... 7
IV. Éléments constitutifs d’une dénition terminologique ....................... 8
1. Domaine ........................................................................................................... 8
2. Dénisseur initial ........................................................................................... 8
3. Caractères ......................................................................................................... 11
V. Principes dénitoires ........................................................................................ 12
1. Principe de concision (PC) .......................................................................... 12
2. Principe de clarté (PCL) ................................................................................ 12
3. Principe d’explicitation et d’adéquation (PEA) .................................... 13
4. Principe de substitution (PS) ..................................................................... 14
5. Principe de non-tautologie (PNT) ............................................................ 15
6. Principe de généralisation et d’abstraction (PGA) ............................. 15
7. Principe d’adaptation aux groupes cibles (PAG) ................................ 15
8. Principe de prévisibilité (PP) ...................................................................... 16
VI. Règles ..................................................................................................................... 16
Règles d’ordre général ...................................................................................... 17
Règles relatives au domaine et au sous-domaine .................................. 20
Règles relatives au dénisseur initial .......................................................... 21
Règles relatives aux caractères dénitoires .............................................. 27
En conclusion .............................................................................................................. 34
Glossaire ........................................................................................................................ 35
Bibliographie .............................................................................................................. 41

5
Préambule
Ce document se veut un outil pratique et accessible pour quiconque a
le souci de rédiger une dénition dans le respect des règles fondamen-
tales de la terminologie. Il s’adresse d’abord aux langagiers, mais toute
personne qui veut constituer un vocabulaire thématique contenant des
dénitions y trouvera son compte. An de servir un plus large éventail
d’utilisateurs que les seuls spécialistes de la langue, un glossaire rassem-
blant les principaux concepts du métalangage utilisé pour parler de la
dénition terminologique est joint à ce document. Toutefois, la partie
qui intéressera au premier chef le praticien est sans doute celle qui re-
cense quelques règles particulières que nous lui suggérons d’observer.
Ces règles s’appuient sur des principes de base issus de l’analyse d’un
large corpus de divers écrits scientiques produits par des spécialistes
du domaine, sur un travail de réexion original d’un comité établi à cette
n, ainsi que sur la longue expérience pratique acquise par les terminolo-
gues de l’Oce québécois de la langue française. Nous commencerons par
énoncer les éléments fondamentaux qui distinguent la dénition qu’on
associe généralement à la lexicographie de la dénition terminologique,
puis nous examinerons les composantes propres à cette dernière. À cet
égard, un premier constat s’impose. Selon le type d’ouvrage de référence
qu’on consulte an de connaître le ou les « sens » d’un mot, d’un terme
ou d’une expression, des similitudes apparaissent, mais les diérences
sont plus frappantes encore. Il y a donc dénition et… dénition.
La dénition en lexicographie et en terminologieI.
On constate aisément que les dénitions (de « mots ») qu’on trouve dans
les dictionnaires de langue générale et celles (de « termes ») qui gurent
dans les dictionnaires spécialisés – lesquels n’intègrent pas, en principe,
le vocabulaire propre à la langue courante – partagent plusieurs caracté-
ristiques quant au fond (par exemple, la dénition par compréhension
est privilégiée tant en terminologie qu’en lexicographie) et à la forme
(les deux types de dénitions tiennent en une seule phrase, le déni
ne doit pas y gurer, etc.). En somme, on peut dire que la dénition,
tant dans un ouvrage terminologique que dans un ouvrage lexicogra-
phique, permet d’expliciter le sens d’une unité ou d’un groupe d’unités
signi antes. La pratique de la dénition en terminologie se distingue
cependant de celle qui est généralement adoptée par les lexicographes,
notamment au regard de sa nalité, en ce qui concerne l’« objet » à
dénir et quant aux procédés employés. Pour cette raison, on peut certes
qualier une dénition de terminologique et la distinguer de la dénition
dite lexicographique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
1
/
44
100%