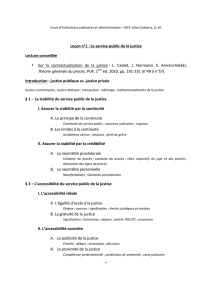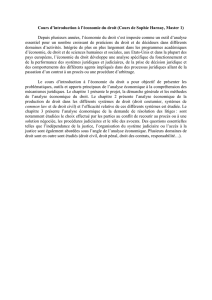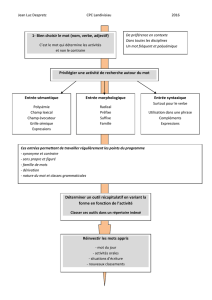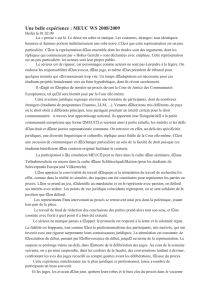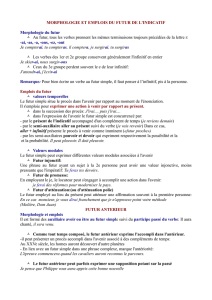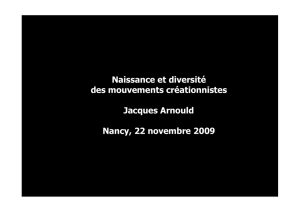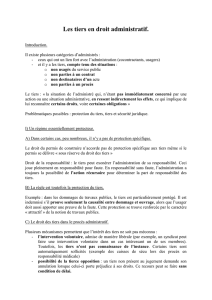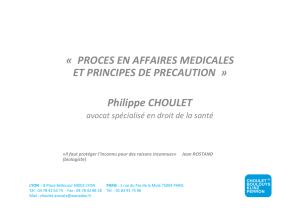Les marqueurs linguistiques de la présence de l`auteur

Gledhill, Christopher (2009b). Vers une analyse systémique
fonctionnelle des expressions verbo-nominales. Dans David
Banks, Simon Easton & Janet Ormrod (réds.), La
Linguistique systémique fonctionnelle et la langue
française. Paris : L’Harmattan. pp 89-126. (PDF)
Vers une analyse systémique fonctionnelle des expressions
verbo-nominales
Christopher GLEDHILL
Université March Bloch, Strasbourg
I. Introduction
Les expressions verbo-nominales (VN) constituent une catégorie de
constructions dont les exemples suivants sont assez représentatifs:
avoir besoin, faire son boulot, mettre un bémol, porter bonheur, prendre son bain.
Toutes ces constructions comportent un verbe (V) denotant un procès
générique et un nom (N) précisant la Portée1 sémantique de l’expression
(Banks 2000, Gledhill 2007). Mais si ces expressions se ressemblent sur
le plan sémantique, elles ont des propriétés syntaxiques assez différentes.
Les expressions VN sont souvent apparentées à des V simples (prendre
un bain : se baigner, mettre un bémol : bémoliser), mais pas toujours
(avoir besoin : ?besogner, faire du boulot : ?boulotter, porter bonheur :
??). Certaines expressions VN permettent le passif (mon boulot est fait),
tandis que d’autres y résistent (?un bémol a été mis). De même, certaines
constructions VN permettent la commutation du V (faire son bonheur :
trouver son bonheur), tandis que d’autres ne permettent qu’un seul V
1 Les termes appartenant spécifiquement au modèle systémique fonctionnel (Halliday
1985, Halliday & Matthiessen 2004) sont marqués ici par une majuscule.

(mettre un bémol : ?donner un bémol). Enfin, certaines constructions
permettent plusieurs types de modification du N (avoir des besoins, faire
des petits boulots), tandis que d’autres n’en permettent aucune (porter ?
des bonheurs).
Est-il possible, ou même souhaitable, de postuler une seule catégorie
pour ces expressions? En effet, beaucoup de linguistes considèrent qu’il
est nécessaire d’établir plusieurs catégories lexicales intermédiaires.
C’est notamment le cas de la grammaire générative, qui propose la
catégorie de ‘prédicat léger’ par rapport au ‘prédicat nominal’ (Björkman
1978, Kearns 1989). D’autres soulignent les rapports réciproques entre
les constructions à ‘verbe support’ et leurs verbes simples équivalents. Ils
parlent ainsi de ‘constructions converses’ (Gross 1989, 2005), ou ‘verbes
étendus’ (Allerton 2002).
Ici, nous nous proposons de démontrer que ces analystes sont allés
trop loin. En effet, il n’y a aucune propriété syntaxique qui rende
l’ensemble ou même une partie de ces expressions uniques par rapport
aux autres co-occurrences VN que l’on peut trouver en français.
Néanmoins, nous n’avons pas l’intention de suivre Pottelberge (2000),
qui renonce à toute caractérisation. Notre but est de présenter plutôt un
système d’analyse global des constructions VN du point de vue de la
grammaire systémique fonctionnelle. Nous proposons d’analyser les
expressions VN au même titre que toute séquence VN, à condition de
rendre compte de trois facteurs :
a) la fonction syntaxique du groupe verbal (GV) et du groupe
nominal (GN),
b) le procès sémantique exprimé par le GV et le rôle joué par le GN,
c) le statut sémiotique de l’expression entière.
Sur le plan syntaxique (a), le N dans la locution avoir besoin est une
Extension structurelle d’un GV complexe. Par contre, dans prendre son
bain le GN son bain est un Complément indépendant. Sur le plan
sémantique (b), les GN dans avoir besoin et prendre son bain expriment
la Portée lexicale du Prédicat. Mais une analyse aux niveaux (a) et (b) ne
suffira pas : il est aussi nécessaire d’examiner les propriétés
paradigmatiques (contrastives) et phraséologiques (référentielles) de ces
expressions ; autrement dit leur statut sémiotique (c). Les questions de ce
genre ne sont guère posées dans la littérature syntaxique ou
lexicologique. Dans la section suivante, nous proposons la notion de
‘signe complexe’ (Gledhill & Frath 2005) pour distinguer d’une part
entre les ‘collocations VN’ (observables dans un corpus de textes) et les
‘expressions VN’ (ayant le statut d’une unité phraséologique).

2. Locutions, synthèmes et signes complexes
Les grammairiens et les lexicographes rangent beaucoup des
expressions qui nous intéressent ici dans la catégorie des ‘locutions
verbales’. Une locution est un mot complexe avec la même fonction
qu’une catégorie lexicale simple (Rey & Chantreau, 2003, vi). Les
locutions sont ainsi des groupes de mots figés par un processus historique
de lexicalisation (So 1991, Brinton & Akimoto 1999). Les exemples les
plus frappants se forment autour d’un ‘fossile lexical’, un élément
archaïque et lexicalement non-productif (Strömberg 2002). Les fossiles
peuvent figurer à chaque rang de la stratification grammaticale, mais il
semblerait que la plupart se forment au niveau du groupe :
Rang Fossile (souligné)
Proposition il y a belle lurette
Syntagme verbal se mettre martel en tête, sans coup férir
Groupe adjectival les bras ballants, mal famé
Groupe adverbial aujourd’hui, peu ou prou
Groupe conjonctif n’empêche que, pourvu que
Groupe nominal pierre d’achoppement, rez-de-chaussée
Groupe prépositionnel sous la férule de, à l’instar de
Groupe verbal avoir maille à, faire la nouba
On peut voir que le fossile maille fait partie d’une structure lexico-
grammaticale étendue : avoir maille à partir avec quelqu’un, un
Prédicateur complexe qui exprime un procès sémantique dans lequel un
V grammatical (complexe) sert à introduire un V lexical (complexe).
Mais quelle est la signification de maille dans cette séquence ? Nous
avons suggéré (Gledhill & Frath 2005) que même si les fossiles sont plus
ou moins opaques, ils ont néanmoins une fonction contrastive au sein de
leurs expressions respectives. Les fossiles sont ainsi des monèmes (des
éléments contrastifs) possédant le même potentiel référentiel que les
autres unités du lexique. Les fossiles sont par ailleurs intégrés dans des
structures lexico-grammaticales de la langue : ce sont des complétifs (en
catimini), des qualifieurs ou extensions (pierre d’achoppement, peu ou
prou), des modifieurs ou intensifieurs (rez-de-chaussée, pourvu que) et
parfois des noyaux (mal famé). L’intégration d’un fossile lexical comme
maille dans un Prédicateur complexe est ainsi un moyen très productif de
créer de nouveaux lexèmes : selon Brinton et Traugott (2005), c’est la
fonction même de la lexicalisation.
Pour les grammairiens (Riegel et al. 1994, 232-233, Wilmet 2003,
163), les locutions verbales sont des ‘idiomes’ caractérisés par l’absence
ou le figement de l’article (faire + face / froid / peur). Selon cette
perspective, le manque de détermination dans ces expressions

correspondrait à la perte d’indépendance référentielle du N et son
intégration au sein du GV. Mais, il est possible d’arriver à une autre
explication. Par exemple, la séquence faire + N exprime souvent des
procès Relationnels ou Mentaux avec un sémantisme parfois très
régulier : faire + beau, chaud, froid… faire + éclat, face, honte, peur,
rage … faire + banqueroute, chou blanc, défaut, erreur, faillite, fausse
route…. De même, la séquence faire + le / la + N exprime souvent des
procès Matériels ou Comportementaux : faire la + fête, foire, java,
nouba …, faire le + amour, beau, con, enfant, fier, point.... Ces
prosodies ne peuvent être expliquées par la présence ou l’absence de
l’article ; ce sont plutôt des paradigmes formés par analogie à un emploi
prototypique. Les séquences de ce type ressemblent aux « constructions »,
de Goldberg (1995) ou aux « lexical patterns » de Hunston et Francis
(2000). Selon ces deux approches, les séquences grammaticales
possèdent des prosodies sémantiques régulières indépendamment des
lexèmes spécifiques dont elles sont composées (Louw 1993). Nous
verrons plus loin que les constructions VN n’échappent pas à cette
tendance générale.
L’aspect paradoxalement productif du figement a été souligné par
Martinet, qui utilise le terme synthème pour toute expression
idiomatique dans laquelle il est possible de reconstituer les processus de
composition (chemin de fer, poser une question). Le synthème est un
« monème complexe » :
[…] il s’agit d’une unité linguistique signifiante, désignant une notion bien définie,
mais où la forme permet de distinguer des éléments successifs porteurs au départ
de sens distinctifs. (1999, 11)
La cohésion du synthème dépend de sa fonction syntaxique. Les critères
de sa définition sont ainsi:
a) l’impossibilité de déterminer individuellement les monèmes constituants, b)
l’obligation de tout synthème de s’intégrer dans une classe préétablie de monèmes.
(1999, 15)
Mais la littérature sur les parties de discours semble indiquer qu’il est
difficile, sinon impossible, de déterminer des « classes préétablies de
monèmes » (Boisson et al. 1994, Pottier 1994, Sinclair 1991, 1996). De
même, on peut se demander s’il est utile de citer des locutions hors
contexte comme au fur et à mesure (adverbe ou préposition ?) ou avoir
maille à (locution verbale ?), car ces expressions n’ont pratiquement
aucune existence sans des contextes plus étendus (au fur et à mesure +
de / que , avoir maille à + partir avec quelqu’un). Il n’est donc pas
suffisant de pouvoir catégoriser les phénomènes comme les locutions ou
les synthèmes : le fait d’accorder à certaines expressions VN une

étiquette comme ‘locution verbale’ ne constitue pas, à notre avis, une
explication du phénomène.
Comment pouvons-nous discuter alors des expressions VN sans
référer à des catégories a priori? Dans Frath & Gledhill (2005) et
Gledhill & Frath (2007) nous avons développé une analyse unifiée des
expressions phraséologiques basée sur la notion de « dénomination »
(Kleiber 1984). Une dénomination est un signe qui nomme ou réfère à un
objet de pensée stable. Sur le plan sémiotique, les mots simples
constituent des dénominations simples. Nous proposons donc de
considérer les unités phraséologiques (les idiomes, les locutions etc.)
comme des signes complexes. Un signe complexe comporte un élément
stable qui lui confère un statut lexico-grammatical (le Pivot) et une
famille d’éléments contrastifs (le Paradigme). L’expression VN faire la
nouba serait ainsi une dénomination stable avec un Pivot (faire) et un
Paradigme (nouba par rapport à fête, java, etc.) Certains éléments comme
les articles peuvent varier entre le Pivot et le Paradigme (faire le point,
faire la nouba, faire (0) face). D’autres, comme l’expression VN avoir
maille représentent une dénomination plus complexe : un Pivot (avoir) et
un Paradigme consistant en maille à partir avec plus une personne ou un
groupe en position d’autorité.
Evidemment, cette conception du « signe complexe » échappe aux
restrictions traditionnelles liées à la structure grammaticale ou à la
catégorie lexicale du mot. Et comme nous le verrons dans la section
suivante, cette perspective est loin d’être adoptée par la majorité des
linguistes.
3. Prédicats nominaux, verbes légers, verbes supports
Nous avons vu que les lexicologues considèrent les locutions comme
des unités phraséologiques dans lesquelles un certain nombre de règles de
syntaxe ont été suspendues. Mais les grammairiens ne partagent pas cette
perspective. La grammaire formelle considère notamment qu’il est
possible d’isoler des sous-types d’expressions verbo-nominales en
appliquant des tests syntaxiques. Dans cette section, nous examinerons en
particulier les catégories proposées par la grammaire générative, la
théorie du lexique-grammaire et la théorie des opérations énonciatives.
Les constructions VN ont des propriétés formelles très variées. La
première série de propriétés concerne les ressemblances formelles entre
les VN et les verbes simples (V):
V1 Equivalence Les constructions VN comportent un V générique (un
verbe fréquent et général) et un N spécifique (sémantiquement plus
précis). Le N est parfois apparenté morphologiquement à un V simple
(faire un bon travail : travailler bien), mais cette dérivation n’est pas
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%