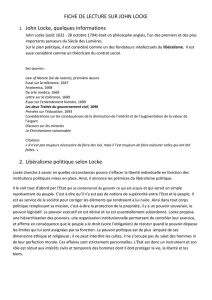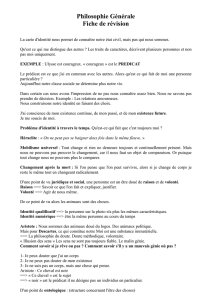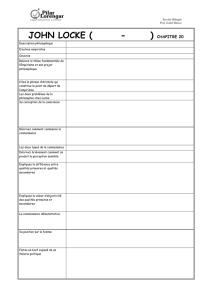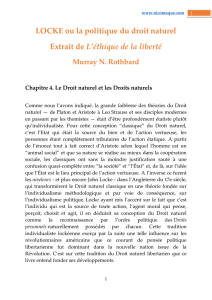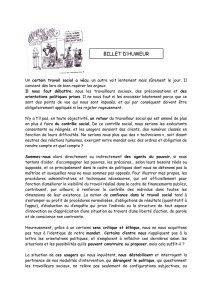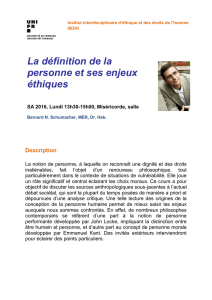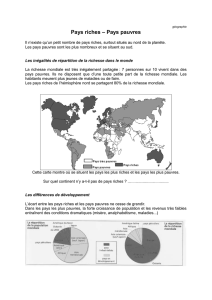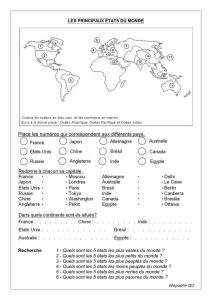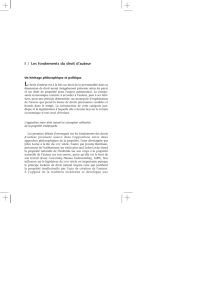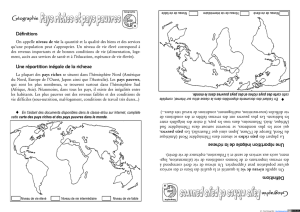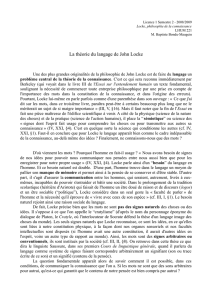Recension : « Locke, J., Que faire des pauvres, trad. Laurent Bury

Recension : « Locke, J., Que faire des pauvres, trad. Laurent Bury, Paris, PUF, 2013 ».
Sous le titre « Que faire des pauvres ? », l’ouvrage présente la première traduction française d’un
texte généralement connu sous le nom de « proposed poor law reform » au sein de la tradition anglo-
saxonne. Dans ce court texte rédigé en 1697, Locke défend une série de mesures ayant pour objectif
de mettre les pauvres au travail en vue de résoudre l’important problème économique qu’ils posent
aux paroisses qui ont pour obligation de les prendre en charge. Le cœur du dispositif d’encadrement
proposé par Locke consiste à lier les pauvres à une paroisse bien déterminée qui sera responsable de
leur entretien, et disposera à cet effet du droit de les forcer à accepter différents emplois, rémunérés
ou non (l’activité étant de toute façon préférable à l’oisiveté). Parallèlement, la société dans son
ensemble aura à charge de fournir de l’emploi aux pauvres, afin que l’usage de la quantité de travail
ainsi rendue disponible résolve le problème de l’entretien matériel des pauvres par les paroisses, et à
terme enrichisse la communauté. Pour Locke, ces mesures ne se justifient pas uniquement sur le plan
économique, mais également sur le plan moral en vertu des prescriptions de la loi naturelle. Dans ce
texte, le philosophe anglais lie en effet explicitement industrie et vertu, vice et oisiveté, et à ce titre
condamne sévèrement ceux qui, capables de travailler, vivent pourtant du labeur des autres. Le
portrait que Locke dresse du « parasite » vagabond qui ne désire pas travailler est édifiant et
révélateur de la place centrale qu’occupe le travail dans sa conception de l’homme et des obligations
qui découlent pour lui de la loi naturelle. L’oisiveté de ces vagabonds, la corruption de leurs mœurs,
et particulièrement la volonté que Locke leur impute d’esquiver les charges qui pèsent de façon
égale sur tous les membres de la communauté, semblent ainsi justifier l’attitude autoritaire et
paternaliste de la communauté qui a tout pouvoir sur eux par l’intermédiaire des « gardiens des
pauvres ». Cette importante dimension morale explique alors aussi le sort qui est réservé dans le
système imaginé par Locke à ceux qui cherchent encore à esquiver leur part de travail : Locke ne
prescrit rien de moins que - selon la gravité des cas et les éventuelles récidives - des châtiments
corporels, le service naval obligatoire, ou les travaux forcés pour une durée de trois semaines (pour
les enfants) à trois ans (pour les hommes). Ces mesures, qui ne diffèrent guère des lois sur les
pauvres déjà en vigueur à l’époque, sont en outre couplées à la mise en place d’ « écoles
d’industrie » dont l’objectif avoué consiste à encadrer les populations précaires en vue d’éduquer les
enfants au travail dès leur plus jeune âge et libérer ainsi le temps de travail des femmes tout en
assainissant les mœurs des plus démunis.
Les mesures autoritaires proposées par Locke pour mettre les pauvres au travail ont donc de quoi
surprendre le lecteur habitué à voir en cet auteur le « père du libéralisme ». Et c’est bien là tout
l’intérêt de ce texte qui contraste grandement avec la philosophie politique des Deux Traités, publiés
quelques années auparavant. Car s’il est certain que l’on trouve une certaine continuité entre les
deux textes quant aux prémisses qui sous-tendent le discours lockéen – en particulier l’importance
du travail dans l’anthropologie lockéenne - il n’en demeure pas moins que l’égalitarisme politique
affirmé dans les œuvres théoriques semble irréconciliable avec l’autoritarisme présent dans ce texte,
sauf à adhérer à la thèse macphersonienne d’une institution politique qui serait l’apanage des
individus « industrieux et rationnels ». Les mesures prescrites par Locke nous obligent en tout cas à
repenser le lien problématique qui existe pour cet auteur entre propriété de soi dans la sphère du
travail et propriété de soi comme liberté dans la sphère politique. Il serait cependant réducteur de

limiter les apports de la proposition de loi sur les pauvres à cette seule ambiguïté théorique, car, in
fine, le texte interpelle tant par l’autoritarisme déployé pour remettre les oisifs dans le droit chemin
que par l’affirmation parallèle d’un droit universel à la subsistance dont sont également titulaires les
pauvres et qui oblige la communauté politique à leur égard. Si la très utile préface de S. Milano
insiste peut-être trop sur ce second aspect au détriment des enjeux théoriques posés par
l’intégration problématique des prescriptions autoritaristes au corpus philosophique lockéen, on ne
peut cependant que se réjouir de la publication de ce texte en français, laquelle intéressera aussi
bien le chercheur se penchant sur l’anthropologie lockéenne que l’historien des idées ou le lecteur
contemporain.
1
/
2
100%