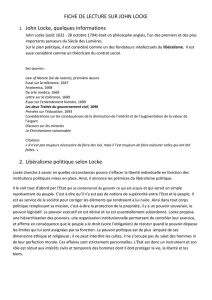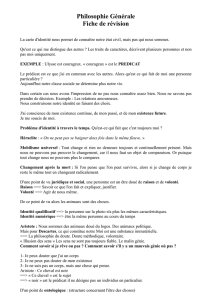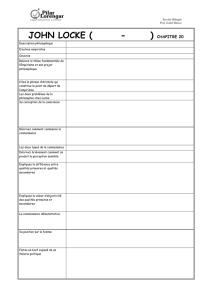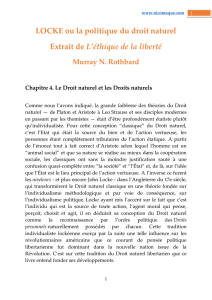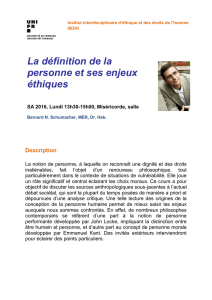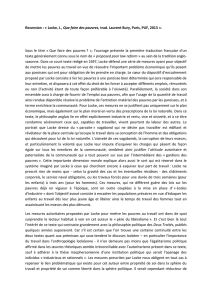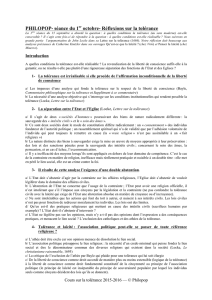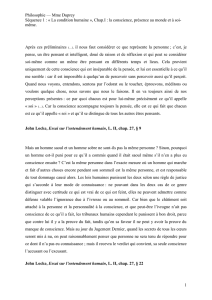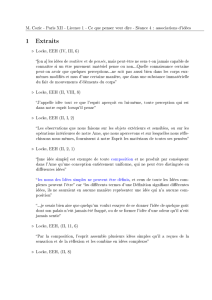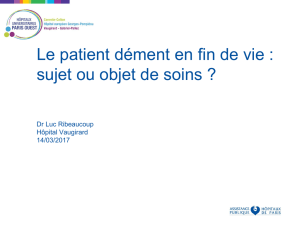La théorie du langage de John Locke

Licence 1 Semestre 2 - 2008/2009
Locke, philosophie de la connaissance
LHUM 221
M. Baptiste Bondu-Maugein
La théorie du langage de John Locke
Une des plus grandes originalités de la philosophie de John Locke est de faire du langage un
problème central de la théorie de la connaissance. C'est ce qui sera reconnu immédiatement par
Berkeley (qui voyait dans le livre III de l'Essai sur l'entendement humain un texte fondamental,
soulignant la nécessité de commencer toute entreprise philosophique par une prise en compte de
l'importance des mots dans la constitution de la connaissance, et dans l'origine des erreurs).
Pourtant, Locke lui-même en parle parfois comme d'une parenthèse dans son ouvrage : « Ce que j'ai
dit sur les mots, dans ce troisième livre, paraîtra peut-être à certains beaucoup plus long que ne le
mériterait un sujet de si maigre importance » (III, V, §16). Mais il faut noter que la fin de l'Essai en
fait une pièce maîtresse de l'édifice scientifique à venir. A côté de la physique (science de la nature
des choses) et de la pratique (science de l'action humaine), il place la “sémiotique” ou science des
« signes dont l'esprit fait usage pour comprendre les choses ou pour transmettre aux autres sa
connaissance » (IV, XXI, §4). C'est en quelque sorte la science qui conditionne les autres (cf. IV,
XXI, §1). Faut-il en conclure que pour Locke le langage apparaît bien comme le cadre indépassable
de la connaissance, au-delà même des idées ? Finalement, ne connaissons-nous que des mots ?
D'où viennent les mots ? Pourquoi l'homme en fait-il usage ? « Nous avons besoin de signes
de nos idées pour pouvoir nous communiquer nos pensées entre nous aussi bien que pour les
enregistrer pour notre propre usage » (IV, XXI, §4). Locke parle ainsi d'un “besoin” du langage en
l'homme. Et ce besoin naturel est double. D'une part, l'homme trouve dans le langage un moyen de
pallier son manque de mémoire et permet ainsi à la pensée de se conserver et d'être stable. D'autre
part, il s'agit d'assurer la communication entre les hommes, qui seraient, autrement, livrés à eux-
mêmes, incapables de pouvoir s'entraider et bâtir une société. Dans le prolongement de la tradition
scolastique (héritière d'Aristote) qui faisait de l'homme un être doué de raison et de discours (logos)
et un être sociable (“politique”), Locke considère dans un seul geste la « faculté de parler » de
l'homme et la nécessité qu'il éprouve de « vivre avec ceux de son espèce » (cf. III, I, §1). Le besoin
naturel rejoint ainsi une raison sociale du langage.
De fait, Locke précise bien que les mots ne sont pas des signes naturels des choses ou des
idées. Il s'oppose à ce que l'on appelle le “cratylisme” (d'après le nom du personnage éponyme du
dialogue de Platon, le Cratyle, où l'interlocuteur de Socrate défend la thèse d'un langage image des
choses du monde). Les seuls signes naturels que Locke reconnaisse, ce sont les idées, en ce qu'elles
sont liées à notre constitution physique, à la façon dont nos organes sensoriels et nos facultés
intellectuelles sont disposés (si l'homme avait une autre constitution, il aurait d'autres idées en
l'esprit, voire un autre type de rapport au monde). Ainsi, les mots sont des signes arbitraires ou
conventionnels, ils sont institués par la société (cf. III, II, §8). On retrouve dans cette thèse ce que
dira le linguiste Saussure, dans ses premiers Cours de linguistique générale, quand il parlera du
langage comme système de signes faisant correspondre arbitrairement un signifiant (son ou trace
écrite de ce son) et un signifié (contenu de la pensée).
La question fondamentale apparaît alors de savoir comment il est possible, dans ces
conditions, de communiquer la connaissance que l'on a. Si les mots ne sont que des sons arbitraires
pour autrui, qu'est-ce qui garantit que le contenu de notre pensée est bien compris par autrui ?

Selon Locke, les mots sont des marques extérieures sensibles qui manifestent les pensées
invisibles de chacun. « Les mots ne signifient rien d'autre, dans leur première et immédiate
signification, que les idées qui sont dans l'esprit de celui qui s'en sert » (III, II, §2). Ainsi, les mots
ne signifient ni les qualités qui sont dans les choses, ni les pensées d'autrui : c'est ce dont ils ne
sauraient en aucun cas être capables. Mais alors, les mots peuvent-ils assurer une quelconque
communication ? Surtout, ne risquent-ils pas de nous empêcher de connaître quoi que ce soit ? Nous
avons pourtant vu qu'il est dans la nature du langage de pourvoir l'homme d'un moyen de
communication et d'un instrument susceptible d'améliorer la connaissance (en étant comme un
remède contre l'oubli).
Les mots portent en fait en eux-mêmes une double « référence secrète » (cf. III, II, §4).
D'une part, l'utilisation d'un mot dans son acception commune est fondé sur la supposition que les
autres hommes lui donnent la même signification. D'autre part, les hommes « veulent qu'on
s'imagine qu'ils parlent des choses selon ce qu'elles sont réellement en elles-mêmes ». Il y a donc un
double risque d'abus dans l'usage du langage. Premièrement, quand je parle, je peux être tenté de
penser que mon interlocuteur comprend les choses comme moi-même je les comprends, alors que
lui-même n'a affaire, comme moi, qu'à ses propres pensées. Deuxièmement, je peux avoir tendance
à confondre les mots et les choses, à penser que le découpage linguistique de la réalité correspond à
un découpage réel.
Faut-il en rester à ce constat d'échec ? Comment concilier la fonction première du langage
(aider à la connaissance et à la communication) et sa tendance profonde (caractère trompeur des
mots et multiplication des conversations fondées sur des malentendus) ?
Le but de Locke est précisément de clarifier la place des mots dans la connaissance. C'est
une fois que les mots se verront attribués leur fonction propre que les abus de langage pourront être
décelés, et ainsi les débats entre les hommes y trouveront moins de confusion. La première chose à
noter, c'est que l'immense majorité des mots sont ce que Locke appelle des “noms généraux”. En
effet, si chaque chose individuelle devait être désignée par un nom propre, la communication
deviendrait impossible (cf. III, III, §1-5). Les noms généraux sont des mots désignant des idées
abstraites. Une idée abstraite est celle que l'on tire quand on considère un aspect déterminé d'une
chose, sans considération des circonstances de l'expérience dans laquelle on rencontre une chose.
Par exemple, la neige, la face de la lune ou le lait ont tous en commun la blancheur, malgré les
nombreux traits qui les rendent dissemblables entre eux.
Dire que presque tous les mots sont des termes généraux ne veut pas dire qu'il soit
impossible de désigner des choses individuelles. On pourra décrire telle ou telle chose par une
connexion de termes généraux. Surtout, on peut témoigner du degré de connaissance d'une chose
(d'une substance notamment, c'est-à-dire d'une réalité naturelle) par le nombre de termes généraux
que l'on pourra lui appliquer. « Celui qui ajoute à son idée complexe de l'or celle de la fixité ou de
capacité d'être dissous dans l'eau régale, qu'il n'y mettait pas auparavant, ne passe pas pour avoir
changé l'espèce, mais seulement pour avoir une idée plus parfaite, en ajoutant une autre idée simple
qui est toujours actuellement jointe aux autres, dont était composée sa première idée complexe »
(III, X, 19). Locke répond ainsi à la difficulté posée plus haut : comment les hommes peuvent-ils
communiquer entre eux et progresser dans leur connaissance alors qu'ils n'ont pas accès à d'autres
idées que celles données dans leurs propres pensées ? Ils le peuvent car le terme général “or”, par
exemple, est commun aux interlocuteurs : chacun pourra y mettre ce qu'il en connaît, partager avec
autrui ce qu'il en sait de plus ou apprendre de l'autre ce qu'il en ignore. La connaissance de la chose
n'interviendra néanmoins que quand il en aura fait une perception claire et distincte ou qu'il en aura
conçu la démonstration (avec la même clarté et distinction).
C'est ici que Locke peut distinguer entre l'essence nominale d'une chose (la seule à laquelle
on puisse véritablement prétendre) et l'essence réelle ou naturelle de la chose (qui reste un objectif
à atteindre, mais qui demeure sans cesse repoussé). La connaissance des choses progresse par
l'énoncé de définitions nominales successives, c'est-à-dire de tentatives de décrire les choses à partir

de termes généraux. L'essence réelle des choses est bien la finalité de la connaissance, mais le
scientifique ne peut donner que des hypothèses probables à son propos, à un moment donné de l'état
des connaissances. Le langage est ce qui permet d'exprimer avec précision ce qu'est cet état de la
science, fondé sur les expériences et les découvertes successives.
Par sa réflexion approfondie sur la nature du langage et son rôle dans la constitution de la
connaissance, Locke apparaît comme un précurseur du “tournant linguistique” de la philosophie
(celle qui naît principalement avec Frege, puis Russell et Wittgenstein). Il faut néanmoins bien
cerner quelle est la thèse générale de Locke. Il ne semble pas qu'il soit un nominaliste (seuls
existent les mots), même s'il se prémunit contre toute forme de réalisme naïf (nous connaissons les
choses sous forme de substances) : il propose plutôt ce que l'on pourrait appeler un
“conceptualisme” (ce à quoi nous avons accès, ce sont nos idées), où les mots jouent le rôle de
cadre pour la pensée. Et c'est dans ce cadre bien clairement et distinctement déterminé que la
science devient possible, par delà les abus et les confusions si fréquents dans le langage et la
conversation ordinaires.
N.B. La validation du semestre sera fondée sur l'explication du texte qui suit. La connaissance du
cours n'est pas requise pour faire l'exercice.
« Les mots, dans leur signification première ou immédiate, ne tiennent lieu
de rien d'autre que des idées dans l'esprit de celui qui s'en sert, quels que soient
l'imperfection et le manque de soin avec lesquels ces idées sont tirées des choses
qu'elles sont supposées représenter. Quand un homme parle à un autre, c'est pour
être compris, et la finalité de son discours est que ces sons, en tant que marques,
fassent connaître ses idées à son auditeur. Ainsi, ce dont les mots sont les
marques, ce sont les idées du locuteur : et nul ne peut les appliquer comme des
marques, de manière immédiate, à quelque chose d'autre que les idées qu'il a lui-
même. Car cela ferait d'eux des signes de ses propres conceptions, tout en les
appliquant à d'autres idées, ce qui en même temps ferait d'eux des signes de ses
idées et n'en ferait pas des signes, ce qui les rend de fait sans signification du tout.
Les mots étant des signes volontaires, ils ne peuvent être des signes volontaires
appliqués par lui à des choses qu'il ne connaît pas. Cela en ferait des signes de
rien, des sons sans signification. Un homme ne peut pas faire de ses mots les
signes soit des qualités dans les choses, soit des conceptions dans l'esprit d'un
autre homme — dont nulle n'est dans son esprit à lui. Tant qu'il a des idées à lui, il
ne peut supposer qu'elles correspondent avec les conceptions d'un autre homme, et
il ne peut pas se servir de signes pour celles-ci, car ce seraient les signes de je-ne-
sais-quoi, ce qui, en vérité, ne sont les signes de rien. Mais quand il se représente
les idées d'autrui à partir de certaines des siennes, s'il consent à leur donner les
mêmes noms que les autres leur donnent, c'est toujours à ses propres idées qu'il
donne ces noms, à des idées qu'il a, et non à des idées qu'il n'a pas. »
John Locke, Essai sur l'entendement humain, III, II, §2
(traduction J.-M. Vienne, modifiée).
1
/
3
100%