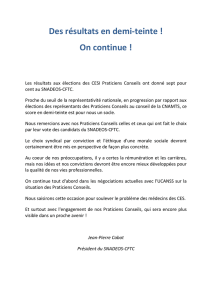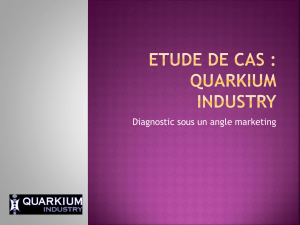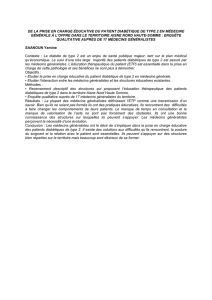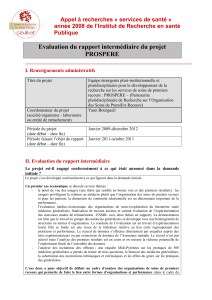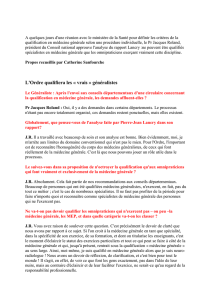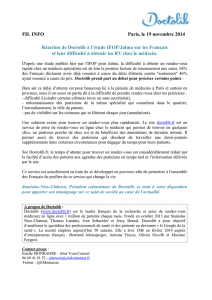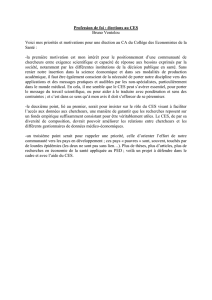L`adhésion des médecins généralistes aux dispositifs de politique

L’adhésion des médecins généralistes aux dispositifs de
politique de santé : un éclairage économétrique
Version préliminaire (ne pas citer).
Philippe Abecassis (CEPN-Université Paris 13)
Nathalie Coutinet (CEPN-Université Paris 13)
Jean-Paul Domin (REGARDS – Université de Reims Champagne-Ardenne)
Introduction
La pratique médicale est depuis les années 1970 fortement réglementée et les
éléments les plus sensibles (modes de rémunération, tarifs, pratiques, …) sont négociés
régulièrement dans le cadre de conventions médicales signées par les représentants de la
profession, de l'État et de la tutelle. Mais celle-ci entend également utiliser ce canal pour
infléchir le comportement des médecins et des patients. Ainsi, depuis le début des
années 1990, la politique de conventionnement doit-elle comprendre des objectifs à
atteindre et un mécanisme de sanctions et récompenses incitant les médecins à prescrire
avec modération (Ferrand-Nagel, 1994). Plus récemment, le dispositif de parcours de
soins ou le CAPI (Contrat d’amélioration des pratiques individuelles) associe les
praticiens à une politique incitative dirigée vers les patients.
En s’appuyant ainsi sur les praticiens, la tutelle parie sur leur adhésion et leur
participation active. Ce pari se fonde en grande partie sur un mécanisme éprouvé
d’élaboration des politiques de santé. Les réglementations en matière de santé sont ainsi
construites en tenant compte du pouvoir politique de la profession qui reste important
(Pierru, 2007). Depuis l’annulation de la convention de 1997, l’approbation des textes
conventionnels par la profession est légitimée par une procédure originale de
reconnaissance officielle de représentativité des syndicats signataires ainsi que par
l’existence d’un pouvoir d’opposition majoritaire. Le pari s’appuie aussi sur un
ensemble d’incitations prenant la forme de rémunérations contractuelles attribuées
individuellement aux médecins qui relaient activement les politiques.
Cependant, le degré d’adhésion comme les motivations des médecins à participer à
ces politiques de santé sont mal connus. Les informations quantitatives, comme la part
des médecins généralistes ayant accepté d’être médecin référent ou ayant signé un CAPI
sont assez pauvres. En particulier, ces données ne fournissent aucune indication sur la
nature de l’adhésion aux dispositifs. Il est, par exemple, impossible de déterminer si une
adhésion correspond à la réaction attendue aux incitations ou simplement à un effet
d’aubaine. Par ailleurs, comment expliquer les taux de refus d’adhérer à certains
dispositifs ?
L’analyse du discours syndical ne renseigne pas beaucoup plus. Si les grandes lignes
de ce discours émergent clairement (Abecassis, Domin, 2009), la représentativité
syndicale souffre d’un émiettement important. Or, face à la nécessité d’être reconnu
comme représentatif pour exister, cet émiettement a naturellement accentué les
positions extrêmes et conflictuelles. Chaque syndicat déploie désormais ses propres

2
revendications et les érige en impératif catégoriel. Chacun tente d’annuler des accords
signés par d’autres ou de bloquer le processus conventionnel.
Dans un tel contexte, la question de la légitimité de la représentation syndicale des
médecins est posée : « le syndicalisme médical ne semble plus satisfaire les aspirations
des médecins libéraux » (Batifoulier, Gadreau, Vacarie, 2008). De plus, l’absence
d’unité syndicale et leur posture conflictuelle peut conduire la tutelle à mettre en place
des mécanismes de contrôle et à décider unilatéralement des tarifs et modes de
rémunération (Volovitch, 2006). Dans ces conditions, certains médecins ne se sentent
plus liés, ni à leurs représentants ni aux textes conventionnels.
Ce travail a pour objectif d’analyser le degré d’adhésion des médecins généralistes
aux dispositifs de politique de santé et d’en déterminer la nature. L’hypothèse retenue
est que la décision d’adhérer (ou non) à un tel dispositif s’inscrit dans une
problématique de crowding out effect ou effet d’éviction. Déjà mobilisée dans le secteur
de la santé (Ammi, Béjean, 2010), cette approche fait intervenir plusieurs registres de
motivation. Le comportement du médecin résulte d’une tension entre des motivations
intrinsèques, selon lesquelles l’action est entreprise pour la satisfaction inhérente à son
accomplissement, et des motivations extrinsèques où l’action est effectuée dans une
perspective instrumentale.
Nous organiserons notre propos en trois temps. Nous verrons dans un premier temps
que la politique économique de santé implique fortement les praticiens d’abord parce
qu’ils participent à son élaboration (via un système de conventionnement), ensuite parce
qu’ils la subissent directement (1). Nous présenterons dans une deuxième partie les
caractéristiques de l'enquête et la méthodologie : création d'un indicateur (H) d’adhésion
des médecins à la politique de santé et d'un indicateur (M) mesurant la nature
intrinsèque ou extrinsèque des motivations (2). La troisième et dernière partie sera
consacrée, quant-à-elle, à l'analyse des résultats (3).
1. Les médecins face à la politique économique de santé
La politique économique de santé a profondément évolué depuis le début des années
2000 : elle organise le retrait progressif de l’assurance maladie obligatoire, favorise le
développement de l’assurance maladie complémentaire et entend orienter le
comportement des médecins libéraux (Batifoulier, Domin, Gadreau, 2007). Cette
politique implique fortement les médecins d’abord parce qu’ils y participent activement
(1.1) et ensuite parce qu’ils en subissent directement les effets (1.2). Les médecins
généralistes semblent d’ailleurs réagir de façon différente aux incitations (1.3).
1.1. Le rôle des médecins généralistes dans la construction de la politique de santé
Au 31 décembre 2009, les médecins généralistes étaient 53 652 selon le Syndicat
national inter-régime (SNIR). 49 263 d’entre eux exerçaient dans le secteur
conventionné (soient 91,2 %) et 4 389 (soient 8,2 %) dans le secteur à honoraire libre.
Le mode d’exercice en médecine ambulatoire, reste principalement libéral avec une
prédominance aujourd’hui de l’exercice de groupe : 54 % des médecins généralistes
libéraux déclarent travailler en groupe. Cette organisation particulière résulte d’un
compromis entre l’État et le marché : le référentiel est le marché, mais le prix de la
consultation est défini par un texte, la convention médicale, renégocié de façon
périodique. Ce texte est national depuis 1971 et s’impose à l’ensemble des praticiens,
sauf ceux qui décident expressément de ne pas y adhérer.
La régulation des dépenses de santé en médecine ambulatoire s’articule autour d’un
mécanisme de convention qui peut se définir comme une régulation concertée entre
l’État, les caisses de Sécurité sociale et les représentants du corps médical (Dupeyroux,

3
Borgetto, Lafore, Rolande, 2001). La convention s’inscrit dans le cadre d’une politique
publique où le praticien libéral est appréhendé, dans le cadre d’une mission de service
public, comme le producteur d’un bien collectif sous tutelle. La convention doit
permettre à la tutelle d’inciter le corps médical à adopter un comportement compatible
avec l’intérêt général. C’est un contrat entre les médecins et l’État (Ferrand-Nagel,
1994). Ce contrat est par nature individuel et collectif : il lie le médecin conventionné à
l’État, mais résulte d’une procédure de négociation collective entre les organisations
syndicales et les pouvoirs publics (État et assurance maladie).
Les organisations syndicales professionnelles ont un rôle important dans ce modus
operandi dans la mesure où elle sont chargées par leurs adhérents d’aller négocier avec
les autres partenaires un texte qui défende au mieux leurs intérêts (Stasse, 1999). Le
syndicalisme médical est marqué en France par son histoire construite autour de la lutte
l’émergence de la protection sociale et la lutte pour le respect des principes de la
médecine libérale (Hassenteufel, 1997b, 2008).
Le dispositif de négociation conventionnelle repose ainsi sur les organisations
syndicales : l’État et l’assurance maladie ont besoin du corps médical pour éviter la
crise conventionnelle. L’absence d’accord met en évidence l’incapacité des deux
premiers à obtenir l’accord des praticiens sur les objectifs de la politique économique de
santé (Bras, 2008). Les habitués des rendez-vous conventionnels sont d’ailleurs
conscients de la dépendance des pouvoirs publics à l’égard des organisations syndicales
qui les pousse depuis plus de vingt ans à satisfaire avant tout les droits des praticiens et
non ceux des patients (Régereau, 2005). Cette situation explique en partie le
« gaspillage négocié » propre à la France (Letourmy, 1995).
La situation est d’autant plus difficile pour les pouvoirs publics que le déficit
chronique de la branche maladie les a incités à mettre en œuvre une politique de
maîtrise comptable des dépenses de santé contre laquelle les médecins se sont vivement
opposés en utilisant un registre de légitimation fondé sur la défense de la santé des
patients (Hassenteufel, 1997b). Le praticien devient le garant de la santé de ses patients
contre l’insouciance des représentants de l’État uniquement préoccupé par le respect des
grands équilibres comptables. Cette position est d’ailleurs renforcée par le fort pouvoir
de lobbying de la profession qui n’est pas sans effet sur le pouvoir politique (Pierru,
2007). Il en ressort que la politique économique de santé ne peut se faire sans
l’assentiment du corps médical et encore moins contre son avis.
1.2. Le développement des incitations monétaires et leur effet
Les médecins généralistes constituent un maillon essentiel de la politique
économique de santé en France. Le marché de la santé s’apparente en effet à un modèle
multi-principaux où le médecin est un agent face à deux principaux, l’assurance-maladie
et le patient (Blomqvist, 1991). Dans ce schéma, chacun des trois acteurs dispose d’un
niveau d’information différent. Le patient sait qu’il est malade, mais ne connaît pas la
nature de sa pathologie. Il délègue son pouvoir de décision au praticien (Arrow, 1963).
L’assurance-maladie (la tutelle) est dans une situation d’inobservabilité totale car elle ne
connaît pas la réalité de la pathologie du malade et ne peut pas mesurer l’effort du
praticien. Ce dernier, par son expertise, identifie la nature de la pathologie. Cependant,
même s’il elle est limitée, l’information dont dispose le praticien est convoitée par les
deux principaux et revêt un caractère stratégique.
Depuis le milieu des années 1990, la politique économique de santé tente d’inciter
les praticiens à modérer leurs dépenses tout en promouvant des mesures d’amélioration
de la qualité. La convention de 1993 met en place un système de Références médicales
opposables (RMO) incitant les praticiens à prescrire avec modération (Ferrand-Nagel,

4
1994). Les conventions de 1997 et de 1998 prévoient la prise en charge d’une partie des
cotisations sociales pour les médecins référents. La mise en place des Accords de bon
usage des soins (ACBUS) généralise le versement de contreparties financières contre les
bonnes pratiques. La convention de 2005 poursuit dans cette perspective en créant une
rémunération forfaitaire pour les médecins traitants, les médecins coordinateurs et ceux
participant à la coordination. Dans le même temps, le décret du 14 avril 2005 (à la suite
de la loi réformant la santé publique du 9 août 2004) rend obligatoire l’évaluation des
pratiques des médecins en exercice.
Le développement des incitations financières constitue, dans la perspective de la
théorie de l’agence, l’un des fondements de la politique économique de santé en
supposant que celles-ci accroissent la performance de l’agent. La littérature économique
s'est, depuis de nombreuses années, inspirée de disciplines proches (Gautié, 2007). Les
travaux sur les motivations et les incitations s'inscrivent tout particulièrement dans cette
perspective.
Depuis les années 1970, les psychologues s’intéressent à l’impact des incitations
monétaires sur la motivation des individus. Une première expérience conclue que les
récompenses financières diminuent les motivations intrinsèques des individus (Deci,
1971). Une étude menée sur la même période montre que les incitations monétaires
destinées à accroître le don de sang sont contre-productives et tendent à réduire la
quantité et la qualité du sang donné (Titmuss, 1970). L’idée soutenue par l’auteur est
que les individus qui donnent leur sang sont motivés par l’action citoyenne. La
rémunération détruirait de facto leur motivation. Cette approche est contestée par
certains économistes qui pensent que l’incitation financière s’ajoute au comportement
altruiste des individus (Arrow, 1972 ; Solow, 1971).
Il faut donc distinguer les motivations intrinsèques qui résultent de forces internes
aux individus et les incitations extrinsèques qui sont issues quant à elle du monde
extérieur. Un individu est intrinsèquement motivé quand il retire de la satisfaction et de
l’intérêt pour la seule pratique d’une activité. Pour qu’une motivation soit effectivement
intrinsèque, l’activité doit même avoir été entreprise sans récompense (Gneezy,
Rustichini, 2000). En d’autres termes, il est envisageable qu’un salarié intrinsèquement
motivé travaille gratuitement. Les motivations intrinsèques sont fragiles et sont
susceptibles d’être détériorées dans certaines conditions. A contrario, un individu est
extrinsèquement motivé quand il entreprend une activité avec l’intention d’en retirer
récompense extérieure (Calder, Staw, 1975), ou bien d'éviter une sanction. La
motivation extrinsèque renvoie donc à des notions assez matérielles.
Le développement des incitations monétaires peut favoriser un crowding-out effect
appelé également effet d’éviction (Frey, 1997). Il y a effet d’éviction quand des
récompenses extrinsèques détériorent les motivations intrinsèques des individus. Bruno
Frey considère que la performance des individus au travail dépend avant tout de leur
motivation. Une récompense monétaire est en mesure de l’améliorer si l’effet
disciplinant (de l’incitation financière) l’emporte sur l’effet d’éviction, mais peut
également la dégrader si le crowding-out effect prime sur l’effet disciplinant. Cette
approche remet donc clairement en question les conclusions de la théorie de l’agence.
Reste à savoir dans quelle mesure l’action du principal (dans ce cas l’assurance
maladie) favorise le crowding out effect ?
Les travaux de psychologie sociale, et notamment ceux issus de l’évaluation
cognitive distinguent les facteurs favorisant la motivation intrinsèque des individus
(crowding-in effect) et ceux qui la détériorent (crowding out effect). Ainsi, la
récompense financière promise par le principal serait-elle en mesure de diminuer le
sentiment d’autodétermination (c’est-à-dire d’autonomie dans l’emploi) et de

5
compétence des individus (Deci, Ryan, 1985). La motivation des individus peut donc
être affectée quand une intervention extérieure détériore la perception qu’ils ont de leur
compétence et de leur autodétermination. Si l’incitation financière favorise le sentiment
de compétence et d’autodétermination, alors la motivation intrinsèque peut être
améliorée. En revanche, si elle l’affaiblit, elle peut être en mesure de la détériorer (Frey,
1997).
Les incitations monétaires sont en mesure de détruire la motivation intrinsèque des
individus notamment quand elles se focalisent uniquement sur la performance. Plus le
lien entre la récompense et le niveau de performance souhaité par le principal est fort,
plus l’agent tend vers les incitations extrinsèques. Néanmoins, les récompenses
financières ont un effet moindre sur la motivation intrinsèque que les ordres. À
contrario, les récompenses symboliques influencent positivement les motivations
intrinsèques dans la mesure où elles récompensent une implication de l’agent dans son
activité (Narcy, 2007).
La question des motivations et de la réaction aux incitations est au cœur de l'analyse
de la politique économique de santé. D'une part, parce que cette dernières développe
depuis la fin des années 1990 un arsenal de mesures (financières, organisationnelles, …)
reposant largement sur les motivations extrinsèques. D'autre part, parce que la
motivation intrinsèque est présente dans le colloque singulier et permet d'intégrer
l'altruisme égocentrique (Khalil, 2004). En d'autres termes, la bienveillance envers le
malade est une source de satisfaction pour le médecin. Par ailleurs, pour certains
auteurs, la satisfaction intellectuelle est une forme de motivation intrinsèque
(Richardson, 1981).
Une étude récente (Videau, Batifoulier, Arrighi, Gadreau, Ventelou, 2010) a tenté de
mesurer la part des motivations intrinsèques et extrinsèques des médecins. Pour 80 %
des praticiens interrogés, les motivations intrinsèques représentent au moins la moitié
des motivations totales. La catégorie la plus importante (plus de 30 % de l'effectif) est
fortement motivée intrinsèquement (entre 0,6 et 0,7). À l'opposé, les médecins
faiblement (moins de 0,2) et fortement (plus de 0,9) motivés intrinsèquement sont
minoritaires. Il en ressort une forte hétérogénéité du corps médical par rapport aux
motivations. En d'autres termes, le médecin représentatif n'est pas forcément très
fortement motivé intrinsèquement.
1.3. La réaction des médecins face aux incitations
Depuis le début des années 2000, l’objectif des pouvoirs publics est de compléter la
rémunération à l’acte par des éléments de forfaitisation (Samson, 2009). Les deux lois
de 2004, la loi de santé publique du 9 août et celle du 13 août relative à la réforme de
l’assurance maladie participent de cette évolution. La seconde instaure le parcours de
soins coordonnés et met en place une rémunération spécifique du médecin traitant pour
la prise en charge des malades atteints d’affections de longue durée (ALD). Cette
rémunération repose sur un forfait de 40 euros par patient en ALD au titre de la
coordination des soins. La loi du 9 août entend, quant à elle, inciter les praticiens à
s’investir dans les missions de santé publique. Le décret du 14 avril 2005 réformant le
Code de santé publique prévoit d’ailleurs une évaluation obligatoire des pratiques des
médecins en exercice.
Pour mesurer la réaction des praticiens à ces incitations, un panel de 600 médecins
généralistes libéraux a été constitué en 2002 par l’observatoire régional de la santé de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, L’objectif est d’observer et d’analyser les pratiques
médicales et notamment la prise en charge des missions de service public. Ce panel a
été construit par échantillonnage aléatoire stratifié sur le sexe, l’âge (moins de 43 ans,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%