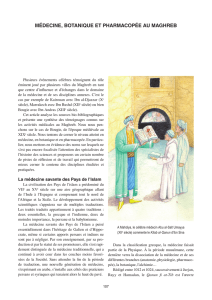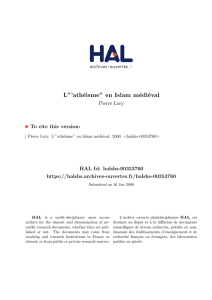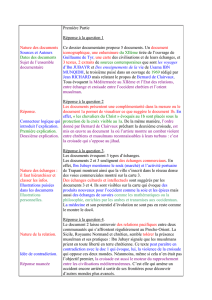La société musulmane et ses minorités religieuses au regard de ses

13 mai 2014
Séminaire RELMIN
Règles de commerce et statut minoritaire
Mohamed Hendaz
La société musulmane et ses minorités religieuses au regard des ses activités commerciales :
Les dhimmi-s et le commerce entre liberté et contrainte.
!
!
!
NB : les textes et articles distribués ici demeurent la propriété de leur auteur, ils ne peuvent être
reproduits ou utilisés sans leur accord préalable.
NB: the papers and articles circulated for this event remain the property of their author. They may
not be reproduced or otherwise used without their prior consent.
Contact : nicolas.stefanni@univ-nantes.fr!
!

1
La société!musulmane et ses minorités religieuses au regard de ses
activités commerciales
Les ḏimmī-s et le commerce entre liberté et contrainte
Dans ce papier, nous proposons d’examiner les échanges commerciaux entre les musulmans et les
minorités religieuses, principalement judéo-chrétiennes, vivant en Occident musulman à l’époque
médiévale. Plus précisément, notre regard se portera sur l’analyse des traités généraux de droit
musulman (fiqh) mais aussi à la littérature des fatwā-s et aux autres travaux composés par les
juristes. Souvent négligés et pourtant nécessaires, ces ouvrages, à la teneur plus circonstanciée,
proposent une grille de lecture davantage contextualisée et mettent en perspective les réalités
sociales souvent absentes des simples manuels de fiqh.
Analyser le traitement des minorités religieuses en terre d’Islam, notamment celui en rapport avec
les activités commerciales, ne pourrait se faire sans une inéluctable consultation du corpus juridique
des lois musulmanes et de ses fondements. En règle générale, il est admis que le système normatif
islamique s’est édifié sur la base commune de deux principes : le Coran et la Tradition (sunna).
C’est en ce sens que nous tenterons d’interroger d’abord ces premières références avant d’explorer
les constructions normatives qui sont censées être, sur le plan doctrinal, leur extension.
Est-ce que le Coran parle des relations financières interconfessionnelles ? Il est difficile de se
prononcer clairement sur cette question. En effet, le texte coranique est, par nature, profondément
allégorique et sa rhétorique n’est pas toujours simple d’accès. De plus, il ne fournit que très peu de
détails et privilégie habituellement les généralités. Toutefois, force est de constater, que certaines
occurrences font, explicitement ou implicitement, allusions aux interactivités commerciales pouvant
exister entre les différentes communautés religieuses. C’est le cas des passages suivants :

2
« Et parmi les gens du Livre (Ahl al-Kitāb), il y en a qui, si tu lui confies un qintar1, te le rend.
Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l’y contrains sans
relâche […] » Coran 3/75.
Ce verset intervient, effectivement, dans un contexte qui s’adresse particulièrement aux fameux
Gens du Livre (Ahl al-Kitāb) : les juifs et les chrétiens. On peut y distinguer ouvertement un appel à
l’échange et au « dialogue inter-confessionnel ». La sourate 3 est réputée pour être de période
médinoise. C’est, en effet, la période où les musulmans connurent, probablement, les premières
relations durables avec les trois principales tribus juives de Yaṯrib (Médine) : les Banū Qurayẓa, les
Banū Qaynuqāʿ et les Banū Naḍīr. Ici, il nous est donné une description nuancée de certains
comportements que les adeptes du judaïsme ou du christianisme pouvaient avoir face aux
problèmes d’argent. Pour résumer, il y aurait l’honnêteté des uns et la malhonnêteté des autres. Au-
delà des considérations morales de ce passage, il convient d’en retenir l’état de fait de l’interaction
sociale, particulièrement dans le domaine impliquant des activités commerciales. Ainsi, à la lecture
de ce passage coranique, il ne semble y avoir aucune interdiction à entretenir des relations
financières avec les Gens du Livre.
Dans une autre passage, beaucoup plus tardif, il est fait mention de la nourriture des Gens du Livre :
« Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est
permise » Coran 5/5
Ce verset offre la possibilité aux musulmans de consommer les nourritures provenant de ceux qui
ont reçu les Écritures et inversement. Rien n’est dit sur la manière d’accéder aux aliments juifs ou
chrétiens, ce qui permet d’envisager différents moyens tels que le don ou l’achat, comme le note
Qurṭūbī2 (m. 671/1273).
Enfin, toujours dans la même sourate, il est question de testament. Le testament implique souvent
des biens à léguer :
1 Le terme arabisé qintar vient de la centenarius latine (Zentner allemand et quintal anglais). Unité de poids,
généralement appliqué dans le Coran à une somme considérable en pièces d’or (habituellement 1 000 ou 10 000 dinars).
2 M. al-Qurṭūbī, al-Ǧāmiʿ li-aḥkām al-Qur’ān, Le Caire, 1964, vol. VI, p. 79.

3
« ô les croyants ! Quand la mort se présente à l’un de vous, le testament sera attesté par deux
hommes intègres d’entre vous, ou deux autres, non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le
monde et que la mort vous frappe. Vous les retiendrez (les deux témoins), après la prière,
puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Dieu : « Nous ne faisons aucun
commerce ou profit avec cela, même s’il s’agit d’un proche, et nous ne cacherons point le
témoignage de Dieu. Sinon, nous serions du nombre des pêcheurs […] » Coran 5/106-108.
Il faut reconnaître qu’il n’est aucunement fait mention des non-musulmans dans cet extrait.
Seulement, pour les juristes et les exégètes, l’expression « deux autres, non des vôtres » implique ici
deux chrétiens en particulier3. Selon cette lecture interprétative, les musulmans en voyage
pourraient faire part de leur testament en prenant à témoin des personnes d’autres confessions.
Cependant, les juristes ne sont pas tous d’accord avec cela, comme en témoigne Ibn Rušd (m.
595/1198), le petit-fils4.
Par ailleurs, la Tradition (sunna) aura gardé en mémoire, entre autres, que le Prophète de l’Islam
avait eu des échanges avec ses voisins juifs à Médine. Selon le célèbre recueil canonique de
traditions, Buḫārī, il est rapporté que : « Le Prophète est mort alors qu’il avait nanti sa cotte de
mailles à un juif en échange de trente mesures (ṣāʿ) d’orge »5. En d’autres mots, il s’est dirigé vers
un juif plutôt qu’un musulman pour emprunter de quoi se nourrir. Même si on ignore les réelles
motivations de ce choix, toujours est-il que ce texte indique des relations.
Ainsi, à l’aune de ces différents passages, on pourrait penser qu’il existait des relations
interpersonnelles impliquant des transactions commerciales. Cela reste, bien évidemment, un aperçu
théorique qui ne peut à lui seul restituer l’aspect pratique. En tout cas, cette première approche
donnera à croire que le plan doctrinal ne semble pas hostile aux échanges sociaux et
particulièrement dans le monde des affaires.
3 ʿAbd al-Ḥaqq Ibn ʿAṭiyya, al-Muḥarrar al-waǧīz fī tafsīr al-kitāb al-ʿazīz, Beyrouth, 2001, vol. II, p. 250 ; Ibn al-
ʿArabī, Aḥkām al-Qur’ān, Beyrouth, 2003, vol. II, p. 230-41 ; Qurṭūbī, op. cit., vol. VI, p. 346-7.
4 M. Ibn Rušd, Bidāyat al-Muǧtahid wa nihāyat al-Muqtasid, Le Caire, sd., vol. IV, p. 246.
5 Muḥammad b. Ismāʿīl al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, Beyrouth, 2001, vol. IV, p. 41.

4
Sur un autre plan, qui est supposé être l’interprétation et l’application légales, les juristes
musulmans ont exprimé leur point de vue à l’égard des ressortissants de confessions différentes,
sous la domination de l’Islam. Les texte qui suivent, extraits de la littérature juridique, spécialement
mâlikite andalouse et maghrébine, représentent le socle normatif des échanges commerciaux avec
les minorités religieuses vivant en terre d’Islam à l’époque médiévale.
Nous sommes parfaitement conscient que l’approche purement juridique que nous proposons ne
saurait satisfaire un médiéviste ou un historien du droit, pas même historien tout court. Cependant,
elle contribuera, peu ou prou, à l’extraction d’un statut légal de la minorité religieuse vivant en terre
d’Islam au Moyen-Âge.
Les activités commerciales du ḏimmī
Selon le juriste andalou Ibn ʿAbd al-Barr (m. 1071), « il n’y a pas de mal (lā ba’sa) à passer un
contrat de musāqāt avec un non-musulman ou n’importe quelle autre forme de contrat de location
de services ou de travaux »6.
Ce juriste nous expose le cas particulier de l’association d’un musulman et d’un non-musulman
dans une affaire commerciale, connue sous le nom de musāqāt7. Ainsi, d’après Ibn ʿAbd al-Barr, un
musulman peut louer ses plantations à un non-musulman afin de les entretenir, en compensation
d’une partie de la récolte.
Cet aspect théorique, apporte en effet des éclaircissements sur les libertés et les contraintes
économiques en terre d’Islam. Le libre exercice d’activités commerciales semble être la règle de
base de son analyse. Cet exemple en est l’illustration. De plus, la tournure utilisée par Ibn ʿAbd al-
Barr donne à croire que la musāqāt avec les non-musulmans ne pose aucun problème. Or, dans la
Mudawwana (Beyrouth : 1994, III, p. 575), Ibn al-Qâsim (m. 806) précisait, deux siècles avant, que
cette possibilité était fonction de l’usage de son salaire (une partie des récoltes ici) qui sera fait par
le chrétien. En d’autres termes, si le chrétien transforme ladite récolte en vin, la musāqāt ne sera
alors plus permise. Cette précision n’apparaît pas dans les propos de l’imam Mālik (m. 795) ni ceux
6 Abū ʿUmar Yūsuf b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Barr al-Qurṭubī, al-Kāfī fī fiqh ahl al-madīna, Riyad, 1980, vol. II, p. 770.
7 Ce terme technique, tel que le définit Ibn ʿAbd al-Barr (II, p. 766), désigne la convention par laquelle un propriétaire
concède la jouissance d’une plantation (palmeraie, vigne, …) à un cultivateur pour une période, afin que ce dernier s’en
occupe moyennant un partage de la récolte dans la proportion convenue entre les parties contractantes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%
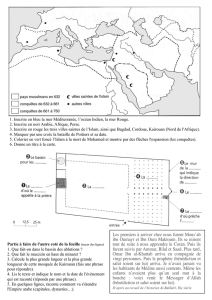

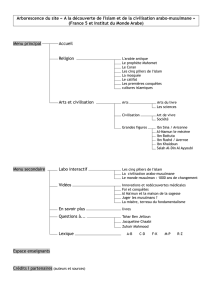
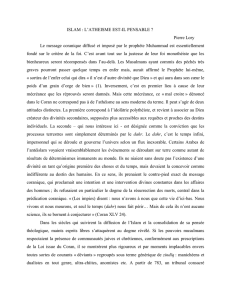


![[halshs-00353760, v1] L`"athéisme" en Islam médiéval](http://s1.studylibfr.com/store/data/004243699_1-541f8da2df16374839fa4fe85eac3f98-300x300.png)