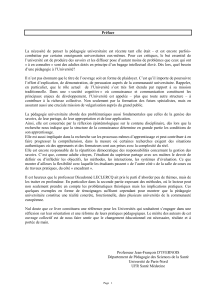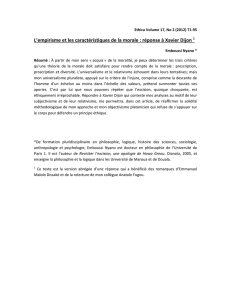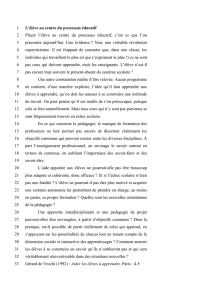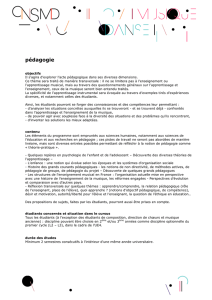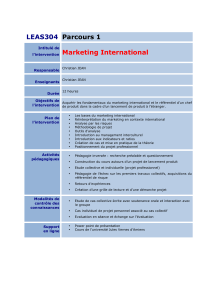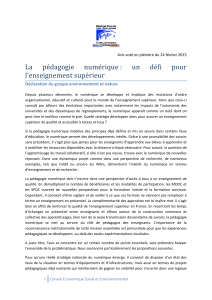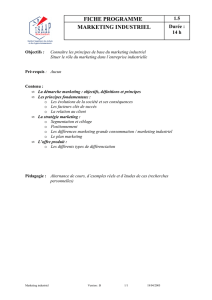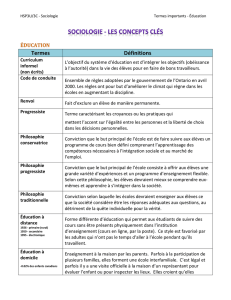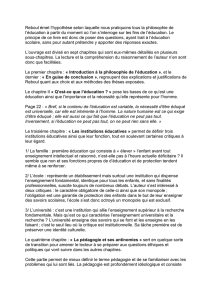L`École entre sociologie, culture et philosophie : la chance de la

Revue Française de Pédagogie, n° 135, avril-mai-juin 2001, 117-124 117
La lecture des travaux que Jean-Claude Forquin
a publiés jusqu’à ce jour appelle ma réflexion
dans trois directions, et elle fait dans le même
temps lever en moi trois questionnements qui
devraient continuer à nourrir le débat entre nous.
Quel plus bel hommage en effet à rendre à un
intellectuel que de traiter ses productions non pas
comme celles d’un ego mandarinal qui n’atten-
drait qu’encensements, ou encore comme celles
d’un petit mandarin qui n’attendrait de l’autre que
la confirmation implicite de ce qu’il pense, mais
comme des objets ouverts à la discussion
publique ? Le chantier permanent des « sciences
de l’éducation » offre heureusement cette possibi-
lité, sans doute plus que d’autres. On admettra
qu’humainement parlant, chacun aime bien avoir
raison, mais faut-il rappeler que, dans le monde
d’un savoir universitaire qui reste en formation,
chacun n’est pas toute la raison, et que l’on n’est
même pas sûr de l’avoir tous ensemble... C’est
pourquoi l’on discute (1).
Ma réflexion se développera autour de trois
binômes qui combineront les éléments constitutifs
du titre de cette contribution : 1) sociologie et
pédagogie ; 2) culture et pédagogie ; 3) pédago-
gie et relativisme culturel.
SOCIOLOGIE ET PÉDAGOGIE
Je sais gré à Jean-Claude Forquin d’avoir, au
milieu de la déferlante sociologique, laissé sa
chance à la philosophie. Il a, en faisant le détour
par la Grande-Bretagne, éveillé le lecteur français
à l’idée que la sociologie de l’éducation n’était
pas forcément une entreprise qui surplombait
la réalité sociale en la soumettant à une Idée
sacralisée : la Reproduction, l’École capitaliste, et
maintenant le Sujet. C’est vrai que, face à cette
prétention, le philosophe avait l’impression de se
sentir dépossédé. Il avait beau expliquer que le
sacre de la grande Idée ne pouvait se faire sans
qu’elle trouve par ailleurs sa justification, qu’il fal-
lait encore et toujours s’expliquer sur le choix
d’une hypothèse globale d’explication : pourquoi
ce « grand Intégrateur » plutôt qu’un autre ? Et
l’Intégrateur suprême, la Société elle-même, pou-
vait-elle être comprise hors de la fin qu’on lui
assignait, et qui fait qu’il y a plusieurs « modèles
sociaux » ?... Vox clamans in deserto, la vague
idéologico-sociologique était telle que le philo-
sophe se trouvait régulièrement rejeté sur la
berge, ou bien se voyait condamné au rôle du
barde de service dans la célèbre bande dessinée,
qui, après avoir ennuyé tout le monde de son
L’École entre sociologie,
culture et philosophie :
la chance de la pédagogie
Michel Soëtard
Sociologie, pédagogie et culture

chant insipide, finit bâillonné tandis que les autres
font la fête... Or, en nous faisant connaître, sur la
question de l’École, « le point de vue des socio-
logues britanniques », alors que nous étions
culturellement conditionnés à soumettre les faits
sociaux à l’unicité d’un Je pense, en nous ouvrant
les portes d’une recherche anglophone « puis-
sante et plurielle », Jean-Claude Forquin nous a
conduits à regarder le fait social pris à sa juste
mesure, qui se mesure d’abord à la diversité des
regards portés sur lui. Je ne sais jusqu’à quel
point son travail fut prémonitoire, et s’il a effecti-
vement favorisé les évolutions que nous consta-
tons actuellement, je veux dire : le retour de la
sociologie à une modestie épistémologique régu-
lée par l’expérience et, dans le cadre de l’école,
attentive à ce qui en constitue le noyau dur, à
savoir l’élève en situation d’apprentissage. Tou-
jours est-il qu’il nous a laissé entendre qu’il n’y
avait pas qu’une seule sociologie de l’éducation,
que plusieurs écoles sociologiques pouvaient
même coexister dans un même pays (la Grande-
Bretagne à vrai dire !), en s’affrontant durement et
sans craindre les implications politiques, dès lors
que l’on se donnait un objet de discussion. Il
nous faut prendre acte de ce que, dans ce
domaine comme en d’autres, l’intellectualité fran-
çaise, avec sa propension au système d’idées
clos sur lui-même, ne constitue pas le nombril de
la pensée européenne.
Intéressant est, dans cette réflexion inspirée par
la sociologie britannique de l’éducation, le fait
que la connexion se soit pour ainsi dire naturelle-
ment établie avec la pédagogie. Ce n’est pas que
les travaux classiques (dans la tradition durkhei-
mienne) de sociologie de l’éducation en perdent
leur utilité et leur valeur : il faudra toujours s’en-
quérir de savoir scientifiquement comment les
choses fonctionnent globalement dans notre
société, et à quel point la réalité constatée est à
mille lieues de l’idéal social dont on rêve dans les
chaumières et dont on se targue dans les palais.
Mais il y a, à côté de cela, une réalité sociale quo-
tidienne qui est en mouvement dans le monde de
l’éducation, et dans d’autres mondes, et que le
savant se doit d’éclairer pour que le praticien
avance plus sûrement. La sociologie du curricu-
lum, chère à nos collègues britanniques, et que
nous aurions tort de réduire à une affaire de pro-
gramme scolaire (un nouvel avatar de notre
abstractionnisme français : le didactisme), se pré-
sente comme un effort de compréhension de
l’acte d’apprentissage dans toutes ses dimen-
sions sociales. La pédagogie a, par chez nous
aussi, tout à gagner de cette « nouvelle sociologie
de l’éducation » qui privilégie les approches de
terrain, l’observation directe des comportements
et des situations, le recueil des données dans les
contextes naturels et quotidiens. Elle a encore
beaucoup à gagner d’une philosophie qui se
détourne des « usines à gaz idéologiques » pour
s’attacher au langage du sens commun et lui ren-
voyer l’image d’une vérité qui lui est immanente...
Ici se trouve implicitement posée la question du
rapport entre sociologie, pédagogie, et la philoso-
phie sociale qui sous-tend l’une comme l’autre. Si
l’on prend le schéma durkheimien d’une pédago-
gie qui ne serait que le reflet d’un état éducatif de
la société, alors il faut travailler sur la transforma-
tion sociale par l’école et de l’école, globalement
parlant. Mais si, sans renoncer à cet objectif, on
constate que le consensus social tend à se déli-
ter et que les individus sont portés à dicter leur
loi aux structures, alors il faut bien s’intéresser à
leur cheminement personnel à travers le laby-
rinthe social, et à travers la société scolaire en
particulier (2). C’est alors que le sociologue ren-
contre le pédagogue, qui porte instinctivement
son regard vers le bas, là où les comportements
s’inscrivent dans une trajectoire sociale qui peut
être celle-ci ou celle-là, qui peut être linéaire, ou
brusquement bifurquer : à la science sociologique
d’en dégager les constantes, même si celles-ci
restent menacées par l’aléatoire individuel.
CULTURE ET PÉDAGOGIE
L’apport le plus intéressant des travaux de
Jean-Claude Forquin me semble trouver son ori-
gine, comme c’est souvent le cas pour les univer-
sitaires qui ont passé des années à creuser un
sujet, dans l’ouvrage directement issu de sa
thèse, et qui inspire le titre de ce colloque : École
et culture. J’y reviens régulièrement, et je ne
compte pas le nombre d’étudiants qui trouvent
dans sa lecture de solides stimulations pour la
réflexion.
Ce qui retient plus précisément l’attention du
philosophe, par-delà les analyses serrées et acé-
rées des positions des sociologues britanniques,
ce sont les considérations finales sur les rapports
118 Revue Française de Pédagogie, n° 135, avril-mai-juin 2001

entre pédagogie, sociologie et culture. Forquin y
tient à distance, en les articulant entre elles, la
« raison sociologique » et la « raison pédago-
gique ». De la raison sociologique, il dit qu’elle
« est tout entière tournée vers la description, l’ex-
plication, l’objectivation des phénomènes. Le
déterminisme est son ressort heuristique, le rela-
tivisme sa tentation naturelle, le cynisme théo-
rique sa vertu ». « Au contraire, poursuit-il, la rai-
son pédagogique est essentiellement normative et
prescriptive, sa tentation naturelle est l’universa-
lisme (...) sa postulation normale, une certaine
sorte d’idéalisme pratique ». Si la sociologie n’a
que faire des valeurs, sauf à les réduire à des
faits descriptibles, le concept d’éducation, lui,
est structurellement – « phénoménologiquement »
insiste Forquin – inséparable du concept de
valeur, indissociable d’un ordre et d’une échelle
des valeurs. Il est prescriptif. Et l’on sait que le
descriptif et le prescriptif ne peuvent pas se sup-
porter. « C’est pourquoi, conclut notre collègue,
la collaboration entre sociologie et pédagogie est
l’objet d’un contentieux perpétuel et le théâtre
d’un perpétuel malentendu » (p. 185).
On ne peut s’empêcher de mettre en rapport, et
en contrepoint, le constat de ce malentendu avec
les analyses des positions des sociologues bri-
tanniques qui constituent la matière de l’ouvrage.
Ce qu’il est convenu d’appeler l’« empirisme
anglais » véhicule dans le même mouvement, sur
la base de la reconnaissance d’un primat du fait
sur l’idée, tout à la fois des analyses scienti-
fiques, aussi fines que rigoureuses, des situations
sociales données, et une appréciation des valeurs
mises en œuvre à travers ce qui est recherché en
fait. Même lorsqu’elle se veut critique, comme
dans le cas de la « nouvelle sociologie de l’édu-
cation », et qu’elle s’emploie à prendre en compte
les présupposés idéologiques qui sous-tendent
les processus et les procédures scolaires, cette
approche ne va pas jusqu’à inverser le primat du
fait sur l’idée. On comprend que, prisonniers de
notre cartésianisme, nous soyons fascinés par
cette façon de procéder qui pose le problème
résolu en principe avant même qu’il soit théori-
quement posé (avec le risque, chez nous, qu’il ne
quitte pas la théorie...). Mais on ne se refait pas
culturellement : le rapport entre sociologie et
pédagogie ne peut être, dans notre bonne France,
que « tragique » condamné au malentendu (3).
Nous sommes peut-être en cela les héritiers
d’une troisième culture, je veux dire : de celle qui,
à partir de Kant et de l’idéalisme allemand, a
façonné notre façon de penser moderne, et de la
manière la plus systématique. Le « perpétuel mal-
entendu » sur lequel Jean-Claude Forquin met le
doigt renvoie au fond, chez le philosophe de
Königsberg, au statut de la liberté dans son rap-
port à la nature. C’est que nous nous découvrons
tout à la fois comme des êtres bien enracinés
dans la nature, mais tout autant capables de nous
en dégager pour penser un sens qui ne lui doive
rien : l’éducation s’appuie précisément sur ce
pouvoir dont nous disposons de par notre liberté.
L’homme est, pour reprendre une formule de la
Critique de la raison pratique, un être « raison-
nable et fini » : fini, il est entièrement soumis au
mécanisme de la nature et déterminé par les
causes qui agissent sur lui (ce qui donne prise
aux sciences humaines) ; mais, raisonnable, il est
capable de penser un sens en soi qui le satisfasse
pleinement (ce qui laisse place à la philosophie).
C’est ainsi qu’un fossé, qui paraît infranchissable,
se creuse entre le domaine de la nature (sociali-
sée) et le domaine de la liberté. Or cette liberté,
si elle veut se réaliser, doit nécessairement trou-
ver un chemin, et où peut-elle le trouver ailleurs
que dans la nature et dans sa transformation
sociale ? Si l’homme veut pouvoir agir sur elle en
vue de l’humaniser – et il agit de fait en ce sens,
il éduque de fait –, il importe que la réalité soit
déjà jusqu’à un certain point finalisée par la
liberté (4). Mais, insiste Eric Weil, jusqu’à un point
seulement, faute de quoi la liberté, réduite au fait
finalisé, en devient insensée.
Nos collègues britanniques partent du fait que
la liberté est à l’œuvre dans la société, que celle-
ci est finalisée de fait par la liberté : la critique ne
peut donc être radicale, elle doit se satisfaire
d’accompagner, de façon assurément critique, un
processus qui est déjà de la liberté à l’œuvre ; la
déconstruction n’est jamais telle chez eux que les
choses ne puissent « fonctionner ». Héritiers de la
tradition allemande, nous sommes, nous, plus
radicaux : si la liberté doit trouver son chemin
dans la nature, ce « devoir » n’est pas de l’ordre
de la nécessité physique, il est porté par une
volonté qui doit d’une façon ou d’une autre faire
plier les faits. D’où notre volontarisme, volontiers
« républicain ».
Il est intéressant, à ce point de notre approche
comparative, de mettre en regard les analyses de
la pensée anglo-saxonne que nous offre Jean-
Claude Forquin, tant dans le champ de la socio-
L’École entre sociologie, culture et philosophie : la chance de la pédagogie 119

logie que dans celui de la philosophie, et le
concept de Bildung, central dans la pensée alle-
mande, et qui peut trouver une traduction dans le
terme de « culture ». Ses origines sont lointaines,
religieuses et mystiques chez Jakob Böhme ;
Herder l’a « éclairé », c’est-à-dire sécularisé, au
XVIIIesiècle ; il va s’épanouir avec Hegel et sur-
tout Wilhelm von Humboldt, le fondateur de l’uni-
versité allemande ; il générera encore tout un
courant de la Kulturpädagogik qui, avec des pen-
seurs comme Eduard Spranger et Theodor Litt, va
associer dans un même mouvement le développe-
ment de la nature, le progrès de la société, le
déploiement de la liberté et le sens de l’éduca-
tion (5).
Mais cette célébration, christianisante d’abord,
puis pleinement humanisante, de la Bildung n’est
pas allée sans problème ni questionnement à par-
tir d’une certaine époque et dans un certain
contexte. On s’est pris à douter des vertus de la
culture en observant qu’elle avait accompagné et
soutenu, chez le peuple le plus intellectuellement
doté d’Europe, l’acte de barbarie le plus horrible
et le plus systématiquement organisé : la dé-
marche critique de l’Ecole de Francfort n’a pas
cessé de tourner autour de ce trou de néant
désormais creusé au cœur de la Bildung. En
termes directs : peut-on, après Auschwitz, philo-
sopher (et éduquer) comme avant cette négation
planifiée de l’humain à travers l’éradication de
l’une de ses racines culturelles ?...
C’est sans doute le moment de se souvenir
d’une phrase de Kant relevée dans ses notes
de cours publiées sous le titre Über Pädagogik
(titre français : Réflexions sur l’éducation): «Un
homme peut être physiquement très cultivé (gebil-
det), son esprit peut être très orné ; et il peut
cependant être bien mal cultivé moralement et
n’être qu’un homme méchant » (trad. Philonenko,
Vrin, p. 109). Rousseau, le Rousseau du Discours
sur les sciences et les arts, mais tout autant le
Rousseau de l’Émile que Kant a sous les yeux
lorsqu’il écrit ses notes, n’est pas loin : l’ordre de
la morale, le monde des valeurs, est à distinguer
radicalement de l’ordre de la nature et du fait
social naturalisé. Le premier appelle la liberté, la
recherche de la fin, l’intention, la décision ; le
second postule le déterminisme des faits, il
régresse vers les causes, il cherche a établir des
lois générales.
Comment se situe maintenant la culture par rap-
port à ces deux univers ? Il peut paraître tentant
d’en faire un concept synthétique où se rencon-
trerait le fait social et le sens que l’homme se
donne, comme une espèce d’horizon philoso-
phique indépassable. Ce n’est pas faux, pour
autant que l’objet culturel, comme l’objet esthé-
tique, est porteur de cette finalité qui permet à
l’homme de ne pas vivre comme une bête, mais
de se construire une existence sensée par-delà
les choses de ce monde. Lire une pièce de
Racine, ce n’est pas seulement engranger une
suite de mots, c’est, à travers eux, rejoindre le
sublime humain porté par la question : « Où va
l’homme ? », et en éprouver dans le même temps
une joie esthétique. Nul doute que la culture est
porteuse de valeurs, qu’elle n’est tout simplement
que la valeur humaine mise en forme. Mais peut-
on en rester là et fonder sur ces objets culturels
l’universalité morale, l’universalité de la morale ?
Car c’est bien ce qui est recherché, et Jean-
Claude Forquin y insiste jusqu’à l’obsession :
comment échapper au relativisme culturel dans
l’enseignement ? Faut-il attendre d’une autorité
– en l’occurrence l’État, après l’Église – qu’il défi-
nisse ce qui vaut la peine d’être enseigné ?
L’entreprise est périlleuse, car cette imposition
culturelle n’offre aucune garantie d’universalité.
Qui décide en effet des valeurs, et au nom de
quoi ? Quid des valeurs catholiques lorsqu’une
école qui s’affiche telle compte plus de 80 %
d’enfants musulmans ? L’État a-t-il seulement
encore un pouvoir d’intégration comme au temps
de ses « hussards » ? Les experts sont unanimes :
La République n’éduquera plus... Quand bien
même elle le voudrait, elle n’en a tout simplement
plus les moyens. – Et elle est encore moins en
mesure de moraliser par objets culturels inter-
posés : Alain Kerlan a superbement démontré
l’échec des deux grandes tentatives « scienti-
fiques » en ce sens, celle de Durkheim et celle de
Comte (6). C’est encore le lieu de rappeler la
phrase de Kant, et de prendre en compte son hor-
rible illustration dans l’événement de la shoah : la
société humaine la mieux formée, qui a généré
des Bach, des Hegel, des Goethe, peut à tout
moment user de toute cette culture pour commet-
tre le crime d’humanité. Et que l’on ne dise pas
que c’est un accident de l’histoire : que les
mêmes choses se soient passées en miniature
au Kosovo n’enlève rien à l’intention maléfique
des hommes...
120 Revue Française de Pédagogie, n° 135, avril-mai-juin 2001

C’est dire que ce n’est pas la culture, ni même
la « valeur » qui fait l’homme. Si elle est le pas-
sage obligé de l’humanisation, elle n’en offre pas
la garantie objective, loin de là : encore faut-il
s’enquérir de ce que l’homme va en faire, de la
volonté qu’il va mettre en œuvre pour la plier au
service d’une intention bienfaisante ou d’un
projet maléfique. On sait trop, dans nos milieux
universitaires, que la hauteur du savoir n’offre
aucune garantie quant à la moralité et à l’honnê-
teté des hommes, et qu’elle permet le plus sou-
vent de redoubler de ruses malfaisantes dans les
relations les plus simples, là où l’on attendrait...
de l’humanité. C’est ce qui me rend également
méfiant à l’égard du discours des « valeurs », de
leur soi-disant « retour » (a-t-on seulement jamais
pu vivre sans valeurs ?) et de leur inscription dans
un ciel objectif (hum ! hum !) : m’importe beau-
coup plus ce que l’homme que j’ai devant moi fait
de ces valeurs dans la réalité de son action, et, en
deçà, dans la pureté de son intention (que je ne
pourrai évidemment jamais complètement percer
à jour, mais quand même...).
On retrouve ici la démarche de Kant dans la
Critique du Jugement : l’objet culturel, assuré-
ment généré par la liberté, laisse encore entière la
question de son usage en vue du réel accomplis-
sement de la liberté en l’homme, de sa dignité.
Cet objet peut promouvoir, mais tout autant
étouffer la liberté : il reste ambivalent au regard
de l’intention humaine. On peut en multiplier les
preuves historiques et quotidiennes.
Or à chacun son intention. Échappera-t-on alors
au relativisme, et à sa propagation à travers la
culture et ses productions ? L’École a-t-elle
encore un sens ? L’enseignement est-il encore
justifié ?
PÉDAGOGIE ET RELATIVISME CULTUREL
Plutôt parménidien qu’héraclitéen, Jean-Claude
Forquin reste porté par le souci de faire échapper
l’École au relativisme culturel et moral qui rendrait
son projet insensé. S’il apprécie et nous fait
partager les acquis de la « nouvelle sociologie de
l’éducation », c’est pour engager le débat sur le
relativisme épistémologique qui la sous-tend ;
l’« anthropologie », assurément bien pratique
lorsque l’on veut produire ce mélange suspect de
fait et de sens qui dispense d’aller jusqu’au fond
du questionnement philosophique, le laisse insa-
tisfait pour autant qu’elle ne tranche pas entre le
relativisme et l’universalisme, ou en offre une syn-
thèse trop facile. Reconnaissant que, dans le
contexte des sociétés multiculturelles contempo-
raines, l’école ne peut plus ignorer la diversité
des publics qui lui sont confiés, il postule –
« faute d’argument scientifique ou logique décisif
qui permettrait de trancher “au fond” la querelle
du relativisme » – qu’elle ne peut que faire le
choix de l’universalisme si elle veut garder sa
cohérence, et que ce choix « comme philosophie
justificatrice de l’enseignement reste plausible,
alors que le choix contraire exclut d’enseigner ».
Et il conclut, prudent : « Mais tout le monde est-
il tenu d’enseigner ? » (7).
La réponse est sans doute intellectuellement
satisfaisante, mais elle laisse le pédagogue prati-
cien dans une grande perplexité : s’il lui faut s’ef-
forcer de « mettre l’accent, au niveau des conte-
nus aussi bien qu’au niveau des procédures de
l’enseignement, sur ce qu’il y a de plus profond,
de plus constant et de plus incontestable dans les
manifestations de la culture humaine » (8), quel
est donc le critère de cette « profondeur », de
cette « constance », de cette « incontestatibilité »
qui me permettra d’agir en conséquence ? N’est-
on pas renvoyé aux productions effectives de la
culture humaine, qui, portant toutes les valeurs
possibles, sont précisément le lieu du problème ?
Ou bien faut-il attendre qu’un doigt supérieur
désigne autoritairement ce qui vaut, et que le pro-
fesseur des écoles l’écrive le matin au tableau,
comme Dieu sur les tables de Moïse ? On répon-
dra oui, si l’on est assuré que c’est Dieu.
L’exigence démocratique est cependant devenue
telle que les « sujets » réclament d’être partie pre-
nante dans cette nouvelle « moralisation », surtout
s’il faut admettre que le consensus social n’existe
plus sur cette matière. Alors, à chacun, ou à
chaque groupe ses valeurs ? On est au rouet.
Si l’action pédagogique doit avoir un sens, il
faut bien trouver une réponse théorique au pro-
blème posé, autrement qu’en dissertant sur le tra-
gique de la condition pédagogique. Il s’agit de
dépasser l’empiriquement parlant, qui nous ren-
voie au relativisme, et le transcendantalement
parlant, qui nous aspire vers l’universalisme, en
se positionnant pédagogiquement parlant. Je
m’explique.
L’École entre sociologie, culture et philosophie : la chance de la pédagogie 121
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%