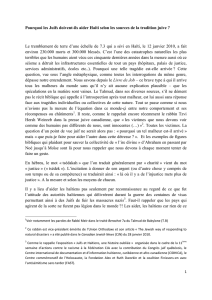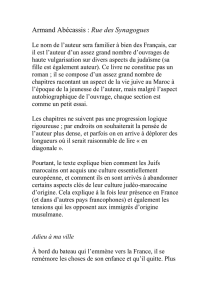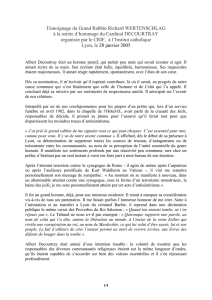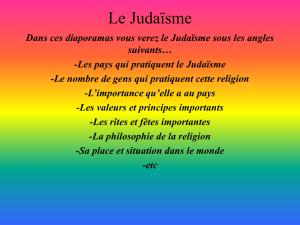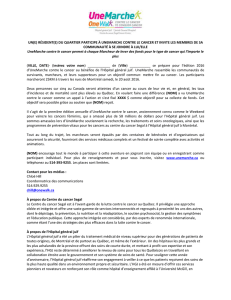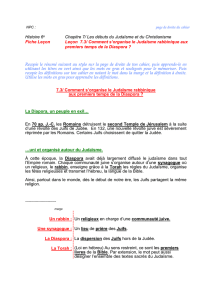Être sépharade à Montréal

DOSSIER SPÉCIAL
Être sépharade à Montréal
26 magazine LVS | Septembre 2015

Ce dossier «Être sépha-
rade à Montréal » est
le premier d’une série
que le LVS consacrera
à l’identité sépharade
dans le monde.
La présence sépharade
au Québec date déjà de
quelques siècles comme
en témoigne la première
synagogue « Sheerit
Israël. Spanish and Portuguese Congregation»
créée en 1768 dans la Belle Province. Et même
si, depuis lors il y eut des Sépharades et non des
moindres comme le rabbin Abraham de Sola
(1825-1882), également professeur d’hébreu
et de littérature à l’Université McGill, la venue
importante des Sépharades au Québec date de la
seconde moitié du XXème siècle. Elle commença
vers les années cinquante par la venue de Juifs
d’Égypte, d’Irak, de Turquie, du Liban, d’Iran,
des Balkans avant celle des Juifs du Maroc qui
constituèrent la large majorité de cette commu-
nauté. Plus de cinquante ans plus tard, soit déjà
trois générations, il est légitime de s’interroger
sur la condition des Juifs sépharades à Montréal,
leurs contributions, leur héritage, la pérennité
de leur identité et culture dans cette partie de
l’Amérique du Nord. Et ce d’autant plus, que la
communauté sépharade de Montréal est l’une
des plus importantes après celles d’Israël et de
la France.
Vous trouverez dans ce dossier, loin d’être ex-
haustif comme vous pouvez vous en douter dans
le cadre d’un magazine, des contributions très
diverses. Le résumé de l’analyse sociologique de
l’étude du démographe Charles Shahar et celle
de Robert Abitbol, portant sur les tendances, les
orientations et le devenir de notre communauté.
Pour savoir où l’on va, il faut d’abord savoir d’où
l’on vient, l’adage est bien connu, c’est pourquoi
nous publions un témoignage de Jean-Claude
Lasry, l’un des fondateurs de cette communauté
à Montréal ainsi que l’extrait d’un texte de l’uni-
versitaire Esther Benaim-Ouaknine. Nous avons
organisé une table ronde avec des membres de
sensibilités diverses, Sylvia Assouline, Michaël
Cohen et Amnon Suissa en les interrogeant sur
les caractéristiques de l’identité sépharade,
l’évolution et le devenir de la communauté sé-
pharade à Montréal. Nous avons également sol-
licité deux jeunes adultes, la relève en quelque
sorte, Patrick Bensoussan et Karen Aflalo à ce
sujet. Nous publions aussi un article du rabbin
Ronen Abitbol, qui interpelle les Sépharades
montréalais sur leur rapport à la loi juive telle
qu’elle a été transmise par les maitres de la tra-
dition sépharade. En ce qui concerne la riche
production culturelle de la communauté sépha-
rade de Montréal, nous avons dû faire un choix
et porter notre attention sur certains aspects de
la création musicale. Que les artistes et créa-
teurs des autres domaines (littérature, théâtre et
peinture) ne nous en tiennent pas rigueur, nous
aurons l’occasion de revenir sur leurs créations
comme nous reviendrons sur tout autre domaine
qui aurait pu être négligé dans cette première li-
vraison. Nous songeons notamment aux Sépha-
rades qui ont choisi de suivre les traditions has-
sidiques des mouvements Loubavich ou Breslav
souvent mentionnés au fil des articles et à qui
nous souhaiterions aussi donner prochainement
la parole. Enfin, afin d’étayer votre réflexion,
nous avons introduit et publié l’extrait d’un
texte du philosophe juif contemporain Shmuel
Trigano, sur les critères de définition de l’iden-
tité sépharade ainsi que des réflexions de deux
penseurs de notre communauté Maurice Chalom
et Léon Oiknine. Il ne reste plus qu’à vous sou-
haiter une bonne lecture et surtout une bonne
année 5776.
Dr Sonia Sarah Lipsyc
ÉDITORIAL
magazine LVS | Septembre 2015 27

28 Magazine LVS | Septembre 2015
ÊTRE SÉPHARADE À MONTRÉAL | DOSSIER SPÉCIAL
Nombre de Sépharades à Montréal
et leur catégorie d’âge
La région métropolitaine de recensement (RMR) de
Montréal compte 22225 Sépharades parmi lesquels 50,2%
de femmes et 49,8 % d’hommes. Les Sépharades repré-
sentent donc 24,5% des 90780 membres de la communauté
juive montréalaise. Ce chiffre est en hausse par rapport à
l’enquête de 2011 puisqu’à l’époque on recensait 21215 Sé-
pharades soit 22,8% de la communauté juive de Montréal.
La communauté sépharade établie dans la région de
Montréal est répartie comme suit: 3755 enfants de moins
de 15 ans, 3 045 adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans,
5315 personnes âgées de 25 à 44 ans, 5 570 personnes âgées
de 45 à 64 ans et 4 540 personnes âgées de 65 ans et plus. Le
plus important groupe d’âge chez les Sépharades est celui
des adultes d’âge moyen (45-64 ans). Environ une personne
sépharade sur cinq (20,4%) fait partie des aînés. Étant don-
né qu’un nombre important de personnes d’âge moyen
approchent de l’âge de 65 ans, la proportion des personnes
âgées chez les Sépharades devrait augmenter sensiblement.
Où habitent les Sépharades dans la RMR de Montréal?
Le quartier de Côte-Saint-Luc (CSL) compte la plus
importante communauté sépharade de la RMR de Mon-
tréal (5580 personnes). Cependant les Sépharades n’y re-
présentent que 28,8% des 19395 Juifs qui y résident, bien
que leur augmentation y soit plus importante (…).Les Sé-
pharades sont également nombreux à Ville Saint-Laurent
(3365) où l’on trouve la plus forte proportion de Sépharades,
car ils représentent 47,7% de la population juive. Il y a aussi
une forte proportion de Sépharades à Mont-Royal (39,6%)
et à Chomedey (36,8%).
Le quartier Snowdon affiche le déclin le plus important
du nombre de Sépharades (- 805). Les pertes dans Snowdon
et Côte-des-Neiges sont d’autant plus préoccupantes que
la plupart des services pour la communauté sépharade sont
situés dans ces quartiers ou du moins à proximité.
Origines des Juifs sépharades d’aujourd’hui
Parmi les Sépharades vivant dans la RMR de Montréal,
9 735 sont nés au Canada, ce qui représente 43,8 % de la
communauté sépharade. Le reste de la population sépha-
rade, 56,2% est composé d’immigrants parmi lesquels plus
du quart (28,3%) sont nés au Maroc. Viennent ensuite, par
ordre décroissant, les personnes nées en France (1690) et
en Israël (1 415); 575 sont nés en Égypte, 430 en Iraq, 410
sont des Sépharades nés en Europe de l’Ouest notamment
en Espagne, Portugal et Grèce, 335 sont natifs d’Algérie/
Libye/Tunisie, 290 du Liban, 230 Sépharades sont nés en
Europe de l’Est, soit en Bulgarie ou dans l’ex-Yougoslavie,
220 en Turquie, 105 en Iran, 35 en Syrie, etc.
Langues parlées par les Sépharades à Montréal
En ce qui concerne la langue maternelle,de toute évi-
dence, le français domine (73%). L’anglais est la langue pre-
mière de 9,2% des Sépharades et l’hébreu, de 7% d’entre
eux. Une plus faible proportion (4%) indique l’arabe comme
langue maternelle et 3,8%, l’espagnol.
Pour ce qui est de la langue parlée:
62,3% des Sépharades disent parler français, tandis que
30,7% disent parler anglais. L’usage de l’anglais au foyer
a connu une augmentation puisqu’en 2001, elle était utili-
sée par 26,5% des Sépharades. L’utilisation du français au
foyer a diminué, passant de 67,8% à 62,3%. Cette tendance
La communauté sépharade
en quelques chiffres
En 2011, Charles Shahar démographe de la Fédération CJA a entamé son étude démographique
et sociologique de la communauté juive de Montréal. La précédente enquête datait de 2001.
L’étude sur la communauté sépharade représente donc le 7ème volet de son «Enquête nationale
auprès des Ménages de la Communauté juive de Montréal ». Les résultats de cette dernière
partie sur la communauté sépharades ont été mis en ligne en avril 20151.
Nous reprenons ci-dessous les faits saillants de cette étude tels qu’ils ont été présentés en
ajoutant quelques précisions tirées de l’ensemble de l’étude sans faire gurer cependant, par
commodité de lecture, les guillemets propres à des citations de textes.
Les conclusions de cette étude, quant aux dés à relever qu’elle souligne, seront exposées dans
une deuxième partie lors d’une prochaine parution du LVS.

Magazine LVS | Septembre 2015 29
ÊTRE SÉPHARADE À MONTRÉAL | DOSSIER SPÉCIAL
peut tenir en partie au fait que les Sépharades d’âge scolaire
ayant immigré durant les années 1960 et 1970 ont fréquenté
les écoles anglophones protestantes ou juives, parce qu’ils
ne pouvaient fréquenter les écoles francophones catho-
liques, et ont par la suite inscrit leurs enfants dans le même
type d’écoles. La langue parlée à la maison serait influencée
par la langue à laquelle les Sépharades ont été exposés du-
rant leurs études.Seulement 3,4% parlent hébreu au foyer,
1,2% parlent espagnol et 0,7% parlent arabe.
Situation familiale des Sépharades
La grande majorité des Sépharades (73,8 %) vit en
couple soit 16395. Cependant le pourcentage de personnes
divorcées ou séparées est un peu plus élevé chez les Sépha-
rades que dans le reste de la communauté juive (respective-
ment 7,6% et 6,6%).
Une personne sépharade sur dix (10 %) vit dans une
famille monoparentale soit 2215 personnes. Ce nombre a
augmenté durant la dernière décennie car il y avait 1920
familles monoparentales en 2001. (…)
Les familles monoparentales sont plus nombreuses
chez les Sépharades que dans le reste de la communauté
juive (respectivement 10 % et 7,7 %) même si on trouve
moins de familles monoparentales chez les Sépharades que
dans l’ensemble de la population de Montréal.
Il y a dans cette communauté 15 % qui sont des per-
sonnes seules soit 3 330 (vivant seules ou avec des per-
sonnes non apparentées). La proportion de personnes
seules est plus faible chez les Sépharades que dans le reste
de la communauté juive (respectivement 15% et 16,9%). Il
faut cependant relever que près du tiers (30,5%) des Sépha-
rades âgés de 65 ans et plus sont des personnes seules, ce
qui représente 1385 personnes. Ces personnes âgées consti-
tuent un groupe particulièrement vulnérable, surtout si
elles n’ont pas de familles ni autres soutiens sociaux, et si
elles ont difficilement accès à des services.
Niveau d’étude des Sépharades
Le pourcentage de Sépharades adultes titulaires d’un
diplôme universitaire a sensiblement augmenté : de 35,7%
en 2001, il est passé à 45,7% en 2011. Comparativement au
reste de la communauté juive, le pourcentage des titulaires
d’un diplôme de premier cycle (29,7%) est plus élevé que
dans le reste de la communauté juive (28,4%) ainsi que le
pourcentage de diplômés Sépharades d’un Cégep ou d’une
école de métiers (respectivement 24,2% et 19,2%). Cepen-
dant les titulaires d’une maîtrise sont en plus faible pro-
portion chez les Sépharades (12,7% et 13,7%), ainsi que les
titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme de médecine (3,3%
et 4,2 %). Le pourcentage de titulaires d’un diplôme uni-
versitaire est beaucoup plus élevé chez les Sépharades que
dans l’ensemble de la population de Montréal (respective-
ment 45,7% et 29,1%).
Quelles sont les professions que
les Sépharades exercent?
Les professions libérales regroupent le plus grand
nombre de Sépharades (3 270); suivent les travailleurs du
secteur de la vente et des services (2 665), les cadres supé-
rieurs et intermédiaires (2 155), le personnel technique et
para professionnel (1 905) et le personnel de secrétariat
et de bureau (1 055). Les Sépharades sont bien représen-
tés dans les diverses catégories professionnelles.Par rap-
port au reste de la communauté juive, les répartitions sont
sensiblement semblables. Les Sépharades sont un peu plus
nombreux dans la catégorie des cadres supérieurs et inter-
médiaires, du secrétariat et du personnel de bureau, ainsi
que dans le secteur de la vente et des services. Alors que l’on
trouve dans le reste de la communauté juive une proportion
légèrement plus forte de membres de professions libérales
et de travailleurs techniques (…).
Niveau de vie des Sépharades
47,2% des Sépharades se situent dans les tranches de
faible revenu (moins de 25000 $), chiffre en baisse com-
parativement au 55,1% de 2001. Ce pourcentage est légère-
ment plus élevé que dans le reste de la communauté juive
(46,1%). Mais leur proportion est légèrement inférieure à
celle de l’ensemble de la population de Montréal (48,4%).
Le revenu médian des Sépharades (29 790 $) est
quelque peu inférieur à celui des Ashkénazes (31 148 $)
mais plus élevé que celui de l’ensemble de la population de
Montréal (28306$).
17,8% des Sépharades se situent dans les tranches de
revenu élevé (70000$ et plus), soit une augmentation sen-
sible par rapport à 2001 (10,4%).
Ce pourcentage est légèrement inférieur à celui du
reste de la communauté juive (19,7 %) mais supérieur à
l’ensemble de la population de Montréal (11,6%).
Le taux de pauvreté des Juifs Sépharades:
On compte 4 080 Sépharades pauvres dans la région
de Montréal, ce qui représente 18,4% de la population sé-
pharade. Ce taux a augmenté durant la dernière décennie,
puisqu’il était de 17,8 % en 2011. Cette augmentation est
toutefois plus faible que celle que l’on constate dans le reste
de la communauté juive : de 18,6% en 2001, elle est passée
à 20,5% en 2011. Le taux de pauvreté chez les Sépharades
est inférieur à celui de l’ensemble de la communauté juive
ainsi qu’à celui de l’ensemble de la population de Montréal
(20,5%).
Les Sépharades les plus vulnérables sont les personnes
âgées vivant seules (47,7%), les adultes de 15 à 64 ans vivant
seuls (47,3%) et les membres d’une famille monoparentale
dirigée par une femme (32,7%)
Sonia Sarah Lipsyc
1 Pour l’ensemble de l’enquête et plus particulièrement l’étude sur la communauté sépharade voir
http://www.federationcja.org/media/mediaContent/2011%20Montreal_Part7_Sephardic%20Community_Final-F.pdf

30 Magazine LVS | Septembre 2015
ÊTRE SÉPHARADE À MONTRÉAL | DOSSIER SPÉCIAL
Identité et Organisation
Entre sauvegarde et mutation
Il nous paraissait nécessaire, depuis quelques années, de com-
prendre l’évolution des structures communautaires en place, les
nouvelles formes d’adhésion et de comportements collectifs de
la communauté sépharade à Montréal. Nous croyons qu’après
plus de cinquante ans de présence d’immigrants juifs d’Afrique
du Nord à Montréal, les leaders et les décisionnaires des insti-
tutions communautaires devraient entamer un long processus
de réflexion sur « l’état des lieux » ainsi qu’une analyse sur la
construction de la mémoire et de l’identité de leurs membres.
Nous présumons que, le temps et à la rencontre des socié-
tés nord-américaines (juive et non-juive), le foisonnement de
reconstructions identitaires de ces immigrants et des généra-
tions subséquentes, donneraient lieu à une réinvention du modèle
organisationnel communautaire. Ce processus prend plusieurs
voix et notamment celle de la recherche et de la compréhension
des motivations premières de la construction d’une société juive
sépharade au sein de la grande communauté juive montréalaise.
Vous trouverez, dans le texte qui suit, quelques éléments de
cette recherche.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%