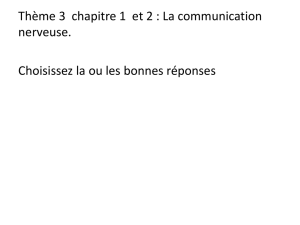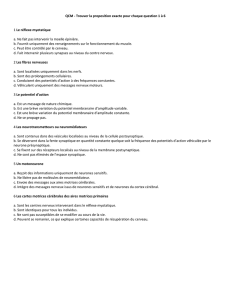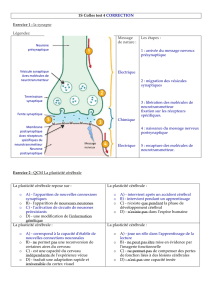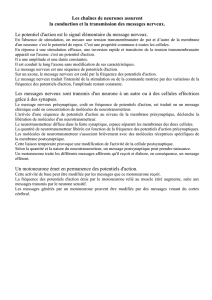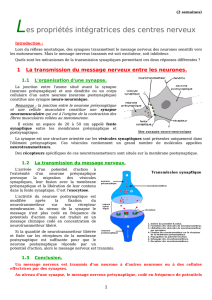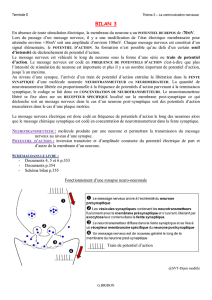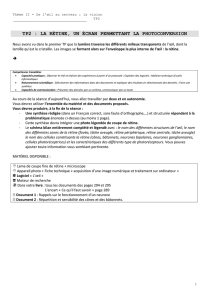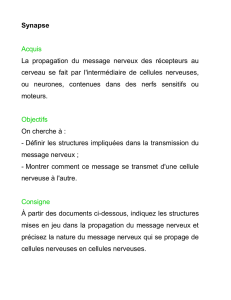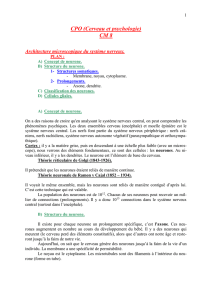QCM « La part du génotype et de l`expérience individuelle sur le

1
QCM « La part du génotype et de l’expérience individuelle sur le fonctionnement du
système nerveux »
1. Un animal spinal :
A- est aveugle.
B- n’a plus de réflexes médullaires.
C- ne sécrète plus d’hormones sexuelles.
D- va le plus souvent avoir une dégénérescence de sa moelle épinière.
E- n’a plus de communications entre sa moelle épinière et son encéphale.
2. La plasticité du cortex cérébral :
A- est essentiellement synaptique.
B- peut se manifester tout au long de la vie chez l’Homme.
C- peut se localiser au niveau des aires sensorielles.
D- est sa capacité à changer de localisation des aires.
E- est indépendante du milieu.
3. Les neuromédiateurs des synapses inhibitrices :
A- sont des ions chlore ou potassium.
B- peuvent être indifféremment fabriqués par le neurone pré- ou le neurone postsynaptique.
C- sont synthétisés par le neurone présynaptique à l’arrivée du PA.
D- seraient des poisons mortels si on les injectait à un sujet.
E- seraient des poisons mortels si on les injectait même à l’individu sur lequel on les aurait prélevés.
4. Le message nerveux de nature électrique :
A- peut être enregistré à l’aide d’électrodes placées à la surface de la peau.
B- peut être enregistré à l’aide d’électrodes à la surface d’un nerf.
C- peut être enregistré à l’aide d’électrodes dans et à la surface d’un nerf.
D- ne se propage pas au niveau d’une synapse.
5. Les motoneurones :
A- conduisent des messages nerveux stimulateurs et inhibiteurs.
B- ont leur corps cellulaire localisé dans la substance grise de la moelle épinière.
C- sont directement stimulés par les neurones sensitifs.
D- présentent sur la membrane plasmique de leur corps cellulaire des récepteurs spécifiques aux
neurotransmetteurs.
6. La substance blanche :
A- doit son qualificatif à l’abondance de la myéline.
B- renferme les corps cellulaires des neurones moteurs.
C- peut contenir des fibres nerveuses sensitives et motrices.
D- est située au centre de la moelle épinière.
7. Excitabilité des membranes :
A- le potentiel d’action est le signal élémentaire du message nerveux.
B- le potentiel d’action prend naissance à partir d’un seuil de dépolarisation.
C- l’amplitude du potentiel d’action est fonction de l’intensité de stimulation.
D- la vitesse de propagation augmente avec le diamètre de la fibre nerveuse.
8. À propos du message nerveux :
A- la vitesse de propagation du potentiel d’action peut dépendre du diamètre de la fibre nerveuse.
B- un neurone postsynaptique fait la somme des différents messages afférents qu’il reçoit, il a un rôle
intégrateur.
C- l’amplitude du potentiel d’action sur une fibre nerveuse varie en fonction de l’intensité.
D- le message nerveux à l’échelle du neurone est automatiquement déclenché dès qu’il y a stimulation.
9. Le réflexe myotatique :
A- entraîne un étirement du muscle concerné.
B- est un reflexe monosynaptique.
C- est une réponse involontaire, stéréotypée et innée.
D- a pour stimulus une variation de longueur du muscle.

2
10. À propos de la synapse:
A- l’arrivée d’un message nerveux à la terminaison présynaptique libère le neuromédiateur.
B- les récepteurs aux neuromédiateurs sont fixés sur la face interne de la membrane postsynaptique.
C- les récepteurs postsynaptiques ont une forme complémentaire à celle du neuromédiateur.
D- la quantité de neuromédiateur libéré dépend de l’amplitude des potentiels d’action arrivant à la
terminaison présynaptique.
11. Un neurotransmetteur :
A- peut être soit excitateur soit inhibiteur pour un même neurone postsynaptique.
B- est une molécule chimique véhiculée par le sang jusqu’à un récepteur spécifique.
C- permet le franchissement de la fente synaptique par le potentiel de repos.
D- se fixe sur un récepteur spécifique de la membrane postsynaptique.
E- est libéré dans la fente synaptique avant d’assurer son rôle.
F- est stocké dans des vésicules cytoplasmiques du neurone postsynaptique.
12. Le message nerveux est :
A- au niveau de la fibre, constitué de trains de potentiels d’action.
B- codé par la fréquence de potentiels d’action sur une ou plusieurs fibres nerveuses d’un nerf.
C- toujours transmis dans un nerf efférent quand il est né dans un nerf afférent.
D- traduit en message chimique au niveau d’une synapse.
E- est transmis de manière unidirectionnelle au niveau de la synapse, structure présentant une
organisation symétrique.
13. Les synapses:
A- sont le lieu de communication entre deux neurones ou un neurone et un organe effecteur.
B- neuromusculaires sont situées entre une terminaison neurale et une fibre musculaire.
C- sont uniquement excitatrices.
D- assurent la transmission du message nerveux, du neurone sensitif au neurone moteur ou d’un
neurone sensitif aux interneurones.
14. La plasticité cérébrale:
A- permet au cerveau de s’adapter à des modifications de l’environnement par l’apprentissage.
B- permet au cerveau de récupérer certaines fonctions perdues à la suite de lésions.
C- est liée à la mise en place, non immuable, de réseaux de neurones dans le cortex cérébral.
D- se caractérise par la conservation de connexions entre neurones stimulés et par l’élimination de celles
ne recevant pas d’influx nerveux.
15. Le cortex cérébral :
A- est le siège d’adaptations sensorielles donc de modifications permanentes.
B- n’évolue plus au-delà des premières années d’un homme.
C- évolue de façon permanente grâce à l’apprentissage, qui joue un rôle essentiel.
D- permet, à un individu, lors d’une lésion d’une zone corticale, la récupération partielle de la fonction
détruite, en empruntant d’autres circuits de neurones.
16. Le réflexe rotulien :
A- est un réflexe polysynaptique.
B- est déclenché par l’étirement des muscles fléchisseurs de la jambe.
C- est un réflexe myotatique.
D- est un réflexe à finalité posturale.
E- a pour récepteur un mécanorécepteur : le fuseau neuromusculaire.
17. Le potentiel de repos d’un neurone myélinisé :
A- peut se mesurer à l’aide de deux électrodes placées en surface de l’axone.
B- se mesure à l’aide d’une électrode de mesure intracellulaire et d’une électrode de référence
extracellulaire.
C- a une valeur de l’ordre de + 70mV.
D- montre que la face intracellulaire est électronégative par rapport à la face extracellulaire.
E- est la différence de potentiel transmembranaire du neurone au repos.
18. La section de la racine antérieure d’un nerf rachidien entraîne :
A- une anesthésie du territoire correspondant.
B- une paralysie du territoire correspondant.
C- une dégénérescence du bout central (partie de la racine reliée à la moelle épinière).
D- une dégénérescence du bout périphérique.
E- la section des axones des motoneurones.

3
19. Le cortex cérébral :
A- est constitué de 6 couches de neurones.
B- est constitué de neurones interconnectés.
C- est constitué de substance blanche.
D- s’édifie sous l’action de gènes homéotiques.
20. Le potentiel de repos :
A- correspond à une différence de potentiel transmembranaire du neurone.
B- correspond au potentiel de membrane d’un nerf.
C- traduit une électronégativité relative du milieu intracellulaire.
D- naît automatiquement quand un neurone est stimulé.
21. Un neurotransmetteur :
A- est stocké dans l’élément présynaptique.
B- se fixe sur la membrane présynaptique.
C- pénètre dans l’élément postsynaptique.
D- engendre toujours, en se fixant, un potentiel d’action.
22. Un potentiel postsynaptique excitateur :
A- correspond à une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique.
B- correspond à une dépolarisation de la membrane postsynaptique.
C- ne modifie pas la polarisation membranaire postsynaptique.
D- rend plus facile la génération postsynaptique d’un potentiel d’action.
E- rend plus difficile la génération postsynaptique d’un potentiel d’action.
23. Parmi les neurones constituant un arc réflexe polysynaptique, il y a :
A- les neurones sensitifs des racines ventrales des nerfs rachidiens.
B- les motoneurones des racines dorsales des nerfs rachidiens.
C- les interneurones de la substance grise.
D- les interneurones de la substance blanche.
24. Un potentiel de récepteur est :
A- un potentiel qui peut être propagé localement le long d’un corps cellulaire ou d’une dendrite.
B- codé en fréquence.
C- codé en amplitude.
D- un potentiel qui induit des potentiels d’action à partir d’une valeur seuil.
25. L’intégration nerveuse :
A- désigne la capacité d’un neurone à prendre en compte des informations nerveuses variées
convergeant vers ce neurone par de nombreuses synapses établies avec lui.
B- résulte de l’action sur le neurone présynaptique des variations de concentration de
neurotransmetteur libéré par le neurone postsynaptique en fonction de la fréquence des potentiels
d’action du message nerveux afférent.
C- est un processus par lequel un centre nerveux recevant un ensemble de messages différents élabore
des messages nerveux originaux à l’origine d’une réponse appropriée.
D- peut être due à une sommation spatio-temporelle au niveau d’un neurone présynaptique.
26. L’étirement d’un muscle a pour conséquence directe ou indirecte :
A- le relâchement du muscle antagoniste.
B- la stimulation de nombreuses unités motrices situées dans ce muscle.
C- l’activation des interneurones en rapport avec les motoneurones du (des) muscle(s) antagoniste(s).
D- le tonus musculaire.
27. À propos du génotype et système nerveux :
A- le génotype est responsable de la division du cortex en zones traitant les informations sensorielles.
B- les limites des aires corticales sont fixées de manière irréversible à la naissance.
C- la plasticité cérébrale est déterminée à la naissance.
D- deux vrais jumeaux n’ont pas un phénotype strictement identique en raison de la plasticité pariétale.
28. Le potentiel transmembranaire de repos :
A- correspond à une différence de potentiel électrique.
B- n’existe que dans les cellules nerveuses.
C- n’existe que dans les cellules excitables.
D- existe dans toutes les cellules.
E- est modifié lors de la stimulation d’un neurone.

4
29. Les synapses chimiques :
A- comporte toujours un élément dit posynaptique.
B- sont les moins abondantes du système nerveux chez l’homme.
C- comporte toujours un espace synaptique.
D- comporte une membrane présynaptique sur laquelle se trouvent des récepteurs canaux chimio-
dépendants.
E- font toujours intervenir un neuromédiateur électrique libéré au niveau de la membrane
postsynaptique.
30. Répondez par 1 si les deux propositions sont vraies et si elles ont une relation de cause à effet. Par 2
si elles sont vraies mais n’ont pas de relation de cause à effet. Par 3 si l’une des deux seulement est
fausse. Par 4 si les deux sont fausses.
A- Le maintien de la posture n’est pas un phénomène réflexe car la contraction musculaire peut être
déclenchée par des neurones moteurs corticaux.
B- Le réflexe myotatique agit sur le tonus musculaire car il correspond à une boucle de régulation entre
longueur et contraction du muscle.
C- L’action d’un neurotransmetteur sur une cellule cible n’est pas spécifique car chaque
neurotransmetteur a toujours la même action quelle que soit la cellule cible.
1
/
4
100%