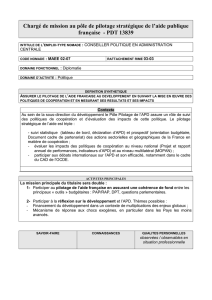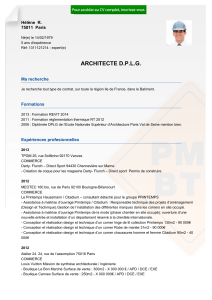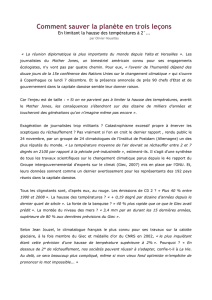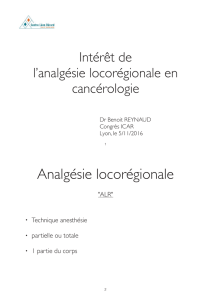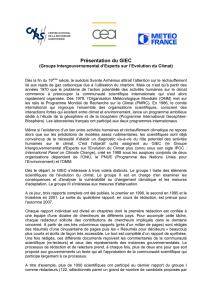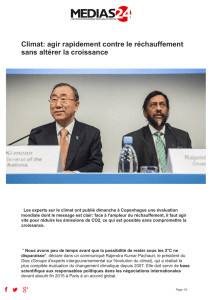Sommaire - Communauté d`agglomération Seine-Eure

Le journal des habitants engagés
pour le développement durable
Sommaire
Le C2D, pour quoi faire, pourquoi pas vous? ....2
Et le développement durable, c’est quoi ? ......2
Culture de la chaleur .......................3
Ces dérèglements, vraiment dus
aux activités humaines? ...................3
La COP 21, et les 2 degrés ..................4
Planter des haies, une des solutions! .........4
Rénovation énergétique et toits végétalisés. . . . . . 4
L’alimentation, autre vecteur du changement ....4
Edito
LeC2D, ou Conseil de Développement Durable, est composé de membres de la
société civile et s’intéresse à tout sujet relatif au développement du territoire.
Le C2D travaille aux côtés des élus du Conseil communautaire et s’attache à
apporter des idées, des pistes d’actions, des retours d’expérience aux élus, afin
de contribuer à une construction soutenable du territoire.
Ce C2D, qui est aussi le vôtre, monte en puissance et a fait sa rentrée. Nous
sommes 50 conseillers bénévoles, concernés par ce qui touche à notre commu-
nauté d’Agglomération et motivés pour apporter une contribution utile à ceux qui
l’animent et dessinent son avenir.
Cette première lettre d’information est consacrée à la présentation de notre
groupe et à la conférence internationale sur le climat (COP 21) qu’il aborde à
travers plusieurs sujets.
Cette année verra de nombreux projets de l’Agglo entrer en phase active. Nos
groupes de compétences sont représentés au sein des commissions de l’Agglo
pour participer à leurs travaux.
Ces projets sont porteurs d’enjeux que nous avons jugés importants:
•Uneambitionàlongtermepourl’AgglomérationSeineEurequiassurela
cohérence des choix de nos élus au long des mandatures successives. C’est
le projet de territoire sur lequel l’Agglo commence à travailler.
•Uneplacepourl’économiesocialeetsolidaireàlahauteurdunombrede
personnes en recherche d’emploi et de reconnaissance. Les projets des Hauts
Prés et de la Ressourcerie vont y contribuer, il faut que nous comprenions
comment en faire des succès et comment aller bien plus loin.
• Laréductiondenotreconsommationenénergiesfossilesrenduepossibleparle
développement des énergies renouvelables et par de nouveaux comportements
(transports, alimentation, circuits courts, réduction des déchets...) pour dimi-
nuer notre dépendance, améliorer notre santé et celle de notre environnement.
•L’attractivitédenotreterritoirepouraccueillirouretenirlestalentsquinous
apporteront la dynamique nécessaire à nos développements.
Enfin je tiens à saluer Rebecca Armstrong qui quitte l’Agglomération après plus
de 8 années au service des politiques de développement durable. C’est en partie
à elle que nous devons la mise en œuvre de l’Agenda 21 et le lancement du C2D.
Nous l’en remercions très sincèrement et lui souhaitons de beaux succès dans
sa nouvelle entreprise.
Jean-Pierre Cabourdin,
Président du Conseil de Développement Durable (C2D)
Numéro 1
PAGE 1
La COP 21, et les 2 degrés…
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, Paris accueillera la 21e Confé-
rence des Parties (COP21), ou Conférence mondiale pour le climat, dans
le but d’aboutir à un nouvel accord international, applicable à tous les
pays, et dans l’objectif de maintenir le réchauffement moyen de la
planète sous la barre des 2°C, d’ici la fin du siècle.
Ces 2°C sont mesurés par rapport à la température de l’année 1850,
donnée comme le début de l’ère industrielle. Cet objectif de 2°Cest une
décisionpolitique,priseparlaConventionClimatdesNations-Unies,et
fondée sur les recommandations des scientifiques du GIEC.
Pourquoi cette recommandation: une hausse limitée à 2 degrés de-
vrait permettre à l’humanité de s’adapter au réchauffement climatique,
malgré de nombreux bouleversements. Au-delà, les conséquences
seront irréversibles.
Rénovation énergétique et toits végétalisés
Vous envisagez une rénovation énergétique de votre logement?
Vous envisagez d’ajouter un garage à votre habitation?
Pensez à l’option du toit végétalisé qui consiste à recouvrir un toit
d’une multicouches d’isolants et de terre qui servira à la végétation.
Sesavantagessontmultiples:
•alorsqu’untoitnormalatteint60°Cenété,lemêmevégétaliséne
dépasse pas 25°C; la température intérieure des locaux diminue
ainsi facilement de 3°C sans source d’énergie, donc gratuitement
(et vice-versa en hiver).
•enzoneurbaine,onrecréedesespacesvertsbénéquesàla
biodiversité et éloignés de la présence quotidienne de l’homme.
•lepiégeagedesparticulesnesaméliorelaqualitédel’air.
Unenouveauté?Non,cette
technique ancestrale d’isolation a
traversélessièclesenScandina-
vie, preuve en est de sa qualité!
Comme beaucoup des préconisa-
tions du développement durable:
il suffit de revenir au bon sens de
nos anciens…
Groupe Habitat du C2D
Planter des haies,
une des solutions !
En ville, comme à la campagne, les haies seront l’un de nos meilleurs
alliés pour s’adapter aux dérèglements climatiques. Elles favorisent
l’infiltration de l’eau grâce à leurs racines, freinent le ruissellement
lors des gros orages, protègent les sols de l’érosion.
En zone rurale, elles sont de parfaits coupe-vent. Leur perméabilité
permet à l’air de circuler et, ajouté à l‘évaporation du feuillage, de créer
un microclimat agréable en période de fortes chaleurs. Elles abritent
des dizaines d’espèces animales et maintiennent une biodiversité; les
insectes pollinisateurs y trouvent un milieu propice.
Sivousêtespropriétaireoulocataire(avecaccorddupropriétaire),il
est concevable de planter une haie qui vous apportera autant d’avan-
tages, dont une esthétique changeante, si vous optez pour une haie
vive.
Avant toute chose, il est impératif de se renseigner à la Mairie de votre
localité pour connaître les réglementations locales si elles existent; en
leurabsence,lesplantationsdemoinsde2mdehauteurdoiventêtre
plantées à plus de 50cm du mitoyen, et pour les hauteurs supérieures
à 2m, penser à l’accès le long de la future haie pour son entretien.
Pour éviter les erreurs, privilégier les achats chez un pépiniériste
proche de chez vous qui vous indiquera les meilleures essences en
fonction de votre terrain et de votre localité.
Sivousavezdéjàunretourd’expériencedanslaplantationoul’entre-
tien des haies, n’hésitez pas à en faire profiter le C2D.
Contact: [email protected]
L’alimentation, autre vecteur du changement
Senourrirestunepréoccupationquotidienne.Unealimentationde
qualité, contrairement aux idées reçues, n’est pas plus chère pour le
porte-monnaie mais demande juste un peu de recherche.
Produits locaux BIO, circuits courts, commerce équitable, produits de
saison, savoir-faire artisanal, jardins partagés, la prochaine «Lettre du
C2D» leur fera la part belle.
Pour une alimentation responsable, rendez-vous au prochain numéro!
Conception&réalisation:Libreéquerre-www.libre-equerre.fr•
Comité de rédaction : Bernard Leroy, Anne Terlez, Marie Le Calonec,
Nelly David, Claire Labigne, Jean-Pierre Cabourdin, Jean-Claude
Charignon,Jean-PierreCobert•Directeurdepublication:Jean-
PierreCabourdin•Dépôtlégal:Automne2015•Imprimésur
papiercertié•PEFC•Tirage:2000ex
Le Cornouiller sanguin, l’une des espèces les plus adaptées au territoire de l’Agglo
Le journal des habitants engagés pour le développement durable
PAGE 4

Le C2D, pour quoi faire, pourquoi pas vous ?
Le réchauffement climatique, une réalité?
Certes, il neige toujours en hiver, et nous avons encore des prin-
tempsfrais et pluvieux.
Néanmoins, il ne faut pas confondre la météorologie où l’on parle
en jours, et la climatologie où l’on parle en dizaines d’années.
L’évolution du climat n’est pas continue mais se fait bien par
paliers, ce qui continue d’alimenter l’argumentaire des derniers
climato-sceptiques. Si les variations astronomiques naturelles
de notre globe nous amènent vers une nouvelle glaciation dans
quelques dizaines de milliers d’années, il n’en reste pas moins
vrai que notre avenir proche se dirige droit vers un réchauffement
accru.
Et l’Agglo Seine-Eure dans tout ça?
Le territoire de l’Agglomération Seine-Eure est bien éloigné de
la banquise qui fond, des glaciers qui reculent, du niveau des
océans qui monte. Est-il, pour autant, peu concerné? Effecti-
vement, nous avons la chance de bénécier, encore, d’un climat
doux, mais, comme le reste de la planète, nous sommes évidem-
ment concernés.
Et pour preuve: Météo-France a réalisé une étude complète du
futur climat de la France, pour 3 scénarios de réchauffement et
pour 2030, 2050, et 2080.
Pour 2030 (dans juste 15ans), et dans le scénario médian, on peut
releverles moyennes suivantes, pour notre territoire:
* hausse des températures hivernales: 1.6°C
* hausse des températures estivales: 1.4°C
* moyenne des précipitations hivernales: +5%
* moyenne des précipitations estivales: -15%
* temps passé en situation de sécheresse: +30%
Concrètement, que peut-on faire
individuellement?
Face à ces dérèglements climatiques, il y a deux solutions: la lutte
contre le réchauffement, et l’adaptation.
* La lutte, ou l’atténuation, sera l’œuvre de l’humanité toute en-
tière. A l’échelle du territoire, les services de l’Agglo Seine-Eure
ont déjà tracé le chemin au travers de l’Agenda 21, du Plan Climat
Energie Territorial 2014-2018, du Plan de réduction des déchets,
du futur Schéma directeur des énergies renouvelables.
* L’adaptation: c’est une approche individuelle. Il est nécessaire
pour les habitants de l’Agglo d’acquérir une CULTURE DE LA
CHALEUR, culture que possèdent peu de Normands. Le C2D
essaiera au fil du temps d’en donner des élémentsprécis; en
voilà un survol:
en zone rurale:
• créer un microclimat autour de la maison en plantant un maxi-
mum d’arbres, d’essences peu stressées par la chaleur, et qui
présentent aussi l’avantage d’être des puits à CO2,
• planter des haies en limite de propriété,
• proscrire les allées bétonnées et les terrasses extérieures dont
les eaux sont évacuées dans les réseaux d’eaux pluviales, et
faire en sorte que les eaux de pluie s’inltrent sur place,
• avoir des murs clairs rééchissant la chaleur,
• installer des toitures végétalisées dans la mesure du possible,
• mettre en place des récupérateurs des eaux de pluie, etc.
en zone urbaine, où lors des fortes chaleurs, la température dé-
passe de 1 à 2 degrés la température des alentours:
• Créer des climatisations naturelles ne consommant pas d’éner-
gie comme les volets ou les stores, les grandes jardinières
avec des plantes hautes, etc.
Adaptation, atténuation, lutte, c’est maintenant. Dans 5 ou 10 ans,
il sera vraiment trop tard.
Groupe Environnement du C2D
Culture de la chaleur
Malgré tous les signes alarmants du dérèglement climatique, certains remettent encore
en cause son existence. Pourtant, il est déjà bien présent.
Ces dérèglements, vraiment
dus aux activités humaines ?
En1988,deuxinstitutionsdesNationsUnies,l’OrganisationMétéo-
rologiqueMondiale(OMM)etleProgrammedesNationsUniespour
l’Environnement(PNUE)ontcrééleGIEC:Grouped’expertsIntergou-
vernemental sur l’Evolution du Climat.
Le GIEC a pour mission d’évaluer, sans parti pris, et de manière métho-
dique et objective, l’information scientifique, technique et socio-écono-
mique disponible, en rapport avec la question du changement clima-
tique. Voici l’évolution de leurs différents rapports:
•Le1erRapportd’évaluationduGIEC(1990),aconrmélesinforma-
tions scientifiques sur lesquelles étaient fondées les préoccupations
relatives à l’évolution du climat.
•Le4èmerapportduGIEC(2007):«onpeutavanceravecundegré
de confiance très élevé que les activités humaines menées depuis
1750onteupoureffetnetderéchaufferleclimat».
•Le5èmerapportduGIEC(2014):«ilya95chancessur100que
le réchauffement climatique soit lié à l’activité humaine».
Il ne fait donc quasi aucun doute que l’Homme en est hautement res-
ponsable…
Le journal des habitants engagés pour le développement durableLe journal des habitants engagés pour le développement durable
PAGE 2 PAGE 3
Le Conseil de Développement Durable,
ou C2D, est une instance de participation
citoyenne. Tout comme les conseils de
quartier, les conseils de développement
sont composés d’habitants ou d’acteurs
du territoire, ayant envie de donner leur
avis et leur expertise sur les projets lo-
caux.
Le cadre: La Loi d’Orientation pour
l’Aménagement et le Développement
Durable des Territoires (LOADDT) ou loi
Voynet, votée en 1999, institue la repré-
sentation de la société civile avec un droit
d’information et de conseil.
Qui sommes-nous ? Des citoyens,
femmes et hommes, qui veulent consa-
crer une partie de leur temps et de leur
énergie à donner leur avis d’usager, ou
qui veulent promouvoir une approche du
vivre ensemble indépendamment des par-
tis politiques (associations). Le bénévolat
est notre force, rien ne nous oblige ou ne
nous lie. Notre nombre et la diversité de
nos origines ou expériences, ainsi que la
recherche d’un consensus ouvert à toutes
les inuences, nous offrent la possibilité
de nous approcher de l’intérêt commun.
Nos avis ne valent pas décision, et notre
valeur ajoutée ne vaut que par la prise en
compte de nos avis et recommandations
par nos interlocuteurs, élus et décideurs.
Comment agissons nous ? Ce peut
être très en amont comme avec le projet
de territoire (voir édito), ce peut être au
moment de la revue des plans d’inves-
tissement comme avec l’Agenda 21 ou
avec le contrat d’Agglo, ce peut être pour
chacun des projets que nous avons iden-
tié et pour lesquels nous intervenons aux
côtés des élus, des agents de l’Agglo et
des intervenants extérieurs au sein des
commissions. Comment: en posant les
bonnes questions, en faisant entendre la
perception du citoyen moyen de manière
à rester au plus près de la réalité et en
apportant un retour d’expérience à travers
la consultation des populations affectées.
Où en sommes-nous ? Nous nous
sommes organisés en groupes de com-
pétence pour que nos délégués puissent
émettre des avis. Aujourd’hui, le C2D
compte 6 groupes: Economie – Environ-
nement – Mobilités/Transports – Culture/
Tourisme/Loisirs – Habitat – Insertion
professionnelle. Chaque groupe dispose
d’une grande autonomie. La confrontation
des idées émises par chacun des groupes
permet d’aboutir à des conclusions ou
positions qui s’approchent de l’intérêt
commun. Chaque groupe a déni les su-
jets sur lesquels il veut travailler. Ils ont
commencé à mener leurs propres inves-
tigations pour comprendre les enjeux, les
points critiques, les critères de succès et
les causes possibles d’échec.
Et maintenant ? Il nous faut gagner en
audience, autant auprès des élus que de
la population. Pour cela nous allons nous
impliquer un peu plus dans les débats et
communiquer sur nos questions et re-
commandations. Nous devons également
compléter nos compétences en recrutant
de nouveaux conseillers.
Alors pourquoi pas vous? Si vous êtes
prêt à nous consacrer 4 à 6 heures par
mois, le premier pas consiste à contacter
Claire Labigne qui saura vous accueillir et
vous diriger vers les bonnes personnes.
Ses coordonnées :
claire.labigne@seine-eure.com /
02.32.50.86.48.
Notion très «à la mode» depuis deux décennies, elle est très
employée, souvent à tort et à travers. Mais qui en connait vraiment
la dénition, et surtout le but?
Le développement durable c’est un «développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurs propres besoins» (Rapport
Brundtland, 1987).
A travers cette expression, il s’agit alors d’améliorer nos conditions
de vie actuelles sans mettre en péril celles de demain.
Il est souvent dit que le développement durable repose aussi sur
les 3 piliers fondamentaux que sont: le social, l’économie, et
l’environnement.
Le social: pour réduire les inégalités.
L’économie: pour créer des richesses et ne pas les gaspiller.
L’environnement: pour protéger notre planète et ses occupants
(animaux, végétaux, humains).
Si le développement ne satisfait
que deux critères, il pourra être
viable, vivable ou équitable.
Il ne sera durable qu’en
satisfaisant les 3 critères
(voir schéma).
Contrairement à ce que beau-
coup de personnes pensent, il
ne s’agit donc pas uniquement
de la politique environnementale
(énergies renouvelables, maitrise des
consommations d’eau, réduction des déchets, etc.), mais doit
s’appliquer à tout développement nouveau et dans tous les do-
maines (habitat, transports, loisirs, emploi, énergies, communica-
tions, programmes sociaux, culturels, etc.)
Groupe Economie du C2D
Et le développement durable, c’est quoi ?
1
/
2
100%