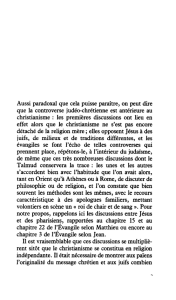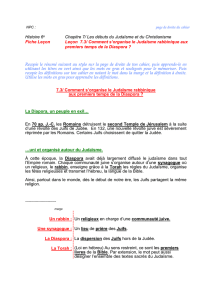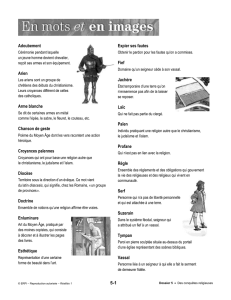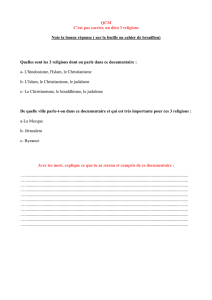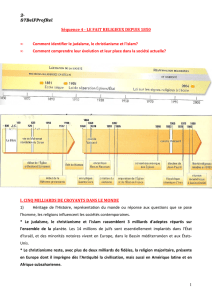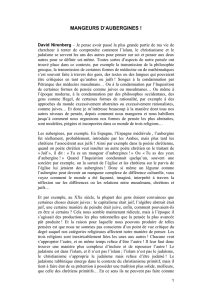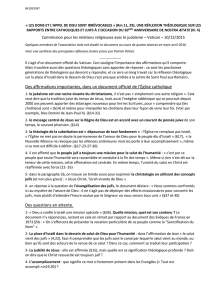Des textes existent donc

Le#paradigme#historico‐théologique#(4)#
#
#
#
#
#
!
TEXTES!!EN!
CONTEXTE!

! "#$%&!'($)*+',+!-$!'.//.0.-,!12,3&.*%!',!-$!'$&$&.*%!',3!&,4&,3!/*%'$&,2+3!,&!',!
-,2+!3&$&2&5!6,!#$.3!7(.%&8+,33,+!$2!+$99*+&!,%&+,!-,!&,4&,!-,!0*%&,4&,5!0,!12.!+,#.,%&!:!3,!
-.#+,+!:!12,-12,3!0*%3.'8+$&.*%3!'(;.3&*.+,!<8%8+$-,=!
! >,!&+*.3.?7,!#*-,&!',!-$!&+.-*<.,!',!@*+'.--$&!,&!A+.,2+!$#$.&!9*2+!
&.&+,!Apocalypse**,&!0*77,!0;$02%!3$.&5!0,!&,+7,!',#,%2!3B%*%B7,!',!0$&$3&+*9;,!
&,+7.%$-,5!3.<%./.$%&!8&B7*-*<.12,7,%&!C!+8#8-$&.*%!D5!,3&!-,!&.&+,!'2!',+%.,+!&,4&,!'2!
Nouveau*Testament5!,%!9+.%0.9,!'E!:!-$!9-27,!',!-("9F&+,!G,$%5!'86:!$2&,2+!'2!HI?7,!
8#$%<.-,=!
! J,!12,!-(*%!3$.&!7*.%35!0(,3&!12(.-!,4.3&,!2%,!$33,K!$)*%'$%&,!-.&&8+$&2+,!$99$+2,!
,%&+,!-,!HH?7,!3.?0-,!$#$%&!,&!-,!HH?7,!3.?0-,!$9+?3!G8323LJ;+.3&!12,!-,3!;.3&*+.,%3!
$99,--,%&!-$!-.&&8+$&2+,!$9*0$-B9&.12,!62.#,=!!
! M%!+,9+*0;,!12.!$!8&8!/$.&!$24!',24!$2&,2+3L+8$-.3$&,2+3!$2+$!8&8!',!'*%%,+!-,!
&.&+,!'("9*0$-B93,!:!-$!38+.,!',!-,2+!'*2K,!87.33.*%35!$-*+3!12,!-$!9+,7.?+,!3,2-,7,%&!
&+$.&$.&!'2!&,4&,!',!N$.%&LG,$%!9*+&$%&!0,!&.&+,=!O%!+,#$%0;,5!*%!%,!-,2+!$2+$!9$3!+,9+*0;8!
',!%($#*.+!+.,%!'.&!',!&*2&,!0,&&,!-.&&8+$&2+,!$9*0$-B9&.12,!62.#,!'*%&!-(Apocalypse!',!
N$.%&LG,$%!%(,3&!12(2%!8-87,%&!9$+7.!&$%&!'($2&+,3!,&!12.!9*2+&$%&!%,!3(80-$.+,!12,!3(.-!,3&!
+,9-$08!'$%3!0,&!,%3,7)-,=!!
! @$.3!0(,3&!12,5!623&,7,%&5!3.!-,3!;.3&*+.,%3L&;8*-*<.,%35!-2.!*%&!'*%%85!,&!32+&*2&!
0*%&.%2,%&!:!-2.!'*%%,+5!2%,!9-$0,!:!9$+&5!0(,3&!12(.-3!3$#,%&!).,%!12,!-(80-$.+$<,!P0(,3&L:L
'.+,5!/.%$-,7,%&5!!-$!3.<%./.0$&.*%Q!%(,3&!9$3!'2!&*2&!-,!7R7,!3,-*%!12,!-(*%!+,9-$0,!0,&&,!
"9*0$-B93,!9$+&.02-.?+,!!'$%3!&*2&,!-$!-.&&8+$&2+,!$9*0$-B9&.12,!62.#,!*S5!9$+!3*%!<,%+,5!
,--,!',#+$.&!3,!&+*2#,+!5!*2!).,%!3,-*%!!12(*%!-$!7,&&,5!0*77,!3(.-!3($<.33$.&!'(2%!&,4&,!
3$%3!812.#$-,%&5!'(2%!<,%+,!.%0-$33$)-,5!,%!+,<$+'!',3!12$&+,!8#$%<.-,3!12.!
$99$+&.,%%,%&5!12$%&!:!,245!:!2%!<,%+,!&*&$-,7,%&!'.//8+,%&!12.5!0,-2.L-:5!,3&!0*%%25!0(,3&L
:L'.+,!-,!<,%+,!%$++$&./!P:!#$-,2+!;.3&*+.12,5!'2!7*.%3!,%!9+.%0.9,Q=!
! >$!12,3&.*%!',!-$!0-$33./.0$&.*%!',3!&,4&,3!/*%'$&,2+3!!L!,&!,%!9+,7.,+!-.,25!-$!
%*&.*%!7R7,!',!&,4&,!/*%'$&,2+!T!,3&!0+20.$-,=!>$!0-$33./.0$&.*%!$0&2,--,5!12.!%(,3&!6$7$.3!
7.3,!,%!0$23,!9$+!9,+3*%%,5!+832-&,!'(2%,!0,+&$.%,!0*%3&+20&.*%!;.3&*+.12,!U!'$%3!-$!
9,+39,0&.#,!'(2%,!'87$+0;,!'80*%3&+20&.#,5!0(,3&!'*%0!-$!9+,7.?+,!0;*3,!32+!12*.!.-!
0*%#.,%&!',!9*+&,+!-(.%&,++*<$&.*%=!
! N.!2%,!0-$33./.0$&.*%!'*%%8,!+832-&,!'(*9&.*%3!&;8*-*<.12,35!+,9+,%'+,!0,&&,!
0-$33./.0$&.*%!3$%3!3(.%&,++*<,+!,%&+$.%,!-$!9+*)$).-.&8!12(*%!$)*2&.+$!$24!*9&.*%3!
&;8*-*<.12,3!12.!*%&!'8&,+7.%8!-$!0-$33./.0$&.*%!,&!*%&!9+*'2.&!-,3'.&,3!*9&.*%3=!

H%#,+3,7,%&5!3(.%&,++*<,+!32+!-$!0-$33./.0$&.*%!,%&+$V%,5!'?3!0,!9+,7.,+!3&$',5!2%!+.312,!
/*+&!'($)*2&.+!:!',3!0*%0-23.*%35!*2!:!',3!;B9*&;?3,35!*2!:!',!%*2#,--,3!.%&,++*<$&.*%3!
12,!%.!-$!&;8*-*<.,!%.!-(;.3&*.+,!&;8*-*<.38,!%($99+80.,+*%&=!!
! J,!%,!3,+$!9$3!3,2-,7,%&!32+!-,3!12$&+,!8#$%<.-,3!,&!-,3!WX!$2&+,3!&,4&,35!'*%&!
-("9*0$-B93,!',!G,$%!12.!/*+7,%&!-,!Y*2#,$2!Z,3&$7,%&!12,!%*23!%*23!.%&,++*<,+*%3!
'$%3!-,!9+*0;$.%!$+&.0-,!U!7$.3!32+!),$20*29!'($2&+,3!12,5!3.!9*33.)-,5!%*23!&,%&,+*%3!',!
&+$.&,+!0*77,!3(.-3!%(8&$.,%&!9$3!'8/.%.3!9$+!2%!<,%+,!'E7,%&!+89,+&*+.8!9$+!9+?3!',!
',24!7.--8%$.+,3!'(;.3&*+.*<+$9;.,=!G,!%,!7,!0*%&,%&,+$.!9$3!',!'.+,!12(:!0F&8!',3!12$&+,!
8#$%<.-,3!'.&3!0$%*%.12,35!.-!,4.3&,!2%!0,+&$.%!%*7)+,!'($2&+,3!8#$%<.-,3!'.&3!
$9*0+B9;,35!,%!/$.3$%&!#$-*.+!12(.-!/$2&!3(.%&,++*<,+!32+!-($2&*+.&8!12.!-,3!$!$.%3.!
'.3&.%<283!,&!32+!-,!7*7,%&!*S!!0,&&,!'.3&.%0&.*%!$!8&8!/$.&,=!G,!%,!7,!0*%&,%&,+$.!9$3!',!
'.+,!12,!0,+&$.%3!8#$%<.-,3!'.&3!$9*0+B9;,3!12(*%!9+83,%&,!&*26*2+3!a"priori!0*77,!
9*3&8+.,2+3!$24!8#$%<.-,3!'.&3!0$%*%.12,3!9,2#,%&!&*2&!$233.!).,%!$#*.+!8&8!80+.&3!:!-$!
7R7,!89*12,5!#*.+,!$#$%&=!G,!&,%&,+$.!',!/$.+,!#$-*.+!12,!-,!&,+7,!'(évangiles!,3&!'86:!
2%,!0-$33./.0$&.*%!,&!12,!'($2&+,3!&,4&,35!9*+&$%&!9$+!,4,79-,!-,!%*7!'(actes5!*2!).,%!',!
mémoires5!*2!,%0*+,!$2&+,7,%&5!'*.#,%&!R&+,!7.3!32+!-,!7R7,!9.,'!12,!0,24!12.!9*+&,%&!
-,!%*7!'(8#$%<.-,3=!
! G,!'.+$.!12,!0,!<+*3!,%3,7)-,!12.!9*+&,!-,!%*7!',!-.&&8+$&2+,!$9*0$-B9&.12,!62.#,!
%,!'*.&!9$3!R&+,!0*%3.'8+8!$!9+.*+.!0*77,!7*.%3!9*+&,2+3!'(;.3&*+.0.&8!12,!'($2&+,35!3*.&!
0*%&,%$%&!',3!+80.&3!0*77,!-,3!8#$%<.-,35!3*.&!0*%&,%$%&!',3!,4;*+&$&.*%35!0*77,!-,3!
89.&+,35!3*.&!,49*3$%&!',3!'*0&+.%,3!0*77,!0,+&$.%3!&+$.&83=!
! H-!3($<.&5!,%!'($2&+,3!&,+7,35!'(8&,%'+,!-$!%*&.*%!',!&,4&,3!/*%'$&,2+3!:!2%,!
,%3,7)-,!-.&&8+$.+,!),$20*29!9-23!#$3&,!12,!0,-2.!;$).&2,--,7,%&!2&.-.385!12.!,3&!2%,!
0*%3&+20&.*%!',!-(;.3&*.+,!&;8*-*<.38,=!![,!<+$%',3!12$%&.&83!',!&,4&,3!3*%&!:!0*%3.'8+,+!
'$&$%&!',3!$-,%&*2+3!',3!'8)2&3!',!-(?+,!0;+8&.,%%,5!'?3!-*+3!12(.-3!9,2#,%&!R&+,!9*+&,2+3!
',!12,-12,3!&+$0,3!'(2%,!9*33.).-.&8!',!+,-.<.*%!%*2#,--,=!"2&$%&!-,2+!0-$33./.0$&.*%!,3&5!3.!
9*33.)-,5!:!*2)-.,+5!$2&$%&!3.!*%!#,2&!0;,+0;,+!:!-,3!0*79+,%'+,5!.-!,3&!.%'.39,%3$)-,!P3.!
9*33.)-,5!8<$-,7,%&Q!',!9-$0,+!-,3!&,4&,3!'$%3!-,2+!0*%&,4&,5!2%!0*%&,4&,!3*2#,%&!$33,K!
-$+<,5!92.312,5!9*2+!-$!9-29$+&5!-,2+!'$&$&.*%!,3&!$33,K!/-*2,=!
! [,3!&,4&,3!,4.3&,%&!'*%05!7$.3!.-!,4.3&,!$233.!',3!0*%&,4&,3!,&!0,!3*%&!).,%!3*2#,%&!
-,3!0*%&,4&,3!12.!$99*+&,%&!2%,!-27.?+,!'80.3.#,!32+!-,3!&,4&,3=!![,3!0*%&,4&,3!,&!%*%!9$3!
2%!0*%&,4&,=!\%!$!&+*9!'.&!,&!+898&8!12,!G8323!,3&!.332!'2!62'$]37,5!'*%0!12,!-,!
0;+.3&.$%.37,!,3&!.332!'2!62'$]37,=!^2,!-,!0;+.3&.$%.37,!$.&!8&8!/*%'8!9$+!G8323!',!

Y$K$+,&;!*2!12(.-!3,!3*.&!/*%'8!$2&+,7,%&5!.-!%(,3&5!,%!,//,&5!9$3!'*2&,24!12,!-,!
0;+.3&.$%.37,!%,!3*.&!.332!'2!62'$]37,5!7$.3!,%!$202%!0$3!'2!62'$]37,!3,2-,7,%&=!
! \+5!0(,3&!2%,!'8/*+7$&.*%!7$6,2+,!T!812.#$-,%&!,&!3,!+$6*2&$%&!:!0,--,!0*%3.3&$%&!:!
'.+,!12,!&*2&!0*77,%0,!:!_,&;-8,7!,&!:!Y$K$+,&;!T!12,!',!#*.+!'$%3!-,!62'$]37,5!,&!
'$%3!-,!62'$]37,!3,2-,7,%&5!-,!),+0,$2!'2!0;+.3&.$%.37,=!M%,!&,--,!'8/*+7$&.*%!,3&!&+?3!
-*2+',!',!0*%3812,%0,3!`!,--,!#$!$7,%,+!-,!0+*B$%&!'83.+,24!',!3(.%/*+7,+!32+!-,3!
*+.<.%,3!',!3$!+,-.<.*%!:!9$33,+!2%!&,793!0*%3.'8+$)-,!:!8&2'.,+!&*2&,!-(;.3&*.+,!'(H3+$a-5!
&,793!'*%&!.-!%,!'.39*3,+$!9-23!9*2+!8&2'.,+!$2&+,!0;*3,=!
! >(;.3&*.+,!'(H3+$a-!,3&!-*%<2,!`!,--,!0*77,%0,!bWcc!$%3!$#$%&!G8323LJ;+.3&=!J,!
%(,3&!3$%3!'*2&,!9$3!$)3*-27,%&!.%2&.-,!9*2+!0*%%$V&+,!G8323!',!Y$K$+,&;!',!0*%%$V&+,!
-(;.3&*.+,!'(")+$;$7!,&!',!@*]3,5!7$.3!0,!%(,3&!9$3!%*%!9-23!$)3*-27,%&!%80,33$.+,!`!-,3!
&+?3!<+$%',3!-.<%,3!32//.3,%&!$79-,7,%&=!
! O%!+,#$%0;,5!0*%%$V&+,!$#,0!2%,!+,-$&.#,!9+80.3.*%!-(;.3&*.+,!'(H3+$a-!'$%3!-,3!bdc!
$%3!12.!9+80?',%&!-,3!'8)2&3!',!-(?+,!0;+8&.,%%,!,3&!.%'.39,%3$)-,!3.!-(*%!#,2&!9+,%'+,!
12,-12,!'.3&$%0,!$#,0!-(;.3&*+.*<+$9;.,!0-$33.12,5!0,--,!12,!6($99,--,!-(;.3&*.+,!
&;8*-*<.38,!12.!#,2&!$)3*-27,%&!/$.+,!$00+*.+,!12(2%!8#8%,7,%&!'(2%,!*+.<.%$-.&8!
$)3*-2,!,3&!.%&,+#,%2!:!0,&&,!89*12,5!3$%3!$202%!9+808',%&!,&!%,!9*2#$%&!$++.#,+!12(2%,!
3,2-,!/*.35!-(.%0$+%$&.*%!'2![.,2!2%.12,!'$%3!-$!0*%'.&.*%!;27$.%,!,&!'$%3!-(;.3&*.+,5!
+*79$%&!'(2%,!7$%.?+,!'80.3.#,!$#,0!-,!'8+*2-,7,%&!%$&2+,-!',3!8#8%,7,%&3=!!
! >$!&;8*+.,!,3&!12($#,0!-$!#,%2,!',!G8323LJ;+.3&5!2%!*+'+,!32+%$&2+,-!#.,%&!.%/-80;.+!
-(*+'+,!%$&2+,-=!J(,3&!0,&&,!.'8,!12,!-$!&;8*-*<.,!0;+8&.,%%,!#,2&!/$.+,!$00+*.+,!,&!$2!
)8%8/.0,!',!-$12,--,!,--,!'8/*+7,!3$%3!30+292-,!-(;.3&*.+,=!!J,&&,!&;8*+.,!',!-(*+'+,!
32+%$&2+,-!12.!3,!32)3&.&2,!:!-(*+'+,!%$&2+,-!3,!0$0;,!3*23!-$!%*%L7*.%3!$%;.3&*+.12,!
&;8*+.,!',!-$!+29&2+,5!'*2)-8,!',!-$!&;8*+.,!',!-(,49$%3.*%!/*2'+*B$%&,!`!-,!
0;+.3&.$%.37,5!:!9,.%,!%85!+*79&!$#,0!-,!62'$]37,!,&!#$!0*%%$V&+,!2%,!9+*<+,33.*%!
.++83.3&.)-,=!
! H-!32//.&!',!+,-.+,!-,!'8)2&!',3!Actes*des*Apôtres,!12,!0,+&$.%3!;.3&*+.,%3L
&;8*-*<.,%3!'*%%,%&!0*77,!2%!'*07,%&!;.3&*+.12,5!-,!9+,7.,+!'*027,%&!12.!
&87*.<%,+$.&!',!-(;.3&*+.0.&8!',!-(O<-.3,!,&!'2!0;+.3&.$%.37,=!N*23!0,&!$39,0&5!-$!12,3&.*%!
9-$08,!$2!0,%&+,!',!7$!Lettre*ouverte*à*Paul*Veyne!%(,3&!%2--,7,%&!$%,0'*&.12,5!7$.3!
$2!0*%&+$.+,!/*%'$7,%&$-,!`!0,--,!',!-$!9+83,%0,!',3!J;+8&.,%3!:!e*7,5!'$%3!-,3!$%%8,3!
fc5!'*%&!*%!#,2&!%*23!/$.+,!0+*.+,!12(,--,!8&$.&!3.!.79*+&$%&,!12(,--,!.%12.8&$.&!Y8+*%5!
$-*+3!7R7,!12,!-,!',+%.,+!0;$9.&+,!',3!Actes!%*23!7*%&+,%&!12,!-,3!%*&$)-,3!62./3!',!

e*7,!,24L7R7,3!.<%*+$.,%&!&*2&!',!-(,4.3&,%0,!'(2%,!C!3,0&,!D!12.!$2+$.&!8&8!,%!&+$.%!',!
/*%',+!2%,!+,-.<.*%!%*2#,--,!,&!&+$#$.--,+$.&!,//.0$0,7,%&!:!<$<%,+!:!3$!0$23,!&*2&,3!-,3!
0*20;,3!',!-$!3*0.8&8g!!
! [,!7R7,5!-,!'8)2&!',3!Actes!%*23!'89,.%&!-,3!9+,7.,+3!9$3!'2!0;+.3&.$%.37,!,%!
A$-,3&.%,!7R7,!3*23!-,!6*2+!'(2%,!,49$%3.*%!/*2'+*B$%&,=!>,3!%*2#,$24!)$9&.383!3,!
0*79&,%&!,%!9-23.,2+3!7.--.,+3!9$+!6*2+!`!C!Ceux"qui"accueillirent"sa"parole"reçurent"le"
baptême"et"il"y"eut"environ"3"000"personnes"ce"jour<là"qui"se"joignirent"à"eux"D=!P"0&,3!W5!
hbQ=!Y*%!3,2-,7,%&!',3!0;,/3!7.-.&$.+,3!',!-($+78,!+*7$.%,!$';?+,%&!:!-$!+,-.<.*%!
%*2#,--,!P>,!J,%&2+.*%!J*+%,.--,5!"0&,35!bc5!bLhXQ5!',3!$7)$33$',2+3!8&+$%<,+3!P!
P>(O2%212,!8&;.*9.*%5!"0&,3!i5!WfLXjQ5!7$.3!-,3!9+R&+,3!'2!62'$]37,!,24L7R7,3!3,!
0*%#,+&.33,%&!,%!<+$%'!%*7)+,!`!«"La"parole"de"Dieu"croissait"et"le"nombre"des"disciples"
augmentait"considérablement"à"Jérusalem":"une"multitude"de"prêtres"obéissait"à"la"loi"D!
P"0&,35!f5!kQ!
! J,!7*2#,7,%&!'(,49$%3.*%!3,!/$.&!:!-($.',!',!7.+$0-,3!`!C!Beaucoup"de"prodiges"et"
de"signes"s’accomplissaient"par"les"Apôtres!C!!"0&,35!W5!hXQ!!C!Beaucoup"de"signes"et"de"
prodiges"s’accomplissaient"dans"le"peuple"par"la"main"des"Apôtres"D!P"0&,35!d5!WQ!J,&!
,%<*E7,%&!9*2+!-$!+,-.<.*%!%*2#,--,!'89-$0,!-,3!/*2-,3!$2!3,%3!-.&&8+$-!`!C!La"multitude"
accourait"aussi"des"localités"voisines"de"Jérusalem"D!P"0&,3!d5!bfQ!
! \+5!&*23!0,24!12.5!'$%3!-,!9$3385!87.+,%&!',3!'*2&,3!32+!-(,4.3&,%0,!;.3&*+.12,!',!
G83235!*2!).,%5!$--$%&!&+*9!-*.%5!$//.+7?+,%&!3$!%*%L,4.3&,%0,5!2&.-.3$.,%&!0,&!$+<27,%&!
3,-*%!-,12,-!-$!-.&&8+$&2+,!9+*/$%,!P:!-(,40,9&.*%!'2!/$7,24!9$33$<,!;B9,+L0*%&+*#,+38!
',!-(;.3&*+.,%!62./!l-$#.23LG*3?9;,5!'.&!Testimonium*flavianumQ!.<%*+,!&*2&!',!-$!#.,!',!
G8323=!!Z+?3!9,2!'(,%&+,!,24!*%&!3.<%$-8!12(.-!%(8&$.&!9$3!7*.%3!8&*%%$%&5!L!:!#+$.!'.+,5!
,%0*+,!9-23!8&*%%$%&!T!12,!l-$#.23LG*3?9;,!.<%*+,!&*2&!'2!'87$++$<,!'2!0;+.3&.$%.37,5!
3(.-!0*++,39*%'!:!0,!12.!,3&!'80+.&!'$%3!les*Actes=!
! J,&&,!-.&&8+$&2+,!9+*/$%,!P12.!,3&!-*.%!',!3,!+8327,+!$2!3,2-!l-$#.23LG*3?9;,Q!
%(.<%*+,!9$3!3,2-,7,%&!G8323!',!Y$K$+,&;=!H-!/$2&!+$99,-,+!12(,--,!.<%*+,!$233.!Y$K$+,&;=!
@$.3!.-!/$2&!32+&*2&!+$99,-,+!12(,--,!%,!0*%%$V&!9$3!'$#$%&$<,!A.,++,5!%.!A$2-!P12.!%(,3&!
0*%%2!12,!9$+!3,3!9+*9+,3!-,&&+,3Q!%.!G,$%5!%.!$202%!$2&+,!m 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%