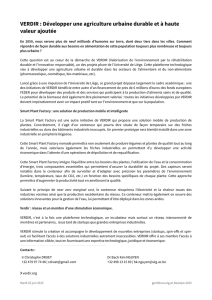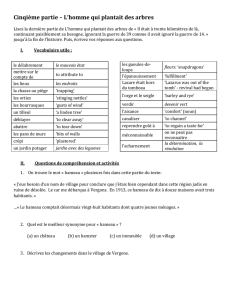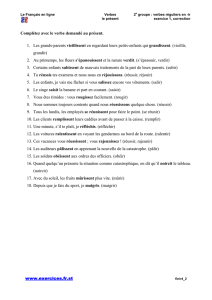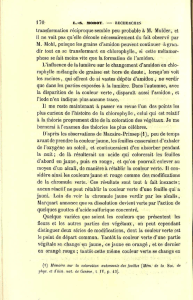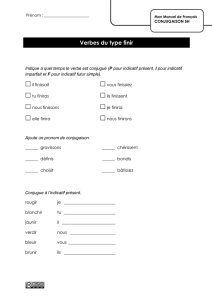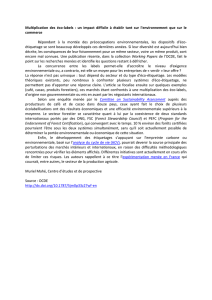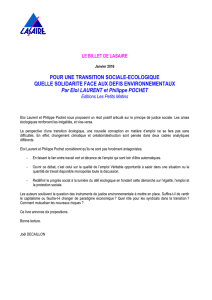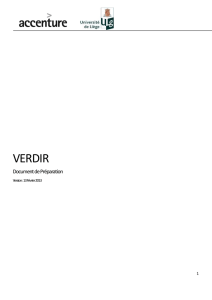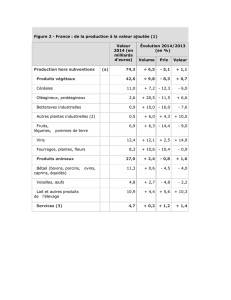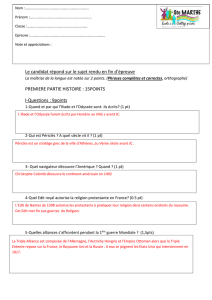Stratégie GLOBALE DU PROJET

1
Document de préparation
Version : 11 février 2013

2
Table des matières
Introduction
Présentation générale
o Pourquoi ?
o Focus sur l’agriculture urbaine
o La complémentarité et l’intégration des différents secteurs sont visées et constituent en soi une
importante innovation afin de favoriser les services écosystémiques
Vision
Mission
Organisation et management
Objectifs du Projet
Stratégie globale du projet
- Produits et services : vers la transversalité des chaînes de valeur
o VERDIR comme plateforme de transformation
o VERDIR comme modèle de développement économique de production et de valorisation
écosystémique
- Définir l’écosystème
o Les acteurs
o Les valeurs proposées
Pour le citoyen
Pour le partenaire industriel ou associatif
Pour l’investisseur
Pour le consommateur
Stratégie opérationnelle du projet
o Besoin en ressources humaines
- Sélection des projets VERDIR sur base des indicateurs de valeur
- Mesurer la contribution de VERDIR

3

4
INTRODUCTION
Le Projet « VERDIR® » (pour « Valorisation de l’Environnement par la Réhabilitation Durable et l’Innovation
Responsable) concerne la reconversion du Bassin liégeois
En effet, la région de Liège cultive la tradition des métiers de l’acier depuis des siècles. Outre l’importante activité de
Recherche sidérurgique au Sart Tilman, c’est aussi à Liège qu’à l’heure actuelle, de nouvelles techniques sont
développées en première mondiale, comme le revêtement de tôles par plasma sous vide, ou le refroidissement des
tôles après recuit à une vitesse de 1000°c par seconde, leur conférant une dureté inégalée. Aujourd’hui, certaines
industries n’ont pu s’adapter aux nouvelles contraintes imposées par la mondialisation. Ainsi, la région est
caractérisée par un certain nombre de friches industrielles et une activité économique en baisse.
S’adapter au changement est donc devenu une priorité pour le Bassin liégeois.
Les friches industrielles, d’une manière générale, entraînent une dégradation de l’environnement, une diminution
de la valeur des propriétés voisines, un éloignement de l’activité économique et de l’emploi. De plus, elles peuvent
constituer une menace pour la santé et la sécurité humaine et environnementale. Au plan social, l’existence de
friches industrielles peut provoquer une détérioration de quartiers, menacer la sécurité publique et réduire la
qualité de vie. Par conséquent, la réhabilitation des sites désaffectés revêt une importance majeure pour
l’aménagement du territoire et pour la mise à disposition d’espaces nouveaux recyclés destinés à l’activité
économique, culturelle et récréative voire à du logement. En ce sens, les espaces urbains, après viabilisation et
moyennant les autorisations urbanistiques nécessaires, peuvent se convertir en opportunité de réduire l’étalement
urbain et les coûts financiers environnementaux qui en découlent.
Les inventaires wallons (SPW-DG04 et SPAQuE) évaluent qu’il existe environ 5.000 friches industrielles, représentant
une superficie totale d’environ 10.000 hectares. 80% de ces friches se situent sur l’axe Sambre-Meuse, en milieu
urbain et périurbain. Pour le bassin liégeois, il s’agit d’une surface totale de 1775 hectares.
Parmi ces sites, il convient de distinguer d’une part 1.500 « sites à réaménager » majoritairement non pollués et
d’autre part 3.500 autres sites considérés comme pollués. La Région wallonne a soutenu le réaménagement de 72
hectares par an de 1995 à 2008. D’après une estimation réalisée en 2008, le coût de réhabilitation des 2.000 sites les
plus pollués s’élèverait ente 2,5 et 5 milliards d’euros (Carnoy & Moric, 2010).
Les possibilités de réhabiliter des friches industrielles sont donc nombreuses: création de logements, espaces
culturels, parc, espaces commerciaux,….
Depuis peu, l’agriculture urbaine devient également un modèle important de rénovation de sites industriels
abandonnés ; elle devient créatrice de nouveaux emplois et de nouvelles activités économiques.
VERDIR s’inscrit donc dans cette dynamique de reconversion des friches via la production de matières vivantes à des
fins alimentaires et non alimentaires. Cette reconversion se veut durable et concernera la plupart des secteurs
traditionnels des activités économiques et sociales (agriculture, architecture, construction, éducation, énergie,
logistique, tourisme, transport, traitement des déchets, …). Verdir vise à repenser ces secteurs en optimisant les
services écosystémiques auxquels ils font appels. Ces différents secteurs seront donc intégrés ensemble de manière
créative et innovante afin de générer un accroissement des rendements par le recyclage de l’eau, des sous-produits
et de l’énergie et par une valorisation maximale de chaque intrant.

5
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Dans ce contexte, brièvement dépeint, l’objectif de VERDIR® est de proposer une réponse créative face à
l’alternative dans laquelle se trouve le Bassin liégeois : péricliter ou se redynamiser. Afin d’aiguiller le Bassin liègeois
dans la voie de la revitalisation, VERDIR® se propose d’axer le redéploiement économique, social et culturel autour
des sciences du vivant et de la production et la valorisation de matières vivantes dans les friches industrielles laissée
en désuétude.
POURQUOI ?
Parce que les porteurs du présent projet pensent que l’effet combiné des différentes crises passées, actuelles et
futures auront un impact colossal sur la hausse permanente des prix des produits alimentaires, non-alimentaires et
énergétiques. Les crises majeures identifiées sont les suivantes :
- L’explosion démographique en Asie et la hausse du niveau de vie des populations des pays émergents. Ces
derniers ayant toujours plus de bouches à nourrir achète massivement des terres dans le Sud afin d’assurer
son approvisionnement.
- La stagnation des productions agricoles terrestres : plafonnement voire réduction des superficies des zones
arables, des rendements agricoles et lenteur du transfert de l’innovation technologique.
- La crise du système financier qui a vu la chute continue des subventions liées au secteur agricole européen
(1969 :80% ; 1980 :70% ; 2008 :43% : et qui sait ce que nous réserve la coupe budgétaire de 2014 ?)
- La crise sociale belge (voire européenne) actuelle où les taux de chômage sont projetés à la hausse.
Ainsi, dans la vision de VERDIR®, outre l’approche innovante des sciences du vivant dans des friches industrielles, la
nouvelle industrialisation du bassin liégeois devrait prendre en compte plusieurs paramètres :
- La création d’activités économiques innovantes, responsables et durables ;
- Un équilibre social entre les emplois hautement qualifiés et peu qualifiés ;
- L’indépendance énergétique et l’utilisation de sources renouvelables d’énergie ;
- Le marché et le positionnement de nos voisins (régions, provinces et pays limitrophes);
- Une révolution culturelle : évolution durable des comportements et des habitudes de consommation par la
valorisation de circuits courts ;
- La gestion efficiente et prévisionnelle des défis actuels et futurs :
o crise du système financier
o crise énergétique
o crise climatique
o crise alimentaire
FOCUS SUR L’AGRICULTURE URBAINE
Avant toute chose, l’agriculture urbaine (hydroponie, aquaponie, aquaculture, petit élevage, jardins potagers…) ,
face aux enjeux mondiaux précédemment évoqués, est un secteur dont la popularité ne cesse de croitre tant au
niveau public que privé. À ce titre, les travaux du Schéma de Développement de l’Espace Régional mettent en avant
le fait que Liège et ses alentours possèdent un potentiel de développement provincial voire transeuropéen fort. Lier
les deux est une chance est à saisir.
L’agriculture urbaine constitue donc l’un des piliers importants du modèle proposé par VERDIR®. C’est pourquoi il
est essentiel de s’y attarder un instant tant ce concept se décline, de par la Terre entière, dans des contextes très
inégaux sur les plans culturel, social, économique et environnemental. Toutefois, force est de reconnaitre que
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%