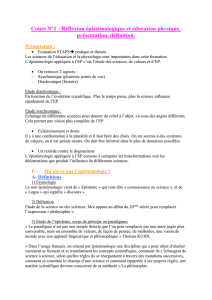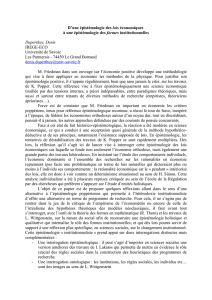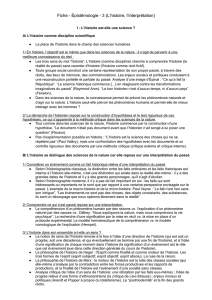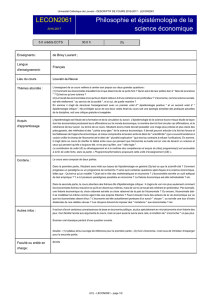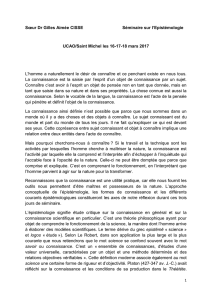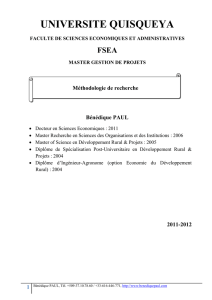L`historiographie et l`épistémologie : une ressource pour enseigner l

L’historiographie et l’épistémologie : une ressource pour enseigner l’histoire ?1
Patrick Garcia
Université de Cergy-Pontoise – IUFM de Versailles
Chercheur associé à l’Institut d’histoire du temps présent (IUFM de Versailles)
En quoi la connaissance de l’épistémologie de l’histoire et de l’historiographie peut-elle aider
à enseigner l’histoire ?
Ainsi formulée la question est somme toute assez nouvelle. Jusqu’à présent la “maîtrise des
contenus” qu’évoque l’argumentaire de ce colloque renvoyait essentiellement à une
dimension purement cognitive et non à un positionnement de type réflexif. En même temps,
pour nouvelle qu’elle soit, cette problématique n’est pas totalement fortuite puisque depuis
1992 une épreuve orale du CAPES d’histoire et géographie – l’épreuve sur dossier – mesure
la culture et la réflexion épistémologique et historiographique des candidats et que le terme
“épistémologie” a même fait son entrée dans le document d’accompagnement des
programmes de cinquième et de quatrième publiés en 1997 quand, à propos de l’usage du
document en classe, il est question de “mise en conformité épistémologique minimale”.
Certes l’histoire accuse encore un certain retard vis-à-vis de la géographie dont l’agrégation
comprend, depuis quelques années déjà, une épreuve écrite faisant place à l’épistémologie
(“concepts et méthodes de la géographie”) mais il n’en s’agit pas moins, si on se replace dans
la longue durée de l’histoire de la discipline, d’une inflexion notable2. L’évolution singulière
de l’épreuve orale sur dossier du CAPES instituée en 1992 qui, en histoire–géographie et
contrairement aux autres disciplines, a rapidement privilégié la réflexion épistémologique et
1 Texte publié in Cécile de Hosson et Aline Robert (dir.). “Intelligence des contenus et méthodes d’enseignement”, Revue
de l’UFR de l’école doctorale ED 400, Université Paris Diderot–Paris 7, 2009, p. 73-86.
2 Sans comporter une épreuve similaire l’agrégation interne d’histoire-géographie traduit aussi une prise en
compte nouvelle du pluralisme interprétatif par l’institution puisqu’elle invite le candidat, lors de la leçon orale, à faire
l’état de l’historiographie de la question dont il doit traiter et à se positionner vis-à-vis de celle-ci avant d’envisager la
façon dont il organiserait un cours à un niveau donné.

Patrick Garcia L’historiographie et l’épistémologie de l’histoire comme ressource pour l’enseignement 2
historiographique aux questions didactiques ou à l’évaluation de la “connaissance du système
éducatif” en témoigne amplement3. Cette orientation délibérément réflexive a induit “en
amont”, à l’université, et pas seulement au cours de l’année de préparation aux concours de
recrutement, la mise en place de modules invitant les étudiants à s’initier à ce questionnement
en donnant, notamment, un tour plus historiographique et épistémologique aux
enseignements dits préprofessionnalisation4.
Mais l’essor de ces enseignements n’est pas seulement un effet de commande aval, elle
correspond aussi à une inflexion majeure de la discipline historique dans les trente dernières
années qui a pu être qualifiée de “tournant réflexif” (François Dosse).
Avant d’aller plus loin qu’entendre par épistémologie de l’histoire et historiographie ? Des
définitions larges me semblent, à ce stade suffisantes :
− La démarche épistémologique, en histoire, n’est pas théorique et essentialiste comme elle
peut l’être en philosophie : elle ne consiste pas, par exemple, à se demander si l’histoire
est ou non une science (Cela n’empêche pas de se poser des questions générales comme,
par exemple, celle du rapport de l’historien au temps ou celle du recours à la
conceptualisation). Elle est une réflexion sur l’histoire en action qui prend en compte
aussi bien les spécificités de cette action par rapport à d’autres domaines de connaissance
que la manière dont a évolué le rapport de l’historien au passé et à son objet d’étude. Elle
consiste à se demander, par exemple, à partir de quelles sources est construit le savoir
historique, quels sont les champs couverts par la recherche, comment s’écrit l’histoire,
quelles sont les attentes de la société à son égard. Pour reprendre une formulation de
Gilles-Gaston Granger l’épistémologie ne joue pas un rôle normatif “[elle] se contente de
3 À l’heure où je rédige ce texte cette épreuve est malheureusement menacée dans le cadre de la refonte générale
du Capes ce qui constituerait une très importante régression (juillet 2008).
4 Une enquête sur l’état des enseignements universitaires en historiographie et en épistémologie de l’histoire est
en cours dans le cadre du Réseau historiographie et épistémologie de l’histoire constitué autour de l’Institut d’histoire du
temps présent (IHTP – CNRS) avec le concours de l’Inspection générale d’histoire-géographie et de l’École supérieure de
l’éducation nationale (ESEN).

Patrick Garcia L’historiographie et l’épistémologie de l’histoire comme ressource pour l’enseignement 3
décrire et de reconnaître l’organisation structurale et le fonctionnement d’une pensée
cognitive dans un domaine déterminé d’objets5”. C’est un travail d’“élucidation” (Certeau)
et de mise à distance.
- L’historiographie consiste plutôt à faire l’histoire des lieux où se construit et se transmet
le savoir historique (institutions savantes, établissements d’enseignement, édition, etc.) et
celle des interprétations successives, controverses et débats sur tel ou tel sujet.
Dans les deux cas, cette attitude est pleinement “réflexive” au sens où l’histoire, sans
négliger pour autant les regards venus d’ailleurs, s’interroge sur ses démarches en prenant en
compte leur historicité.
Pour tâcher de répondre à l’interrogation qui nous préoccupe ici il me semble nécessaire de
revenir en premier lieu sur quelques caractéristiques de l’épistémologie de l’histoire, puis
d’essayer de dresser un état des pratiques avant d’envisager l’historiographie et l’épistémologie
comme ressources.
I) Une épistémologie du mixte
a) Une longue défiance
Il faut, tout d’abord, rappeler que, pendant longtemps, la réflexion épistémologique n’a guère
été prisée par les historiens. Pierre Chaunu parlait, pour désigner l’épistémologie, de la
“morbide Capoue6”, celle en somme qui détourne de la route de Clio. Aujourd’hui encore les
dénonciations contre les “historiens épistémologues” se font régulièrement entendre au sein
5 Gilles-Gaston Granger, “La spécificité des actes humains”, entretien, EspacesTemps, “L’opération
épistémologique. Réfléchir les sciences sociales”, n°84/85/86, 2004, cit. p. 55.
6 “L’épistémologie est une tentation qu’il faut résolument savoir écarter [...] Tout au plus est-il opportun que
quelques chefs de file s’y consacrent – ce qu’en aucun cas nous ne sommes ni ne prétendons être – afin de mieux
préserver les robustes artisans d’une connaissance en construction – le seul titre auquel nous prétendions – des tentations
dangereuses de cette morbide Capoue.” Pierre Chaunu, Histoire quantitative, histoire sérielle, Armand Colin, 1978, p. 10.

Patrick Garcia L’historiographie et l’épistémologie de l’histoire comme ressource pour l’enseignement 4
de la communauté historienne (donner des exemples d'historiens) comme si le fait de
s’adonner à une réflexion théorique était une contre-indication à la pratique d’une “bonne”
histoire. Cette méfiance est ancienne et provient de la volonté des historiens professionnels
de se démarquer de la philosophie (Humboldt par exemple), et notamment de la philosophie
de l’histoire, lorsque s’affirme le processus de professionnalisation des historiens – pour la
France dans le dernier tiers du XIXème siècle7.
De fait les historiens français qui se sont risqués à une réflexion de type épistémologique et
l’ont revendiquée sont peu nombreux tant et si bien qu’on peut citer les principaux : Charles
Seignobos, Marc Bloch, Paul Veyne, Henri-Irénée Marrou, Michel de Certeau, Roger
Chartier, Antoine Prost, François Dosse ou encore François Hartog. Si on peut noter une
plus grande densité de travaux depuis les années 1980, la réflexion épistémologique a
longtemps été comme externalisée ou plutôt ce sont des philosophes voire des sociologues
qui se sont emparés du chantier (Raymond Aron, Paul Ricœur, Jacques Rancière, Jean-Claude
Passeron…).
Parler épistémologie pour un historien ne va donc pas de soi. Se pensant comme un artisan
voire un chiffonnier du passé, l’historien parle plus volontiers de méthode que
d’épistémologie, son empirisme est même un élément de distinction revendiqué. Dans le
débat qui l’oppose à François Simiand en 1907, Charles Seignobos, qui s’est pourtant efforcé
de théoriser sa pratique dit au sociologue : “Avec des pierres, je peux construire une maison,
je ne puis pas construire la Tour Eiffel8”. Puis il confesse, faussement affecté “Oh ! c’est un
sale travail que celui d’historien !9”, pour mieux soutenir ensuite que les productions
historiennes ne peuvent correspondre à l’idéal de perfection des “philosophes” (i.e. les
sociologues durkheimiens) et que “ce ne sont pas les auteurs des grandes spéculations, les
philosophes, qui ont créé la science moderne ; ce sont les empiriques10”. La faiblesse
7 Cf. Gérard Noiriel, La ‘crise’ de l’histoire, Belin, 1996 ou Christian Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia, Les
courants historiques en France XIXe/XXe siècles, coll. “U”, Armand Colin, 1999, réédition revue et augmentée : Gallimard,
Folio histoire, 2007.
8 Charles Seignobos, “Intervention lors de la séance du 30 mai 1907”, Bulletin de la société française de Philosophie,
Armand Colin, cit. p. 268.
9 Ibid., p. 305.
10 Ibid., p. 289.

Patrick Garcia L’historiographie et l’épistémologie de l’histoire comme ressource pour l’enseignement 5
théorique de l’histoire serait ainsi le gage de sa fécondité comme de son adaptation à son
objet. Lucien Febvre le remarque malicieusement dans sa leçon inaugurale au Collège de
France en 1933 : “Je me le suis souvent laissé dire d’ailleurs, les historiens n’ont pas de
grands besoins philosophiques”.
Le poids de la tradition est tel qu’Henri-Irénée Marrou doit, en dépit de sa position
académique, se justifier d’avoir ce type de préoccupations quand il publie en 1954 De la
connaissance historique :
“Il faut […] s’arracher à l’engourdissement dans lequel le positivisme a trop longtemps
maintenu les historiens. […] Notre métier est lourd, accablant de servitudes
techniques ; il tend à la longue à développer chez le praticien une mentalité d’insecte
spécialisé. […] Parodiant la maxime platonicienne nous inscrirons au fronton de nos
Propylées : ‘Que nul n’entre ici s’il n’est philosophe’ – s’il n’a d’abord réfléchi sur la
nature de l’histoire et la condition de l’historien : la santé d’une discipline scientifique
exige, de la part du savant, une certaine inquiétude méthodologique, le souci de
prendre conscience du mécanisme de son comportement, un certain effort de réflexion
sur les problèmes relevant de la ‘théorie de la connaissance’ impliqués par celui-ci11.”
Si le statut de l’historiographie est meilleur, le genre historiographique est tout aussi
marginal, du moins sur le plan institutionnel. Une seule université – Paul Valéry à
Montpellier – possède une chaire d’historiographie (qui détient cette chaire actuellement???
Quid de Didaxis?? bref historique de cela en bas de page).
L’historiographie et l’épistémologie ont donc trouvé refuge dans des institutions
périphériques par rapport à l’université : l’EHESS tout d’abord les IUFM en raison de la
commande aval par l’épreuve sur dossier du Capes en second (et bien moindre) lieu12.
J’ajoute que la question n’est pas seulement une question interne à la communauté
historienne puisque les historiens sont constamment confrontés à une image sociale forte et
normative de ce qu’est leur discipline de la part des politiques ou pour l’enseignement des
élèves et/ou de leurs parents. Rappelons-nous Michel Debré interpellant en 1980 le
ministre de l’éducation nationale de Valéry Giscard d’Estaing, René Monory!!!!(en 1980 le
ministre de l'éducation est Christian Beullac), et lui disant, sur un ton péremptoire :
11 Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, (1954), Points Seuil, 1975, cit. p. 8-9.
12 Cf. L’histoire entre épistémologie et demande sociale, Actes de l’Université d’été tenue à Blois en septembre 1993,
IUFM de Créteil, de Toulouse et de Versailles, 1993.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%