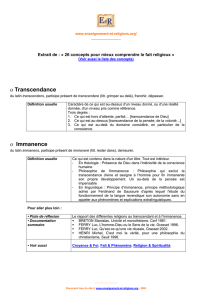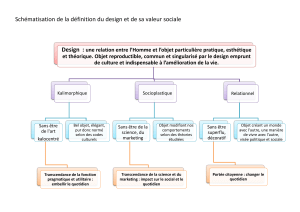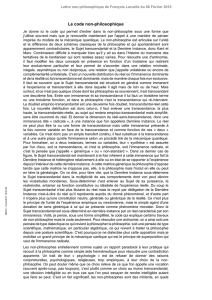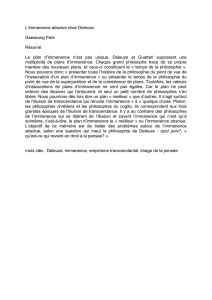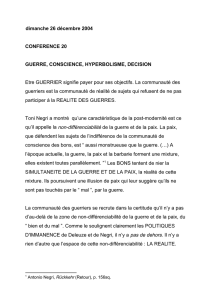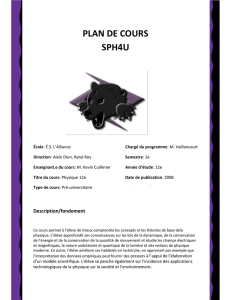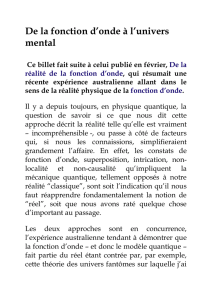Aux sigles utilisés nous ajoutions le glossaire des

SIGLES USUELS
Des sigles abrègent certains signifiants qui désignent des agrégats de notions. Selon une certaine
logique phénoménologique et en vertu de l’inséparabilité quantique nous usons fréquemment
d’agrégats conceptuels.
DI, Dernière Instance (détermination-en-DI)
DU, Dualité unilatérale.
FP/RP, Forces productives et Rapports de production dont l’unité sous les RP constitue chez Marx la
causalité dite de la « dernière instance ».
I et T, Immanence et transcendance, les deux composants élémentaires les plus généraux, ou encore
les deux variables canoniquement conjuguées dans la philosophie et donc dans la matrice générique.
MQ, Mécanique quantique, nous reprenons pour faciliter l’orientation du lecteur cette ancienne
expression inadaptée mais utile, remplacée parfois par Théorie ou Physique quantique, ou encore
par « quantique », terme que nous utilisons aussi comme généralité indéterminée.
PMS, Principe de mathématique suffisante, l’un des deux principes de précaution ou de prévention
théorique, formule jumelle du PPS, elle implique le suspens de l’usage « suffisant » ou englobant de
la mathématique dans la quantique (et semi-englobant dans la philosophie), c’est le principe de la
limitation générique de l’Idéal mathématique dans ces disciplines.
PPS, Principe de philosophie suffisante, l’un des deux principes de précaution ou de prévention, il
résume le suspens partiel de l’usage « suffisant » de la philosophie comme doublet de la
transcendance, c’est un principe de limitation non pas « critique » mais générique ou non-
philosophique.

GLOSSAIRE DE LA QUANTIQUE GENERIQUE
Aux sigles utilisés nous ajoutions le glossaire des notions propres au traitement générique de la
Quantique. Il résume des notions théoriques nécessaires à la préparation de la Matrice et à la
conduite de l’expérience. Nous laissons donc de côte la terminologie la plus classique de la
philosophie et convoquons surtout celle de la quantique mais dans sa version générique.
L’entrelacement des notions est tel qu’il a fallu se résoudre à suivre l’ordre alphabétique et renoncer
à un glossaire raisonné. Même le dictionnaire d’une langue que l’on supposerait totalement
inconnue peut servir d’introduction et éviter des tâtonnements infinis. D’ailleurs beaucoup des
explications des concepts se font par recours à des synonymes présents dans le texte. Il s’agit de
fixer un minimum de stabilité et de reconnaissance possible dans un usage parfois fluant de ces
concepts formés d’agrégats qui sont des super positions. L’idéal, tout à fait contraire à nos habitudes
de lectures soit d’essais soit d’ouvrages techniques appartenant à un domaine déterminé, serait de
mémoriser un minimum ce vocabulaire à la manière d’une langue étrangère aux physiciens et aux
philosophes mais leur empruntant une partie de leur vocabulaire. La simple lecture de ce glossaire
montre à quel point nous nous éloignons sciemment de la Mécanique quantique dans l’usage de ses
concepts, dans une autre fonction ou un autre système dont les paramètres sont tous de nature
unilatérale. Elle devrait éviter des confusions ou des apparences liées a l’empiètement des concepts
scientifiques et des concepts génériques (ou philosophiques) et qui induiraient les spécialistes dans
une interprétation erronée du sens de cette entreprise.
Amplitude de futuralité ou de virtualité. Equivalent dans la sphère générique de l’amplitude de
probabilité, de la fonction d’onde ou vecteur d’état dans la MQ. Formule ou équation dont la forme
générale est celle de la Matrice et qui programme la transformation quantique en-dernière-instance
d’une Identité conceptuelle corpusculaire, loi de sa sous-détermination et de sa détection. C’est la
condition de-dernière-instance sous la forme d’un non-agir futural et virtuel qui définit l’amplitude
d’une pensée dans le processus d’invention.
Clonalité. Ecriture générique ou particulaire d’un concept obtenue à la suite d’une expérimentation
de pensée faite en Matrice. La clonalité fait complémentarité unilatérale avec la virtualité ou la
futuralité. Quoique actuelle ou réalisée à la différence de l’onde immanente de virtualité, elle
n’existe comme écriture qu’à l’état de clone ou de noème, détectable sous des conditions de-
dernière-instance qui sont virtuelles. C’est le mode de présence de l’Identité conceptuelle en tant
que particule configurée par l’onde. La proportion des cas réalises ou réellement détectés aux cas
possibles tels que programmes par l’onde de virtualité avec ses variables et son nombre imaginaire
est le type générique de « probabilité » ou le hasard radical et n’est pas une question de quantité
mais de quantum générique.
Clone. Forme ondulatoire mais noématique de la particule comme transcendance tombée en-
immanence. Identité-sans-unité en tant qu’appréhendée en-immanence dans sa forme achevée de
particule, front d’onde compris. Se dit en particulaire de la forme-sujet ou ego particulaire sous le
nom de « sujet-Etranger ».
Complémentarité unilatérale. Rapport effectif ou concret des diverses dualités de la SG issues de la
dualité primitive onde/corpuscule. Son essence est la dualité unilatérale et non la dialectique ou
l’exclusion selon Bohr. Mais nous conservons le terme de complémentarité difficilement expugnable.
Il s’agit plutôt d’une sup-plémentarité et d’une sous- plémentarité, la particule étant comme

corpuscule ajoutée à l’onde et à son immanence radicale (supplémentarité) qui la sous-détermine
(sous-plémentarité).
Configuration, effet particulaire ou noématique du non-agir ondulatoire sur la particule, lorsque
l’ondulation s’achevé comme front. Contenu phénoménal, entre autres interprétations de la dualité
onde-corpuscule, de l’ « onde-pilote » ou guide (de Broglie) de la particule.
Dé-numérisation et de-conceptualisation. Procède de réduction des aspects numériques de
l’engobant mathématique (PMS) de la MQ et des aspects suffisants de l’englobant philosophique
(PPS). La quantification générique de la philosophie est un science-sans-nombres ou sans-calcul et
sans-transcendantal. Opération de simplification des doublets (PPS) et de réduction de la sécularité
en général.
En-personne. Caractère phénoménal de l’immanence radicale ou de l’Un, son pouvoir de se montrer
comme uni-latérale ou uni-faciale, unique face-(de)-l’Un ou Un-en-personne. L’En-personne se dit
soit de l’immanence soit de la transcendance tombée en-immanence. Le générique s’oppose à la
singularité individuelle et au tout, il est l’immanence elle-même et donc la face de transcendance ou
la « personne » de l’immanence. Se dit des notions réduites à l’immanence radicale.
Fonction d’onde. Formule ou équation combinant les symboles variables philosophiques ou réelles
(Un, Etre, Autre, Multiple, Etant, etc.), affectées du nombre imaginaire ou complexe compris
géométriquement comme quart de tour ou de cercle, et phénoménalement comme dualité
unilatérale. Désignant la loi d’un processus ondulatoire et non d’un « état », cette ancienne
expression est souvent préférée ici au mathématique « vecteur d’état », la vectorialite du vecteur
étant elle-même un processus et non un simple état objet d’une opération mathématique.
Futural. Etat de ce qui sous-vient comme DI au-devant du sujet-Etranger tel un agir passif. Non-agir
sous-déterminant la transcendance première, sa propre expérience du « future » comprise. La DI ou
le Sujet générique avant-première est futural ou une forme de virtualité.
Idemmanence. Forme radicale, non absolue, de l’immanence lorsqu’elle est obtenue par
superposition de l’idempotence d’origine algébrique et de l’immanence comme concept d’origine
philosophique. Caractérise le plan générique comme transcender simple pour le distinguer du « plan
d’immanence » absolue (Deleuze) comme ayant partie liée avec la double transcendance
philosophique.
Idempotence. Propriété algébrique de certaines opérations (A + A = A), ici interprétée
philosophiquement comme propriété phénoménale de la superposition et de son immanence.
Principe de l’ondulation ou forme a priori de la particule.
Identité conceptuelle. Objet corpusculaire ou supposé en soi, typique de la réalité philosophique,
forme macroscopique par excellence de la pensée dont participe tout représentation philosophique
ou standard (concept, terme, sens, catégorie). C n’est pas spécialement le transcendantal de l’Un
sauf si celui-ci se dit aussi de tout terme philosophique. Reçu comme apparemment simple, c’est
l’objet et le matériau de la déconstruction ondulatoire qui en produit la genèse quantique sous la
forme d’une « micro-identité » particulaire, qui peut se reconvertir par apparence objective en en
soi macroscopique.

Immanental. Directement opposé à transcendantal, son symétrique pour l’immanence radical. Non-
rapport de l’immanence (par superposition) à l’expérience c’est-à-dire à la particule et plus loin au
corpuscule. Pouvoir de sous-détermination par la Dernière Instance de la double transcendance qui
tombe en-immanence.
Indirect (discipline indirecte ou interdiscipline). Une discipline générique est indirecte si elle atteint
son objet par une double médiation inséparable, si son objet fait partie de ses moyens, si son moyen
principal est aussi un objet. Une quantique de la philosophie use de la philosophie non-seulement
comme objet mais comme moyen. Une discipline générique de la quantique use de celle-ci comme
moyen et pas seulement comme objet. Tout objet d’une discipline est aussi un moyen de celle-ci.
L’agir vectorial du module ne dépend pas seulement en général de la phase mais l’investit à même
son objet. Une science indirecte est celle des moyens avant d’être celle de l’ « objectivité » simple
ou rationnelle.
Médiat-sans-médiation. Dans le langage de la causalité, l’effet en tant qu’il sous-détermine ou
détermine en-dernière-instance sa cause, donc sans procéder par une simple inversion de l’ordre
causal. Effet d’une médiation dont la cause ou l’acte a été sous-déterminé par cet effet agissant
comme « Dernière Instance ». Statut de ce qui est réel, immanent ou phénoménal et dont l’acte soit
de médiation soit de donation est rejeté comme transcendance particulaire. Immanence mais
indirecte, immédiateté mais sans transparence, action indirect mais immédiate, action à distance
mais par la distance même. Comme le « non », le « sans » n’est pas absolu mais seulement radical,
c’est le pli unilatéral d’un plan générique ou d’une immanence qui transcende sans être parvenue
encore à l’état de transcendance particulaire (simple) qui suppose qu’elle est tombée-en-
immanence ou devenue éventuellement perceptible comme biface. Plutôt que l’individu ou la
singularité opposé à l’universel ou bien médiatisé par celui-ci, c’est l’indivi-dualité ou l’uni-latéralité,
soit la généralité sous-universelle ou l’immanence qui engendre de soi une transcendance simple et
non double comme l’universel philosophique. Le médiat-sans-médiation est l’immanence radicale
par superposition des médiations réciproques ou des interprétations mutuelles des variables
quantique et philosophique de la matrice. Il n’est pas absolument « sans » médiation mais ne l’est
que radicalement ou unilatéralement. C’est le milieu qui n’est plus partagé entre deux bornes mais
devenu consistant ou autonome par immanence et non plus par transcendance. Le médiat-sans-
mediation est ondulatoirement un mi-lieu mais par rapport au cercle philosophique il devrait être dit
un « quart-lieu ».
Nombre imaginaire ou complexe. Représente géométriquement par le quart de tour ou de cercle, il
s’écrit racine carrée de -1. Non réel comme les nombres arithmétiques, il y ajoute le sens de la
direction et de la transformation. Il équivaut phénoménalement et non physiquement au spin ¼ ou
immanent de la Dernière Instance dont il est la partie imaginaire. Principe immanente ou pré-
ondulatoire de l’a priori ondulatoire.
Non-agir. Etat spécifique de la Dernière Instance ou du Sujet générique en tant qu’elle n’est pas un
principe d’auto-production, pas davantage un non-agir extrême-oriental ou absolu, mais un non-agir
radical. Le non-agir radicale est un agir virtuel, futural, sollicite occasionnellement ou relancé par le
répétition d’une occasion sur laquelle il agit en la configurant, sous-déterminant sa double
transcendance. Relance du Sujet générique et répétition occasionnelle de l’ondulation forment une

complémentarité unilatérale. La réaction du non-agir que sollicite l’occasion n’est pas constitutive ou
réelle de l’action du non-agir, c’est pour lui une simple relance.
Non-commutabilité. Un des deux principes universels de la MQ, d’origine algébrique, à cote de la
superposition. Il stipule que les produits inverses de deux « quantités physiques » ne sont pas égaux
ou commutables. Transformé ici en ordre unilatéral ou de la Dernière Instance dont il est
inséparable. Il stipule maintenant que celle-ci comme générique et la philosophie qui est son objet
et même son occasion herméneutique ne sont pas commutables ou forment une complémentarité
unilatérale.
Non-einsteinien (cf non-gödelien, non-schrödingerien, non-cohenien, etc.). Le « non » qui modalise
les noms propres assignes à une théorie ou un système de pensée est, comme le « sans », une
caractéristique du générique qui use de la science ou de son pouvoir critique sur leurs propres et
dernières prétentions philosophiques. Le « non » dit l’Un-en-Un d’Einstein, de Gödel, etc. et non pas
leur être. Il a donc une valeur négative extrêmement réduite et n’engage aucune dialectique de
contraires ou d’opposes, aucune opération d’’évidement, à la rigueur une neutralisation ou une
simplification de la transcendance pour le corpuscule passant à l’état de particule, ou encore de
négation de-dernière-instance. En toute rigueur il faudrait parler de non-négation ou de non-néantir
sans en appeler à une dialectique. Son effet est celui d’un « transfert brisé ou unilateral », la
transcendance subsiste en perdant sa forme doublet, l’immanence est ré-affirmée ou radicalisée
comme superposition. C’est l’effet général de la substitution de la superposition à l’identification ou
au doublet philosophique.
Ondulation. Notée algébriquement -1. Objet élémentaire macroscopique puis microscopique dont la
SG pout suit la connaissance particulaire sur la base du quart de cercle « imaginaire ». Sous cette
forme réduite et déduite du quart, c’est l’a priori morphologique de la « correlation » (du non-
rapport ou unilation) onde-particule. Ou encore la distance semi-extatique, semi-phénoménologique
ou unifaciale qui donne la particule comme clone du corpuscule.
Ondulatoire. 1. Adjectif ou parfois nom général pour tout ce qui concerne le phénomène et la
thématique des ondes, s’oppose alors plutôt à corpusculaire (les corps individuels ou
macroscopiques dans lesquels on inclut le concept et ses variétés). Dans le passage de cette
physique classique ou newtonienne à une conception quantique de l’ondulatoire et de la particule,
le phénomène ondulatoire obéit alors à des lois nouvelles que nous utilisons pour le vécu
(superposition et non-commutativité, nombre complexe ou imaginaire) et qui ne sont pas celles des
corpuscules mais des particules. Ondulatoire est ici employé pour l’interprétation quantique des
ondes, rarement pour leur interprétation macroscopique. 2. La MQ résorbe mathématiquement la
dualité onde/particule au profit de la particule. Nous donnons plutôt un certain privilège à
l’ondulatoire en général en le distinguant évidemment du corpuscule et partiellement de la particule
dont elle est la forme génétique. Onde et particule sont le « même » et/ou « distinctes », onde-
particule et corpuscule également mais cette fois à une apparence objective près. L’ondulatoire est
aussi particulaire mais pas à la manière classique, l’ondulation n’est que la forme même de la
particule (pas sa matière) comme s’il y avait superposition et non-commutativité de l’onde et de la
particule. Le résultat est la dualité unilatérale de l’ondulation « comme » particulaire. L’onde est un
phénomène d’immanence radicale par superposition, la particule est l’excès de transcendance
« simple » mais bifaciale, achevée sans être fermée, sur l’immanence qu’elle est aussi. On distingue
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%