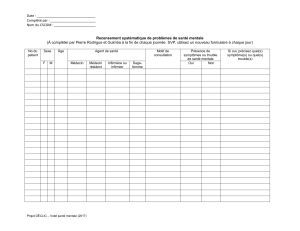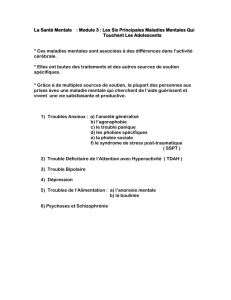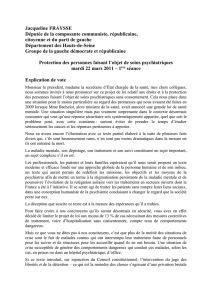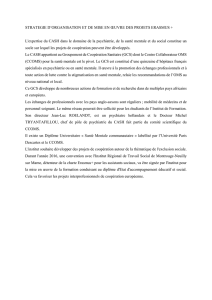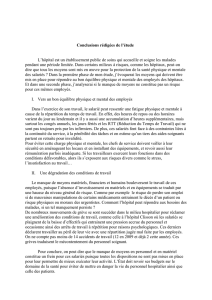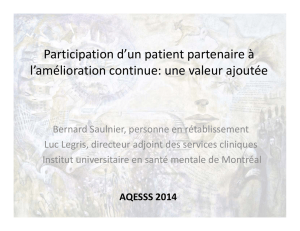Le maire et le psychiatre: ensemble pour la santé mentale Le maire

Le maire et le psychiatre:
ensemble pour la santé mentale
Actes de la journée d'étude de Grenoble
13 mars 2007
Association
Nationale des villes
pour le développement
de la santé publique
Conçue dans la continuité de la journée d'étude
organisée en octobre 2006 à Nantes par l'ORSPERE-
ONSMP et l'association "Elus, Santé Publique &
Territoires" sur les compétences des élus locaux en
matière d'hospitalisation psychiatrique, la journée
d'étude " le maire et le psychiatre: ensemble pour la
santé mentale " tente d'explorer les expériences de
partenariat large construites entre la ville et les acteurs
locaux de la santé mentale, dont l'objectif est de trouver
une réponse adaptée aux problématiques de la
souffrance psychosociale et de la maladie mentale, dans
l'urgence, mais avant tout en amont, par des dispositifs
concertés de prévention.
L'association nationale des villes pour le développement de la
santé publique "Elus, Santé Publique & Territoires", créée en
2005, a pour objectifs de fédérer les élus locaux pour:
- promouvoir toute politique visant à la réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé, favorisant l'accès
aux droits, aux soins, à la prévention, à la santé égale pour
tous, contribuant à l'éducation et à la promotion de la santé
et intégrant les déterminants de la santé;
- affirmer, faire reconnaître et légitimer le rôle des communes
et de leurs groupements dans la mise en oeuvre de politiques
territoriales de santé publique, en particulier dans le cadre
d'une co-production avec l'Etat;
- développer et consolider toute forme de programmes de
santé publique contractualisée entre les collectivités
territoriales et l'Etat, dans la logique et sur le modèle des
"Ateliers Santé Ville".
11 rue des anciennes mairies
92 000 Nanterre
01 47 24 67 58
espt.ass[email protected]r
www.espt.asso.fr
es
Le maire et l
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
ement
de la
PT
ensemble pour la santé mentale
e la journée d'étud
13 mars 2007

L’association « Élus, Santé Publique & Territoires »
L’association « Élus, Santé Publique & Territoires » a été créée en octobre 2005 à
l’initiative d’élus locaux en charge de la Santé, désireux d’œuvrer avec les pouvoirs
publics pour que la santé devienne l’un des champs des politiques municipales.
Jusqu’à présent, les villes engagées dans des actions de santé publique, de prévention
et/ou de soins agissent en fonction de priorités ou sensibilités particulières. L’association
souhaite leur apporter un lieu d’échange et de réflexion et les aider à définir des lignes
d’action cohérentes. Elle se positionne également comme partenaire privilégié de l’Etat,
central et déconcentré, pour parvenir à faire de la Santé publique un objet de débat
politique local et d’action de la Ville.
La mobilisation de « Élus, Santé Publique & Territoires » en matière de santé
mentale
Du point de vue strictement légal, la légitimité des élus locaux à agir en matière
de santé mentale est réduite à la gestion provisoire des troubles de l’ordre public en lien
avec un trouble mental (articles L. 3213-1 et L 3213-2 du Code de la Santé Publique).
Pourtant, selon un nombre croissant d’élu(e)s locaux, une approche de santé mentale
inclut la reconnaissance et la lutte contre une souffrance psychosociale, conçue comme
une perturbation de la capacité du vivre ensemble des citoyens. A l’initiative de
l’ORSPERE-ONSMP1, plusieurs études2 successives ont tenté d’explorer les manières de
sentir et de penser des élus locaux confrontés à une demande de santé mentale. Dans le
sillon de ces recherche-actions, l’association nationale des villes pour le développement
de la santé publique est née, avec notamment pour préoccupation de faire de la santé
mentale une question avant tout politique, relevant moins d’une expertise spécialisée en
médecine, que d’une préoccupation publique nationale et locale.
Les travaux de l’ORSPERE-ONSMP, auxquels ont participé de nombreux élus de
l’association ESPT ont rendu explicites:
- la souffrance et la sollicitude des élus locaux en tant qu’acteurs de première ligne
confrontés à la complexité de la souffrance psycho-sociale,
- la légitimité d’une préoccupation collective de santé mentale,
- la nécessité de « passer d’une logique d’expert à une logique de gouvernance »
qui renvoie aux difficultés à faire de la santé mentale une préoccupation
affranchie du monopole de l’expertise psychiatrique, ainsi qu’à la position
stratégique de l’élu local capable d’interpeller les acteurs des champs non
sanitaires de la prise en charge (social, éducatif, de la sécurité, de la justice) et de
réguler une action transversale susceptible de prévenir la souffrance
psychosociale.
« Elus, Santé Publique & Territoires » a consacré sa dernière journée d’ étude aux
compétences des élus locaux en matière d’hospitalisation psychiatrique (« Santé mentale
et ordre public : quelles compétences pour les élus locaux ? », Nantes, octobre 2006).
Elle a en outre pris position quant à la prochaine réforme des hospitalisations
psychiatriques sans consentement par un communiqué de presse consultable sur le site
www.espt.asso.fr.
1
L’Observatoire National des Pratiques en Santé Mentale et Précarité, soutenu par la Direction générale de la
Santé et la Direction Générale des Affaires Sociales, est une structure de recherche-action spécialisée dans le
champ de la précarité sociale en lien avec les questions de santé mentale.
2
Grâce au soutien de la Délégation Interministérielle à la Ville, l’ONSMP-ORSPERE a ainsi mené un séminaire
national regroupant des élu(e)s locaux durant plus de deux ans autour de la problématique de la souffrance
psychosociale puis de l’hospitalisation d’office. Cf. le séminaire DIV/ONSMP-ORSPERE 2003-2004 : « Les élu(e)s
locaux dans la nouvelle donne de la santé mentale » - Rapport final, Septembre 2005, ainsi que sa publication :
« Les élu(e)s locaux face à la souffrance psychosociale : de la sollicitude au politique », Ed. de la DIV, coll.
Etudes et Recherches, novembre 2005.

2

3
Sommaire
OUVERTURE
Michel Destot, maire de Grenoble …………………………………………………………………………………. p. 5
PRESENTATION DE LA JOURNEE
Marina Girod de l’Ain, maire adjointe à Grenoble, vice-présidente de l’association « Elus,
Santé Publique & Territoires » ………………………………………………………………………………………. p. 9
CONFERENCE PRELIMINAIRE « Après la loi de prévention de la délinquance »
Débat animé par Loïck Villerbu, professeur de psychologie clinique
« La place du juge dans les hospitalisations d’office » …………………………………………….… p. 11
Bernard Azéma, premier vice président du Tribunal de grande instance de Grenoble
« Le pouvoir des maires en matière d’hospitalisation d’office » …………………………….…. P. 19
Pauline Rhenter, politologue
PREMIERE TABLE RONDE « Agir en amont des hospitalisations contraintes : les
dispositifs d’alerte »
Débat animé par Serge Kannas, psychiatre, membre permanent de la Mission Nationale
d’appui en Santé Mentale
« Le groupe de la vulnérabilité de la ville de Champigny sur Marne » ……………………… p. 29
Marie Odile Dufour, maire adjointe et Françoise Bargero, attachée principale, chef de
service de l’Aide légale au CCAS
« La cellule d’alerte de la ville d’Evry » …………………………………………………………………….… p. 36
Philipe Lefèvre, médecin coordinateur du centre de santé
SECONDE TABLE RONDE « Pour une prévention en santé mentale : les
dispositifs de concertation »
Débat animé par Guy Gozlan, psychiatre, directeur médical du réseau PREPSY
« La santé mentale dans l’atelier santé ville d’Aubervilliers » ….………………………………. p. 59
Pilar Giraux, psychiatre, médecin de santé publique
Guillaume Kammer, psychiatre de secteur
« La construction d’un diagnostic local et le dispositif de concertation en santé mentale à
Grenoble » ……………………………………………………………………………………………………………………. p. 71
Marina Girod de l’Ain, maire adjointe
François-Paul Debionne, médecin directeur de la ville
Pierre Murry, psychiatre, chef de service
CONCLUSION
Jean Furtos, psychiatre chef de service, directeur de l’ORSPERE-ONSMP ……………….. p. 85
« Le rôle des élus en matière de santé mentale » - Document transmis par Eric Piel,
psychiatre chef de service …………………………………………………………………………………………... p. 91
CLOTURE
Laurent El Ghozi, maire adjoint à Nanterre, président de l’association « Elus, Santé
Publique & Territoires » ………………………………………………………………………………………….….. p. 97
BIBLIOGRAPHIE …………………………………………………………………………………………………….. p. 101
LISTE DES ABREVIATIONS…………………………………………………………………….………..…… p. 105

4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
1
/
106
100%