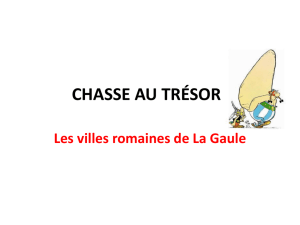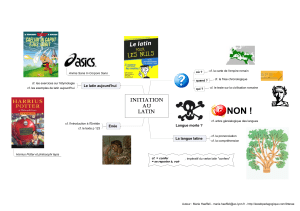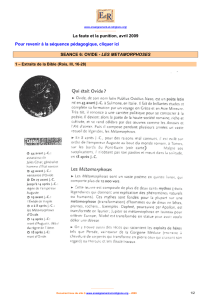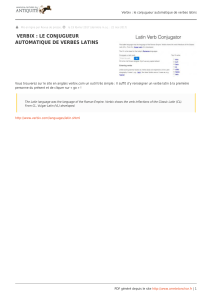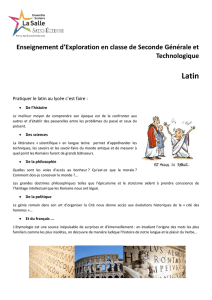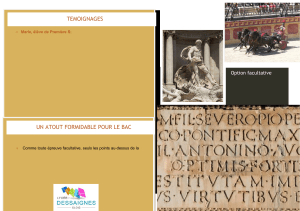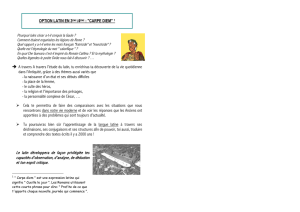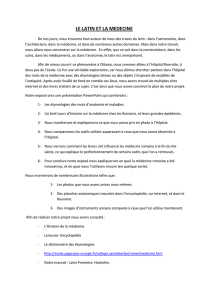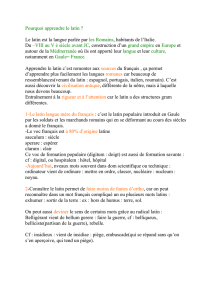1 RUOZZI PAOLA - Sujet n°1 - Dipartimento di Lingue e Letterature

1
RUOZZI PAOLA - Sujet n°1 : “L’EMPRUNT ET LE CALQUE (DECALQUAGE, DECALQUE) LINGUISTIQUE”
L-11 LLS (Ling) = Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere, curriculum Linguistico-didattico
3 LT- Corso: “Introduzione al cambiamento linguistico” (Linguistica d’area) – 36h – 6 CFU
Sources (monographies):
BLOCH O. & W. v. WARTBURG (2004 (2002, 1932)). Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris : PUF.
Collection « Quadrige ».
BRUNOT F. & C. BRUNEAU (1949). Précis de grammaire historique de la langue française. Paris : Masson & Cie. 5e éd.
HUCHON M. (2002). Histoire de la langue française. Paris : Librairie Générale Française.
KOCOUREK R. (1991). La langue française de la technique et de la science. Vers une linguistique de la langue savante.
Wiesbaden : Oscar Brandstetter.
ULLMANN S. (1970 (1966)). La semantica. Introduzione alla scienza del significato. Bologna: Il Mulino. Ullmann S.
(1962). Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Oxford: Basil Blackwell & Mott Ltd.
Sources (sitographie) :
FRANCE TERME. Tous les termes publiés au Journal Officiel par la Commission générale de terminologie et de néologie
(http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/ )
LE TRÉSOR DE LA LANGUE FRANÇAISE INFORMATISÉ (TLFi) (2004). Paris : CNRS Éditions (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm)
Portail linguistique du Canada ( http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/bien-well/fra-eng/angl-engl/syntax-
fra.html)
Sources (articles) :
Laugier R. I. A. , " Rendons à Marianne ... ou les emprunts de retour". Interculturel, 2011, Vol. 15, pp. 35-47.
(1) L’EMPRUNT LINGUISTIQUE ALLOGÈNE (EMPRUNT, TERME D’EMPRUNT, UNITÉ LEXICALE D’EMPRUNT).
L’emprunt, sous ses multiples formes, est l’un des mécanismes les plus universels et répandus du
changement linguistique. Il répond à un besoin de la langue de nommer de nouveaux objets ou concepts
pour lesquels elle ne dispose pas, ou pas encore, de termes autochtones ou pour lesquels elle trouve ses
propres termes moins adéquats. Le terme en soi indique à la fois et le procédé par lequel, d’habitude, une
langue dite receveuse (ou emprunteuse ou d’accueil) emprunte un terme, une expression syntagmatique
ou une construction syntaxique à une langue étrangère, dite prêteuse, et le résultat de ce même procédé.
Le cas qu’on vient de décrire, dit emprunt allogène ne doit pas être confondu avec celui de l’emprunt
hérité, ou héréditaire, tels que les apports du latin (ou bien du francique, du gaulois), par exemple, dans le
développement naturel du français en tant que langue romane. A ce propos, l’adjectif « naturel » est
important, puisque le latin fera aussi l’objet, au cours des siècles, d’emprunts savants qui finiront par se
superposer, avec un sens différent, aux termes issus du fonds latin et naturellement modifiés par l’action
aveugle des lois phonétiques (par ex. le latin hospitale(m), sous l’action des lois phonétiques, avait donné
hostel > hotel > hôtel, la forme hospital > hôpital , avec restitution de la syllabe pré-tonique interne, est
donc un emprunt savant ). Pour qu’un emprunt puisse être défini comme tel, il faut que le terme ou
l’expression empruntés soient suffisamment fréquents dans la langue prêteuse pour intégrer le lexique de
cette dernière, soit-il celui de la langue courante et/ou celui d’une ou de plusieurs langues de spécialité
(technoscientifiques).
L’emprunt constitue donc un moyen d’innovation du système lexical, tout occupant une position marginale
de ce dernier ; l’emprunt est un élément important mais labile de l’enrichissement lexical, à cause du fait
qu’il peut connaître un sort différent et qu’il peut faire l’objet, lors de son accueil, de plusieurs procédés
d’adaptation (ou intégration, ou assimilation), notamment sur le plan phonétique et graphique. L’unité
lexicale empruntée peut être adaptée au français du point de vue phonique: les phonèmes anglais, par ex.,
sont remplacés par des phonèmes français imitant la prononciation anglaise ou américaine : tel est le cas,
par exemple, des mots

2
- spray [sprε]
- know-how [noaw]
- coach [kotʃ ]
- hardware [ardwεr]
- rewriter [rəraitœr]
Parfois l’adaptation ne concerne que l’accent, que le français déplace sur la dernière voyelle ou diphtongue
disponible, comme dans le cas de
- jap. karaoke, pronconcé et graphié karaoké [karao’ke]
ou bien de l’anglais
- angl. ‘fitness [fitn’εs]
- angl. ‘glamour [glam’ur]
- angl. show-‘business [ʃ obis’nεs]
- angl. people [pi’pɔl]
- angl. leader [li’dεr]
- angl. cow-boy [ko’boi]
- angl. cocktail [kok’tεl]
- angl. summit [sœ’mit]
et de beaucoup d’autres.
Parfois, un phonème d’emprunt est transposé tel quel dans la prononciation française ; c’est le cas du
phonème [ŋ] de camping, meeting, planning, parking, merchandising, pressing, zapping, etc.
L’intégration ou adaptation phonique n’est réalisée que rarement, et deux variantes subsistent le plus
souvent dans la prononciation :
- gas-oil [gɑzɔil] [gɑzwɑl]
- pipe-line [pajplajn] [piplin]
- container [kõtεnεr] [kõtεnœr]
- check-up [ʃ εkœp] [tʃ εkœp]
- flash-back [flɑʃ bɑk] [flɑʃ bεk]
- merchandising [mεrʃ ãdizŋ] [mεrʃ ãdajzŋ]
Une assimilation avancée peut être signalée par une intégration graphique, c.-à-d. par une réfection
graphique francisée (le cas le plus répandu est ici celui des noms de lieux):
- gazole (gas-oil)
- héliport (angl. heliport)
- jerricane (angl. jerry can, jerrican)
- média (lat. media)
- redingote (angl. riding coat)
- Londres (angl. London)
- Copenhague (danois Copenhagen)
- Prague (tchèque Praha)
- Milan, Venise, Florence, Naples (it. Milano, Venezia, Firenze, Napoli) etc.
L’adaptation de l’emprunt peut passer par un démantèlement en morphèmes du terme étranger, ce qui
donne lieu à un emprunt lexico-morphologique : le morphème lexical originaire est le plus souvent
conservé, mais le suffixe étranger, ou morphème grammatical, est remplacé par un morphème dérivatif

3
français fonctionnellement équivalent ; nous sommes ici à mi-chemin entre emprunt proprement dit et
calque morphologique (partiel) :
- zonage (angl. zoning)
- trappage (angl. trapping)
- ingénierie (angl. engineering)
- conteneur (angl. container)
- criticité (angl. criticality)
- boxeur (angl. boxer)
Lorsqu’un emprunt est bien acclimaté dans la langue d’accueil, il devient souvent productif, et utilise alors
pour ses dérivés les morphèmes grammaticaux mis à disposition par la langue d’accueil : ex. relooker, verbe
fr. du 1er groupe tiré de l’anglais to relook, alors que relooking, en tant que substantif indiquant le
processus, a conservé la forme anglaise. Même chose pour le verbe anglais rewrite, francisé sous la forme
rewriter (« il rewrite des articles », Gilbert ’80 : 560, cit. Kokourek 1991 : 155). D’autres emprunts
productifs :
- angl. sport > fr. sportif/ive
- angl. film > fr. filmer
- angl. sponsor > fr. sponsoriser
- angl. test > fr. tester
- angl. an/to interview > fr. interviewer
- angl. to scan > fr. scanner (nom et verbe)
- angl. to format > fr. formater
- angl. to box > fr. boxer ; boxer > fr. boxeur
- haut all. scoc, moyen haut all. schocke, angl. shock > fr. choc, choquer, choquant
- angl. manager > fr. managérial/e
- angl. to camp > fr. camper
Un cas particulier est celui des faux emprunts, et, en particulier, des faux anglicismes : le terme, une fois
emprunté, voit son sens virer vers une acception inconnue de la langue prêteuse :
- pressing (en fr. : teinturerie, blanchisserie) < angl. steam-pressing ou dry cleaner’s
- parking (en fr. : parc de stationnement) < angl. parking lot
- fuel (en fr. : carburant) < angl. fuel-oil
- smoking (tenue de grande soirée pour l’homme), forme en réalité issue de smoking jacket
« vêtement d’intérieur pour fumer » mais dont le sens est devenu celui de l’angl. dinner jacket ou
de l’amér. tuxedo.
Finalement il existe des cas, plutôt nombreux dans l’histoire du français, de mots apparemment empruntés
à l’anglais mais dont l’origine est française ; on parle alors de remprunts, d’emprunts de retour ou de
navette d’emprunt :
Quelques emprunts de retour
Les termes qui ont été choisi ici constituent seulement un exemplier [SIC]
du phénomène des emprunts français-anglais-français. Ceux qui sont
proposés répondent à l’exigence de donner un aperçu du processus de
migration à travers des mots usuels qui sont souvent faussement sentis
comme des xénismes, du moins sous leur aspect extérieur. Outre que dans les
trois répertoires de langue française déjà cités − GR, DH et TLF − les traces
de leur « va et vient » ont été recherchées également dans l’Online Etymology

4
Dictionary (OED), Old French-English Dictionary
1
(OFE) et The Oxford
English Dictionary
2
(OD). Étant donné que la variation de sens transparaît
dans la plupart des cas examinés, les lexèmes sélectionnés sont ainsi
présentés selon un ordre qui privilégie, là où il apparaît prépondérant, soit
l’aspect phonétique soit l’aspect graphique, sous lequel est illustrée leur
éventuelle évolution sémantique.
a) Variation phonétique/sémantique
Bacon
En français contemporain: lard fumé; prononcé bécon.
Selon le TLF et le DH, l’étymologie du mot renvoie (avant 1100) au judéo-
français bacun. Ce même terme se retrouve en ancien français au XIIème
provenant du francique bakko où il indique aussi bien le jambon que le lard.
Il est attesté en ancien provençal sous la forme bacon à la moitié du XIIème
(1157). Il se serait répandu pour désigner les tranches de lard qui servaient de
redevances en nature. Par métonymie, il a assumé le sens de jambon du
XIIème au XVIIème. Son emploi récent (1884), avec une prononciation plus ou
moins anglicisée, est un emprunt à l’anglais bacon qui avait été à son tour
emprunté à l’ancien français (v.1330) avec le sens de « viande du dos et des
parties latérales du porc » (OED, OFE). Sens qui s’est spécialisé par la suite
pour désigner le lard fumé.
Pour cet emprunt de retour, l’écart sémantique est minime puisque sa
valeur est restée confinée dans le même domaine de spécialité: de
lard/jambon à lard. Il a simplement perdu un de ses sèmes spécifiques
(jambon).
Jet
En français contemporain: avion à réaction; prononciation du t final.
En moyen français (XIème) [SIC], jet désigne l’« action de lancer »,
dérivation nominale du verbe jeter. En 1671, s’y ajoute le sens de jet d’eau et
c’est probablement avec cette signification que l’anglais l’emprunte (DH). Le
TLF précise qu’au XVIIème toutefois, jet s’était déjà spécialisé en français
pour indiquer l’action de faire couler un métal dans un moule de fusion et que
c’est à travers ce dernier sens qu’il en est venu à celui d’avion à propulsion
en 1867 (OED). A partir de la deuxième moitié du XIXème il a indiqué par
synecdoque l’avion lui-même.
Il s’agit ici d’un néologisme de retour dont le sens et la phonie sont venus
s’ajouter au lexique français où ils coexistent avec le modèle (jet d’eau).
Reporter
En français contemporain: journaliste affecté aux reportages; prononciation
du r final.
Le sens actuel est repris (1828) de l’anglais reporter, spécialisé en
journalisme, à son tour emprunté à l’ancien français reporteur (XIIème −
TLF), proprement « celui qui rapporte, qui relate » et spécialement en droit
(DH) « rapporteur des tribunaux » (1617). En français moderne, l’ancien
verbe a été substitué par rapporter, alors que l’anglais a conservé le verbe
original, qui est retourné « au bercail » sous forme de substantif, cohabitant
avec le nouveau verbe et le nom rapporteur.
Inaltéré dans sa graphie, il a été l’objet d’un changement fonctionnel (de
verbe à substantif) et d’une variation sémantique.
Set
En français contemporain: série de jeux (tennis) et de napperons de table.
La prononciation est identique à l’original sette, malgré la disparition du -te
final.
L’anglais set, aux acceptions variées, attesté seulement au XIVème avec le
sens de « séquence, collection d’objets », est un déverbal de to set, « établir,
1
A. HINDLEY − F.W. LANGLEY − B.J. LEVY, Old French-English Dictionary, Cambridge University Press, 2000.
2
2ème édition, Clarendon Press, 1989.

5
disposer » et un emprunt de l’ancien français sette (XIIème) “groupe de
personnes de même croyance » (TLF). […] Le mot revient au français
(1833) avec le sens aujourd’hui disparu (sauf dans le néologisme récent jet-
set) de « cercle, milieu mondain », puis comme terme de tennis (1893)
désignant une série de jeux. Au XXème il passe dans le domaine
cinématographique où, toutefois, il ne résiste pas longtemps à la concurrence
de plateau. Il est par contre en usage dans le sens de set de table (1933).
Du point de vue formel, bien que ce terme ait subi une apocope de sette à
set, sa nature phonétique restée en quelque sorte identique permet de le
classer dans cette catégorie.
Suspense
En français contemporain: état d’incertitude, d’appréhension; prononciation
de la nasale selon les règles phonétiques françaises.
A l’origine utilisé en anglais dans la locution « in suspense » (OED), le
terme dérive de l’adjectif français suspens (1440-TLF; 1485-DH) qui avait le
sens de « remis à plus tard ». La locution prend par la suite (1553) la valeur
« dans l’incertitude, l’indécision » et plus couramment (1636) « en état
d’inachèvement ». En tant que substantif féminin, le terme aujourd’hui
disparu, a signifié « interdiction » au début du XIVème et ensuite « intervalle,
délai » (DH). Après 1850, le substantif masculin suspens, qui désigne une
attente angoissée, sera remplacé par la graphie anglaise suspense.
La place de suspense dans cette catégorie renvoie aux observations faites
pour le terme précédent.
b) Variation graphique/sémantique
Budget
En français contemporain: somme d’argent dont on dispose pour acheter ou
faire qqch.; prononciation francisée en [budjé].
Repris de l’anglais (1764), ce mot est une évolution graphique de formes
plus anciennes: bowgette, bouget, boudget, bouget (DH). Sous ces différents
aspects, il vient du français bougette, « petit sac de cuir », dont il a pris
d’abord le sens de sac de voyage, bourse. En anglais, l’acception financière
date de 1764 en tant que « état annuel des dépenses et des recettes
publiques ». A la même époque, le terme retourne au français avec cette
même valence sémantique, mais en se réduisant à la sphère privée (budget
d’une famille, budget pour les vacances, etc.).
Le retour au français de bougette s’est effectué à travers le filtre de la
phonétique anglaise, et par conséquent, en en influençant la graphie: le
diphtongue -ou se transforme en -u, la consonne -g en -dg avec apocope du -
te final (comme pour sette – set).
Sport
En français contemporain: exercice physique ou jeu, individuel ou en
équipe; le t final n’est pas prononcé.
Emprunté de l’anglais après le XVème avec le sens de « passe-temps,
distraction, jeu », il remonte à l’ancien français deport/desport « plaisir,
amusement », dérivé des formes verbales deporter et desporter (XIIème). Au
sens de distraction (1523) a fait suite (1594), sous l’influence de l’anglais,
celui d’exercice physique en plein air et de compétitions athlétiques (TLF).
Le français a ainsi repris le terme sport, issu par aphérèse du desport
original, avec le sens premier d’exercice physique.
Square
En français contemporain: petit jardin au centre d’une place, généralement
entouré de grilles; prononcé [skwar].
Emprunté à l’ancien français esquire, esquierre (1300): « carré», dérivé de
esquerre (XIIème), « rectangle », il désignait en anglais un instrument pour
mesurer les angles (OED). A partir de 1867, il est attesté en français avec le
nouveau sens de « espace urbain approximativement rectangulaire, entouré
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%