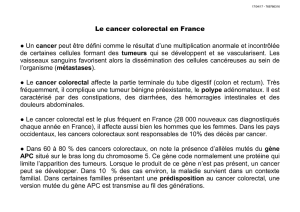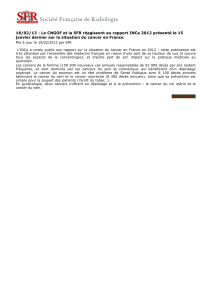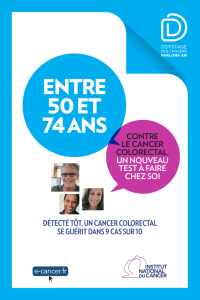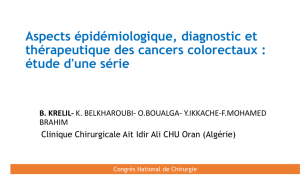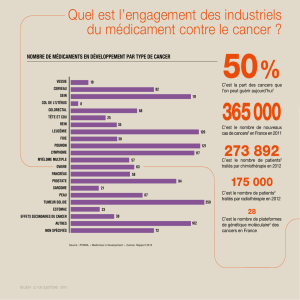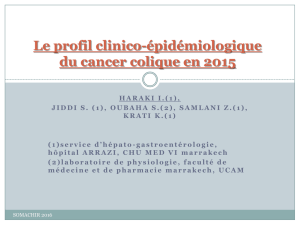La cancérogenèse colique humaine et expérimentale - iPubli

5:
-
»
A
1

3 .
lue
3 3
3
1.
vol. 88

3.

·
r
*

1
1
 6
6
1
/
6
100%