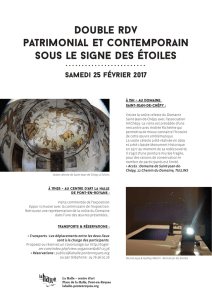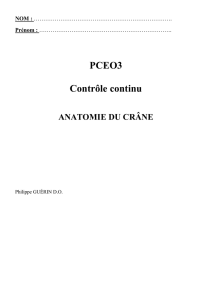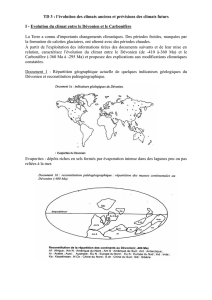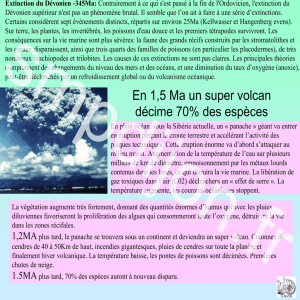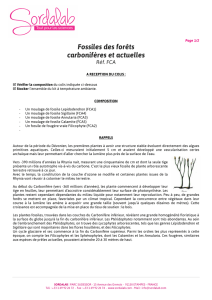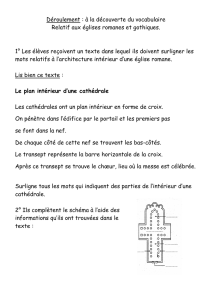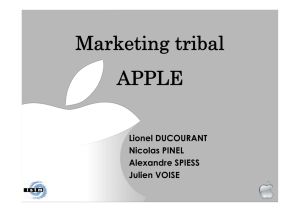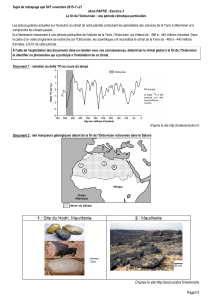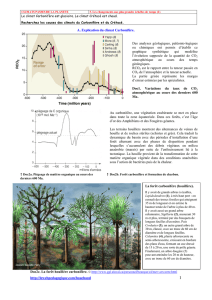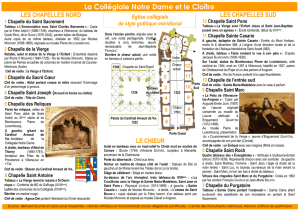Bassin de Béchar et ses marges

Bassins de la province occidentale
Bassin de Béchar et ses
marges
Le bassin de Béchar au sens strict du
terme se situe au nord-ouest de la
plateforme saharienne (fig. 1.47). Il est
limité au nord par l’accident sud-
atlasique, au sud et au sud-ouest par la
chaîne de l’Ougarta. Il se prolonge à
l’ouest audelà de la frontière algéro-
marocaine. Il est séparé du bassin de
Timimoun au sud-est et à l’est par
l’ensellement de Beni-Abbès et les
voûtes de Méharez et de l’Oued Namous.
Il s’agit d’un vaste domaine minier du
Sud-Ouest algérien très peu exploré.
Ce bassin est connu pour sa complexité
tectonique, qui est l’une des causes de la
mauvaise compréhension du système
pétrolier et des résultats médiocres
obtenus. Cependant, deux importantes
découvertes récentes dans le Strunien,
réalisées dans la partie nord de Gourara
et la voûte d’Allal, font entrevoir des
possibilités de prospection, aussi bien
dans les marges orientales du bassin de
Béchar que dans le bassin au sens strict.
La région représente une superficie de
plus de 70 000 km2, une densité de
forage de 3 puits par 10 000 km2 et une
densité sismique de 3 500 km par 10
000 km2. Les premiers puits
d’exploration, TK-1 arrêté à l’Ordovicien
et NM-1 arrêté au Siegénien, ont été
réalisés respectivement à Taoudrara
Kahla, au sud de la voûte de Méharez en
1953, et à Oued Namous en 1955. Les
tests n’ont montré aucun résultat positif.
De 1960 à 1961, quatre forages sont
réalisés sur la voûte de Méharez et son
flanc est, avec des indices de gaz dans
les calcaires du Viséen supérieur (400
m3/h) et dans les grès du Siegénien. En
1970, trois puits ont exploré les
bioconstructions carbonatées dans la
cuvette de Nekheila sans atteindre le
Dévonien. Les forages qui ont suivi ont
exploré la voûte de l’Oued Namous,
l’ensellement de l’Oued Gharbi et deux
structures au sud qui longent la chaîne
de l’Ougarta, sans résultats positifs.
La série stratigraphique,16 illustrée sur
la figure 1.48, montre les différences
d’âges, de lithologies et d’épaisseurs
notamment au niveau du Carbonifère
entre le bassin profond de Béchar-Abadla
et les marges de celuici, ainsi que les
plays pétroliers possibles.17
Le bassin de Béchar-Abadla se distingue
par la subsi dence intense18 durant le
Carbonifère (fig. 1.49). Il est perturbé au
cours de la phase hercynienne par
l’anticlinal de Chebket Mennouna d’axe
est-ouest qui le sépare en deux : le
bassin de Kénadza au nord, avec une
couverture méso-cénozoïque,
notamment les sels du Crétacé, et le
bassin d’Abadla au sud (fig. 1.47). Cette
fosse est séparée brutalement de la zone
haute d’Ioucha-Méharez vers l’est par un
couloir de failles NNE-SSO d’un rejet
normal dépassant les trois kilomètres.19
Néanmoins, le bassin est limité par des
failles est-ouest à l’extrême nord, où
elles se confondent avec l’accident
sudatlasique.
Dans cette zone, la tectonique alpine est
très intense et des chevauchements des
couches jurassiques sur celles du Viséen
supérieur sont mis en évidence.19
Les données biostratigraphiques, les
corrélations entre les puits et la sismique
réflexion ont montré l’existence de
plusieurs discordances17, 18, 20 dans
les terrains paléozoïques, notamment
dans les niveaux suivants :
_ À la base du Paléozoïque (discordance
panafricaine), entre le Cambrien moyen
et l’Ordovicien, entre le Silurien et
l’Ordovicien (discordance taconique),
entre le Silurien et le Dévonien (fin du
cycle calédonien), la phase bretonne à la
fin du Dévonien (début de l’hercynien),
les discordances intra-viséenne, intra-
namurienne, fini-moscovienne et
hercynienne finale.
_ Du Silurien jusqu’à la fin du Dévonien,
le bassin de Béchar ne se distingue pas
du reste de la plate-forme saharienne du
point de vue géodynamique. Les dépôts
de plate-forme prédominent dans un
contexte intracratonique, à part qu’ici les
sédiments sont plus distaux et donc plus
fins. À partir du Carbonifère, le bassin de
Béchar ne fait plus partie de la plate-
forme saharienne au sens géologique du
terme. Un chevauchement à partir de
Tamlalt marocain avec une composante
décrochante crée une fosse profonde
dans laquelle plus de 10 000 m de
sédiments flyshoïdes (de type
wildflysh)21 prennent place durant la
période allant du Tournaisien au Viséen

Bassins de la province occidentale
supérieur. Durant tout le Carbonifère,18
le centre du bassin connaît une
sédimentation sans discontinuité
majeure (fig. 1.49).

Bassins de la province occidentale
Systèmes pétroliers
Play Namurien
Le réservoir est constitué de
bioconstructions carbonatées coiffées par
des niveaux oolithiques, mais dont
l’extension est limitée à la zone de la
cuvette de Nekheila et son prolongement
nord-est.22 Ces niveaux sont très
fracturés à Nekheila mais ne sont pas
explorés ailleurs. Des incisions fluviatiles
formant de bons niveaux réservoirs
gréseux affleurent et s’enfouissent en
direction du bassin profond de Béchar-
Abadla (Tableau 1.19).

Bassins de la province occidentale
Play Viséen
Le réservoir dans le play du Viséen22 est
constitué de bioconstructions
carbonatées dans la partie nord dont
l’extension est limitée à la zone de la
cuvette de Nekheila et son prolongement
nord-est. Il est essentiellement gréseux
au sud dans la Saoura, et flyshoïde en
direction du bassin profond de Béchar-
Abadla, à l’ouest, et de Ben-Zireg, au
nord. Des débits non commerciaux de
gaz ont été obtenus dans les calcaires du
Viséen à Ioucha (Tableau 1.20).
Play Famennien
Roche mère
Les roches mères23 sont constituées par
les argiles du Silurien et du Givétien-
Frasnien qui ont le meilleur potentiel,
ainsi que celles du Famennien (fig.
1.50).
À la fin du Dévonien, de grandes
quantités d’huile et de gaz sont
expulsées par la roche mère silurienne
située dans la dépression de Terfas, sur
le flanc nord de l’Ougarta (fig. 1.51 et
1.52). La période allant du début du
Tournaisien jusqu’à la fin du Viséen
inférieur correspond à celle d’un
maximum d’expulsion d’hydrocarbures.
Pas moins de 50 % du total d’huile et de
gaz sont expulsés durant cette période à
partir des roches mères dévoniennes. Le
reste des hydrocarbures est expulsé
durant la période restante du
Paléozoïque, et seules les régions du
nord du bassin de Timimoun pouvaient
être alimentées durant le Mésozoïque à
cause d’une évolution thermique moins
intense.
Réservoir
Dans la région de Méharez, les faciès
gréseux se trouvent à la base du
Famennien.24 Dans la partie centrale, au
nord de la dépression de Terfas, les grès
forment des bancs très épais qu’on
retrouve tout au long de la série du
Famennien-Strunien. Les grès
appartiennent à des dépôts de bassin et
de pente comme le suggèrent les figures
de glissement, les contacts abrupts entre
les grès et les argiles et des ichnofaciès
de la famille zoophycos « outer shelf ». A
ces dépôts de bas niveau marin
succèdent parfois des dépôts moins
profonds de l’avant-plage où des HCS et
des SCS sont décrites. Les bonnes
caractéristiques pétro physiques (fig.
1.53) sont démontrées par les
découvertes commerciales de gaz
enregistrées au nord du Gourara et sur
la voûte d’Allal. De l’eau salée est
récupérée à Ioucha sur le flanc est de la
voûte de Méharez. Le réservoir Strunien-
Famennien a montré des indices dans 13
puits (Tableau 1.21).

Bassins de la province occidentale
Play Siegénien-Gédinnien
Les associations d’ichnofaciès, les
structures sédimentaires, la texture fine
des sédiments ainsi que l’évolution
verticale des faciès montrent une
succession de séquences argilo-
gréseuses d’une avant-côte progradante
allant de l’offshore à la base jusqu’à
l’avant-côte supérieure au sommet.25
Les caractéristiques pétrophysiques sont
montrées sur la figure 1.48. D'abondants
indices de gaz sont obtenus sur 22 puits,
aussi bien sur carottes que dans la boue
de forage à travers toute la région allant
de la voûte de Méharez à l'ouest jusqu'à
la voûte d'Allal à l'est.
La salinité des eaux de formation
diminue de l'est (380 g/l sur la voûte
d'Allal) vers l’ouest où elle n'est que de
60 g/l sur la voûte de l’Oued Namous et
80 g/l à Méharez (Tableau 1.22).
Play Ordovicien
C’est le play le moins étudié dans la
région car il n’est pas l’objectif principal.
Tout comme pour le Dévonien, les
réservoirs gréseux sont fins et plus
distaux que les niveaux productifs du
reste de la plate-forme saharienne.
Malgré d’abondants indices au niveau de
treize puits, ce play n’a montré aucun
débit (Tableau 1.23).
Résultats et perspectives
Les niveaux roches mères ayant le
meilleur potentiel sont les argiles du
Silurien et du Givétien-Frasnien et,
localement, celles du Namurien dans la
cuvette de Nekheila. Les roches mères
de l’Ordovicien, du Dévonien inférieur et
du Carbonifère inférieur sont d’une
moindre importance, mais peuvent
contribuer au potentiel global généré.
Des pièges structuraux faisant partie des
plays dévoniens sont décelés sous le
Carbonifère peu déformé dans le bassin
profond de Béchar-Abadla et sont en
bonne position pour être alimentés en
fluides durant le Carbonifère, qui est la
période principale de génération et
d’expulsion des hydrocarbures. Sur la
voûte de Méharez et la cuvette de
Nekheila, tous les réservoirs dévoniens
et carbonifères sont envahis par les eaux
douces d’infiltration.26
 6
6
1
/
6
100%