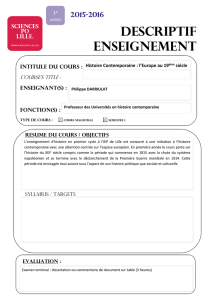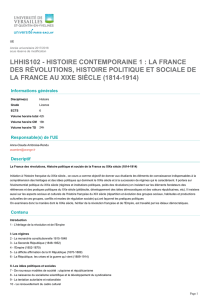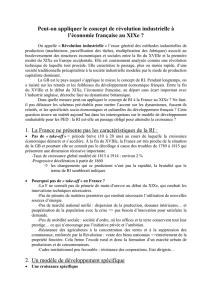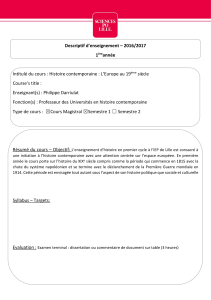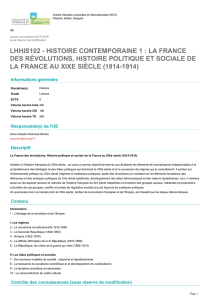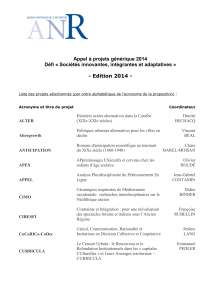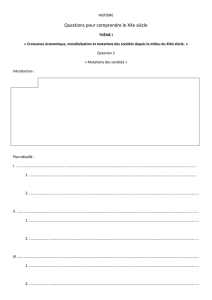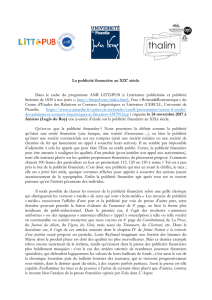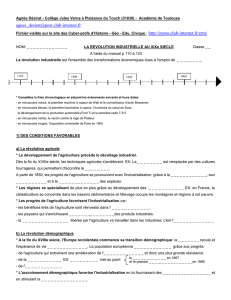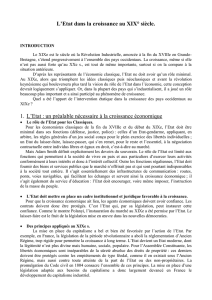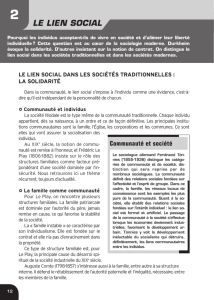Fiche concours : La croissance économique française au XIX siècle

Économie, sociologie et histoire du monde contemporain, 2e édition © Armand Colin, 2016.
Fiche concours : La croissance économique française
au XIXe siècle (Chapitre 4-I )
Introduction
Le XIXe siècle est celui de la révolution industrielle et celui au cours duquel les hiérarchies économiques mondiales vont
s’établir. La France, à la veille du XIXe siècle a des atouts mais aussi des handicaps et surtout elle sort difficilement de la
révolution de 1789. À la veille de la première guerre mondiale, l’économie française reste une économie de premier rang
mondial mais elle est concurrencée par de nouveaux arrivants (États-Unis, Allemagne…). L’économie française aurait-elle
manqué le train de la croissance au XIXe ou s’est-elle appuyée sur ses particularismes ?
I. La croissance économique française au XIXe siècle : lenteur,
retard et des potentialités mal exploitées
Malgré des avantages au départ, la croissance économique française s’est réalisée sur un rythme beaucoup plus faible
que ses principaux concurrents, en particulier le Royaume-Uni. La France n’aurait pas connu de «
take off
» au sens de
Rostow. Ainsi, les engrenages positifs entre révolutions agricole, démographique et industrielle ne semblent pas avoir
vraiment eu lieu.
Une croissance qui cumule des handicaps : un commerce extérieur peu développé et peu diversifié, des innovations qui
apparaissent moins efficaces que dans d’autres pays (Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne…), une modernisation de
l’agriculture lente, une croissance démographique plus faible (la population française est multipliée par 1,5 alors qu’en
Angleterre, elle est multipliée par 3 sur le XIXe siècle), une épargne qui ne sert pas les intérêts nationaux (emprunts
russes à la fin du XIXe siècle), une administration fortement présente (mesures protectionnistes à la fin du XIXe siècle avec
les lois Méline en 1892 et la loi du cadenas en 1897), une prise de risque trop limitée (frilosité du patronat français en
matière d’investissement)…
II. La croissance économique française au XIXe siècle : la marque d’un modèle original de croissance
Si la France n’a pas connu de «
take off
», elle a connu cependant un processus d’industrialisation certes plus lent mais
continu avec aussi des accélérations. En effet, sous le Second Empire (1852-1870), sous l’effet des travaux
d’aménagements de Paris (baron Haussman) et du chemin de fer, l’industrialisation s’accélère.
Un encadrement étatique prononcé, facteur de développement économique (plan Freycinet en 1878 de soutien au
chemin de fer) et social (lois Ferry sur l’enseignement par exemple en 1881-82). Un État qui reste très présent dans
l’économie en association avec tout un ensemble d’entreprises privées plutôt de taille moyenne. La croissance française
s’est réalisée de manière introvertie. Il y a bien des relations avec l’extérieur mais elles se font en grande partie dans le
cadre de relations coloniales.
Si le début du XIXe siècle n’est pas marqué par une évolution des droits sociaux, ce n’est pas le cas de la fin du siècle. Il y a
des avancées sociales (droit de grève en 1864, de se syndiquer en 1884, loi sur les accidents du travail en 1898…). Une
dimension sociale du capitalisme français semble se dessiner à la fin du XIXe siècle.
Conclusion
Si l’économie française n’a pas connu de «
take off
», ce n’est pas pour autant qu’elle n’a pas connu de croissance. Le
rythme de croissance a tourné autour de 2 % (en rythmes annuels) sur le XIXe siècle. On le retrouve au XXe siècle en
dehors de la période des Trente Glorieuses. La France aurait-elle manqué sa révolution industrielle comme elle
aurait pu manquer la révolution récente de l’internet ? Le thème du retard français est ancien mais il reste toujours
vivace dans la société française.
1
/
1
100%