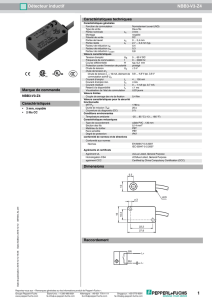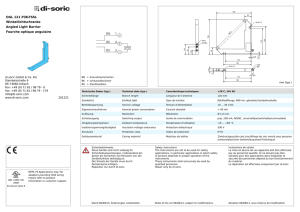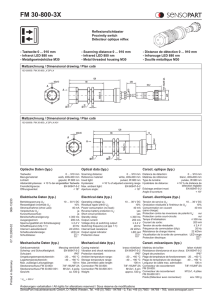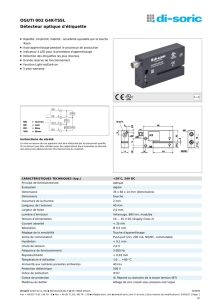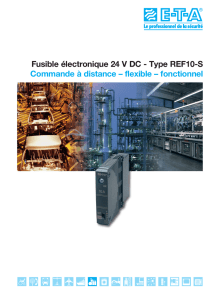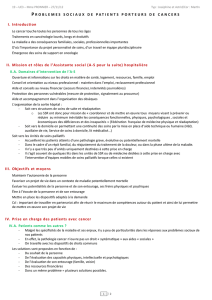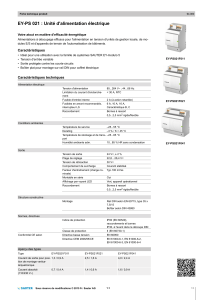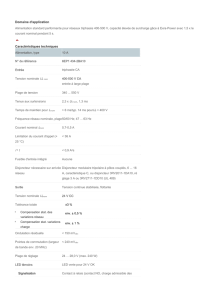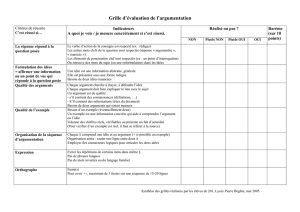L O G I Q U E - Prologue Numérique

Dictionnaire philosophique et historique de la
Steeven Chapados
LOGIQUE
définitions • étymologies • analyses historiques • interprétations philosophiques
index des auteurs • bibliographie générale, historique et thématique


STEEVEN CHAPADOS
DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE
ET HISTORIQUE DE LA
L O G I Q U E

Les Presses de l’Université Laval reçoivent chaque année du Conseil des Arts du Canada et de
la Société de développement des entreprises culturelles du Québec une aide financière pour
l’ensemble de leur programme de publication.
Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du
livre du Canada pour nos activités d’édition.
Maquette de couverture : Laurie Patry
ISBN 978-2-7637-3144-5
PDF 9782763731452
© Presses de l’Université Laval. Tous droits réservés.
Dépôt légal 1er trimestre 2017
www.pulaval.com
Toute reproduction ou diffusion en tout ou en partie de ce livre par quelque moyen que ce soit est
interdite sans l’autorisation écrite des Presses de l’Université Laval.

À ma conjointe Annie,
mes enfants Lili-Rose et Alexis,
qui m’ont appuyé au cours de ces dernières années
consacrées à la recherche et l’écriture.
À mes parents églement,
mes anciens professeurs, mes amis fidèles
et tous ceux perdus quelque part dans le temps.
Je remercie spécialement le cégep de St-Laurent,
qui m’a appuyé sans hésitation dans mon projet,
ainsi que mon ami et collègue Pierre Charette,
pour ses nombreux commentaires éclairés.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%