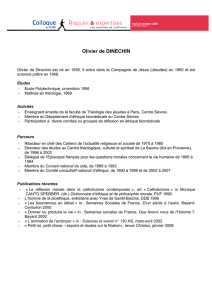Weber - Le savant et le politique

1
WEBER
Le savant et le politique (1919)
Max Weber, Le savant et le politique, Paris, Bibliothèques 10/18, 2000, 223 pages, ISBN : 2-264-02535-2.
I. Le métier et la vocation de savant.
A) Un hasard aveugle :
Les grands instituts de science sont devenus des entreprises du capitalisme d’Etat. Certes cela amène des
avantages techniques mais il y a maintenant une grande différence entre le chef de cette grande entreprise et le
vieux style du professeur titulaire, et l’on voit apparaître comme partout ailleurs où s’implante une entreprise
capitaliste, son phénomène spécifique qui aboutit à « couper le travailleur des moyens de production ». Une
chose cependant n’a pas changé c’est l’importance due au hasard. Beaucoup de médiocres jouent un rôle
considérable dans l’université. La raison s’en trouve dans les lois même de l’action concertée des hommes. Ce
qui en devient étonnant c’est surtout le nombre considérable de nominations qui sont justifiées.
Il faut posséder des qualités de savant et de professeur, deux choses qui vont rarement ensemble. La qualité du
savant est impondérable. L’éducation scientifique est une affaire d’aristocratie spirituelle. La tâche
pédagogique décisive consiste à exposer les problèmes scientifiques de telle manière qu’un esprit non préparé
puisse les comprendre et se faire une opinion propre.
B) La science et l’inspiration :
La science est parvenue à un stade de spécialisation jamais atteint auparavant. De nos jours une œuvre
importante est toujours une œuvre de spécialiste.
On ne force pas l’inspiration. Il faut que l’idée exacte vienne à l’esprit du travailleur sinon il ne sera jamais
capable de produire quelque chose de valable. Or elle ne vient souvent qu’après un travail acharné.
Dans les sciences, l’intuition est aussi importante que dans l’action pratique et dans l’art. Le processus
psychologique est le même. Les intuitions scientifiques dépendent de « dons » qui nous sont cachés. Cela
entraîne deux idoles : la « personnalité » et l’ « expérience vécue » (p.85). Elles ont entre elles des liens
étroits. Les « expériences vécues » sont ce que nous cherchons tous avec ferveur à nous fabriquer, persuadé
que cela constitue une attitude digne d’une personnalité, en cas d’échec on se donne au moins l’air de posséder
cette grâce. Mais la véritable « personnalité » est exprimée par celui qui met tout son cœur à l’ouvrage et rien
qu’a cela, il s élève ainsi à la hauteur et à la dignité de la cause qu il veut servir. Le problème se pose de la
même manière pour l’artiste, mais si le travail scientifique est solidaire d’un progrès, dans le domaine de l’art
au contraire il n’en existe pas, du moins en ces termes.
C) Le désenchantement du monde :
En pratique, la rationalisation intellectualiste que nous devons à la science ne signifie pas que nous avons une
connaissance générale croissante des conditions dans les quelles nous vivons. Simplement nous croyons qu’à
chaque instant « nous pourrions, pourvu seulement que nous le voulions, nous prouver qu’il n’existe en principe
aucune puissance mystérieuse et imprévisible qui interfère dans le cours de la vie ; bref que nous pouvons
maîtriser toute chose par la prévision.» (p.90). Cela revient à « désenchanter le monde ».
L’intellectualisation signifie ce recours à la technique et à la prévision, à la différence du monde enchanté du
sauvage qui croit en l’existence de puissances qu’il peut maîtriser par des moyens magiques.
Ce processus de désenchantement a-t-il un sens qui dépasse la pure pratique et la pure technique ? Tolstoï nous
dit que pour l’homme civilisé la mort n’a pas de sens. En effet plongée dans le progrès (donc dans l’infini) la
vie individuelle du civilisé ne semble plus avoir de fin. Avant les hommes pouvaient se dire satisfaits de leur
vie parce qu’ils étaient installés dans un cycle organique, à leur mort, elle leur avait apporté tout le sens qu’elle

2
pouvait leur offrir. L’homme civilisé placé dans une civilisation qui s’enrichit continuellement de pensées, de
savoirs et de problèmes, peut se sentir « las » de la vie et non pas comblé par elle. Il ne peut saisir que du
provisoire et jamais du définitif. C’est pourquoi la mort à ses yeux est un évènement qui n’a pas de sens, tout
comme la vie n’en a plus non plus. Du fait de sa « progressivité » dénuée de signification, la vie elle-même
devient un évènement sans signification. La jeunesse perçoit alors les constructions intellectuelles de la science
comme un royaume d’abstractions artificielles s’efforçant de recueillir la sève de la vie réelle, mais sans jamais
réussir.
Il existe deux grands instruments du travail scientifique :
1. le concept, découverte importante formulée par Platon. On crut qu’il suffisait de découvrir le concept
de Beau ou du courage pour en comprendre l’être véritable.
2. l’expérience rationnelle élevée par la Renaissance en un principe de la recherche comme telle, elle
devint le moyen d’une expérience contrôlée et rendait possible la science empirique. Pour la
Renaissance elle représentait le chemin vers le vrai, conduisant vers la vraie nature. Or c’est l’inverse
qui semble vrai aujourd’hui.
La présupposition fondamentale de toute vie en communion avec Dieu pousse l’homme à s’émanciper de
l’intellectualisme de la science : cette aspiration devient l’un des principes utilisés par la jeunesse portée vers
l’émotion religieuse ou en quête de l’« expérience vécue » en général.
Bien qu un optimisme naïf ait pu célébrer la science – c'est-à-dire la technique de la maîtrise de la vie fondée
sur la science – comme le chemin qui conduirait au bonheur, on peut reprendre, pour lui répondre, la critique
dévastatrice de Nietzsche sur ces « derniers hommes » qui « ont encore découvert le bonheur ».
D) La science comme vocation :
Pour Tolstoï la science n’a pas de sens, elle ne nous donne pas de réponse pour savoir comment vivre. En quel
sens alors ne nous donne-t-elle « aucune » réponse ?
Tout travail scientifique suppose toujours des présuppositions :
1. la validité des règles de la logique et de la méthodologie qui forment les fondements généraux de
notre orientation dans le monde.
2. une valeur en soi au travail scientifique, c'est-à-dire qu’il vaut la peine d’être connu. Or les sciences
échappent à toute démonstration par des moyens scientifiques. Nous sommes contraint d’accepter ou de
refuser cette présupposition suivant nos prises de position personnelles à l’égard de la vie. Personne ne
peut démontrer la présupposition d’une valeur en soi de la science. Si elle en a une c’est seulement en
tant qu’elles représentent une « vocation ».
En effet, on ne peut pas prouver que le monde dont elles font la description mérite d’exister, qu’il a un « sens »
ou qu’il n’est pas absurde d’y vivre. Toutes les sciences de la nature nous donnent une réponse à la question :
que devons nous faire si nous voulons être techniquement maître de la vie ? Mais elles ne peuvent solutionner
celles-ci : cela a-t-il au fond un sens ? Devons nous et voulons nous être techniquement maître de la vie ?
• Exemple du médecin. Le devoir du médecin consiste dans l’obligation de conserver la vie et de diminuer
autant que possible la souffrance. Grâce aux moyens dont il dispose il maintient en vie le moribond,
même si celui-ci l’implore de mettre fin à ses jours. La médecine ne pose pas la question de savoir si la
vie mérite d’être vécue et dans quelles conditions.
• Exemple de l’esthétique. La question « devrait il y a avoir des œuvres d’art ? » est écartée au profit de la
présupposition de l’œuvre d’art, l’esthétique se propose donc simplement de rechercher ce qui
conditionne la genèse de l’œuvre d’art.
• Exemple du droit.
Ce que ne doit pas faire un professeur : imposer à son auditoire une quelconque prise de position, la politique
n’a pas sa place dans la salle de cour d’une université, ni du côté des enseignants ni des étudiants. Il s’agit
d’analyser scientifiquement des structures politiques et des doctrines de partis, et non de prendre des positions
pratiques. Chaque fois qu’il fait intervenir son propre jugement de valeur, il n’y a plus de compréhension
intégrale des faits.

3
Ce que doit faire un professeur : parvenir à soumettre des phénomènes aux mêmes critères d’évaluation par
tous, du catholique à l’athée, et même si c’est impossible, il doit en avoir l’ambition et se faire un devoir d’être
utile à l’un et à l’autre. Certes un catholique sera forcément en opposition avec le professeur en ce que la
science refuse la soumission à une autorité religieuse. Mais le croyant connaît les deux positions. Cette science
sans présuppositions exige de sa part le simple souci de reconnaître que le cours des choses doit être expliqué
sans l’intervention d’aucun élément surnaturel auquel l’explication empirique refuse tout caractère causal.
Il doit apprendre à ses élèves à reconnaître qu’il y a des faits inconfortables, c'est-à-dire désagréables à
l’opinion personnelle d’un individu. Il s’agit là d’une « œuvre morale » (p105).
Il faut qu’il reconnaisse également que divers ordres de valeurs s’affrontent dans le monde : par exemple une
chose peut-être belle non seulement parce qu’elle n’est pas bonne mais précisément par ce en quoi elle n’est pas
bonne (Les fleurs du mal de Baudelaire). On ne peut trancher scientifiquement la question de la valeur, cf.
Mill : lorsqu’on part de l’expérience pure on aboutit au polythéisme, de même qu’il existe plusieurs cultures
incomparables, il existe différents dieux qui se combattent et sans doute pour toujours.
Exemple du chrétien qui « n’oppose pas de résistance au mal » ou encore la parabole des deux joues, ce n’est
pas réfutable scientifiquement et pourtant il est clair que ces préceptes évangéliques font l’apologie d’une
éthique qui va contre la dignité. Suivant les convictions profondes de chaque être, l’une des éthiques prendra le
visage du diable, l’autre celle du dieu et chaque individu aura à décider, de son propre point de vue, qui est dieu
et qui est diable. La religion catholique se voulait la vérité une et apostolique en vue d’une morale pour tous,
mais aux prises avec la réalité de la vie, elle s’est vue contrainte de consentir peu à peu à des compromis dont
nous a instruit l’histoire : « Tel est le destin de notre civilisation : il nous faut à nouveau prendre conscience de
ces déchirements, que l’orientation prétendue exclusive de notre vie en fonction du pathos grandiose de
l’éthique chrétienne avait réussi à masquer pendant mille ans » (p108).
L’erreur de la jeunesse : attendre du professeur autre chose que « des analyses et des déterminations de
faits », en ce cas elle cherche en lui un chef et non un professeur (deux choses qu’il ne faut pas confondre).
Il ne faut pas oublier que la valeur d’un être humain ne dépend pas fatalement de ses qualités de chef, sans
compter que les individus qui se prennent pour les chefs sont en général les moins aptes à cette fonction.. En
tout cas, les dispositions qui font d’un homme un savant éminent et un professeur d’université ne sont pas les
mêmes que celles qui pourraient faire de lui un chef de la conduite pratique.
E) L’apport positif de la science à la vie pratique :
C’est le problème de la vocation de la science en elle même :
1. la science met à notre disposition des connaissances pour dominer techniquement la vie par la précision
(aucune différence avec la marchande de légumes)
2. elle apporte des méthodes de pensées, c'est-à-dire des instruments et une discipline (ce que n’apporte
pas une marchande de légumes mais elle reste un moyen de s’en procurer)
3. elle contribue à une œuvre de clarté, elle est un moyen d’indiquer clairement qu’en présence de tel ou
tel problème de valeur qui est en jeu, les différentes positions que l’on peut pratiquement adopter. En
outre, elle permet d’indiquer quelles sont les conséquences subsidiaires auxquelles il faudra consentir en
vue de telle ou telle fin (problème qui concerne tout technicien lorsqu’il s’agit de choisir un moindre
mal, mais avec une différence toutefois : le but est donné préalablement au technicien, alors que pour les
problèmes fondamentaux de la science, le but n’est pas donné a priori).
4. elle doit permettre aux savants de dire (en toute conviction) que tel parti adopté dérive de telle vision
dernière du monde. Une prise de position peut dérive de plusieurs visions du monde différentes entre
elles. « La science vous indiquera qu’en adoptant telle position vous servirez tel dieu et vous offenserez
tel autre parce que, si vous en restez fidèles à vous-mêmes, vous en viendrez nécessairement à telles
conséquences internes, dernières et significatives » (p.113).
F) La science et la théologie :

4
La science en principe est susceptible d’obliger l’individu à « se rendre compte du sens ultime de ses propres
actes » (p.113). Un professeur obtenant ce résultat est au services de « puissances morales », à savoir le devoir
de faire naître en l’âme des autres la clarté et le sens des responsabilités.
Ces opinions ici exposées ont « pour base la condition fondamentale suivante : pour autant que la vie a en elle-
même a un sens et qu’elle se comprend d’elle même, elle ne connaît […] que l’incompatibilité des points de vue
ultimes possibles, l’impossibilité de régler leurs conflits et par conséquent la nécessité de se décider en faveur
de l’un ou de l’autre » (p.114).
Notre destin est de vivre à une époque indifférente à Dieu et aux prophètes. Quelle position adopter devant le
fait qu’il existe une théologie qui prétend au titre de science ? La théologie est une rationalisation intellectuelle
de l’inspiration religieuse. Il n’existe pas de science entièrement exempte de présuppositions et aucune ne peut
apporter la preuve de sa valeur à qui les rejettent. Toute théologie accepte la présupposition que le monde doit
avoir un sens, la question qui se pose est alors de savoir comment il faut interpréter ce sens pour pouvoir le
penser, démarche identique à celle de KANT qui, partant de la présupposition « la vérité scientifique existe et
elle est valide », se demande ensuite quelles sont les présuppositions qui la rendent possible. Démarche
également identique à celle de LUKACS en esthétique qui présuppose l’existence « des œuvres d’art ». La
théologie nous explique comment accepter les présupposés religieux parfois douteux : ils appartiennent à une
sphère qui se situe au-delà des limites de la science. Elle ne constitue donc pas un « savoir » au sens habituel du
mot, mais un « avoir », en ce sens qu’aucune théologie ne peut remplacer la foi chez celui qui ne la
« possède » pas. Dans toute théologie « positive » le croyant aboutit à un point où il ne pourra faire autrement
qu’appliquer la maxime de St Augustin : je crois parce que c’est absurde. Le « sacrifice de l’intellect »
constitue le trait caractéristique et décisif de tout homme pratiquant.
Certains croient voir dans la religion une possibilité de fonder le lien social afin de le rendre plus solide. Or s’il
est vrai que cela peut contribuer à renforcer la solidarité entre les hommes, il est douteux d’inscrire la dignité de
ce lien dans une religion unique. Les prophéties n’ont d’autres résultats que de former des sectes de fanatiques,
jamais de véritables communautés. Cela dit, il vaut mieux moralement se donner sans conditions à une religion
que de ne pas chercher à voir clair dans ses choix derniers en se réfugiant dans un relativisme précaire : rien ne
s’est encore fait par l’attente. C’est pourquoi il faut se mettre au travail pour répondre aux demandes de chaque
jour dans sa vie d’homme comme dans son métier. Et ce travail sera simple et facile si chacun trouve le démon
qui tient les fils de sa vie.
II. Le métier et la vocation d’homme politique.
A) Les fondements de la légitimité :
On peut définir la politique comme la direction du groupement politique appelé Etat ou bien l’influence qu’on
exerce sur cette direction. On la retrouve soit entre les Etats, soit entre les divers groupes à l’intérieur d’un
même Etat. L’Etat se définit sociologiquement par le moyen spécifique qui lui est propre : la violence
physique. Tout homme qui fait de la politique aspire au pouvoir – soit parce qu’il le considère comme un
moyen en vue d’autres fins, idéales ou égoïstes, soit qu’il le désire « pour lui même » en vue de jouir du
sentiment de prestige qu’il confère.
Il existe trois fondements de la légitimité, trois formes « pures » qui légitiment l’obéissance :
1. l’autorité traditionnelle : celle des coutumes sanctifiées par leur validité immémoriale et par l’habitude
enracinée en l’homme de les respecter (celle du patriarche ou du seigneur terrien d’autrefois).
2. l’autorité charismatique : fondée sur la grâce personnelle d’un individu, elle se caractérise par le
dévouement tout personnel des sujets à la cause d’un homme et par leur confiance en sa seule personne
en tant qu’elle se singularise par des qualités prodigieuses (celle du prophète, du chef de guerre élu, du
souverain plébiscité, le grand démagogue ou le chef d’un parti politique).
3. l’autorité légale rationnelle : elle s’impose en vertu de la croyance en la validité d’un statut légal et
d’une « compétence » positive fondée sur des règles établies rationnellement, en d’autres termes elle est
fondée sur l’obéissance à des obligations conformes au statut établi (pouvoir tel que l’exerce le
« serviteur de l’Etat » moderne, ainsi que tous les détenteurs du pouvoir qui s’en rapprochent sous ce
rapport).

5
B) Affirmation de l’autorité des forces politiques dominantes :
Toute entreprise de domination a besoin d’assurer une continuité administrative par :
1. un état major administratif : oriente l’activité des sujets par leur obéissance aux détenteurs de la force
légitime, il figure l’aspect extérieur de l’entreprise de domination politique. Son obéissance se fonde
moins sur les conceptions de la légitimité exposées plus haut que sur la rétribution matérielle et
l’honneur social
2. des moyens matériels de gestion : biens matériels nécessaires le cas échéant pour exercer la force
physique (grâce à l’obéissance de l’état major), deux catégories d’administration :
• les détenteurs du pouvoir sont eux-mêmes propriétaires des moyens de gestion (bâtiments, moyens
financiers, matériel de guerre)
groupement structuré en « états », le souverain ne gouverne
qu’avec l’aide d’une aristocratie indépendante et partage de ce fait le pouvoir avec elle.
• l’état major est coupé des moyens de gestion comme le prolétaire l’est des moyens de production
matériel dans l’entreprise capitaliste
le souverain s’appuie sur des couches sociales dépourvues de
fortune et de tout honneur social. Par conséquent ces derniers dépendent entièrement de lui et ne
peuvent concurrencer son pouvoir (cela correspond au pouvoir de type despotique ou bureaucratique
– or l’Etat bureaucratique caractérise le mieux le développement rationnel de l’Etat moderne).
Partout le développement de « l’Etat moderne » a pour point de départ la volonté du prince d’exproprier les
puissances privées indépendantes. L’Etat moderne est donc un groupement institutionnel de domination qui a
cherché à monopoliser, dans les limites d’un territoire, la violence physique légitime comme moyen de
domination et qui, dans ce but, a réuni dans les mains de ses représentants les moyens matériels de gestion. Il a
exproprié les individus qui en disposaient autrefois par leur droit propre et s’est substitué à eux au sommet de la
hiérarchie.
C) Les aspects de la politique professionnelle :
On voit apparaître alors une nouvelle sorte d’ « hommes politiques professionnels » (p.134). On peut faire de
la politique de deux manières : soit d’une manière occasionnelle (lorsque nous votons par exemple) soit en la
pratiquant comme profession (en tant que représentant).
Il existe deux catégories d’homme politique professionnel ou bien il vit « pour » la politique (celui qui en fait
le but profond de sa vie) ou bien il vit « de » la politique (celui qui voit dans la politique une source
permanente de revenu), cette distinction est économique. Mais toute couche dirigeante se sert de sa situation
dominante pour vivre également « de » la politique et pour valoriser ses propres intérêts.
Un Etat dirigé par des hommes qui vivent exclusivement « pour » la politique signifie nécessairement que les
couches dirigeantes se recrutent de façon « ploutocratique ». Exercer sans rétribution la politique nécessite une
fortune personnelle ; si on démocratise le pouvoir, il faut rémunérer les individus qui l’exercent, on parle alors
d’emplois politiques. Les luttes partisanes non donc plus seulement des buts objectifs, mais s’expliquent
surtout pour le contrôle de la distribution de ces emplois.
L’évolution qui transforme la politique en une « entreprise » exige une formation spéciale de ceux qui
participent à la lutte pour le pouvoir et qui en applique les méthodes. Elle aboutit à une division des
fonctionnaires en deux catégories : les fonctionnaires de carrière (ceux qui quittent leur poste à la suite d’un
changement de majorité parlementaire, d’un changement de cabinet) et les fonctionnaires politiques (on peut
les déplacer à volonté, les mettre en disponibilité comme les préfets en France).
Comme dans une entreprise le ministre est avant tout le représentant de la constellation politique au pouvoir ; il
a donc pour tâche de faire appliquer le programme de cette constellation. Les choses ne se passent pas
autrement dans une entreprise privée.
D) Les traits particuliers des hommes politiques professionnels :
Ils sont apparus autrefois avec la lutte qui opposa les princes aux « ordres » ; ils se mirent à leur service, il en
existe plusieurs types : les clercs (ceux qui savaient écrire, ils avaient un potentiel administratif et pouvaient
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%