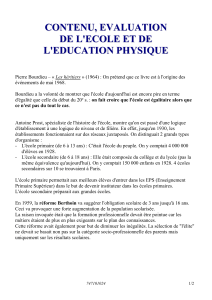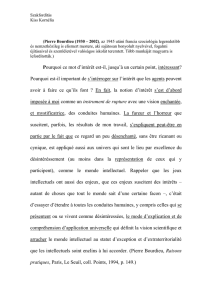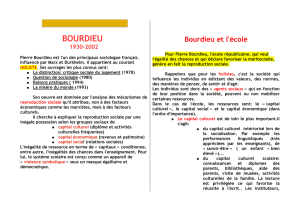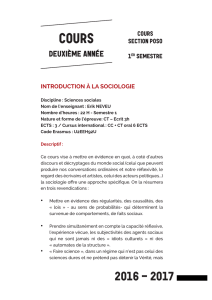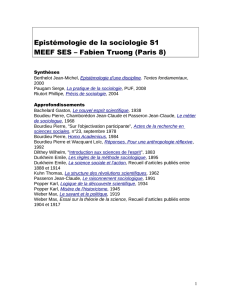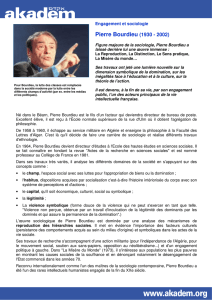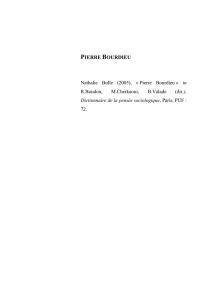biographie - Banque de données en santé publique

Recherche en soins infirmiers n° 116 - Mars 2014 l
Copyright © ARSI tous droits réservés
-
81
BIOGRAPHIE
Pour citer l’article :
SUAUD C. Pierre Bourdieu : la sociologie comme « Révolution symbolique ». Recherche en soins inrmiers, mars 2014 ; 116 : 81-94.
Adresse de correspondance :
Charles SUAUD : [email protected]
The article combines two objectives: understand the genesis and development of the sociology of
Bourdieu in connection with his social and intellectual positioning. The sociology of Bourdieu is a
theory of Action which reconciles the double requirement of objectification and taking account
of the practical logic bound by social agents. From the character both objective and subjective
of social space, he analyzes how different institutions (firstly School) are doing that mental
structures match the objective structures of society. By making acceptable reality and registering
it in the body, these instances contribute to reproduce social divisions and participate in the
work of domination. Gradually, Bourdieu develops a general theory about Power, which leads to
a sociology of State. But he refuses any sociological fatalism. Because he perceived homologies
between the sociologist and the artist facing the social order, each in their own way, he devoted
two researches to Flaubert and Manet, seized in the same enterprise of aesthetic subversion he
described as a ‘symbolic revolution’. In many aspects, the sociology of Bourdieu opens ways of
looking for an objectification of caregivers and their practices.
Key words : Social space, domination, incorporation, power, symbolic struggle.
ABSTRACT
RÉSUMÉ
L’article combine deux objectifs : comprendre la genèse et le développement de la sociologie de
Bourdieu en lien avec son positionnement social et intellectuel. La sociologie de Bourdieu est
une théorie de l’action qui concilie la double exigence d’objectivation et de prise en compte de la
logique pratique engagée par les agents sociaux. Partant du caractère à la fois objectif et subjectif
de l’espace social, il analyse comment les différentes institutions (à commencer par l’École) font
correspondre les structures mentales aux structures objectives de la société. En rendant la réalité
acceptable et en l’inscrivant dans les corps, y compris chez les dominés, ces instances contribuent
à reproduire les divisions sociales et participent du travail de domination. Progressivement, c’est
une théorie générale du pouvoir que Bourdieu élabore, qui le conduit à faire une sociologie de
l’État. Mais il se refuse à tout fatalisme sociologique. C’est parce qu’il perçoit des homologies
entre le sociologue et l’artiste en butte à l’ordre esthétique qu’il consacre deux recherches à
Flaubert et Manet, saisis dans une même entreprise de subversion de l’ordre établi qu’il qualifie
de « révolution symbolique ». Par bien des aspects, la sociologie de Bourdieu ouvre des voies de
recherche pour une objectivation des soignants et de leurs pratiques.
Mots clés : Espace social, domination, incorporation, pouvoir, luttes symboliques.
Charles SUAUD
Sociologue, professeur émérite, université de Nantes, Centre Nantais de Sociologie (CENS)
Pierre Bourdieu : la sociologie comme
« révolution symbolique »
Pierre Bourdieu : sociology as a « symbolic revolution »

82 l Recherche en soins infirmiers n° 116 - Mars 2014
Copyright © ARSI tous droits réservés
INTRODUCTION
Exposer et discuter la théorie sociologique élaborée et mise
en œuvre par Pierre Bourdieu dans une revue s’adressant
en priorité à des professionnels en soins infirmiers ne doit
pas relever de l’exercice formel, finalisé sur lui-même, dont
l’institution scolaire raffole. Pierre Bourdieu, pur produit des
filières et instances les plus nobles du système d’enseignement
français, n’a cessé d’expliquer comment les conditions de mise
à l’écart du monde social que l’École1 offre pour penser le
monde - pour indispensables qu’elles soient - sont en même
temps un piège redoutable pour le chercheur tenté de
croire que les enquêtés partagent le même objectif que lui :
comprendre intellectuellement le monde. Autrement dit, la
condition de retrait, constitutive de la démarche de recherche
qu’il désigne par le mot de scholè2, risque de faire oublier au
sociologue cette vérité basique qu’il lui faut comprendre les
faits et gestes d’individus engagés dans le monde social et
sommés de répondre au quotidien à des injonctions pratiques
qui ne laissent guère le loisir de réfléchir théoriquement avant
d’agir. L’obsession de Pierre Bourdieu a été précisément de
se doter d’une théorie sociologique qui doit se contrôler en
permanence - tel est l’impératif de « réflexivité » - afin de
mettre en œuvre une démarche compréhensive qui soit à la
fois distanciée et soucieuse de respecter le point de vue des
agents sociaux qu’il importe de toujours situer sur les espaces
de pratique (familial, amical, professionnel, religieux, etc.) sur
lesquels ils sont pris.
On peut dire que la sociologie de Bourdieu est une théorie
de l’action et c’est afin de concilier la double exigence
d’objectivation et de prise en compte de la logique pratique
engagée par les individus dans leur vie ordinaire qu’il a été
amené à prendre le corps comme médiation obligée entre les
conditions sociales et les comportements observés. Agir, c’est
mettre en actes sur un espace donné qui a ses contraintes
propres des dispositions socialement acquises tout au long
des diverses socialisations marquant le déroulement d’une vie
(familiale, scolaire, professionnelle, etc.). L’une des hypothèses
centrales de Bourdieu est de penser que les représentations
ou les savoirs que nous mettons spontanément à la base
de nos actions ne sont qu’une modalité, relevant plus de la
justification que de l’explication, des dispositions qui nous font
réellement agir. L’état premier de ces dernières est d’exister
sous la forme incorporée, au point de ne plus apparaître
dans leur dimension sociale à la conscience des agents
convaincus d’agir librement, en réponse à des « penchants
naturels ». Une autre avancée théorique de Bourdieu est de
montrer que la place des dispositions incorporées dans la
1 Le mot « École », avec majuscule, désigne l’institution scolaire dans sa
fonction globale d’inculcation mentale et d’intégration sociale.
2 La situation de scholè place le chercheur dans un « temps libre et libéré
des urgences du monde qui rend possible un rapport libre et libéré à ces
urgences et au monde » (Bourdieu, 1997, 9) [28] ». Le premier impératif d’une
démarche réflexive est d’objectiver les effets de cette position de retrait sur
l’acte de compréhension sociologique du monde social.
chaîne de production sociale des actions individuelles n’est
pas le propre des agents observés qui, par définition, sont
soumis aux contraintes extérieures : le sociologue est lui-
même sujet à des déterminations sociales de même nature
susceptibles d’agir sur l’exercice de son « métier »3. Même
si celui-ci recourt à des théories explicites, il ne cesse pour
autant d’engager dans son travail intellectuel des manières
incorporées d’être, de voir et de faire qui résultent d’une
double histoire, attachée d’une part au parcours social
individuel et d’autre part à la formation professionnelle reçue
dans le « champ intellectuel » 4.
L’objectif principal de cet article consiste à montrer que les
objets empiriques que Pierre Bourdieu a construits et les
questions sociologiques qu’il en a tirées - seul ou, le plus
souvent, au sein du collectif de recherche créé par lui à la
fin des années 1960 - résultent de la théorie du social qu’il
a élaborée progressivement. À une demande qui lui était
adressée de fournir les ouvrages donnant les clés de sa
sociologie (Bourdieu, 2013, 102) [36], c’est fort logiquement
qu’il ait répondu en citant l’enchaînement des trois livres
que sont l’Esquisse de la théorie de la pratique, 1972, [9],
Le sens pratique, 1980, [16] et Méditations pascaliennes,
1997, [28], dans lesquels il ne cesse de préciser, avec un
souci de réflexivité croissant, comment il a forgé une théorie
de la pratique. Sans évacuer le sujet comme le faisait le
structuralisme des années 60, Bourdieu pense les individus
comme des agents sociaux dotés de dispositions socialement
acquises et incorporées par lesquelles ils agissent en fonction
de ce qu’ils perçoivent comme pensable, désirable et possible,
dans les limites objectivement contenues dans l’espace social.
L’intention de cette contribution n’est pas de faire un état,
année par année, des productions de Pierre Bourdieu mais
3 Rédigé sous une forme un peu scolaire avec Jean-Claude Passeron et
Jean-Claude Chamboredon, Le métier de sociologue, 1968, [7] a été le livre
fondateur pour une sociologie réflexive combinant de manière raisonnée
les apports de Durkheim, Marx et Weber. Ce premier tome, à finalité
épistémologique, devait être suivi de deux autres portant sur la problématique
et les outils qui ne verront pas le jour. C’est l’ensemble des travaux de Pierre
Bourdieu qui, fort avantageusement, en tiendra lieu.
4 Le « champ » d’après Bourdieu est un espace spécifique (un « microcosme
social relativement autonome »), réservé à une pratique particulière (littéraire,
médicale, religieuse, juridique, etc.), sur lequel des agents sélectionnés et
spécialement formés sont en concurrence pour conquérir les positions les
plus fortes, autrement dit les plus fortement dotées du pouvoir exercé sur
cet espace afin d’en contrôler les règles de fonctionnement interne et, le cas
échéant, pour agir à l’extérieur du champ au nom d’une autorité légitime que
celui-ci confère : c’est, par exemple, le philosophe ou le prêtre qui dicte sa
vision du monde au politique ou au médecin. Parmi les nombreuses définitions
de la notion de « champ », celle donnée dans Réponses (Bourdieu, Wacquant,
1992, 72-73) [22] se caractérise par le fait d’accorder le primat aux positions
existant sur un espace donné par rapport aux individus qui les occupent :
« En termes analytiques, un champ peut être défini comme un réseau, ou une
configuration de relations objectives entre des positions. Ces positions sont
définies objectivement dans leur existence et dans les déterminations qu’elles
imposent à leurs occupants, agents ou institutions, par leur situation (situs)
actuelle et potentielle dans la structure de la distribution des différentes
espèces d pouvoir (ou de capital) dont la possession commande l’accès
aux profits spécifiques qui sont en jeu dans le champ ». Dans le texte, nous
distinguerons l’individu « Pierre Bourdieu » de la position occupée dans le
champ sociologique, désignée par le seul nom « Bourdieu ».

Recherche en soins infirmiers n° 116 - Mars 2014 l
Copyright © ARSI tous droits réservés
-
83
Pierre Bourdieu : la sociologie comme
« révolution symbolique »
de donner à comprendre la genèse et le développement de
travaux en fonction du positionnement social et intellectuel
de leur auteur en recherche incessante d’une cohérence
théorique. L’article se termine en suggérant que les principes
clés de la théorie du social chez Bourdieu sont de nature à
alimenter une sociologie qui interroge les métiers infirmiers
non seulement sous l’angle de l’organisation professionnelle,
mais du point de vue de la pratique elle-même, dans la relation
entre corps soignant et corps soigné.
UN SCHÈME TRANSVERSAL
D’(AUTO) - ANALYSE :
LA DOMINATION
Dans le prolongement d’une critique qu’il avait formulée à
propos des présupposés inconsciemment acceptés dans un
usage non contrôlé de la biographie en sociologie, Bourdieu
avait renoncé à s’appliquer à lui-même ce qui relève plus d’un
genre littéraire que d’une méthode, préférant l’expression
« auto-analyse » à celle rejetée d’« autobiographie », 2004,
[34]. Ce refus n’était pas que de forme. Il se fonde sur un
principe largement développé dans la sociologie de Flaubert,
1992, [23] et de Manet, 2013, [36] qui s’écarte résolument
du concept idéaliste sartrien de « projet » qui met dans une
intention initiale tout le développement d’une œuvre à venir.
Il semble que l’on reste plus proche de la conception que
Bourdieu se faisait du travail sociologique en adoptant, dans un
premier temps, un point de vue durkheimien sur l’ensemble
de ses productions afin d’en dégager un « sens objectif »5
construit au fur et à mesure des enquêtes.
Dans le but de donner des points de repères pour se déplacer
avec profit dans le monde de la recherche de Bourdieu, il a paru
profitable de privilégier les travaux jugés les plus significatifs
des avancées théoriques, choix nécessairement discutables
mais nécessaires pour découvrir, ou approfondir, une œuvre
impossible à réduire à une progression linéaire, avançant
inexorablement vers des découvertes transcendantes. Il ne
s’agit pas de faire une « lecture » de Bourdieu dans le pur style
des exercices scolaires propres à mettre en valeur le lecteur,
mais de suivre le conseil qu’il a lui-même retenu de Flaubert
se demandant pourquoi on ne lit jamais les textes « du point
de vue de l’auteur » ?
Parmi les premiers travaux de Bourdieu - qui sont
des enquêtes de terrain et non des textes théoriques
programmatiques, deux se détachent en ce qu’ils engagent,
avec toute la détermination mobilisée dans les moments
fondateurs, une rupture franche avec la sociologie abstraite
et théoriciste des années 1960 : à savoir l’article « Célibat
5 Par « sens objectif » d’une œuvre, il faut entendre le sens que l’on peut tirer de
l’analyse de l’œuvre elle-même, une fois réalisée, en contournant les intentions
subjectives de l’auteur. Cette mise entre parenthèses de l’auteur ne peut être
que provisoire dans une perspective de compréhension sociologique.
et condition paysanne », 1962, [1] et le livre co-produit
avec des économistes et statisticiens de l’INSEE, Travail
et travailleurs en Algérie,1963, [2]. Indépendamment des
intentions de leur auteur et par-delà l’éloignement entre
les populations étudiées - des salariés agricoles célibataires
en pays béarnais, sa région d’origine, pour la première et
des ouvriers et sous-prolétaires algériens saisis en pleine
période de guerre coloniale pour la seconde -, ces deux
enquêtes présentent des points communs qui montrent
en train de se forger le point de vue à partir duquel
Bourdieu analysera inlassablement les rapports de force
qui s’exercent au sein des sociétés. Leur caractéristique
essentielle n’est pas de prendre comme objet des groupes
sociaux « défavorisés », disposant de peu de ressources
économiques. Ce qui attire l’attention de Bourdieu, c’est
l’état de dépossession qui accompagne ce manque et qui
consiste moins en une privation pourtant réelle de biens
matériels ou culturels qu’en une absence de maîtrise du sens
de la vie, à commencer par une impossibilité de contrôler
les images dévalorisantes dont ces individus sont l’objet.
Célibataires béarnais et sous-prolétaires algériens partagent
des conditions de dépendance telles qu’ils sont entièrement
« faits » par les jugements des groupes sociaux qui, tenant les
normes de la société, les relèguent au plus bas de la condition
humaine. La « domination symbolique » par laquelle les
dominés intériorisent leur condition fait partie intégrante
de la « domination sociale ». Cette condition sociale que
Bourdieu qualifiera plus tard à l’aide de la notion de « classe-
objet », 1977, [13] a comme autre caractéristique qu’elle
s’inscrit durablement et ostensiblement dans les corps. Le
paysan célibataire « immariable » comme le sous-prolétaire
algérien sans emploi portent dans leur corps les stigmates
d’une condition qui leur apparaît dès lors comme un destin
naturel irréversible. Tout en étant un lecteur attentif mais
aussi critique de Marx, c’est sur les traces de Max Weber
que Bourdieu décrira ses premiers enquêtés, cherchant
à les saisir en priorité dans leur condition de domination
sociale, et non dans la relation d’exploitation économique
à proprement parler. Sans négliger la dureté des rapports
économiques qui écrasent les familles paysannes béarnaises
aussi bien que celles des ouvriers algériens, Bourdieu
raisonne comme si le concept d’exploitation risquait de
mettre les relations de dépendance sur le compte exclusif et
externe des « exploiteurs », laissant aux « exploités » toute
leur capacité de révolte. Penser en termes de domination
oblige à voir que les rapports de classe transforment en
profondeur les dominés, à la fois mentalement et jusque
dans la profondeur de leur chair. Cette découverte traverse
toute l’œuvre de Bourdieu.
On peut rassembler sous la dénomination d’une sociologie
de la domination la majeure partie de la production de
Bourdieu. Au fur et à mesure des enquêtes empiriques, il
précise sa conception de l’espace social qui existe, avec ses
hiérarchies et ses divisions, sous une double modalité : dans
les faits et dans les têtes, la correspondance entre les deux

84 l Recherche en soins infirmiers n° 116 - Mars 2014
Copyright © ARSI tous droits réservés
univers, objectif et subjectif, n’étant pas d’abord de l’ordre
de la représentation explicite, mais d’une « incorporation des
structures objectives de l’espace social » (Bourdieu, 1984, 5)
[20]. Et cette incorporation n’a rien d’une donnée naturelle.
Elle résulte au premier chef des expériences multiples qu’un
individu connaît tout au long de sa vie. L’incorporation
des conditions et positions de classe se réalise sur fond
de catégories de perception du monde social organisées
et imposées par les institutions. Et si Bourdieu refuse les
frontières entre des sociologies spécialisées en fonction de
leurs objets concrets (de l’éducation, de la culture, de la
politique, etc.), c’est précisément qu’à travers leur division
du travail de mise en forme du social, les institutions
contribuent dans leur logique propre à la même fonction
de domination, qualifiée de « symbolique », dans le sens où
elles rendent pensables et acceptables les divisions sociales
qui, au final, s’imposent comme des évidences du « sens
commun »6. Il serait vain de chercher à classer les différents
travaux de Bourdieu pour les enfermer dans des sous-
ensembles clos relevant, par exemple, d’une sociologie de
l’école, de la production artistique, des médias ou de l’État.
Si Bourdieu s’est attelé à l’étude de toutes ces institutions,
c’est parce qu’elles ont partie liée à un travail différencié
et systématique de mise en ordre du monde social. De
sorte que les institutions, dans leur fonction d’imposition
de représentations mentales, demandent à être lues à deux
niveaux : pour elles-mêmes dans la mesure où chacune
a son mode spécifique de construction symbolique de la
société (que ce soit par la transmission de la culture scolaire
ou la production de romans, de tableaux, d’émissions
de télévision, de lois, etc.) et dans les relations qu’elles
entretiennent entre elles. Soit, les deux exemples suivants,
pris dans des travaux réalisés aux deux extrémités de la
carrière. La sociologie de l’institution scolaire a été, après
l’Algérie, le domaine privilégié de recherche de Bourdieu,
en collaboration avec Jean-Claude Passeron, 1964, [3]. En
bonne tradition durkheimienne, la première approche a
consisté à expliciter les fonctions de reproduction sociale
de l’École, les classements scolaires retraduisant, tout en les
masquant, les divisions sociales et culturelles. L’analyse s’est
ensuite affinée pour décrire le fonctionnement interne de
l’institution, en décrivant « les catégories de l’entendement
professoral », 1975, [12] et en expliquant comment l’École,
par ses rites de passage que sont les examens, consacre en
les transformant en profondeur les élus qu’elle retient, 1981,
1982, [17, 19]. Mais ce point de vue n’a qu’une autonomie
provisoire. Pour Bourdieu, le travail de consécration scolaire
est inséparable d’une sociologie de l’État qui reproduit,
dans une logique républicaine méritocratique, la fonction
de distinction inscrite aussi bien dans les corps que dans les
esprits que remplissait l’appartenance à la noblesse dans la
France d’Ancien Régime, 1989, [21]. L’autre exemple est
6 Bourdieu a choisi cette expression de conception très durkheimienne
comme nom de la collection qu’il a dirigée aux Éditions de Minuit.
emprunté au dernier chantier consacré à la sociologie du
peintre Edouard Manet, 2013, [36] qui clôt une entreprise
commencée dès les années 1975 et qui avait été ponctuée
par l’ouvrage important sur Flaubert, 1992, [23]. C’est avec
une insistance appuyée que Bourdieu assène tout au long
du cours qu’il lui a consacré que la révolution picturale
accomplie par Manet est inséparable de la production
scolaire de l’époque qui accroît le nombre de prétendants
au métier d’artiste et, de manière plus déterminante encore,
du rôle de l’État qui contrôlait entièrement le système de
formation des artistes, organisait la demande sociale en
matière de goût pictural et consacrait sélectivement les
peintres académiques (telle était la fonction du Salon).
Le « Manet » de Bourdieu est une immense construction
- Bourdieu dit avoir à peu près tout lu sur le sujet - des
conditions sociales, politiques, intellectuelles, artistiques
(une grande importance est accordée à la critique) et
institutionnelles qui ont permis qu’un individu singulier,
doté d’un fort capital, ait pu, à travers ses choix de peintre,
casser le monopole exercé par l’État sur la production de
la peinture et proposer une vision du monde radicalement
nouvelle : « Il est certain que Le déjeuner sur l’herbe […]
est un jeu académique. Manet règle des comptes avec
l’institution académique et, pour comprendre ce qui se passe
dans ce tableau, il faut comprendre cet art d’institution et du
même coup l’institution qui garantit cette institution, c’est-
à-dire l’État […] L’État intervenait très directement dans
le domaine de l’évaluation de la représentation officielle du
monde, c’est-à-dire dans ce qui mérite d’être représenté
et de la hiérarchie des choses représentables […] Dans la
réalité, il y a aussi une hiérarchie, mais la différence tout
à fait radicale aujourd’hui par rapport à ce qu’on avait à
l’époque, c’est que l’art académique était un art d’État […],
c’est-à-dire un art entièrement gouverné par l’État. » (2013,
164-165) [36].
En clair, ce refus des cloisonnements entre des spécialités
factices de la sociologie, qui sont le plus souvent au service
d’intérêts corporatistes de chercheurs, a été commandé par
la réalité sociale elle-même, comprise comme un ensemble
structuré de relations entre différents espaces de pratique.
On trouve dans cette conception de l’espace social les
principes qui ont forgé le positionnement sociologique
de Bourdieu. Si le fait de penser le monde social comme
multidimentionnel, impossible à réduire à une opposition
binaire, lui a fait prendre quelque distance par rapport à
Marx7, son parti pris d’une théorie de l’action engagée sur
ces espaces répondant à des dispositions pour une large
part incorporées le fait pencher du côté de Pascal sous
7 « La construction du modèle de l’espace social qui soutient cette analyse
[portant sur la genèse des classes sociales] suppose une rupture tranchée
avec la représentation unidimentionelle et unilinéaire du monde social
qui sous-tend la vision dualiste selon laquelle l’univers des opposition
constitutives de la structure sociale se réduirait à l’opposition entre les
propriétaires des moyens de production et les vendeurs de force de
travail. » (1984, 9) [20].

Recherche en soins infirmiers n° 116 - Mars 2014 l
Copyright © ARSI tous droits réservés
-
85
Pierre Bourdieu : la sociologie comme
« révolution symbolique »
l’égide duquel est placé le texte de synthèse des acquis d’une
sociologie réflexive de la pratique8, 1997, [28].
UN PARCOURS SOCIAL
TRANSFORMÉ EN PROJET
INTELLECTUEL
Chercher à comprendre le point de vue qui a porté Bourdieu
à privilégier la question de la domination donne l’occasion
d’énoncer un principe d’analyse fondamental à partir duquel
celui-ci a construit sa sociologie du travail symbolique, en
particulier des intellectuels. Analyser qui sont les producteurs
de biens symboliques9 et, partant, comprendre les œuvres
qu’ils créent ne peut se réduire à une prise en compte isolée,
si précise fût-elle, du positionnement social initial. Les effets
de l’origine sociale sont nécessairement médiés d’une part par
les acquis de la formation reçue pour accéder à la pratique
concernée (littéraire, médicale, artistique ou autre), d’autre
part à travers les transformations individuelles que l’insertion
sur l’espace professionnel - que Bourdieu appelle « champ »
- ne manque jamais d’entraîner chez les entrants. Rappelant
sans cesse depuis Le métier de sociologue, 1968, [7] que
la première tâche du sociologue est d’objectiver sa propre
position ainsi que le rapport qu’il entretient aux objets d’étude
qu’il se donne, Bourdieu s’est appliqué à lui-même sans répit
cette exigence au point d’en avoir fait l’objet de son ultime
cours au Collège de France, durant l’année universitaire 2000-
2001, 2001, 2004, [31, 34].
Juste évoquée au terme de ce dernier cours, l’auto-analyse
développée dans Esquisse pour une auto-analyse publiée
après sa mort pousse la logique de construction à son
8 « J’avais différentes raisons […] de placer ces réflexions sous l’égide de
Pascal. J’avais pris l’habitude, depuis longtemps, lorsqu’on me posait la question,
généralement mal intentionnée, de mes rapports avec Marx, de répondre qu’à
tout prendre, et s’il fallait à tout prix s’affilier, je me dirais plutôt pascalien :
je pensais notamment à ce qui concerne le pouvoir symbolique, côté par où
l’affinité apparaît le mieux, et à d’autres aspects de l’œuvre, moins perçus,
comme la révocation de l’ambition des fondements. Mais, surtout, j’avais
toujours su gré à Pascal, tel que je l’entendais, de sa sollicitude, dénuée de
toute naïveté populiste, pour le « commun des hommes » et les « opinions du
peuple saines » ; et aussi de sa volonté, qui en est indissociable, de chercher
toujours la « raison des effets », la raison d’être des conduites humaines en
apparence les plus inconséquentes ou les plus dérisoires - comme « courir
tout le jour après un lièvre » -, au lieu de s’en indigner ou de s’en moquer. »
(1997, 9-10) [28].
9 Les « biens symboliques » sont des produits dont la valeur - sans lien direct
avec la valeur économique des matériaux qui les constituent - fait l’objet
d’une « reconnaissance sociale » (Bourdieu parle également de « croyance »
collective) qui, en principe, reste indifférente aux sanctions positives du marché.
Ce qui n’exclut pas qu’il puisse y avoir une véritable économie du marché
des biens symboliques comme on le constate avec le réseau des galeries
d’art : « J’en viens à l’économie des biens culturels. On y retrouve la plupart
des caractéristiques de l’économie précapitaliste. D’abord la dénégation de
l’économique : la genèse d’un champ artistique ou d’un champ littéraire, c’est
l’émergence progressive d’un monde économique renversé, dans lequel les
sanctions positives du marché sont ou indifférentes ou négatives [avec un
renvoi à (Bourdieu, 1992, 201) [23]]. Le best-seller n’est pas automatiquement
reconnu comme œuvre légitime et la réussite commerciale peut même avoir
valeur de condamnation. » (1994, 198-199) [26].
comble en postulant que comprendre son œuvre, « c’est
comprendre d’abord le champ avec lequel et contre lequel
[il] s’est fait » (2004, 15) [34], avant même d’évoquer les
années de jeunesse. Restituant l’ordre chronologique pour ne
pas trop dérouter le lecteur mais sans dénaturer l’intention
théorique de Bourdieu, il faut se représenter le jeune Pierre
Bourdieu comme ce garçon, fils d’un petit employé de la
fonction publique ayant quitté la petite agriculture dont il est
issu mais resté distant du monde des notables et devenu très
critique vis-à-vis des politiques en place, sélectionné comme
« boursier » du fait de résultats scolaires brillants obtenus
dans une institution scolaire des années 50 dans laquelle il ne
se reconnaît pas. En mentionnant son origine sociale dans un
second temps de son auto-analyse, Bourdieu veut signifier
que cette tension initiale créée par la reconnaissance de
l’institution scolaire dont il n’accepte pas le code n’éclaire
son œuvre que dans la mesure où elle s’actualise à travers
des prises de position proprement intellectuelles effectuées
une fois entré dans le champ de la philosophie du moment.
C’est ainsi que le Bourdieu des Héritiers, 1964, [3], du
Déracinement, 1964, [4], de La Distinction, 1979, [15] ou de
La Misère du monde, 1993, [24] se construit au prix d’une
double rupture opérée sur le terrain le plus consacré par
l’université, celui de la philosophie. Son histoire est celle d’une
première conversion problématique aux valeurs du monde
intellectuel qui, dans son état de structuration vers le milieu
du XXème siècle, ne pouvait que rappeler aux « boursiers »
l’indignité de leur prétention à entrer dans un univers qui
ne leur était pas destiné. La distance que Pierre Bourdieu
ressent quasi physiquement entre une hyper-reconnaissance
scolaire et son entrée sur un espace philosophique soucieux
de maintenir le monde social à distance (ne serait-ce que par
le refus méprisant des méthodologies les plus objectivantes),
le met dans un état de grand malaise qui va l’attirer du côté
des philosophes critiques. C’est à travers ce « sens du
placement » dans l’espace de la philosophie qu’il transformera
par choix successifs un parcours social et scolaire en parti
pris intellectuel résolument tourné vers l’analyse du social.
Dans Esquisse pour une auto-analyse, 2004, [34], Bourdieu
exprime à la fois sa fascination pour le travail théorique
le plus accompli et son rejet pour les jeux philosophiques
académiques, faits de fausses révolutions à ses yeux, qui le
conduisent à ne « reconnaître » que les philosophes qui
le « reconnaîtront », comme Georges Canguilhem, et qui
lui donneront « la possibilité de vivre la vie intellectuelle
autrement » (2004, 40) [34]. Les effets de cette contre-
socialisation philosophique s’inscriront dans une démarche
intellectuelle confirmée au terme d’une seconde conversion,
marquée par un engagement sociologique total en situation
de guerre coloniale (durant la guerre d’Algérie) où le
moindre acte technique d’enquête nécessite un contrôle de
la part du chercheur et révèle les enjeux vitaux de la théorie
pour les enquêtés. C’est à travers la mise en demeure de
ces scènes d’enquête en Algérie où la réflexivité devient
condition de survie au sens premier du terme (comment
sauver sa peau en posant la bonne question) que Pierre
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%