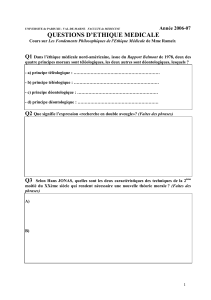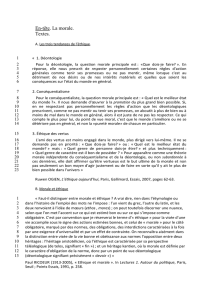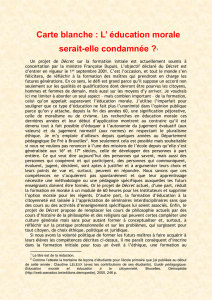Mail Mr Moutot

Mr Moutot a tenu à mettre à la disposition de tous les étudiants la réponse qu’il a donné à une
étudiante lui ayant envoyé un mail. Nous vous transmettons l’échange qu’ils ont eu:
« Dans la partie "les deux pôles de la vie morale", vous parlez tout d’abord de la morale ( avec le
deontologisme et le conséquentialisme ) puis vous parlez de l’éthique ( perspective téléologique et
perfectionnisme ) , du coup quels sont pour vous les poles de la morale ? Le deontolgisme et le
conséquentialisme ? Dans ce cas qu’est ce que represente la perspective théologique et le
perfectionnisme ? Ou alors ces quatre notions sont liées ? »
« J’ai également deux autres petites questions en lien avec cette partie :
-Parmis ces quatre notions lesquels représentent l’éthique antérieur ? Toutes ?
- Peut on parle d’éthique déontologique et éthique conséquentialisme ? (car dans la séance 13 du
tutorat il y avait écrit « éthique déontologique » et l’item était compté vrai ) »
« Quelques mots très brefs, car, comme je l’ai dit en cours, il n’est plus question de répondre
aux mails, désormais. Je le fais pour ne pas vous laisser dans l’embarras, voire dans
l’angoisse, mais j’en suis très gêné. Je vous demande de partager ces quelques lignes avec les
tuteurs (à qui j’adresse de toute façon ce message en copie) et je souhaite que ceux-ci les
mettent, d’une manière ou d’une autre, à disposition des autres étudiants (ils peuvent faire
suivre ce mail à la promo, par exemple). Sinon, prendre la peine de vous écrire, à ce moment
de l’année, s’apparenterait à une rupture d’égalité entre les candidats. De toute façon, je pense
que les tuteurs ont en réalité toutes les informations nécessaires pour vous répondre et vous
rassurer, puisqu’ils sont en possession d’indications précises en relation avec nos cours.
On peut, par convention, distinguer les « deux pôles de la vie morale » au moyen des
vocables de morale et d’éthique, puisqu’après tout, comme le note Ricœur, ils nous
sont légués par la tradition. Cela n’a donc rien à voir avec ce que sont ces pôles « pour
moi » : je me sers simplement de l’approche ricœurienne (que d’autres philosophes, au
reste, pourraient tout à fait discuter, voire rejeter). Disons que celle-ci s’accorde assez
bien avec les définitions / distinctions que je donne au début du cours : la morale,
comme région des normes, cette réalité objective (sociale, historique, etc.) de la
distinction entre le permis et le défendu (dont la face subjective est le sentiment
d’obligation) ; l’éthique, que l’on peut définir comme un rapport réflexif aux normes
(que l’on rattache celle-ci à l’action par devoir — Kant, pour aller vite — ou à la règle
cherchant, du côté des conséquences de l’action, à maximiser le bien-être — collectif,
notamment : c’est l’utilitarisme ; dans le cours, je me suis ensuite essentiellement
référé au modèle déontologique, kantien).
C’est au sein de ce rapport que l’on peut à nouveau distinguer deux directions, que
Ricœur repère comme l’amont et l’aval des normes. L’amont : comment les normes
s’ancrent-elles dans nos vies ? Qu’est-ce qui, pour le dire très vite, nous pousse à
vouloir agir « moralement », en suivant des normes ? Les deux grandes réponses
déposées dans les principales traditions de la philosophie morale (déontologisme) sont
le devoir et la vertu (perfectionnisme, vertuisme : quelle personne est-ce que je vise à
être ? = le but, la fin, que je poursuis, le telos, en grec, d’où le vocable « téléologique »
— et non pas « théologique » [theos = dieu]). D’un point de vue déontologique, le
« moteur » de l’action morale (son « mobile », en termes kantiens) apparaît comme
étant le respect (qui s’adresse à la loi morale et aux personnes), tandis que le point de
vue téléologique met en avant le souci d’agir selon la « préférence raisonnable »
(perfectionnisme moral : s’exercer à agir, dans chacune de nos conduites, selon cette
visée de la préférence raisonnable — prohairesis, en grec). Sans doute notre vie
morale est-elle nourrie par ces deux impulsions, ou plus exactement, peut-être, ces

deux soucis. Quant à l’aval des normes, il désigne l’insertion des normes, leur
application, leur prolongement si vous voulez, dans les circonstances concrètes de
l’action. En termes déontologiques, on soulignera alors l’importance d’affirmer
l’égalité de sujets libres, qu’il faut traiter le plus possible comme tels (cf. principe du
respect de l’autonomie, p. ex.), alors qu’à la perceptive vertuiste / perfectionniste se
rattache le souci d’agir selon la prudence (phronesis), cette attention à la singularité
des situations, à la réflexion que celle-ci exige notamment lorsque les principes de
l’action s’y trouvent mis en tension, voire en contradiction. J’ai ainsi signalé, dans la
suite du cours, la manière dont l’ensemble de ces orientations (déontologiques /
téléologiques, éthique antérieure / postérieure) étaient reprises et réélaborées, à partir
d’une perspective intersubjective, dans l’éthiq ue de la discussion de Habermas.
Enfin, quant à l’item auquel vous faites allusion, oui, dans un contexte général (qui
était probablement celui de l’énoncé), on peut aussi bien parler d’éthique que de
morale déontologique ou conséquentialiste.
Encore un fois, j’insiste pour que cette réponse ne reste pas privée et soit accessible à tout
étudiant de PACES susceptible d’y trouver quelque éclaircissement. Et, à partir de
maintenant, je ne répondrai plus à aucune question.
Bien cordialement,
Gilles Moutot.
1
/
2
100%