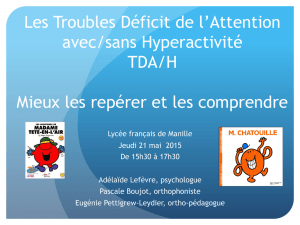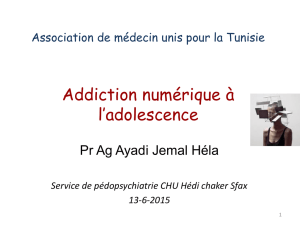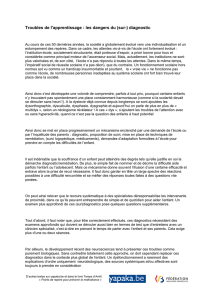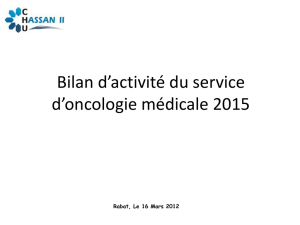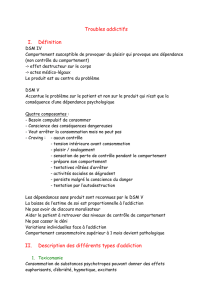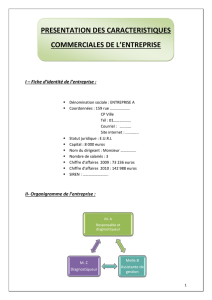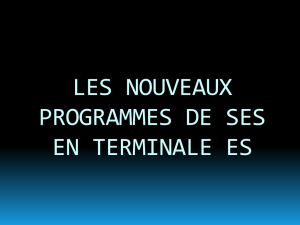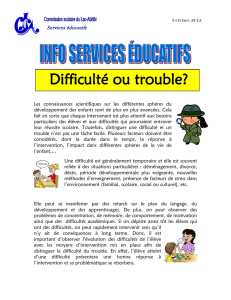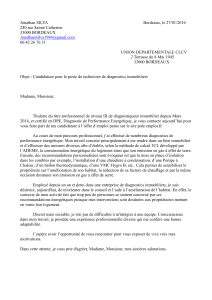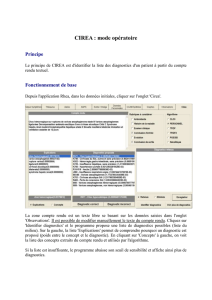INTRODUCTION Chapitre MODÈLES CLINIQUES DES

1Modèles Cliniques A.3
Manuel de la IACAPAP pour la Santé Mentale de l’Enfant et de l’Adolescent
INTRODUCTION
Chapitre
A.3
omas M Achenbach & David M Ndetei
Edition en français
Traduction : Laure Bera, Elodie Smette
Sous la direction de : Priscille Gérardin
Avec le soutien de la SFPEADA
MODÈLES CLINIQUES DES TROUBLES
COMPORTEMENTAUX, ÉMOTIONNELS
ET SOCIAUX DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT
Cette publication est à destination des professionnels de la santé mentale, qu’ils soient en formation ou en exercice. Elle n’est pas destinée au grand
public. Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement le point de vue de l’Editeur ou de la IACAPAP. Cette
publication tente de décrire les meilleurs traitements et pratiques basés sur des preuves scientiques disponibles au moment de sa rédaction, traitements
et pratiques qui pourraient donc évoluer en fonction des recherches à venir. Les lecteurs doivent mettre en perspectives ces connaissances avec les
recommandations et les lois en vigueur dans leur pays. Certains traitements pourraient ne pas être disponibles dans certains pays et les lecteurs devraient
consulter les informations spéciques des médicaments car tous les dosages et les eets indésirables ne sont pas mentionnés. Les organisations, les
publications et les sites web sont cités ou mis en lien an d’illustrer les résultats et de pouvoir rechercher davantage d’informations. Cela ne veut pas dire
que les auteurs, l’Editeur ou la IACAPAP endossent leurs contenus ou leurs recommandations, lesquelles pourraient être évaluées de façon critique par
le lecteur. De même, les sites web peuvent changer ou cesser d’exister.
©IACAPAP 2017. Ceci est une publication en accès libre sous la Creative Commons Attribution Non-commercial License. L’utilisation, la
distribution et la reproduction sur tout type de support sont permises sans permission préalable du moment que le travail original est correctement
cité et que l’utilisation n’est pas commerciale. Envoyez vos commentaires sur ce livre ou ce chapitre à jmreyATbigpond.net.au
Citation suggérée : Achenbach TM, Ndetei DM. Clinical models for child and adolescent behavioral, emotional, and social problems. In Rey JM
(ed), IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. (édition en français; Cohen D, ed.) Geneva: International Association for Child and
Adolescent Psychiatry and Allied Professions 2017.
Thomas M Achenbach PhD
Professor of Psychiatry and
Psychology, University of
Vermont, Burlington, Vermont,
US.
Conict of interest: President
of the nonprot Research
Center for Children, Youth,
and Families, which publishes
the Achenbach System of
Empirically Based Assessment
(ASEBA).
David M Ndetei MD
Professor of Psychiatry,
University of Nairobi, Nairobi,
Kenya.
Conict of interest: Director
of the nonprot Africa Mental
Health Foundation, which
promotes mental health
services, training, and research
in Africa.

2Modèles Cliniques A.3
Manuel de la IACAPAP pour la Santé Mentale de l’Enfant et de l’Adolescent
Ce chapitre présente des modèles permettant de distinguer les diérents
types de troubles comportementaux, émotionnels et sociaux manifestés
par les enfants (nous utilisons les termes « enfant «, et « enfance « pour
désigner les âges de la naissance à 18 ans). Nous utilisons le terme « modèles » pour
désigner les nosologies ocielles (A savoir, les classications des maladies), telles
que l’Organisation mondiale de la Santé (1992), la Classication internationale des
maladies (CIM) et le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM)
de l’American Psychiatric Association (2000). Nous utilisons également le terme
«modèles» pour des nosologies alternatives, telles que la Classication diagnostique
des troubles mentaux et développementaux de l’enfance, version révisée (DC : 0-3, zéro
à trois, 2005), et également pour des modèles empiriques tirés des données sur de
grands échantillons d’enfants.
Le terme «modèle» est largement utilisé pour désigner des représentations
systématiques de phénomènes. Cela implique qu’un phénomène particulier peut
être représenté (à savoir, modelé) de multiples façons. Cela implique également
que les diérents modèles correspondant à des phénomènes particuliers peuvent
être évalués quant à leur utilité pour des sujets particuliers, plutôt que de devoir
faire un choix entre le bon et le mauvais modèle. Ainsi, par exemple, le modèle
DSM peut utiliser des termes et critères diérents du modèle de la CIM pour les
troubles de d’attention, mais les deux peuvent être utiles pour des sujets diérents
et / ou dans des systèmes de soins diérents.
Certains modèles sont conçus pour représenter les relations entre des
phénomènes particuliers sans représenter leurs causes. Alors que d’autres modèles
sont conçus pour représenter les causes des phénomènes. Au stade actuel de leur
développement, les modèles cliniques présentés dans ce chapitre ne comprennent
pas les causes spéciques des problèmes comportementaux, émotionnels ou
sociaux. (Ce chapitre ne traite pas des retards mentaux ou de troubles tels que
le syndrome de Down, le syndrome de Prader-Willi, le Syndrome de Williams,
ou de la phénylcétonurie pour lesquelles les étiologies génétiques ou organiques
autres sont bien documentés - voir chapitre C.1). Bien que les étiologies génétiques
et organiques soient susceptibles d’aecter le comportement, les émotions et la
dynamique sociale, le manque de compréhension des voies causales spéciques
signie que les modèles cliniques doivent se concentrer sur les caractéristiques
phénotypiques que les praticiens peuvent identier et avec lesquels ils peuvent
travailler. Collaborer avec les praticiens est nécessaire à faire progresser notre
compréhension des étiologies, et des eets des traitements, les chercheurs ont
également besoin d’utiliser les mêmes modèles phénotypiques pour faire le lien
entre leurs travaux de recherche et les cas cliniques rencontrés par les praticiens.
CIM ET DSM
Les classications nosologiques de la CIM-11 et du DSM-5 sont encore en
cours de développement, et nous ne pouvons donc pas être précis sur les formats,
les catégories, ou les critères de ces classications nosologiques. Par conséquent,
nous devons fonder notre présentation sur les aspects des versions actuelles de la
CIM et du DSM qui pourraient être les mêmes dans les éditions en attente.
Les classications CIM et DSM se basent sur des données de comités
d’experts qui formulent les catégories diagnostiques à utiliser et les critères à
spécier dans l’objectif de déterminer si les individus répondent aux diagnostics

3Modèles Cliniques A.3
Manuel de la IACAPAP pour la Santé Mentale de l’Enfant et de l’Adolescent
Emil Kraepelin (1856-1926)
Le père putatif de la nosologie psychiatrique
Emil Kraepelin est connu comme le constructeur des modèles cliniques de
psychopathologie qui ont représentés les bases des classications nosologies psychiatriques.
Au cours de sa formation médicale à l’Université de Leipzig dans les années 1870, Kraepelin
est devenu un disciple de Wilhelm Wundt, qui est considéré comme le fondateur de la
psychologie expérimentale. En utilisant les méthodes expérimentales de Wundt pour étudier
le fonctionnement psychologique des patients, il a inclus des caractéristiques psychologiques
dans ses modèles cliniques, et il a consacré sa thèse de doctorat sur la place de la
psychologie en psychiatrie.
Kraepelin a d’abord pensé que la documentation minutieuse des différents
phénotypes psychopathologiques engendrerait la découverte d’une maladie cérébrale
spécique à chaque phénotype. En 1883, Kraepelin publié la toute petite première édition
de son Compendium Der Psychiatrie, qui a été suivie au cours des 43 années suivantes par
huit autres éditions progressivement de plus grande stature. Parmi ses autres réalisations,
Kraepelin est reconnu pour avoir brisé la catégorie unique des psychoses en des catégories
distinctes : troubles maniaco-dépressifs et dementia praecox (démence précoce), plus
tard rebaptisée : « la schizophrénie ». Dans les éditions ultérieures de son Compendium,
Kraepelin a ajouté les troubles psychogènes, ainsi que les troubles de la personnalité qu’il
considérait comme à la frontière entre la maladie et les particularités communes.
Comme l’a révélée une caricature dessinée par Kraepelin, il ne prenait pas les
diagnostics psychiatriques trop au sérieux. La bande dessinée reproduite ci-dessous à partir
du Bierzeitung (Beer Newspaper) de 1896 est sous-titrée “Psychiatres de l’Europe! Protégez
vos plus sacrés diagnostics!, “Kraepelin mis ainsi en garde contre le fait de devenir trop
impressionné par les diagnostics.
.

4Modèles Cliniques A.3
Manuel de la IACAPAP pour la Santé Mentale de l’Enfant et de l’Adolescent
modélisées par chaque catégorie. Les experts couvrent un large éventail de la santé
publique dans le domaine clinique, administratif et de la recherche.
Des brouillons des catégories et critères proposés sont largement distribués
pour permettre des commentaires et sont secondairement révisés sur la base de ces
commentaires. Dans la version IV-TR du manuel DSM, les catégories diagnostiques
des enfants sont principalement dénies en terme de troubles comportementaux,
émotionnels et sociaux (ex : troubles de l’attention, troubles des conduites, trouble
oppositionnel avec provocation, anxiété, dépression), les catégories comprennent
une liste de symptômes, et un diagnostic ne peut être posé que si l’on identie chez
un patient un nombre susant de symptômes de la liste (Association Américaine
de Psychiatrie, 2000). Il existe des critères supplémentaires comme la durée des
symptômes, l’âge d’apparition, et le retentissement. Les critères sont similaires
quel que soit l’âge de l’enfant ou son genre. Les critères sont également similaires
quelle que soit la source d’information, cela peut être par exemple les parents, les
enseignants, les enfants, les échelles diagnostiques, ou les observations cliniques.
S’il y a des incohérences ou des contradictions entre les diérentes sources (par
exemple, un enseignant signale des problèmes d’attention, mais le parent et enfant
ne le rapportent pas), c’est le praticien qui doit nalement évaluer la présence ou
l’absence des critères et poser ou non le diagnostic.
Les critères diagnostiques dimensionnels du DSM
Alors que le DSM-5 est en préparation, l’Association Américaine de
Psychiatrie a nommé un groupe de travail pour étudier la pertinence de critères de
diagnostic «dimensionnels» (à savoir, quantitatifs). Le groupe de travail a fait une
publication apportant son soutien à une composante dimensionnelle des critères
diagnostiques pour de nombreux troubles de l’enfant et de l’adulte (Helzer et al,
2008). Cependant, nous ne savons pas actuellement de quelle façon les critères
du DSM-5 pourraient être « dimensionnés ». L’une des possibilités semblerait être
que les critères pour les diagnostics cliniques conservent le même format que le
DSM-IV-TR, alors que les critères diagnostiques pour la recherche incluent une
sorte de dimensionalisation.
Les critères diagnostiques de recherche de la CIM 10
La CIM-10, Classication des troubles mentaux et du comportement: Critères
Diagnostiques pour la recherche (Organisation mondiale de la Santé, 1993), a
ajouté des critères pour la recherche aux critères publiés antérieurement qui ne
concernaient que les diagnostics cliniques (Organisation mondiale de la Santé,
1992). Les critères diagnostics de recherche de la CIM-10 ressemblent à ceux du
DSM-IV-TR dans le sens où il est demandé d’évaluer la présence ou l’absence
de chaque symptôme ou critère. Après l’évaluation de chaque symptôme en
particulier, l’évaluateur doit juger si le diagnostic global peut être posé pour chacun
des enfants.
Les diérences entre les critères cliniques de diagnostic de la CIM-10 et du
DSM
Les critères cliniques de diagnostic de la CIM-10 (Organisation mondiale
de la Santé, 1992) dièrent de ceux du DSM-IV-TR dans le sens où ils ne donnent
pas de description explicite des symptômes, des autres caractéristiques, et des
critères de jugements pour décider si un enfant est admissible à un diagnostic
La CIM 10 diffère du
DSM-IV car la CIM
10 n’a pas de liste
explicite de symptômes
spéciques, d’autres
caractéristiques, et de
règles de décision pour
émettre un avis afrmant
ou inrmant le fait qu’un
enfant a un diagnostic
particulier.

5Modèles Cliniques A.3
Manuel de la IACAPAP pour la Santé Mentale de l’Enfant et de l’Adolescent
particulier. La CIM 10 et le DSM-IV-TR dièrent aussi considérablement dans la
description des catégories diagnostiques et dans certaines catégories elles-mêmes.
Par exemple, la CIM-10 a une catégorie diagnostique pour les troubles de la rivalité
fraternelle, les troubles des conduites hyperkinétiques, et les troubles désinhibés de
l’attachement que l’on ne retrouve pas dans le DSM-IV-TR.
La CIM-10 et le DSM-IV-TR dièrent également dans leurs subdivisions de
certaines catégories diagnostiques. Par exemple, le DSM-IV-TR divise sa catégorie
du trouble décitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) en 3 types : un type
avec une inattention prédominante, un autre type à prédominance hyperactive-
impulsive, et un type mixte. En revanche dans la CIM-10, la catégorie la plus proche
de TDAH est le trouble hyperkinétique, qui n’est pas subdivisé en type comme
dans le DSM-IV-TR. Par contre, la CIM-10 subdivise les troubles des conduites
en trois : troubles des conduites limitées à l’environnement familial, troubles de
conduite sans socialisation, et troubles des conduites socialisées. Bien que l’annexe
H du DSM-IV-TR liste les numéros de code la CIM-10 correspondant à beaucoup
de catégories diagnostiques du DSM, les praticiens ne doivent pour autant pas
attendre beaucoup d’accord entre les diagnostics du DSM et les diagnostics de la
CIM faits pour les mêmes enfants, et cela même lorsque les diagnostics du DSM
et de la CIM ont les mêmes numéros de code.
CLASSIFICATION DIAGNOSTIQUE POUR
L’ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE
La classication diagnostique de la santé mentale et des troubles du
développement de l’enfance et de la petite enfance (DC: 0-3) a été publié pour la
première fois en 1994, suivie par une édition révisée (DC: 0-3R) en 2005 (zéro
à trois, 1994, 2005). L’un des objectifs clés était de répondre «à l’échec du
système DSM à traiter de façon large (1) des syndromes de la petite enfance qui
nécessitent une attention clinique ou (2) un examen précis des caractéristiques
développementales des troubles précoces » (Zero to ree, 2005, p4). Comme
le DSM et la CIM, la DC: 0-3 a été développé par des experts qui ont déni des
catégories et critères diagnostics.
Les axes DC : 0-3 R
Le DC: 0-3R comprend les cinq axes suivants:
I. troubles cliniques
II. classication des relations
III. troubles du développement et les conditions médicales
IV. facteurs de stress psychosociaux
V. fonctionnement émotionnel et social.
Certains des troubles cliniques de l’Axe I, tels que l’état de stress post-
traumatique, le trouble anxiété de séparation, ou le trouble anxieux généralisé, ont
leurs homologues dans le DSM-IV-TR. Cependant, comme ils sont conçus pour
les âges de 0 à 3 ans, les critères du DC : 0-3R sont très diérents de ceux du DSM-
IV-TR et sont illustrés par des exemples cliniques pour les 0 à 3 ans. D’autres
troubles du DC: 0-3R n’ont pas d’homologues dans le DSM-IV-TR. On peut
citer par exemple le trouble de carence/mauvais traitements, qui « se produit dans un
Cliquez sur l’image pour
accéder au site internet
du DSM-5 qui détaille les
changements proposés
pour la classication et
leur motivation.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%