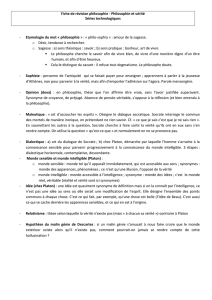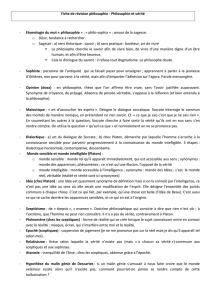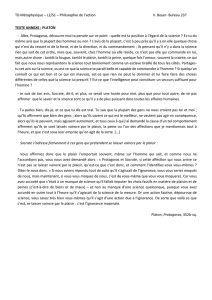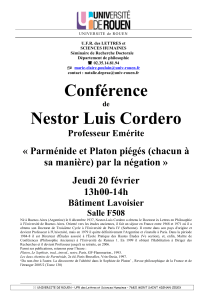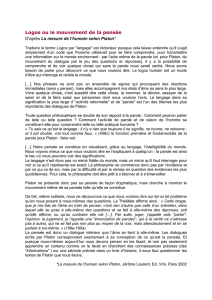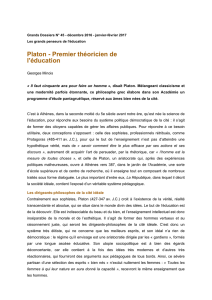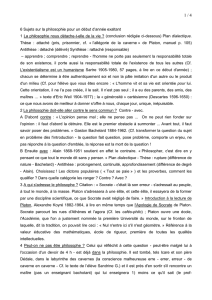La science, quel savoir pour quel pouvoir ? Par cette question, la

La science, quel savoir pour quel pouvoir ?
Par cette question, la science est vue comme un savoir qui produit des effets, a
une efficace, exerce une influence sur la nature, la société ou même l’homme
lui-même dans son histoire et son devenir.
L’idée peut même surgir que la science, contrairement à l’art ou à la religion, serait
le seul savoir à avoir une puissance véritable sur les choses naturelles ou
humaines : si nous voulons changer les choses, n’est-ce pas à la science que
nous le demandons ?
Contrairement à l’art ou à la religion, qui n’auraient qu’un pouvoir symbolique,
c’est-à-dire un pouvoir sur les idées seulement, la science seule aurait un
pouvoir matérialisé par des machines, des techniques, des transformations
physiques ou biologiques : mais si la science est le seul savoir qui permet d’agir et
de transformer matériellement et non pas symboliquement l’homme et le monde
n’est-elle pas alors toute puissante ?
L’enjeu de cette question n’est donc pas simplement de définir la science
comme un savoir ou de voir quels effets ce savoir peut engendrer sur le monde et
sur l’homme, mais d’examiner l’idée que la science est dans son essence même
un savoir qui vise un pouvoir, qu’on ne peut donc pas la limiter à un savoir
désintéressé ou inutile, mais qu’on a voulu un savoir de ce genre, un savoir qui
soit capable de donner à l’homme un pouvoir sur la nature ou sur lui-même.
Examinons, comme préalable, 3 perspectives qui font de la science un pouvoir :
I
La science serait d’abord le modèle exclusif de toute connaissance véritable :
une connaissance qui n’est pas constituée selon la méthode expérimentale qui
donne naissance à la science moderne ne vaudrait rien : en ce sens, tout
savoir aspire comme à son achèvement à devenir une science. C’est l’idéal
scientiste affirmé pour la 1ère fois par Félix Le Dantec en 1911 :
! " #
"$ %
" ! $&
'"'
($
)*+',- './..
Ce scientisme cad cette confiance absolu en une certaine manière de poser les
problèmes et de les résoudre, cette manière étant celle de la méthode

expérimentale, conduit à refuser l’idée même d’une autre forme de savoir, la
possibilité de la religion (Le Dantec publiera aussi un livre sur l’Athéisme), la fin de
la métaphysique comme somme d’énoncés absurdes et sans signification.
Mais un tel idéal est-il acceptable ? N’est-ce pas demander trop à la science et
fonder des espoirs vains sur un idéal inaccessible ? N’est-ce pas, en définitive,
méconnaître la nature de la réflexion scientifique et les limites de toute
connaissance qui se présenterait comme science ?
Car ce qui se cache derrière cette conviction c’est l’idée d’un rapport exclusif de
la science à la vérité au point que la science ne serait pas seulement la seule
forme de vraie connaissance mais elle serait la seule connaissance possible
donnant accès à la vérité.
Mais quel est ce pouvoir de vérité de la science? Et de quelle vérité est-il
question ?
On devra examiner dans cette perspective une certaine illusion ou ce qu’on
pourrait appeler plus simplement une croyance : la croyance de la science en la
vérité.
De l’idée présente dès l’antiquité d’une puissance propre à la science de
dévoiler l’essence des choses, idée présente jusqu’à l’âge classique, il faudra
reconnaître que les modernes, dès le début du XXème siècle, renonceront à
penser le savoir scientifique comme révélateur de l’essence même des
choses : ne restera alors plus qu’une confiance en un pouvoir limité mais
critique de la raison humaine.
En sera-ce pour autant fini avec cette idée de la toute-puissance de la
science ?
II
Nous retrouvons cette idée dans la conception d’un savoir qui donne un pouvoir
d’action sur le monde et sur l’homme. Francis Bacon, savant et philosophe du
17ème, pouvait proposer comme règle de la science cette courte expression :
' ($ Mais ce pouvoir n’est pas simplement celui de
connaître, c’est celui de changer le monde et l’homme selon la science :
0 0 0 "
00
0'"' 0
' "
0000"
' 0
"$(12'.3456127
Remarquons 3 choses dans ce que dit Bacon :

1) le projet d’une maîtrise du monde par l’homme donne un sens à l’existence
humaine
2) la méthode de connaissance impose de reconnaître des lois de la nature et
d’agir en respectant ses lois
3) la technique (ce que Bacon appelle « les arts ») est l’intermédiaire entre le
savoir et l’action humaine.
Bacon trace dans cette petite citation le projet qui sera celui des savants à venir :
Mais c’est chacun de ces 3 points qu’il faudra examiner si l’on veut comprendre le
genre de pouvoir qui est attendu de la science telle qu’elle est constituée à
partir du 17ème siècle et telle qu’elle s’applique jusqu’à aujourd’hui et c’est bien aussi
cette « toute puissance » de la techno-science qu’on devra interroger : quels
sont les risques inhérents à ce projet de domination de la nature ? Ces risques
ne sont peut-être pas ceux seulement que l’écologie moderne pointe du doigt,
peut-être portent-ils aussi sur le sens même de l’existence humaine : la
science peut-elle, en définitive, donner un sens, une direction à l’existence
humaine, est-ce même de son ressort ?
On retrouvera aussi cette question dans la dernière partie.
C’est d’ailleurs à partir d’une conception des risques que peut se présenter le dernier
aspect de cette toute puissance de la science :
III
La science serait un moyen de se libérer des croyances, des superstitions, elle
serait l’unique moyen d’une émancipation des peuples.
8", philosophe contemporaines, résume ainsi l’opinion que nous
venons d’identifier, dans Sciences et Pouvoirs :
*' '
"''
($9:"$
&";#!'
" <('
' ' '
' ' !"= %
"
!$> ?@9
@)
: @
1A1:'
'!=1
'"'

:$9!
' ' '
'(
$*
'
' :
$9!!
:!!"
''
B$
C $ * '
!
$(/D.5
Le ton ironique de l’auteur à la fin de ce texte doit nous avertir qu’il y a une certaine
illusion qui persiste dans cette affirmation d’une science neutre et
indépendante des enjeux sociaux :
a) Remarquons d’abord que cette idée que la science libère de
l’obscurantisme, on la trouve déjà au siècle des Lumières : c’est même
par elle que les idées d’égalité et de liberté sont davantage que de simples
espérances : la science doit répandre ses Lumières sur le monde : mais
faut-il croire en cette harmonie du monde des savants ? Ne sont-ils pas,
eux aussi, les jouets de leurs sentiments, de leurs formations
universitaires, d’intérêts économiques, financiers, idéologiques qu’ils ne
peuvent pas maîtriser ? C’est donc le pouvoir même de faire de la
science qui serait en question : quelles doivent être les conditions
sociales et politiques pour que la science soit possible ? Il faudrait voir
comment l’ordre social et politique doit permettre une neutralité
méthodologique qui est à l’origine de l’esprit scientifique.
b) Remarquons aussi, que cette illusion d’une science dégagée des enjeux
sociaux et politiques pourrait presque faire croire en une possibilité pour la
science de juger de haut, de l’extérieur, « de façon impartiale », les
enjeux de société et les enjeux politiques : mais faut-il croire que le savoir
scientifique est l’expression de la sagesse même ? La science peut-elle
dicter la conduite des hommes en se substituant à la réflexion, et pour le
dire clairement, à la philosophie ? Il faudrait alors voir que la science,
même la science politique, laisse ouvert le champ de la réflexion sur les
fins de l’action humaine : aucune science n’aurait alors le pouvoir de
dicter quelles sont les fins (buts) que les hommes doivent se donner
pour être humain car une science est un savoir qui dit ce qui est et non
pas ce qui doit être !
c) Concluons ce troisième point en disant que cette impuissance de la science
à dire ce qui doit être choisi par les hommes pour accomplir leur existence
d’être humain, a pour conséquence l’impossibilité pour la science d’être
indifférente à sa propre puissance : le savant ne peut pas renoncer à sa
responsabilité dans la connaissance qu’il produit : il n’y a plus ici un

enjeu méthodologique mais moral : si la science, pour se constituer
comme savoir objectif, doit être indépendante dans sa méthode des
enjeux moraux et politiques, doit-on accepter tous les changements,
qu’ils soient sociaux ou moraux, que ses découvertes et ses inventions
entraînent ?
Ces 3 grandes directions pour penser cette idée étrange, à bien y regarder, d’une
toute puissance de la science nous demanderont donc, pour résumer, de penser 3
choses :
I Quel pouvoir de vérité le savoir de la science possède-t-il ?
II Quel pouvoir technique le savoir de la science permet-il d’exercer ?
III Quel pouvoir social, moral ou politique le savoir de la science possède-t-il?
Nous conclurons par une définition de la science, indiquant ses conditions, ses
limites et sa finalité.
I Le pouvoir de vérité de la science
Comment définir la science et que penser de sa relation à la vérité ?
La première idée est de penser que la science est le seul savoir véritable dans la
mesure même où il fait connaître les choses telles qu’elles sont, cad les
choses dans leur vérité.
Mais qu’est-ce que connaître les choses dans leur vérité ?
1) la science comme savoir absolu
Lisons un petit texte de Platon, extrait du Livre V de la République, 476b-
476d : Socrate s’adresse à Glaucon.
E ' ' !F!
'''
'!
!!''G
$
& @ $
& ' '
' " '
'!'!"
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%