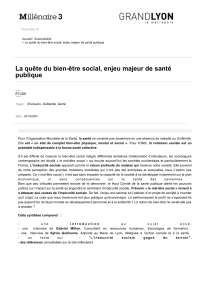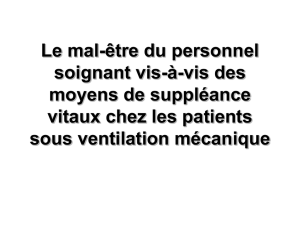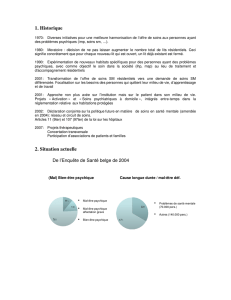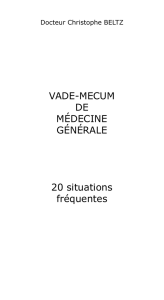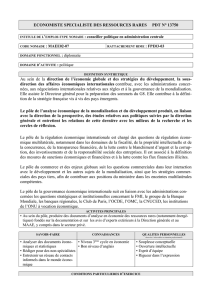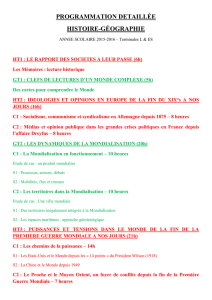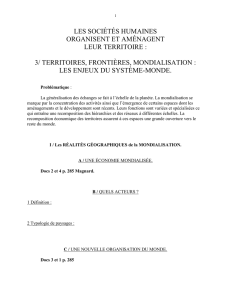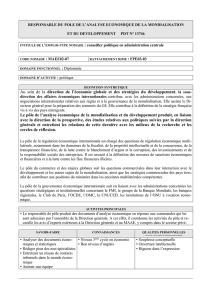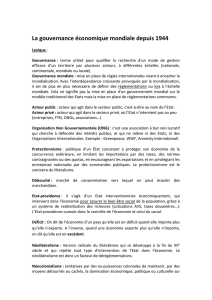Le bien-être pour tous Concepts et outils de la cohésion sociale

Le bien-être pour tous
Concepts et outils de la cohésion sociale
Tendances de la cohésion sociale, n o20
Editions du Conseil de l’Europe

Les vues exprimées dans cet ouvrage sont de la responsabilité des auteurs et ne
reflètent pas nécessairement la ligne officielle du Conseil de l’Europe.
Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être traduit,
reproduit ou transmis, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit
– électronique (CD-Rom, internet, etc.), mécanique, photocopie, enregistrement
ou de toute autre manière – sans l’autorisation préalable écrite de la Division
de l’information publique et des publications, Direction de la communication
(F-67075 Strasbourg Cedex ou [email protected]).
Couverture : Atelier de création graphique du Conseil de l’Europe
Editions du Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
http://book.coe.int
ISBN : 978-92-871-6505-3
© Conseil de l’Europe, novembre 2008
Imprimé en Belgique

3
A UTRES TITRES DANS LA MÊME COLLECTION
n o1 Promouvoir d’un point de vue comparatif le débat politique sur l’exclusion
sociale (ISBN : 978-92-871-4920-6, 8 € /12$US)
n o2 Le fi nancement des systèmes de retraite et de santé en Europe : réfor-
mes et tendances au cours des années 1990 (ISBN : 978-92-871-4921-3,
8 € /12$US)
n o3 Utiliser des aides sociales pour combattre la pauvreté et l’exclusion
sociale : examen comparatif des opportunités et des problèmes
(ISBN : 978-92-871-4937-4, 13€ /20$US)
n o4 Nouvelles demandes sociales : défis de la gouvernance
(ISBN : 978-92-871-5012-7, 19€ /29$US)
n o5 Lutte contre la pauvreté et accès aux droits sociaux dans les pays du Sud-
Caucase : une approche territoriale (ISBN : 978-92-871-5096-7, 15€ /23$US)
n o6 Etat et nouvelles responsabilités sociales dans un monde global
(ISBN : 978-92-871-5168-1, 15€ /23$US)
n o7 Société civile et nouvelles responsabilités sociales sur des bases éthiques
(ISBN : 978-92-871-5309-8, 13€ /20$US)
n o8 Les jeunes et l’exclusion dans les quartiers défavorisés : s’attaquer aux
racines de la violence (ISBN : 978-92-871-5389-0, 25€ /38$US)
n o9 Les jeunes et l’exclusion dans les quartiers défavorisés : approches poli-
tiques dans six villes d’Europe (ISBN : 978-92-871-5512-2, 15€ /23$US)
n o10 L’approche de la sécurité par la cohésion sociale : propositions pour
une nouvelle gouvernance socio-économique (ISBN : 978-92-871-5491-0,
17€ /26$US)
n o11 L’approche de la sécurité par la cohésion sociale : déconstruire la peur
(des autres) en allant au-delà des stéréotypes (ISBN : 978-92-871-5544-3,
10€ /15$US)
n o12 Engagement éthique et solidaire des citoyens dans l’économie : une res-
ponsabilité pour la cohésion sociale (ISBN : 978-92-871-5558-0, 10€ /15$US)
n o13 Le revenu de la retraite : développements récents et propositions
(ISBN : 978-92-871-5705-8, 13€ /20$US)
n o14 Les choix solidaires dans le marché : un apport vital à la cohésion sociale
(ISBN : 978-92-871-5761-4, 30€ /45$US)
n o15 Concilier fl exibilité du travail et cohésion sociale – Un défi à relever
(ISBN : 978-92-871-5813-0, 35€ /53$US)
n o16 Concilier fl exibilité du travail et cohésion sociale − Des idées pour l’action
politique (ISBN : 978-92-871-6014-0, 30€ /45$US)

4
n o17 Concilier fl exibilité du travail et cohésion sociale – Les expériences et
enjeux spécifiques de l’Europe centrale et orientale (ISBN : 978-92-871-
6151-2, 39€/59$US)
n o18 Quelle cohésion sociale dans une Europe multiculturelle ? Concepts, état
des lieux et développements (ISBN : 978-92-871-6033-1, 37€ /56$US)
n o19 Concilier bien-être des migrants et intérêt collectif – Etat social, entreprises
et citoyenneté en transformation (ISBN : 978-92-871-6285-4, 44€ /88$US)

5
S OMMAIRE
Préface.........................................................................................................9
Alexander Vladychenko
Introduction ............................................................................................11
Gilda Farrell
Partie I – Bien-être de tous et implication des citoyens :
l’approche du Conseil de l’Europe...............................15
I. Le bien-être de tous :
objectif de la cohésion sociale ......................................................15
Gilda Farrell
1. Bien-être et bien-être de tous : quelles différences?...........................16
2. Les apports du concept de bien-être de tous .....................................17
3. Une meilleure compréhension des rapports entre
bien-être subjectif et bien-être objectif..............................................25
4. Faire du bien-être de tous un levier pour améliorer la vie ensemble....27
Conclusion ..............................................................................................30
Bibliographie ...........................................................................................32
Annexe – Tableaux sur les indicateurs de bien-être en entreprise..............33
II. Définir et mesurer le bien-être et le progrès
avec les citoyens ............................................................................35
Samuel Thirion
Introduction ............................................................................................35
1. Le cadre d’analyse proposé................................................................37
2. Aborder la question du bien-être (questions épistémologiques)..........48
3. Construire la connaissance pour le progrès sociétal
avec les citoyens – Premiers résultats des expérimentations ..............55
4. Réflexions sur les éléments clés du bien-être de tous .........................64
Conclusions.............................................................................................73
Bibliographie ...........................................................................................77
Annexe – Eléments de méthode .............................................................78
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
1
/
188
100%