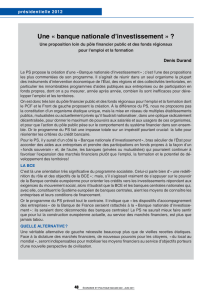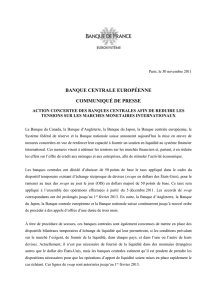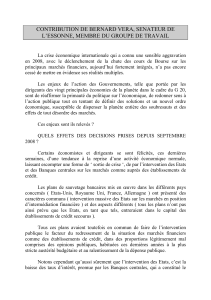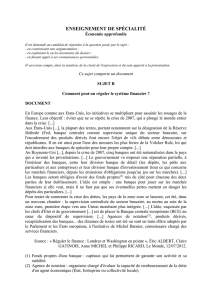Eclairages - Credit Agricole, Etudes Economiques

N°119 – Février 2008 1
Eclairages
L
es articles qui suivent offrent un éclairage sur
le déroulé de cette crise atypique, sur ses ef-
fets de contagion avérés ou potentiels et sur les
tentatives de réponses qui ont été apportées.
À l’origine, une base déséquilibrée
et donc fragile
La crise des
subprime
a un effet d’amplification, à
proportion de la situation de fragilité qu’avait dé-
veloppée l’économie mondiale, une fragilité mas-
quée par ses succès : libéralisation des marchés
financiers et intégration globale des économies, y
compris des nations émergentes asiatiques, le
tout sur fond de croissance forte et de désinfla-
tion. Mais,
toute médaille a son revers et crois-
sance mondiale forte a rimé avec déséquilibres
financiers croissants,
déficits jumeaux améri-
cains, gonflement de l’endettement des ménages
et des prix immobiliers, recherche de rendement
des investisseurs alimentant effets de levier et
comportements spéculatifs.
Un vecteur commun à l’ensemble de ces désé-
quilibres semble identifié, sous la forme de taux
d’intérêt excessivement bas, synonyme de crédit
bon marché et carburant d’une liquidité mon-
diale abondante.
Les banques centrales sont ainsi
incriminées pour avoir suivi scrupuleusement
leur mandat d’ancrage nominal dans un régime
d’inflation basse et stable. Elles ont ainsi mainte-
nu des conditions monétaires trop souples, pen-
dant trop longtemps, surtout après l’éclatement
de la bulle internet. Cette profusion de liquidités
(née aussi de l’excès d’épargne de pays émer-
gents en plein essor comme la Chine), associée à
une crédibilité renforcée des banques centrales,
est également responsable du niveau anormale-
ment bas des taux longs. C’est ce qu’Alan
Greenspan a en son temps qualifié d’énigme (le
célèbre
conundrum
). Cette situation a stimulé, en
retour, l’endettement et la prise de risque pour
nourrir toujours plus de rentabilité. La liquidité
s’est aussi déversée sur les autres marchés d’actifs
en en faisant grimper les prix : hausse des bour-
ses et compression historique des primes de ris-
que sur les obligations privées et émergentes.
Une marchéisation à grande échelle
de crédits risqués
En parallèle à cette logique d’ensemble, et sans
doute en relation avec elle, s’est développée une
série d’innovations financières.
Le modèle de
base est celui du triplet origination-structuration-
Direction des Études Économiques
Eclairages
Mensuel - N°119
Février 2008
Crise financière, six mois après l’éclatement 1
Déroulé de la crise 3
Gestion de la crise par le gouvernement américain 5
Gestion de la liquidité par les banques centrales 7
Encadré - Credit crunch : les raisons du danger 10
Gestion de la crise par les banques 11
La première grande crise financière du XXI
e
siècle
Crise financière, six mois après l’éclatement
2007 va entrer dans l’histoire avec le mot
subprime
, que l’on pourra facilement coller au mot sur-
prise. Quelques mois seulement avant la crise, les marchés pariaient encore sur une croissance mon-
diale forte. Le prix du risque, excessivement bas à l’époque, était censé remonter un peu, sans que
toutefois il soit possible d’en préciser l’origine. L’histoire en a décidé autrement, puisque le retourne-
ment de la conjoncture financière a été précoce et surtout plus brutal que prévu.

N°119 – Février 2008
2
Eclairages
1.
Taux d’appel hors condi-
tions de marchés, révisables
après une période de grâce,
différés de paiement du prin-
cipal et/ou un mix des deux.
2.
Asset backed Commercial
Paper
, soit des émissions de
billets de trésorerie garantis
par des actifs de toutes natu-
res (créances commerciales,
crédits immobiliers résiden-
tiels…).
distribution. Un opérateur bancaire ou financier
origine le crédit puis le cède, ce qui lui permet
de poursuivre ses opérations, avec une base en
fonds propres faible.
En théorie, cette marchéisa-
tion des crédits est censée améliorer l’efficience
du système financier dans son ensemble, en per-
mettant une meilleure dissémination du risque.
En pratique, ce découplage entre l’originateur
du crédit et le porteur final du risque réduit l’in-
citation à l’évaluation et au suivi (
monitoring
)
des risques.
La quantité de crédits distribués aug-
mente, et leur qualité moyenne se dégrade, tan-
dis que les fonds propres bancaires censés les
garantir sont réduits.
La crise du
subprime
est l’illustration exemplaire
de cette marchéisation à grande échelle de cré-
dits risqués.
Au moment du boom immobilier, la
croyance communément partagée que les prix ne
pouvaient que monter a poussé les acteurs finan-
ciers à faire la course aux parts de marchés, en
étendant l’offre de crédits à des ménages de plus
en plus fragiles. Pour solvabiliser ces clientèles
risquées, les critères d’octroi de prêts ont été ex-
cessivement relâchés, avec le développement de
crédits dits « exotiques »
1
. Ensuite et très schéma-
tiquement, ces
pools
de crédits constitués à partir
de sous-jacents précaires, ont été coupés en tran-
ches et logés, parfois au côté d’actifs de meilleure
facture, dans des structures hors bilan des ban-
ques, l’ensemble étant financé par l’émission de
papiers courts. L’accélération de ce processus a
été considérable, puisqu’on a vu très rapidement
naître un marché, celui des ABCP
2
, de plus de
1 200 milliards USD.
Des canaux de transmission nouveaux,
une contagion à multiples facettes…
Lorsque le marché immobilier américain a fini
par se retourner, les défauts sur ces cohortes de
crédits risqués se sont envolés, notamment pour
les derniers prêts accordés. Ils ont contaminé les
différentes tranches de titrisation, avec en corol-
laire un effondrement de leur prix. Les structures
n’ont pu alors refinancer le papier arrivant à
échéance.
Les lignes de crédit contingentes des
banques ont dû être activées, concourant à une
explosion soudaine de la demande de liquidité,
alors même que le marché monétaire entrait en
phase de paralysie. C’est le point de départ de la
crise de liquidité qui s’est enclenchée le 9 août.
Les banques centrales n’ont alors eu d’autres choix
que d’assurer, coûte que coûte, cette liquidité, en
menant des interventions de prêteurs en dernier
ressort exceptionnelles par leur montant, leur ma-
turité et l’étendue des collatéraux acceptés.
Mais, rapidement, le mouvement de défiance à
l’égard de la finance titrisée s’est généralisé. Le
doute s’est installé quant à la capacité des ban-
ques à faire face à des pertes encore inconnues.
Pour faire renaître la confiance, on a alors appe-
lé à davantage de transparence.
De ce point de
vue, les banques ont déjà fait un gros travail, en
dépréciant un large montant de leurs actifs non
performants (près de 100 mds USD), en même
temps qu’elles « réintermédiaient » à marche for-
cée une part de leurs actifs, logés hors bilan.
Et pourtant la confiance n’est pas encore revenue
du fait notamment de la dynamique destructrice
qu’implique la valorisation des actifs au prix de
marché (
mark to market
). Il s’ensuit un effet de
procyclicité et de volatilité que l’arrivée en force
des fonds souverains est censée calmer. Aujour-
d’hui, la crise déborde le cadre pur et simple du
subprime
.
A mesure que le temps passe, la ques-
tion de la transmission du choc financier à l’éco-
nomie réelle se pose avec plus d’acuité, faisant
resurgir le spectre du
credit crunch
et de la réces-
sion mondiale. Les marchés se demandent si d’au-
tres segments de crédits, déjà fragilisés (le
consu-
mer
finance en général) ne risquent pas à leur tour
de déraper. L’inquiétude porte également sur les
stratégies de couvertures,
via
les CDS et les assu-
reurs
monoline
, ces assureurs qui garantissaient la
qualité des actifs et des montages. De quoi se
faire très peur et nourrir les scénarios les plus
noirs…
Les réponses (baisses de taux, injections massi-
ves de liquidité, interventions supplémentaires
de fonds souverains) ou tentatives de réponses
(Mlec ou le Superfonds européen) n’ont pas suffi-
samment convaincu pour ancrer les anticipations
autour de l’idée que la sortie de crise était pro-
che. Il faudra donc compter sur la prise de cons-
cience et la réactivité des banques centrales et
des gouvernements, pour éviter de nouvelles dé-
gradations.
L’idée d’une structure de
defeasance
à large échelle fait progressivement son chemin,
à l’image de la RTC (
Resolution Trust Corpora-
tion
) qui en son temps avait réglé, dans la durée,
une phase de surinvestissement immobilier…
aux Etats-Unis… En son temps : il y a moins de
vingt ans, au siècle passé.
Jean-Paul BETBÈZE
01 43 23 45 12
jean-paul.betbeze@credit-agricole-sa.fr
Isabelle JOB
01 43 23 69 32
isabelle.job@credit-agricole-sa.fr

N°119 – Février 2008 3
Eclairages
Déroulé de la crise
D
ès 2005, les signes d’un ralentissement voire d’un retournement de l’activité sont perceptibles
dans le secteur immobilier. La détérioration de la situation devient patente à partir de février
2007 : accentuation des défauts sur les prêts hypothécaires
subprime
, craintes des marchés résultant de
la dégradation de la qualité du crédit et de la potentielle sous-estimation du risque. Baisse des prix et
remontée des taux d’intérêt font plonger dans l’insolvabilité nombres d’emprunteurs, une proportion
élevée de ces ménages à risques ayant opté pour des emprunts à taux variables. Or, une part non négli-
geable de ces prêts hypothécaires risqués (les célèbres « subprime ») a été cédée sur le marché. La titri-
sation et les techniques de rehaussement de crédit,
via
la structuration des produits et l’émission de
titres adossés aux actifs sous-jacents, ont normalement vocation à transférer le risque à des investisseurs
tiers. En juillet, le taux de défaut sur ces prêts
subprime
atteint des niveaux élevés, les tranches les
moins risquées et les mieux notées de ces actifs sont contaminées. La valorisation de certains fonds
s’en trouve affectée, l’absence de contreparties acheteuses empêche le calcul des valeurs liquidatives.
Cet épisode constitue le point de départ de la vague de défiance, de rétention de liquidité et de diffi-
cultés des « bancaires » qui caractérise cette crise d’un genre nouveau.
Phase 1 : Vague de déclassements d’actifs, premières difficultés de fonds et d’établissements financiers
Juin 2007
• Deux fonds spéculatifs gérés par Bear Stearns ayant investi dans des titres adossés à des prêts
subprime seraient sur le point d’être fermés.
• L’un de ces fonds est renfloué par une injection de 3,2 milliards USD de prêts.
Juillet 2007
• Les agences de notations Moody’s et Standards & Poor’s mettent sous surveillance et déclassent
nombre de titres adossés à des crédits hypothécaires.
• La valeur des deux fonds de Bear Sterns massivement investis dans les prêts immobiliers à risque
s’effondre.
• Démission du directeur général d’UBS suite aux récentes déconvenues (fermeture en mai d’un hedge
fund spécialisé dans les créances hypothécaires à risque).
• Aux États-Unis, l’organisme de prêts au logement Countrywide Financial Corp. et le premier
constructeur de logements DR Horton annoncent respectivement une chute des bénéfices et une perte
au 2e trimestre 2007.
• La banque allemande IKB lance un avertissement sur ses résultats en raison de craintes sur l’impact
potentiel de la crise des crédits immobiliers.
•
L’American Home Mortgage Investment Corp.
annonce son incapacité à financer ses obligations de prêt.
Phase 2 : Aggravation des difficultés, premières mesures et premier soutien
Août 2007
• La mise en évidence de nouvelles pertes par IKB entraîne la constitution d’un fonds de secours de
3,5 milliards € par son principal actionnaire, KfW, et un groupe de banques publiques et privées.
La première banque australienne d’investissement Macquarie, indique que de lourdes pertes pourraient
être enregistrées sur deux de ses fonds.
• Oddo ferme trois de ses fonds affectés par la crise du subprime.
• BNP Paribas gèle trois fonds de placement adossés à des créances immobilières (impossibilité de
procéder à une évaluation appropriée).
• L’American Home Mortgage Investment Corp. demande à bénéficier du chapitre 11 de la loi sur les
faillites, l’une de ses structures d’émission est amenée à rallonger l’échéance sur l’encours de papier
commercial adossé à des actifs.
• Les fonds gelés de BNP Paribas sont réouverts.
• Les principales banques centrales injectent massivement des fonds sur les marchés monétaires : 94,8
puis 61 et 48 milliards d’euros pour la BCE, 24, puis 35 et 2 milliards de dollars pour la Fed,
participation aussi de la BoE.
• La Fed abaisse son taux d’escompte de 50 pb à 5,75%, annonce que le financement à terme sera fourni
jusqu’à trente jours et injecte 6 milliards de dollars supplémentaires.
• Les banques centrales poursuivent leurs injections dans le circuit.
Septembre
2007
• La Banque d’Angleterre fournit un soutien financier d’urgence à la banque spécialisée dans le crédit
hypothécaire, Northern Rock, ce qui accentue les inquiétudes des déposants qui retirent 3 milliards £
au cours du week-end.
• HSBC ferme sa filiale de crédits immobiliers à risque.
• La BCE maintient inchangé son taux directeur mais procède à des opérations de fine tuning à 1 jour et
de refinancement à 3 mois. La Fed abaisse de 50 pb le taux des Federal funds, le portant à 4,75%, et
assortit ce geste d’une même diminution du taux d’escompte (désormais à 5,25%).

N°119 – Février 2008
4
Eclairages
Phase 3 : Des stress plus sévères, des pertes en hausse, des démissions et des actions
volontaristes des banques centrales
Octobre
2007
• Avalanche de mauvais résultats pour le troisième trimestre : ceux de Deutsche Bank sont affectés
par la crise, Merrill Lynch affiche une perte et son PDG démissionne.
• Aux Etats-Unis, un projet de super fonds de sauvetage constitué par les banques sur demande du
gouvernement est proposé, parallèlement à l’élaboration du plan « Hope Now » consistant
essentiellement à geler les renégociations des taux des prêts subprime émis au cours des deux
dernières années.
Novembre
2007
• Poursuite des mauvaises nouvelles : Merrill Lynch aurait eu recours à des fonds spéculatifs pour
masquer des pertes, Citigroup enregistre de lourdes dépréciations d’actifs (8 milliards de dollars),
son patron démissionne à son tour.
• La BCE maintient son taux directeur à 4%, la Fed assouplit les règles pour les teneurs de marché
(ils peuvent davantage emprunter auprès de son guichet).
Décembre
2007
• Bear Stearns enregistre la première perte nette de son histoire, les profits de Morgan Stanley
reculent de 57% en 2007 et le fonds souverain chinois CIC entre pour 9,9% dans le capital du
groupe. Citigroup intègre dans son bilan un montant substantiel d’actifs dépréciés. Après UBS, un
fonds de Singapour qui entre dans Merrill Lynch.
• En début de mois, les grandes banques centrales mènent une action concertée et injectent
64 milliards de dollars sur le marché. Devant le succès relatif de l’opération, la BCE ne modifie pas
son taux mais injecte des liquidités de manière illimitée afin de contenir les tensions sur le marché
monétaire (348,6 milliards d’euros au taux de 4,21%). La Banque du Canada diminue son taux
directeur de 25 pb à 4,25% (fin d’un cycle de resserrement monétaire initié trois ans plus tôt),
la Banque d’Angleterre fait de même et porte son taux à 5,5%, la Fed baisse ses taux de 25pb
à 4,25% afin de contrer les risques sur la croissance. Elle procède à deux adjudications à 1 mois
de 20 milliards de dollars chacune, accepte une palette élargie de collatéraux en garantie et
un allongement des maturités offertes.
• Abandon du projet de super fonds qui devait permettre aux banques de racheter leurs titres placés
dans des SIV.
• Au total, les fonds souverains (organismes d’État, généralement véhicules publics d’investissement
des excédents de pays émergents) ont injecté 35 milliards de dollars dans la finance mondiale.
Olivier BIZIMANA
01 43 23 24 13
olivier.bizimana@credit-agricole-sa.fr
Florence TOUYA
01 57 72 41 45
florence.touya@credit-agricole-sa.fr
Phase 4 : Des banques centrales bienveillantes face au risque de contagion à d’autres secteurs
d’activité et à l’économie
Janvier
2008
• Après UBS, Merrill Lynch et Citigroup, démission du PDG de Bear Stearns.
• En raison du ralentissement de la croissance et de la dégradation de la qualité du crédit,
American Express annonce une charge exceptionnelle.
• La première banque de détail américaine, Bank of America, rachète l’émetteur de crédit immobilier,
Countrywide Financial, lourdement victime de la crise.
• Pertes substantielles pour Merrill Lynch et Citigroup, d’environ 10 milliards de dollars chacune,
au 4e trimestre 2007 (au cours duquel les deux groupes enregistrent des dépréciations respectives
de 18,1 et 14,3 milliards de dollars). Si Citigroup parvient à rester excédentaire sur l’exercice,
Merrill Lynch perd 7,8 milliards de dollars sur l’année.
• Inquiétude sur les assureurs Monoline. Mini krach boursier du 21 janvier.
• La BCE régule les montants de liquidité mis sur le marché.
• Lancement d’une opération allouant 10 milliards de dollars sur 28 jours aux banques européennes,
dans le cadre d’un accord de swap avec la Fed.
• La première réunion de la BCE pour 2008 s’est soldée par un nouveau statu quo.
• Le gouvernement Bush annonce un plan de relance budgétaire, dont le montant devrait se situer
aux alentours de 150 milliards de dollars.
• 75 pb de baisse des taux de la Fed, le 22 janvier, en inter-meeting pour stopper la panique
boursière.

N°119 – Février 2008 5
Eclairages
F
ace à la crise immobilière, financière et au
risque élevé de récession, le gouvernement
américain ne peut rester sans rien faire pour des
raisons politiques évidentes : les élections prési-
dentielles sont en novembre. Or, sur le plan éco-
nomique, il frôle l’impuissance : la faisabilité de
certaines des mesures ciblant le marché immobi-
lier pose question, ainsi que l’efficacité d’une
relance keynésienne face à une crise financière.
Chaque mesure, prise isolément, ne suffira pas à
sortir l’économie américaine de l’ornière. C’est
leur addition qui pourrait faire la différence, en
liaison avec l’action monétaire.
Cible n°1 : le marché immobilier
Pourquoi ?
Selon les estimations de la
Mortgage Bankers
Association
, jusqu’à 1,4 million de logements
pourraient être saisis en 2008 suite au défaut du
propriétaire sur son prêt immobilier. Réduire ce
nombre répond à un impératif social et économi-
que.
Il s’agit de briser le cercle vicieux selon
lequel l’accroissement induit de l’offre de loge-
ments renforce les pressions baissières sur les
prix, exacerbant en retour le risque de défaut et
de saisie.
L’ampleur des pertes essuyées par le
système financier pourrait ainsi être limitée et
l’impact de la récession immobilière sur l’ensem-
ble de l’économie amorti.
Comment : en facilitant la révision des prêts
subprime
(
Hope Now
)
Une approche au cas par cas devenant impossi-
ble, l’administration Bush propose de rationaliser,
systématiser et accélérer l’identification des bons
candidats
subprime
éligibles à une modification
de leur contrat de prêt. Il s’agit d’éviter leur dé-
faut au moment du
reset
(c’est-à-dire du passage à
taux variable au bout de 2 ou 3 ans)
1
. L’alliance
Hope Now
a été formée dans ce but en octobre
2007. Elle rassemble des acteurs du marché hy-
pothécaire, des associations d’aide aux familles et
des investisseurs.
Les critères d’éligibilité, dévoilés début décem-
bre, sont stricts.
Ceux qui peuvent honorer leurs
mensualités après le
reset
aux conditions existan-
tes sont exclus, ainsi que ceux qui ne peuvent pas
honorer leurs mensualités, même au taux initial
(
teaser rate
). Les bénéficiaires potentiels sont donc
ceux qui ne peuvent honorer leurs mensualités
après le
reset
mais le pourraient sous des condi-
tions plus favorables. La solution pour cette caté-
gorie intermédiaire est donc un refinancement ou
un gel des taux au niveau du
teaser rate
pendant
cinq ans.
Les modifications de contrat sont faites sur la base
du volontariat. Il est en effet moins coûteux de
revoir les termes du prêt, afin d’éviter le défaut et
donc la perte, que de procéder à la saisie du bien.
Selon les estimations, entre 10 et 20 % seulement
des Américains avec un prêt
subprime
à taux va-
riable pourraient bénéficier du plan. Ceci repré-
sente entre 200 et 400 000 emprunteurs sur 1,8
million d’Américains exposés à un
reset
de leur
prêt
subprime
en 2008 et 2009.
Comment : en facilitant le refinancement des
prêts
subprime
et en accroissant l’offre de crédit
L’administration Bush soutient depuis août 2007
un projet de modernisation de la
Federal Housing
Administration
(FHA)
2
pour accroître son offre de
prêts, grâce à une baisse de l’apport personnel et
une hausse des montants prêtés
3
. Environ 200 000
familles pourraient être ainsi aidées. Le pro-
gramme
FHASecure
, lancé à l’automne 2007,
donne à la FHA plus de flexibilité pour prêter à
des ménages actuellement en défaut de paiement
lorsqu’il s’agit pour eux d’une première fois.
240 000 familles supplémentaires pourraient ainsi
éviter la saisie. Plusieurs projets de lois circulent
aussi en faveur d’un rôle accru de Fannie Mae et
Freddie Mac dans le financement de la clientèle
subprime
et d’une augmentation du montant maxi-
mal des prêts qu’elles achètent et titrisent (417 000
dollars actuellement). Mais il y a une grande résis-
tance du régulateur à accorder plus de poids en-
core à ces deux institutions, avec en toile de fond
un risque systémique.
Comment : réouvrir la piste RTC ?
La création d’un équivalent à la
Resolution Trust
Corporation
(RTC) pourrait être une solution
efficace à la crise financière actuelle. En 1989, à
l’époque de la crise des
Savings and Loans
, la
RTC avait été chargée de vendre les actifs des
caisses d’épargne en faillite. Aujourd’hui,
via
l’agence, l’Etat se porterait acquéreur des prêts
Gestion de la crise par le gouvernement américain
L’interventionnisme du gouvernement américain, couplé à celui de la Réserve fédérale, évitera-t-il
la récession à l’économie américaine ? Difficile à dire. Ce ne sera pas faute d’avoir essayé, d’abord
en ciblant le marché immobilier et une réduction du nombre de saisies, ensuite en visant plus large,
avec une relance budgétaire pour doper à court terme la croissance.
1.
Par ailleurs, en cas d’aban-
don de créances sur la rési-
dence principale, le montant
ainsi économisé n’est plus
considéré comme un revenu
imposable : ce qui est donné
d’une main n’est plus repris
de l’autre (
Mortgage Forgive-
ness Debt Relief Act of 2007,
ratifié en décembre).
2.
La Chambre des Représen-
tants et le Sénat ont chacun
voté leur propre projet de
loi ; reste à se mettre d’ac-
cord sur une version com-
mune.
3.
La FHA fournit des garan-
ties gouvernementales sur
des prêts immobiliers accor-
dés à une clientèle à bas
revenus. La garantie permet à
l’emprunteur de payer moins
cher l’assurance et donc de
contracter un prêt à un taux
d’intérêt proche de celui d’un
prêt
prime
. Par rapport à un
prêt
subprime
, cela peut
abaisser le taux d’intérêt de
2 points de pourcentage ou
plus.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%