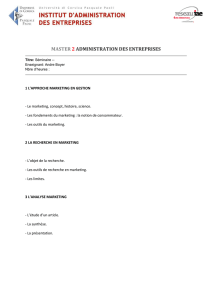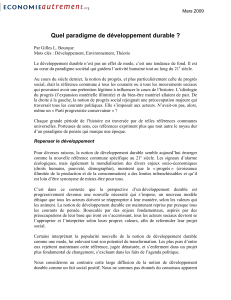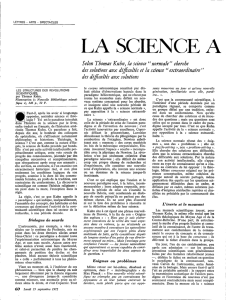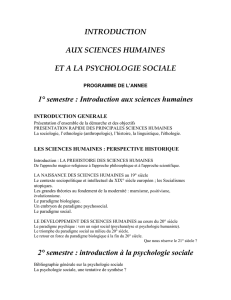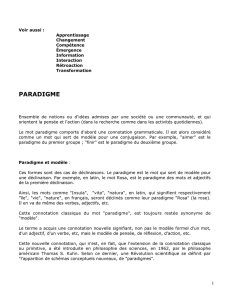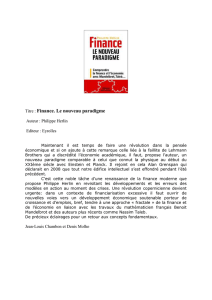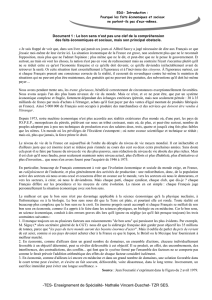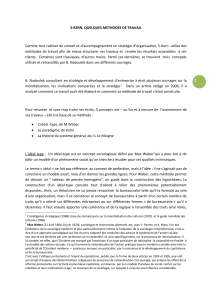L`idée de jeu peut-elle prétendre au titre de paradigme de la science

1
L'IDÉE DE JEU PEUT-ELLE PRÉTENDRE AU TITRE DE
PARADIGME DE LA SCIENCE JURIDIQUE ?
par
François OST et Michel van de KERCHOVE
Facultés universitaires Saint-Louis
http://www.legaltheory.net/
(paru dans Revue Interdisciplinaire d’études juridiques, n° 30, 1993, p 191-216)
Introduction
Entamés il y a une bonne vingtaine d'années, nos travaux en théorie du droit ont
progressivement adopté la forme d'une théorie ludique du droit. Il ne s'agit, en
l'occurrence, ni d'une théorie anthropologico-littéraire relative aux multiples aspects
théâtraux de la pratique du droit, ni d'une théorie économico-stratégique relative à la
prise de décision dans des contextes d'incertitude sur le modèle de la "théorie des jeux".
La définition du jeu que nous privilégions - "mouvement dans un cadre" - entend, en effet,
s'appliquer à toute espèce de jeux (jeux sportifs, jeux de l'esprit, jeux solitaires, jeux de
compétition, jeux de hasard, de représentation, jeux mécaniques, jeux de la nature…),
ainsi qu'à leurs multiples aspects (stratégie et représentation, coopération et conflit,
réalité et fiction, régulation et indétermination, internalité et externalité,…). De sorte que
l'objectif théorique poursuivi s'avère extrêmement ambitieux : s'il est vrai que le
"mouvement dans un cadre" n'est autre que l'écart qui permet la transformation, la case
vide, dans une combinatoire donnée, qui autorise la poursuite du mouvement (y compris
le mouvement qui affecte le cadre de la combinatoire lui-même), alors il apparaît qu'avec
le modèle du jeu s'annonce une méthode dialectique. Cette théorie dialectique entend
fournir une représentation cohérente tant du phénomène juridique lui-même que de
l'épistémologie de sa science et de l'éthique de sa mise en oeuvre. Sur chacun de ces
plans, la pluralité est substituée à l'unité, la récursivité prend la place de la linéarité, la
gradualité est préférée à la binarité, tandis que l'incertitude (qui ne signifie pas pour
autant l'aléa complet), adaptée à la complexité des temps présents, est assumée en lieu et
place de la pseudo-sécurité que croient garantir les pensées de la simplicité.
En 1992, nous avons publié, sous le titre Le droit ou les paradoxes du jeu1, un
ouvrage synthétisant cette perspective qu'annonçaient de nombreux travaux antérieurs2. La
1. Paris, P.U.F., 1992, 268 p.
2. Sur l'évolution progressive de nos études dans le sens de l'élaboration d'une théorie ludique du droit,
cf. Le droit ou les paradoxes du jeu, op. cit., p. 50-59.

2
même année paraissaient, sous le titre Le jeu : un paradigme pour le droit3, les Actes
d'un colloque que nous avions organisé sur ce thème, les 4 et 5 juin 1991, en
collaboration avec la Revue Droit et Société et l'Institut des Hautes Études sur le Justice
(Paris). C'est la thèse évoquée dans le titre de cet ouvrage : "le jeu : un paradigme pour
le droit" que nous voudrions interroger ici. Il s'agira, dans un premier temps, de rappeler
le, ou plutôt les sens exacts du terme "paradigme" dans la pensée de Th. Kuhn. Nous
pourrons ensuite, dans une deuxième section, examiner dans quelle mesure l'idée de jeu
sur laquelle fonder une théorie ludique du droit répond aux spécifications du concept de
paradigme. Nous nous attacherons enfin, dans une troisième section, à confronter le
paradigme ludique (si tant est qu'une telle qualification résulte de nos analyses
antérieures) à quelques autres paradigmes qui s'affrontent dans le domaine des sciences
de l'homme et de la société ; la mise en lumière de ces rapports de proximité et/ou de
rivalité devrait également contribuer à une meilleure intelligence du paradigme ludique.
Section 1. Le concept de paradigme dans la pensée de Th. Kuhn.
Il n'est pas aisé - la chose est bien connue - d'assigner un sens précis au concept de
paradigme tel qu'il apparaît dans l'oeuvre de Th. Kuhn. Un critique attentif, non désavoué
par l'auteur, a dénombré non moins de vingt-deux usages distincts du terme4. Kuhn lui-
même concède que, si son ouvrage La structure des révolutions scientifiques devait être
accompagné d'un index thématique, l'entrée "paradigme" devrait être suivie de la
mention : "pp. 1-172, passim" : autant dire que le concept informe l'ensemble de l'oeuvre
et y prend, inévitablement, des connotations diverses. Il reste que Kuhn croit néanmoins
pouvoir ramener à deux sens principaux les multiples usages de son concept de
paradigme. Nous y reviendrons.
Auparavant, on voudrait expliquer la fonction du paradigme en le replaçant dans le
contexte général de la thèse de Kuhn. Celui-ci entend livrer une théorie des révolutions
scientifiques qui, à certains moments, affectent la marche de la science normale, avant
qu'elle retrouve un nouvel équilibre. L'enjeu de ces mutations n'est autre que le combat en
vue du maintien de l'ancien paradigme ou de l'adoption d'un nouveau, si tant est qu'une
science ne peut produire de résultats satisfaisants qu'autant que le groupe scientifique
concerné s'accorde sur un cadre théorique commun (nous disons provisoirement "cadre
théorique", bien que, on le verra bientôt, le paradigme est une notion plus large que celle
3. Paris, L.G.D.J., 1992, 300 p. L'ouvrage regroupe treize contributions.
4. Th. KUHN, La structure des révolutions scientifiques, Paris, 1972, p. 215 (Il s'agit de la traduction
de la nouvelle édition augmentée de 1970). Dans la suite, nous citerons cet ouvrage directement
dans le cours du texte à l'aide de la mention SRS, p.

3
de "cadre théorique"). Ce cadre théorique - le paradigme - détermine une tradition de
recherche en fournissant aux scientifiques les hypothèses de travail et les méthodes
nécessaires pour procéder à l'exploration systématique du domaine que couvre, au moins
présomptivement, ce cadre. L'attachement obstiné à celui-ci permet, en période
"normale", la résolution systématique des énigmes (puzzles) qui s'y présentent, ainsi que
l'accumulation d'un savoir cumulatif considérable, au moins dans une direction
déterminée. Paradoxalement, c'est aussi cette fidélité au paradigme qui prépare la voie à
son dépassement (SRS, p. 86). En effet, seul l'attachement à un corps fixe d'hypothèses et
de méthodes permettra de faire surgir, un jour ou l'autre, des "anomalies", qui, si elles
viennent à se répéter sans trouver de solution, ouvriront une période de "crise"
caractéristique de la science "extraordinaire" au cours de laquelle la communauté
procède à la recherche, dispersée et fiévreuse, d'un paradigme plus satisfaisant. On peut
donc dire que le paradigme ancien, fécond dans un premier temps, devient - dans le
langage de G. Bachelard - un "obstacle épistémologique"5 qu'il s'agira de surmonter et de
dépasser dans un deuxième temps.
Le contexte général de la démonstration étant maintenant fixé, nous pouvons revenir
aux sens qui s'attachent au concept de paradigme. Kuhn, disions-nous, croit pouvoir les
ramener à deux (SRS, p. 207)6.
Le premier sens viserait : "tout ce à quoi adhère un groupe scientifique" (TE,
p. 392), ou encore : "l'ensemble des croyances, de valeurs reconnues et de techniques qui
sont communes aux membres d'un groupe donné" (SRS, p. 207). A cet ensemble, Kuhn
donne le nom de "matrice disciplinaire" (SRS, p. 215 ; TE, p. 396).
Quant au second sens, il viserait : "un sous-ensemble du premier" (TE, p. 392), "les
solutions d'énigmes concrètes qui, employées comme modèles ou exemples, peuvent
remplacer les règles explicites en tant que bases de solutions pour les énigmes qui
subsistent dans la science normale" (SRS, p. 207). A ce sous-ensemble, Kuhn donne le
nom d'"exemple commun" (SRS, p. 221) ou d'"exemplaire" (TE, p. 397).
On peut penser néanmoins que cette distinction entre "matrice disciplinaire" et
"exemplaire" ne fait pas suffisamment justice à la richesse des analyses de Kuhn, et qu'il
convient d'en élaborer une seconde qui n'apparaît pas très explicitement sous sa plume,
5. G. BACHELARD, La formation de l'esprit scientifique, Paris, 1977, chap. 1 : "La notion d'obstacle
épistémologique".
6. Voyez aussi Th. KUHN, La tension essentielle. Tradition et changement dans les sciences, trad. de
l'anglais par M. Biezunski, P. Jacobs, A. Lyotard-May et G. Voyat, Paris, 1990 (l'édition anglaise
remonte à 1977),p. 392. Dans la suite, nous citerons cet ouvrage directement dans le cours du texte à
l'aide de la mention : TE, p.

4
notamment parce qu'elle croise partiellement la première. Il s'agirait, selon nous, de
distinguer encore un sens sociologique du paradigme, relatif à sa genèse et sa fonction (en
tant que matrice disciplinaire et exemple commun), et un sens cognitif ou méthodologique
relatif cette fois à son contenu (en tant que matrice disciplinaire et exemple commun).
Au sens sociologique, est paradigme ce qui est accepté par un groupe donné (Kuhn
parle parfois de "communauté") de chercheurs, le groupe scientifique étant défini par
référence aux personnes qui pratiquent une certaine spécialité scientifique (ou un secteur
particulier de cette discipline) (SRS, p. 209). Les critères d'appartenance au groupe ainsi
défini tiennent notamment au fait que ces personnes ont bénéficié d'une formation
professionnelle comparable, ont assimilé la même littérature et en ont tiré les mêmes
leçons, appartiennent à des sociétés savantes et sont abonnés aux mêmes périodiques
scientifiques. De cela se dégage une "relative unanimité" de jugement en matière
professionnelle (TE, p. 394), voire même une activité de recherche "hautement
convergente", fermement fondée sur "un solide consensus" (TE, p. 307). Ce consensus
repose sur une familiarité partagée avec le domaine de recherche concerné, induite par
un apprentissage de terrain, une formation "par l'exemple" (SRS, p. 226) : d'où l'utilité du
paradigme en tant qu'"exemple commun" - il s'agit, en effet, pour les futurs scientifiques,
d'apprendre à voir un nouveau problème comme apparenté à un problème typique
(paradigme) dont on connaît déjà la réponse. Une communauté scientifique se soude ainsi
par un ensemble d'intuitions collectives, de dispositions acquises, de connaissances
tacites, qui ne sont pas nécessairement verbalisées ou théorisées, et qui débordent de loin
les règles explicites qui prétendraient diriger la pratique effective suivie par ce groupe7.
Au sens sociologique, le paradigme s'entend donc d'un ensemble de dispositions acquises
par l'expérience permettant à un groupe de chercheurs de se livrer aux activités de la
science normale.
Au sens cognitif, le paradigme vise la matrice disciplinaire et les exemples
communs. Quant à la matrice disciplinaire, elle contient quatre séries d'éléments (SRS,
p. 216 à 221) :
(1) des "généralisations symboliques" qui prennent la forme de formules ou de lois
scientifiques ("l'action est égale à la réaction"), certaines d'entre elles s'analysant
comme des définitions fondamentales (et souvent tautologiques) de la discipline ;
7. En ce sens, cf. P. DUMOUCHEL, v° Paradigme, in Encyclopédie philosophique universelle. II Les
notions philosophiques, t. II, Paris, 1990, p. 1847-1848. Cf. notamment SRS, p. 64 : dès lors que
les paradigmes sont une certaine façon de "voir" le monde (ainsi les astres avant et après Copernic),
"il se peut que les paradigmes soient plus anciens, plus complets et plus contraignants que n'importe
quel ensemble de règles de recherche qu'on pourrait en abstraire sans équivoque".

5
(2) "la partie métaphysique des paradigmes", c'est-à-dire l'adhésion à un certain nombre
de croyances (telle que : "la chaleur est l'énergie cinétique des parties constituantes
des corps"). Ces modèles métaphysiques engendrent des modèles "heuristiques" ("les
molécules de gaz se comportent comme de petites boules de billard élastiques, se
mouvant au hasard") qui, eux-mêmes, se traduisent souvent par un ensemble de
métaphores et d'analogies préférées par les membres du groupe ;
(3) des "valeurs", qui, bien que partagées par les membres de la communauté
scientifique, peuvent néanmoins différer dans leur application concrète ; on
souhaitera, par exemple, que les prédictions soient "vraies", que les théories soient
"simples, cohérentes et plausibles", que les résultats scientifiques présentent une
certaine "utilité sociale" ;
(4) les "exemples communs" qui visent les cas archétypiques identifiés comme modèles
de base par les étudiants et qui concernent des réussites scientifiques
particulièrement exemplaires dans le domaine concerné - nous dirions, mais
l'expression ne se trouve pas chez Kuhn, quelque chose comme un "lieu commun", un
topos de la discipline. Ce quatrième élément de la matrice disciplinaire, on l'aura
compris, ne diffère pas du second sens ("exemplaire") que distingue Kuhn.
Nous en savons ainsi suffisamment pour tenter maintenant de répondre à la question
que nous nous sommes posée : "dans quelle mesure l'idée du jeu peut-elle prétendre au
titre de paradigme de la science juridique" ?
Section 2. Application à la théorie ludique du droit.
L'idée de jeu, telle qu'elle est reçue dans le champ de la théorie du droit, est-elle un
paradigme au sens sociologique ? Pour répondre à cette question, il faut commencer par
identifier le groupe de référence, ce qui, assurément, n'est pas l'opération la plus simple.
Pour nous limiter à ce seul aspect de la question : faut-il, oui ou non, inclure dans la
communauté pratiquant la science du droit, les auteurs dits de "doctrine", ou encore les
auteurs s'inscrivant dans le cadre de la "dogmatique juridique" ? Tout dépendra, bien
entendu, de la définition qu'on adoptera de la science du droit (mutatis mutandis,
comparaison n'est pas raison, on peut aussi demander si l'alchimie relève de la chimie,
ou l'astrologie de l'astronomie). Quant à nous, nous considérons que la dogmatique
juridique ne relève de la science du droit qu'au sens faible : il s'agit d'une rationalisation
du discours pratique qui, si elle contribue très utilement à la définition, classification et
systématisation des solutions juridiques, n'en est pas moins largement tributaire des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%