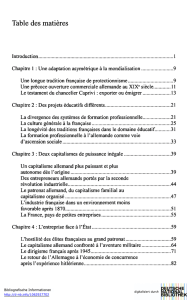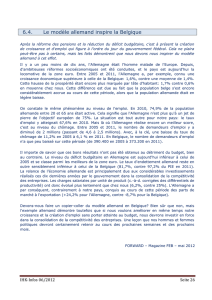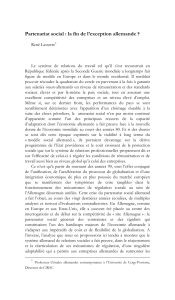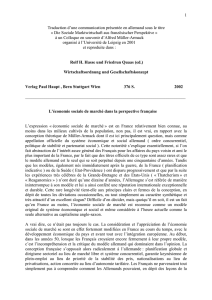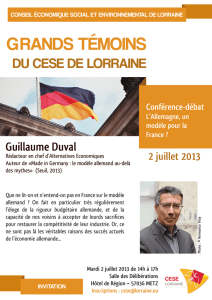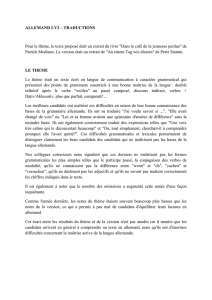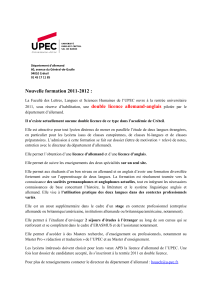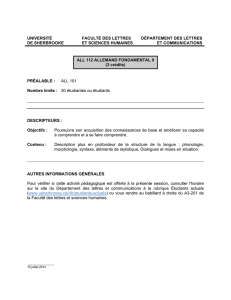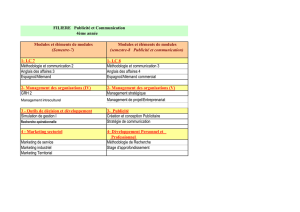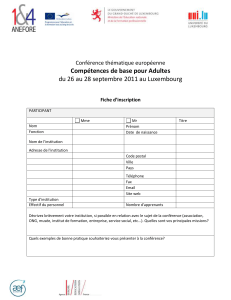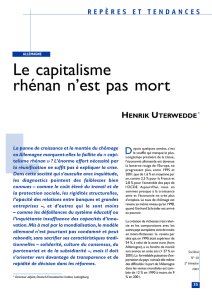Le modèle économique allemand en question

169
Le modèle économique allemand en question
René Lasserre
Henrik Uterwedde
L’extraordinaire réussite de l’économie allemande a toujours été un topos
important dans la perception de l’Allemagne d’après-guerre et un facteur
déterminant dans l’action internationale de l’Allemagne, compte tenu du
caractère largement économique et monétaire de la construction européenne
et de l’impact de la globalisation sur les relations internationales. De manière
récurrente depuis les débuts de l’intégration européenne, l’économie la plus
forte en Europe n’a cessé de provoquer un mélange ambivalent d’admiration,
de crainte, de regard critique, voire de rejet. Dans une Europe économique
plus que jamais intégrée et interdépendante, l’économie et la politique écono-
mique allemandes interpellent les voisins, notamment en France. L’Allemagne
sert de référence (benchmark) pour mesurer ses propres forces et faiblesses1.
Elle est critiquée pour son eet de domination, voire pour son «égoïsme» au
détriment des voisins2. Et quand bien même elle montre des signes de faiblesse,
comme pendant la décennie suivant la réunication allemande marquée par une
perte de dynamisme et une grande diculté à renouveler le modèle allemand,
ces problèmes inquiètent également les partenaires à cause des conséquences
négatives pour l’économie européenne, nourrissant de surcroît la crainte
d’un repli sur soi et d’un manque d’engagement européen3. Enn, le décalage
économique franco-allemand ne se contente pas de susciter des craintes sur le
1.– Voir à titre d’exemple, CEO-Rexecode, Mettre un terme à la divergence de compétitivité entre
la France et l’Allemagne, Paris, 14janvier 2001; Dorothée Köhler, Jean-Daniel Weisz, Pour
un nouveau regard sur le Mittelstand. Rapport au Fonds stratégique d’investissement, Paris, La
Documentation française, 2012.
2.– Rémi Lallement, «Quel rééquilibrage pour les moteurs de la croissance allemande?», Note
de veille, n°176, Centre d’Analyse Stratégiques, Paris, mai2010.
3.– René Lasserre, Introduction, in: Isabelle Bourgeois (dir.), Allemagne 2001, Cergy-Pontoise,
CIRAC, p.7.

170 René Lasserre, Henrik Uterwedde
déséquilibre des relations franco-allemandes et sur « l’Europe allemande»,
il s’introduit aussi dans le débat économique français. Faut-il suivre le modèle
allemand an de vaincre les faiblesses structurelles en France? Les réformes du
gouvernement Schröder de 2003-2005 (Agenda 2010) montrent-elles la voie
pour la politique française, victime d’un blocage des réformes structurelles ?
Ou bien est-ce une voie néfaste, « néolibérale», «antisociale», «austéri-
taire», qu’il faudrait rejeter tant en France qu’en Europe?4 Il est vrai que cette
controverse n’est plus vraiment un débat sur l’Allemagne mais une querelle bien
française portant sur la bonne politique pour vaincre la crise économique en
France, et que dans cette querelle, l’expérience allemande est instrumentalisée (et
souvent dégurée) an d’appuyer la position idéologique de chacun des contra-
dicteurs. Cela va de pair avec une grande confusion sur le terme et le contenu
même du «modèle allemand», chacun se servant à sa guise des éléments qui
peuvent appuyer sa propre position en ignorant superbement le reste.
Ces mécanismes d’une perception partiale, voire déformée, du modèle
allemand ne sont pas nouveaux5. C’est pourquoi notre contribution se propose
de décrypter ce modèle. Nous allons dans un premier temps revenir sur les
questions de base: la notion même de modèle et sa signication; la naissance, la
nature et les caractéristiques du modèle économique allemand. On verra que la
naissance du modèle allemand (comme d’autres modèles nationaux) est le résultat
d’une conguration historique spécique et une réponse aux faiblesses du passé
comme aux dés du moment. Il n’est donc pas immuable, même si certaines
continuités historiques sont à noter. Dans un deuxième temps, nous tenterons
de dégager la dynamique de ce modèle allemand, avec une attention particulière
portée aux dés et dicultés auxquels il a été confronté dès les années 1980,
ainsi qu’aux adaptations et transformations qu’il a connues depuis. Enn, dans
un troisième temps nous nous demanderons si, et dans quelle mesure, le modèle
allemand peut servir de «modèle» aux pays voisins, voire à l’Europe entière.
Que désigne le modèle allemand?
Précisons tout de suite que le terme de «modèle» tel que nous l’utilisons ici n’a
rien à voir avec une quelconque connotation normative, au sens où l’Allemagne
serait un modèle à suivre, sauf quand nous poserons la question explicite de
l’exemplarité à la n de cet article. Il s’agit de décrire, et d’analyser, un modèle de
fonctionnement, pris au sens de «système», et ce à partir de quelques questions:
comment l’Allemagne organise-t-elle sa vie économique et sociale? Selon quels
référentiels et quelles règles? Par quelles spécicités se distingue-t-elle d’autres
4.– À titre d’exemple la critique très partiale et sans merci de la politique de Gerhard Schröder
par Guillaume Duval, Made in Germany. Le modale et sans merci de la politique, Paris, Seuil,
2013, et le point de vue opposé d’Alain Fabre, Allemagne: miracle demploi ou désastre social?,
Paris, Institut de l’entreprise, septembre2013.
5.– Cf. René Lasserre, Henrik Uterwedde, «Die wirtschaliche und soziale Berichterstattung
über das Nachbarland. Vergleichende Analysen anhand zweier Fallstudien ». in : Die
Information und die deutsch-französischen Beziehungen.- Bonn, Europa Union Verlag
1979, p.108-127.

171
Le modèle économique allemand en question
modèles nationaux? Quelle est la dynamique propre de ce modèle, quelle est sa
performance?
Dans les sciences économiques et sociales, la chute du communisme après
1990 a provoqué un regain d’intérêt pour les diérentes formes que peut
prendre le capitalisme, notamment à partir du livre Capitalisme contre capita-
lisme de Michel Albert6. La recherche sur des «variantes de capitalisme» a
produit des classications idéal-typiques, comme la distinction entre «l’éco-
nomie de marché libérale» et «l’économie de marché coordonnée»7, mais
s’est penchée aussi sur les modes de fonctionnement des modèles nationaux
«réels»8. Cette dernière approche a dégagé trois principaux types de capita-
lisme en Europe, représentés par les trois grands pays de l’Union européenne:
le capitalisme libéral (dominant la Grande-Bretagne de l’après-atcher), le
capitalisme étatique (dont la France reste le représentant majeur) et le capita-
lisme coopératif à l’allemande. Cette approche, qui ore un cadre analytique
et des critères permettant de distinguer et de décrire un modèle national, nous
servira de point de départ.
L’économie sociale de marché: un mythe fondateur
Mais d’abord convient-il de s’arrêter sur la naissance du modèle allemand.
Après 1945, l’Allemagne occidentale, comme ses voisins, doit répondre non
seulement au besoin de reconstruction d’une économie dévastée par la Guerre
mondiale mais veut aussi tirer la leçon des errements du passé. À chaque pays
son dé spécique. La France veut sortir du malthusianisme démographique et
économique et surtout rattraper la modernisation économique et sociale que
la Troisième République n’a pas su mettre en œuvre. Pour dépasser un capita-
lisme à dominante nancière qui a trop négligé le développement industriel
du pays, elle va prendre le chemin de ce qui sera appelé plus tard «Les Trente
Glorieuses», à savoir la mutation profonde de l’économie française stimulée par
une politique de modernisation économique et sociale forcée, sous l’impulsion
d’un État-modernisateur. Quant à l’Allemagne, le désastre est total: le pays est
détruit, matériellement par la guerre et moralement suite aux crimes du régime
nazi. Tout ceci provoque la nécessité d’un renouveau profond et complet: il
s’agit de bâtir une démocratie exemplaire fondée sur la diusion et non plus la
concentration du pouvoir (fédéralisme, pluralisme politique assuré par le scrutin
proportionnel), ainsi que sur le partage des valeurs démocratiques et le rejet des
extrémismes de gauche comme de droite qui avaient déchiré la République
de Weimar; et au plan socio-économique de dépasser la lutte des classes et les
eets pervers du capitalisme libéral tout en rejetant l’économie administrée et
commandée du régime nazi, ou de celle qui se met en place à l’Est et donnera
naissance au régime communiste de la RDA.
.– Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, Paris, Seuil, .
.– Peter Hall et David Soskice, Varieties of Capitalism. e Institutional Foundations of
Comparative Advantage, Oxford, Oxford University Press, .
.– Colin Crouch, Wolfgang Streeck (dir.), Les capitalismes en Europe, Paris, La Découverte,
. Vivien A. Schmidt, e Futures of Capitalism, Oxford, Oxford University Press, .

172 René Lasserre, Henrik Uterwedde
Sur le plan politique, la réponse est la Loi fondamentale de 1949, qui bâtit
une République fédérale fondée sur le partage et l’équilibre des pouvoirs
(fédéralisme; rôle de la Cour constitutionnelle; pluralisme parlementaire). S’y
ajoutent une culture politique «centriste» qui rejette les extrêmes et le renou-
vellement du système des partis qui dégage rapidement des partis de gouver-
nement, modérés, et fera preuve d’une stabilité et d’une continuité étonnantes.
Sur le plan économique et social, c’est la recherche d’une «troisième voie»
entre capitalisme et communisme: le référentiel de l’économie sociale de marché
«dont l’objectif est de combiner, sur la base d’une économie concurrentielle, la
liberté d’entreprendre avec un progrès social garanti justement par la performance
des marchés»9. Ce concept est né de plusieurs courants de pensée, tel l’ordo-
libéralisme de l’école de Fribourg (Walter Eucken, Franz Böhm), des courants
anthropologiques et chrétiens, que l’économiste Alfred Müller-Armack a
combinés pour une nouvelle doctrine inconnue jusqu’alors en Allemagne. Ses
éléments clés sont le néolibéralisme, l’idée d’une « réconciliation sociale »
prégurant le partenariat social pratiqué depuis 60ans, ainsi qu’un fondement
éthique justiant l’intervention politique assurant la justice sociale. Cette
volonté de concilier ce que d’autres considéraient comme des antagonismes
irréductibles peut être caractérisée comme l’essence innovatrice de l’économie
sociale de marché. On la retrouve dans maintes pratiques du capitalisme coopé-
ratif à l’allemande.
Ce modèle d’un capitalisme social, popularisé par le «père» de la réforme
monétaire de 1948, Ludwig Erhard, deviendra la marque du « miracle » et
de la réussite économiques, les «Trente Glorieuses» allemandes. Il tente de
combiner la logique marchande et entrepreneuriale avec la cohésion sociale et le
partenariat social. S’il postule la primauté des marchés, il les soumet aussi à un
cadre réglementaire et à des mécanismes correcteurs (politiques sociales, parte-
nariat social entre patronat et syndicats)10.
Les dimensions du capitalisme rhénan
Comme en France, on peut constater que ces mythes fondateurs ont la vie dure
et continuent à inuencer la pensée et le comportement des acteurs jusqu’à
nos jours. Le référentiel de l’économie sociale de marché ne cessera d’inspirer
tous les partis politiques même s’il y a débats et controverses légitimes sur
l’équilibre concret entre «marché» et «social». Pourtant, dans la réalité,
d’autres pratiques se font jour qui, sans être en conit direct avec la doctrine
ordolibérale, le complètent et parfois le contournent. Ainsi émerge un «capita-
lisme rhénan» avec de traits spéciques, avec des fondements tant politiques et
sociaux, qu’économiques.
9.– Alfred Müller-Armack, «Soziale Marktwirtscha», in: Alfred Müller-Armack Wirtschas-
ordnung und Wirtschaspolitik, Rombach, Freiburg, 1956, p.245.
10.– Cf. Henrik Uterwedde, «L’économie sociale de marché: la jeunesse d’un référentiel», in:
Isabelle Bourgeois (dir.), Allemagne, les chemins de lunité, Cergy-Pontoise, CIRAC, 2011,
p.39-49.

173
Le modèle économique allemand en question
Côté politique, malgré la formule minimaliste de la doctrine de l’économie
sociale de marché («autant de marché que possible, autant d’État que néces-
saire »), l’État est bien présent dans la vie économique et sociale, à travers
le développement de l’État-providence et de pratiques interventionnistes,
savamment dosées, dans l’économie. Pourtant, suivant une philosophie et
une organisation de l’État fondée sur la subsidiarité, son intervention se veut
modeste et ne prétend pas se placer au-dessus de la sphère économique et sociale,
mais en partenaire. Elle respecte l’autonomie des partenaires sociaux dans les
conventions collectives ; en outre, les Verbände (organisations syndicales ou
professionnelles) sont souvent associés à l’élaboration des lois et peuvent parti-
ciper activement aux politiques et régulations publiques (comme c’est le cas dans
le système dual de la formation professionnelle initiale, ou dans les politiques
d’innovation11). Quant aux marchés, ils sont, selon la formule de W. Streeck,
«institués politiquement, régulés socialement et considérés comme le résultat
de politiques gouvernementales destinées à servir des intérêts publics»12. Cette
forme néo-corporatiste de la régulation politique est une des caractéristiques du
capitalisme allemand, se distinguant nettement des formes de régulation plus
étatistes en France ou strictement libérales en Grande-Bretagne.
Côté social, un capitalisme partenarial et coopératif se développe,
notamment dans l’industrie, qui organise la co-détermination des entreprises et
un partenariat entre le capital et le travail. Ce réexe coopératif, avec sa force de
négociation et de coopération qui favorise l’émergence de réponses collectives
aux problèmes, a toujours constitué un atout pour l’économie allemande et sa
capacité d’adaptation dans les périodes diciles.
Enn, les fondements économiques: il ne faut pas oublier que le modèle
allemand est essentiellement un modèle industriel. C’est aux besoins industriels
qu’il répond le mieux, c’est dans l’industrie qu’il fonctionne au mieux, alors
qu’il apparaît moins bien adapté aux services. Une bonne spécialisation «haut
de gamme», reposant sur innovation permanente et une main-d’œuvre très
qualiée, produit une excellente compétitivité qualitative des entreprises, justi-
ant des salaires élevés et les coûts d’une protection sociale généreuse. Le revers
de la médaille: l’industrie, très spécialisée, produit pour les marchés mondiaux et
dépend d’une manière signicative des exportations. Très ouverte, l’industrie, et
à travers elle, l’économie allemande a dû s’adapter en permanence aux dés de la
mondialisation. Le souci permanent de la compétitivité des entreprises et du site
de production allemand (Standort Deutschland) contribuent à une préférence
générale des pouvoirs publics pour une politique de l’ore (visant à renforcer
l’appareil productif via un cadre de développement favorable aux entreprises et
propice au renforcement de leur compétitivité) au détriment d’une politique de
la demande aux eets de croissance dius et incertains.
11.– Solène Hazouard, René Lasserre, Henrik Uterwedde (éd.), Les politiques dinnovation coopé-
rative en Allemagne et en France, Cergy-Pontoise, CIRAC, 2010.
12.– Wolfgang Streeck, «Le capitalisme allemand: Existe-t-il? A-t-il des chances de survivre?»
in: Colin Crouch et Wolfgang Streeck (dir.), Les capitalismes en Europe, Paris, La Découverte,
1996, p.47-75.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%