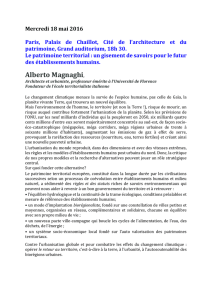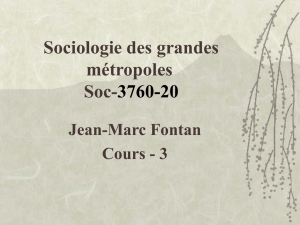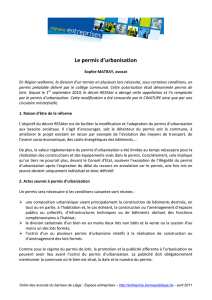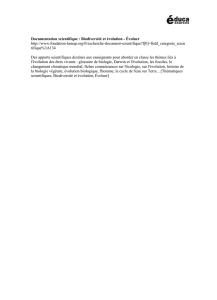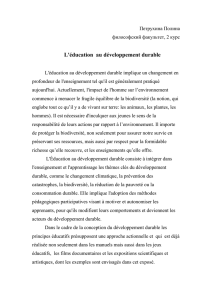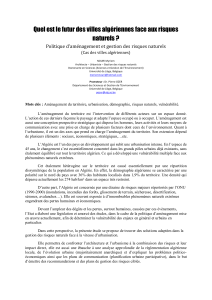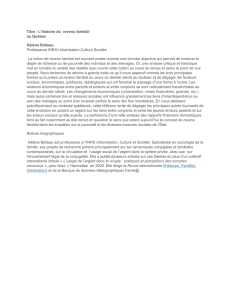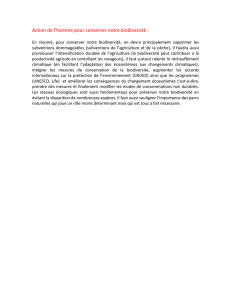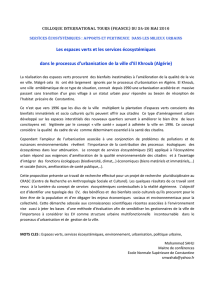Le programme ECORURB : comprendre les effets de

Le programme ECORURB : comprendre les effets
de l’urbanisation sur la biodiversité locale et
l’émergence de risques biologiques
The ECORURB Program: understanding the effects of
urbanization on the local biodiversity and the emergence of
biological risks
Philippe CLERGEAU1, Laurence HUBERT-MOY2, Hervé DANIEL3, Alain BUTET4
1 INRA-SCRIBE,Equipe Gestion des Populations Invasives, Avenue Général
Leclerc, 35042 Rennes Cedex
Tél : 02 23 48 50 02 - Fax : 02 23 48 50 20 -
philippe.clergeau@beaulieu.rennes.inra.fr
2 Université Rennes 2, COSTEL UMR 6554 LETG, 6, Avenue Gaston Berger,
35043 RENNES Cedex
Tél : 02 99 14 18 38 – Fax : 02 99 14 18 95 - laurence.hube[email protected]
3 INH-INRA-Université AngersUMR A 462 SAGAH, Equipe Végétation et
contraintes urbaines, 2, Rue Le Nôtre, 49045 ANGERS Cedex
Tél : 02 41 22 54 54 - Fax : 02 41 73 15 57 - hdaniel@angers.inra.fr
4 CNRS-Université Rennes1UMR Ecobio, équipe ‘Ecologie du Paysage’, Avenue
du Général Leclerc, 35042 RENNES Cedex
Tél. : 02 23 23 69 26 - Fax : 02 23 23 51 38 - alain.butet@univ-rennes1.fr
Résumé
Plusieurs travaux antérieurs sur les comportements de colonisation et d’invasion du milieu
urbain par des espèces comme l’étourneau, le goéland ou le renard, sur la composition des
communautés animales et végétales en ville (micromammifères, oiseaux, graminées, etc.)
et un questionnement récent sur les méthodes d’évaluation des espaces à caractère naturel
en système fortement anthropisé ont abouti à une collaboration entre différentes équipes de
géographes et d’écologues de Rennes et d’Angers. Très rapidement la collaboration s‘est
traduite par la mise en place de véritables sites ateliers supportant l’ensemble des
recherches et a fédéré d’autres chercheurs des universités et de l’INRA (notamment en
parasitologie, microclimatologie, sociologie).
Le programme qui regroupe actuellement une quinzaine de chercheurs et intègre la
collaboration d’une dizaine d’autres se concentre sur une problématique générale de
connaissance et de prévision de l’évolution des relations biologiques ville-campagne. Nous
présentons les méthodes (télédétection appliquée à la lecture des usages des sols en milieu
urbain, stations sur un gradient d’urbanisation, instrumentations et suivis périodiques des
stations durant 10 ans, etc.) et les principales analyses qui ont été retenues par le groupe
pour traduire l’effet de l’urbanisation (mesure et évolutions des structures de paysage
environnant chaque station, des climats locaux, des microclimats, et des caractères
pédologiques) sur (1) la biodiversité locale (dynamique des communautés et des
populations, plasticité et adaptation comportementales, processus de colonisation) et sur (2)
141

l’émergence de risques biologiques (analyse du processus d’invasion en milieu urbanisé,
parasitologie des vertébrés, étude sociétale des notions de risque et de nature).
Abstract
A multi-disciplinary project started in 2002 is being conducted at two study sites in western
France in order to understand the effects of urbanisation on biodiversity evolution, and
especially of the isolation phenomenon on populations of plant and animal species in semi-
natural ecosystems found in peri-urban and urban areas. Our objective is to identify
mechanisms involved in colonisation, invasion and adaptation processes for these
populations. Research is based on advanced theory and methodology of animal and plant
ecology, landscape and land-use/land-cover properties, and the climatology and sociology
features. Observations will take place over a period of 10 years on 12 stations selected
along an urban-rural gradient for both study areas of Rennes and Angers. This work also
approaches the biological risks related to exchange between urban and peri-urban systems,
for example through the identification of invader species or some vertebrate parasites.
Mots-clés : paysages urbain et périurbain, biodiversité, comportements adaptatifs,
mécanismes de colonisation et d’invasion.
Keywords: urban and periurban landscapes, biodiversity, adaptive behaviour, colonisation
and invasion mechanisms.
1. Evolution de la biodiversité et urbanisation
L’importance progressive prise par le développement des espaces urbanisés,
notamment au 20ème siècle, est bien connue : la proportion de la population
mondiale vivant en milieu urbanisé dépasse les 50%, atteignant 80% dans les
pays développés, et les surfaces construites sont en constante augmentation
(Marzluff, 2001). La conséquence directe de l‘étalement urbain, au niveau de la
petite ville comme de la mégapole, est la disparition d’espaces ruraux, ou à
caractère plus naturel, au bénéfice de nouveaux espaces construits (zones de
logements, zones d’activités, infrastructures routières…). Des sites d’intérêts
écologiques et les espèces qui y sont associées peuvent alors disparaître, comme
la ripisylve canadienne entre Montréal et Québec, ou encore les marais côtiers en
Bretagne, ce qui a un impact direct sur la biodiversité régionale. De plus,
l’extension urbaine entraîne des transformations perceptibles dans certains cas
jusqu’à plus de vingt kilomètres à partir de la périphérie de la ville, comme le
mitage de l’espace par des constructions. Ce phénomène de « rurbanisation » se
traduit par la multiplication des résidences de nouveaux citadins (travail en ville et
logement en milieu périurbain1) ou encore le développement de réseaux
d’infrastructures routières. Elle provoque également des perturbations sur son
environnement plus ou moins proche (pollutions diverses, modifications
climatiques, propagation d’espèces exotiques, augmentation des fréquentations
humaines, etc.).
1 Le terme périurbain est utilisé ici dans le sens géographique : espace rural ou naturel
extérieur à la ville et dont la largeur est dépendante de la zone d’influence de la ville (entre 5
et 15 km pour une ville moyenne).
142

Aujourd’hui les espaces périurbains n’évoluent pas seulement à travers la
destruction de sites par le « bulldozer » urbain mais aussi par la fragmentation et
l’isolement des espaces à caractère naturel. La « conservation » de milieux
« naturels » en zone urbanisée a débuté au milieu du 19ème siècle par la création
de parcs et de jardins publics ; elle s’amplifie et se poursuit actuellement au fur et à
mesure de l’avancée de l’urbanisation des territoires.
En effet, les nouvelles sensibilités et rapports à la nature s’expriment de plus en
plus à tous les niveaux, depuis les cadres législatifs (Directive habitat applicable
dans les PLU2.) jusqu’au souhait de nature de proximité par les citadins, en
passant par les décisions des services municipaux (faible entretien d’espaces
urbains non construits pour une biodiversité maximale).
Depuis plusieurs décennies, la création ou la conservation d’espaces à caractère
naturel au sein d’un environnement urbanisé aboutit à un ensemble de taches
d’habitat plus ou moins riches en espèces animales et végétales. Ce phénomène
de fragmentation débouchant sur l’isolement de populations animales ou végétales
est connu en milieu rural où le concept de métapopulation est aujourd’hui à l’étude
(Burel et Baudry, 1999). Mais peut-on poser les mêmes hypothèses dans le cadre
de l’urbanisation où (1) les espaces à caractère naturel subissent des contraintes
différentes (sol remanié, fréquentation humaine, sélection de certaines espèces,
introduction d’espèces exotiques…) et où (2) la matrice, espace entre les habitats
d’une espèce agissant souvent comme un frein à la dispersion ou à la survie de
celle-ci, est à la fois très stable (il n’y a pas de rotation des cultures) et très
répulsive (pavés, goudrons, bâtiments) ? On peut s’attendre à une réelle forme
d’insularité comme l’ont suggérée Davis et Glick (1978), l’isolement étant entretenu
par les difficultés de flux d’individus, par les comportements humains qui favorisent
ou repoussent certaines espèces, par des caractères climatiques particuliers
(température plus élevée, changements locaux de la vitesse et de la direction du
vent) (Sacré et Eliasson, 2002).
Si cet isolement est effectif sur plusieurs générations alors une possible évolution
des populations peut être attendue sur des traits d’histoire de vie3. C’est par
exemple ce qui a été observé dans une étude sur l’écologie d’une population
urbaine du mulot Apodemus sylvaticus (Cihakova et Frynta, 1996). On peut aussi
s’attendre à ce que l’écosystème urbain favorise et sélectionne certaines espèces
plutôt que d’autres et contribue à accentuer l’importance de certains groupes, par
exemple les oiseaux omnivores (Clergeau et al., 1998), les coléoptères les plus
petits (Sustek, 1987) ou des espèces végétales annuelles exotiques (Godefroid,
2001).
Du fait de la densité de structures urbaines réparties sur l’espace géographique et
de leur rythme d’évolution actuel, l’intérêt de l’étude des populations animales ou
végétales dépasse la seule caractérisation de populations adaptées (plasticité des
comportements, adaptation, évolution génétique) ou la traduction d’impacts
environnementaux liés à la ville (résistance à la pollution, accessibilité à des
2 Plan Local d’Urbanisme remplaçant les Plans d’Occupation des Sols.
3 Nous utilisons le terme ‘trait d’histoire de vie’ dans son sens le plus large, c’est à dire
intégrant l’ensemble des caractères comportementaux, morphologiques, phénologiques et
démographiques, etc.
143

ressources trophiques, refuge hivernal). La prise en compte de cette évolution
s’inscrit complètement dans un processus de changement global où nous
identifions au moins deux hypothèses qui concernent la biodiversité : la première
considère le caractère climatique de la ville qui, ayant une température en
moyenne plus élevée que son environnement rural, peut accueillir des espèces au
nord de leur aire de distribution habituelle ou qui peut favoriser l’adaptation de
certaines espèces. La deuxième considère les espaces à caractère naturel de la
ville comme des îlots favorisant l’isolement reproductif ou comportemental de
certaines populations ; ceci débouche sur la sélection de certains caractères et
favorise la dérive génétique. Dans les deux cas, il s’agit bien d’un pilotage
anthropique indirect impliquant l’évolution et les rythmes des changements
d’environnement (paysage, climat, comportements humains) sur l’évolution des
traits d’histoire de vie et des capacités de dispersion des espèces. Il a déjà été
clairement suggéré que les villes puissent simuler des changements climatiques
globaux dans le cas des populations végétales (Sukopp et Wurzel, 2000).
Les interrogations que nous venons de soulever concernent bien sûr directement
la gestion et la conservation de la biodiversité. Mais aujourd’hui il ne s’agit pas
seulement de positionner la notion de patrimoine biologique par rapport aux
habitats urbains. Il faut prévoir les possibilités d’évolution des assemblages
spécifiques en s’interrogeant sur les effets sélectifs des facteurs liés à
l’urbanisation sur les différents niveaux d’organisation biologique (individus,
populations, communautés) et aux différentes échelles spatiales (la ville,
l’agglomération et son périurbain, la région).
Enfin ces interrogations, ciblées sur l’adaptation et l’évolution des populations au
milieu urbain, sont un support à l’étude du processus de colonisation et d’invasion
qui va impliquer à la fois les capacités de dispersion de l’espèce et la structuration
des paysages. Ceci est indispensable aux prévisions des risques d’invasions par
de nouvelles espèces et des risques épidémiologiques entre ville et campagne,
que cela soit dans un sens ou dans un autre.
2. Une recherche pluridisciplinaire et à long terme sur
une zone atelier
Cette problématique de recherche d’un effet de l’urbanisation sur l’évolution de la
biodiversité nécessite un travail pluridisciplinaire. Plusieurs travaux antérieurs sur
les comportements de colonisation et d’invasion du milieu urbain, sur les structures
des communautés végétales sous contrainte urbaine et un questionnement récent
au sein de l’INRA sur les méthodes d’évaluation des espaces à caractère naturel
en système fortement anthropisé avaient abouti à une collaboration entre
différentes équipes de géographes et d’écologues de Rennes et d’Angers. Cette
collaboration s‘est traduite par la mise en place, au cours de l’année 2002, d’une
zone atelier supportant l’ensemble des recherches. Elle est constituée de deux
sites correspondant à deux agglomérations de taille moyenne, Rennes et Angers,
144

afin de mener des études comparatives dans des conditions similaires
d’expérimentation.
Cette démarche a fédéré d’autres chercheurs des universités et de l’INRA
notamment en parasitologie (CHU Rennes-labo Parasitologie, INRA Theix-labo
d’Epidémiologie animale) et sociologie (Université Rennes2-LARES). Aujourd’hui
le programme regroupe une douzaine de chercheurs, intègre la collaboration d’une
dizaine d’autres et s’appuie également sur un partenariat efficace avec les services
municipaux et d’agglomérations.
La problématique retenue impose de travailler sur des espaces semblables mais
caractérisés par des environnements différents ; nous avons retenu des petits
boisements d’environ un hectare sur un gradient d’urbanisation allant du centre
ville jusqu’à la campagne périurbaine très agricole ; au total 12 stations boisées ont
été sélectionnées par site d’étude, certaines étant prochainement soumises à un
phénomène d’urbanisation. Ce programme répond également à la volonté
d’inscrire l’observation sur une longue période, afin de comprendre les réponses
des communautés végétales et animales aux perturbations induites par
l’urbanisation, et intégrer l’effet de perturbations récentes. Ainsi nous avons décidé
de suivre périodiquement les espèces pendant au moins 10 ans.
3. Les analyses engagées
La question centrale de ce projet de recherche est de déterminer si l’urbanisation
peut jouer un rôle sélectif dans l’évolution des assemblages spécifiques. Pour cela,
nous entamons une recherche des indicateurs à la fois 1) de changement
d’environnement et 2) de typologie des espèces et des comportements sous
contraintes d’urbanisation.
3.1 Facteurs et rythmes de changements environnementaux
Pour répondre à la première question sur les facteurs et les rythmes de
changements environnementaux qui caractérisent l’interface ville-campagne, nous
souhaitons non seulement tenter de modéliser l’évolution spatiale et temporelle
des paysages et des paramètres climatiques à l’interface urbain-périurbain, mais
aussi intégrer les comportements humains dans leurs rapports aux espèces.
Nous avons donc retenu :
- L’étude d’indicateurs abiotiques : ils relèvent des structures paysagères et
de l’occupation des sols, de la climatologie, et de la micro-climatologie.
La cartographie et le suivi des indicateurs liés au phénomène d’isolement
des populations et relevant des structures paysagères et des modes
d’occupation des sols (présence de la végétation, répartition spatiale et
forme des structures végétales, typologie la végétation, présence et
répartition des surfaces en eau…) seront effectués à partir d’images de
télédétection à haute, voire à très haute résolution (SPOT 5, QUICKBIRD),
couplées à un SIG (Puissant et Weber, 2002). Les résultats seront
analysés à différentes échelles (îlot, quartier, agglomération). La
reconnaissance des facteurs qui motivent l’évolution de ces indicateurs
145
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%