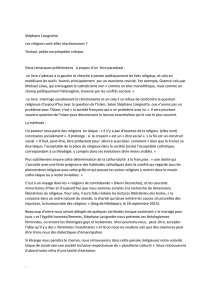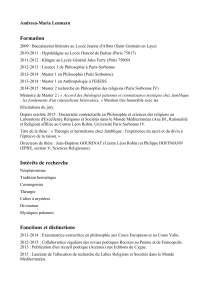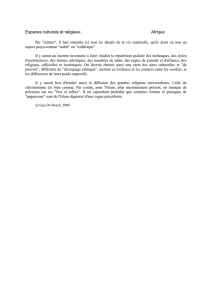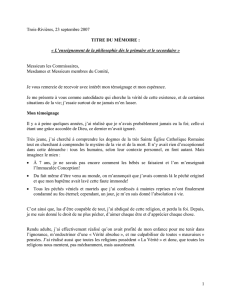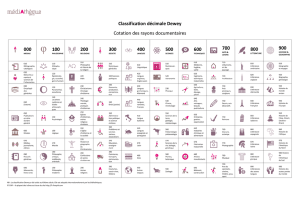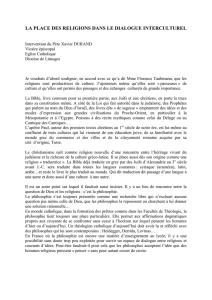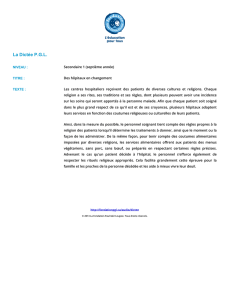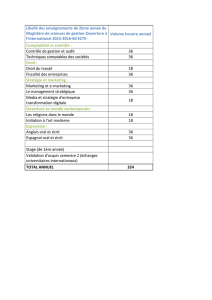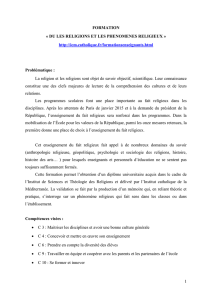La question n`est pas celle d` « un peu plus » ou d`« un peu moins

La question n’est pas celle d’ « un peu plus » ou d’« un peu moins de religion »
L’initiative « Fir de choix » a récemment pris position par rapport à l’élaboration du
nouveau cours d’ « éducation aux valeurs » en affirmant que « les représentants de
l’instruction religieuse et morale sont prêts à coopérer de manière constructive, (…)
alors que l’autre camp ne semble s’y mettre que s’ils peuvent imposer unilatéralement
leur concept laïciste ».
S’il est effectivement remarquable que ceux qui ont tenté d’empêcher un cours unique à
l’école par tous les moyens – fût-ce en proposant un cours confessionnel également aux
autres religions – contribuent désormais de façon constructive au nouveau cours Vie et
société, on peut se demander ce qui permet d’affirmer que l’ « autre camp » contrarierait
les travaux en étant « antireligieux » ?
Si par « autre camp » on entend le camp laïque, il convient de noter, d’une part, que
celui-ci plaide depuis longtemps en faveur d’un cours unique pour tous les élèves
d’appartenances et de cultures diverses, et d’autre part, que laïque et laïciste ne sont pas
à confondre.
« Laïque » ne signifie pas non-croyant et moins encore antireligieux. Conformément à
son origine étymologique laos (en grec peuple), la laïcité est comprise comme un
principe d’égalité et affirme l’unité du peuple. Elle se traduit par le principe de la
séparation entre domaines politique et religieux ainsi que par le principe de la neutralité
en matière de Weltanschauung. Le premier principe constitue la garantie pour
qu’aucune religion ne domine le pouvoir politique et les institutions publiques. La
neutralité, quant à elle, est un principe que doit s’imposer l’Etat pour pouvoir
représenter la totalité du peuple. Le respect de ces deux principes semble donc
indispensable pour garantir la liberté de conscience ainsi que l’égalité de tous les
citoyens, qu’ils soient croyants, agnostiques ou athées.
C’est dans ce sens que les professeurs d’éthique défendent une école laïque où, d’une
part, tous les élèves sont réunis indépendamment de leurs convictions religieuses, et
d’autre part, l’enseignement se fait sans emprise de communautés particulières.
L’ALPE n’a jamais contesté l’importance de l’enseignement du fait religieux qui fait
d’ores et déjà partie du cours d’ « éducation morale »
1
. Si l’introduction à la foi est
confiée aux parents, il ne s’agit toutefois pas de chasser le religieux de l’école. Au
contraire, il va de soi que la connaissance des différentes religions est essentielle afin de
1
Education morale et sociale (EMS) au fondamental et Formation morale et sociale
(FMS) au secondaire.

combattre les préjugés, de comprendre sa culture et celle des autres ainsi que les
conflits qui déchirent le monde d’aujourd’hui.
D’ailleurs, tout le monde est d’accord sur la nécessité de prendre en compte l’étude des
religions dans l’enseignement. Le problème est donc ailleurs : comment étudier les
religions et dans quelle proportion !
Par rapport à ces questions, l’ALPE s’est toujours positionnée de la façon
suivante (conformément au programme d’EMS et FMS):
Les religions (et les courants de pensée séculière) doivent être présentés d’un
point de vue extérieur, factuel et objectif.
Aucune conviction ne doit être privilégiée ou discriminée et en conséquence
toutes les religions traitées de façon égale.
Une réflexion critique sur le phénomène religieux doit être intégrée au
programme.
Par souci d’objectivité, le programme ne doit passer sous silence ni crimes ni
bienfaits des religions.
Etant donné le grand nombre de questions relatives à la vie en société, les
religions ne doivent constituer qu’une partie des sujets du programme.
Dès lors, l’enseignement du fait religieux ne devrait pas se limiter à la transmission de
savoirs en matière de religions, mais permettre aux jeunes de se situer d’une manière
éclairée et réfléchie par rapport aux traditions religieuses, y compris le courant de
pensée auquel ils se rattachent personnellement.
La méthode adéquate pour encourager la réflexion et permettre à chacun de se forger
une opinion librement élaborée nous semble être celle de la philosophie. Selon l’ALPE, le
moyen le plus approprié pour relever les défis de l’éducation à la citoyenneté et à la
tolérance, pour développer les compétences requises permettant de faire face au
pluralisme, comme le dialogue interculturel et interreligieux, est incontestablement
celui de l’approche de la Philosophie pratique (ou en général ce qui se nomme dans
d’autres pays Philosopher avec les enfants, Nouvelles pratiques philosophiques, Ethique,
etc.).
Par conséquent, l’ALPE regrette que les programmes de Philosophie pratique ne soient
pas pris en compte à l’heure actuelle et que soient ignorés les efforts considérables faits
préalablement sur ce terrain au cours des deux dernières décennies (quant aux
programmes, au matériel didactique et à la formation des enseignants). Tous ces efforts
auront été vains avec comme seule justification qu’il faut quelque chose de nouveau, de
commun. Or, si la mise en place d’un cours commun est innovateur, est-ce qu’il faut pour
autant réinventer la roue ?
Regrettant donc fortement que la philosophie n’ait pas été retenue comme discipline de
référence pour l’élaboration du nouveau cours, l’ALPE se félicite du moins du fait que,
selon Lex Delles du PD, le plan cadre de ce cours aurait été revu et que l’élément
philosophie aurait été renforcé à la veille de la publication de ce document.
Si, comme il a été annoncé, ce nouveau cours est censé devenir une branche scolaire
comme toutes les autres, plusieurs questions se posent :

Etant donné que la convention avec les cultes prévoit qu’ « il va de soi qu’un futur
Conseil des Cultes comptera parmi les acteurs à être consultés régulièrement sur
les questions philosophiques et religieuses », l’ALPE se demande quel sera au
juste le rôle des intervenants externes à l’école ?
Est-ce que la branche « Vie et société » sera affectée d’un coefficient comme
toutes les autres branches ?
L’attitude de l’enseignant – définie par la circulaire ministérielle sur les principes
de neutralité dans les écoles du 26 juin 2014 - pose également problème.
Comment concilier l’interdit d’exprimer ses convictions personnelles avec le
droit de répondre aux élèves en les informant « succinctement de ses positions
personnelles sans les étaler » ou encore avec l’apprentissage du « philosopher »
qui va de pair avec l’art de l’argumentation ?
Toujours convaincue du bien-fondé d’un cours d’éthique commun, l’ALPE espère que le
nouveau programme tiendra compte de la méthodologie de la philosophie pratique qui,
au cours des dernières années, a fait ses preuves et chez nous et à l’étranger.
1
/
3
100%