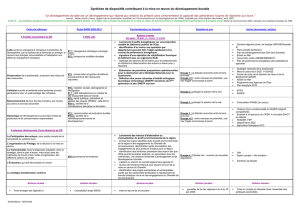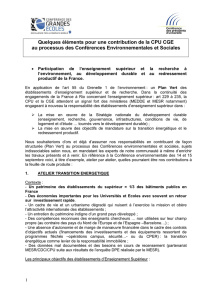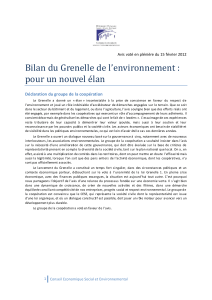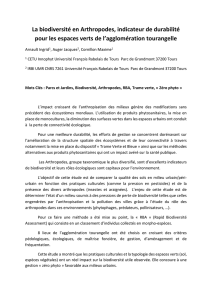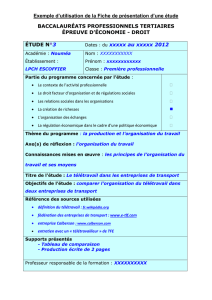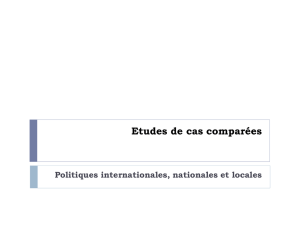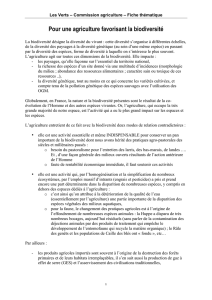rapport developpement durable - Université François Rabelais

RAPPORT DU GROUPE DE RÉFLEXION
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
JUIN 2008 - OCTOBRE 2009
UNIVERSITÉ FRANCOIS RABELAIS

Introduction
RAPPORT DD 2
INTRODUCTION
Depuis le rapport Brundlandt de 1979, le développement durable ou soutenable est défini
comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs ». Depuis 2000, la stratégie de Lisbonne vise à développer
dans l’Union Européenne « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique
du monde d’ici à 2010, capable d’une croissance économique durable, accompagnée d’une
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ».
Après adoption de la loi portant engagement national pour l’environnement, l’article
110.1.III du code de l’environnement comportera la définition suivante :
L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond à cinq finalités :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;
5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.
En l’espace d’une trentaine d’années, la notion de développement durable s’est imposée
non plus comme une source de recommandations mais comme un impératif juridique (Charte de
l’environnement à valeur constitutionnelle ; lois Grenelle…) qui englobe les champs économique,
social et environnemental. La seule adaptation de l’université aux nouvelles normes juridiques
« durables » imposerait de construire une stratégie de DD.
Mais le développement durable constitue également une source d’innovation qui prend en
compte des évolutions technologiques et de nouvelles pratiques sociales et économiques, fondées
en grande partie sur les technologies de l’information et de la communication. À défaut d’adopter
des pratiques plus respectueuses des autres et de l’environnement parce qu’elle croit réellement en
la dégradation de son cadre de vie, la population active de demain utilisera le développement
durable comme un atout commercial, un paradigme économique, social et politique.
La place de l’Université au cœur de la cité, comme pôle de recherche et de formation,
implique qu’elle ne se contente pas de suivre un mouvement général, mais qu’elle joue un rôle
actif et novateur dans la nouvelle société qui se construit aujourd’hui, notamment
- en élaborant une politique environnementale : parce qu’elle est répartie sur plusieurs
sites, l’université génère des déplacements urbains et une multiplication des déchets rendant plus
complexe la gestion du recyclage ; le nombre élevé de biens immeubles nécessite une politique
cohérente pour aboutir aux normes qui seront imposées dans les années qui viennent ; une gestion
cohérente des espaces verts permettrait d’y développer la biodiversité et l’entraide ;
- en ranimant ses politiques sociales : l’université rassemblant des acteurs divers, des
étudiants aux enseignants-chercheurs en passant par les BIATOSS ; ces différentes catégories
cohabitent souvent sans dialoguer, ce qui ne favorise ni sentiment d’appartenance à une
institution commune, ni solidarité, alors que les structures universitaires devraient permettre
d’apporter un soutien (psychologique, médical, administratif) à ses acteurs en difficulté
- en dynamisant ses politiques de recherche, par la promotion inévitable d’innovations
scientifiques liées aux besoins énergétiques de demain, mais aussi par une réflexion sur le rôle de la
médecine, de l’économie, des sciences humaines dans le développement durable
- en mettant en œuvre une nouvelle politique de formation et d’information, non
seulement en direction des étudiants ou de l’ensemble de ses acteurs, mais aussi en direction de
l’environnement économique et social de l’université.

Introduction
RAPPORT DD 3
La modification des pratiques dans de multiples secteurs (transport, habitat, énergie,
alimentation, déchets) implique également de nouvelles formes de gouvernance, plus élargies, qui
tiennent compte de l’imbrication complexe des préoccupations économiques, sociales et
environnementales.
Le groupe de réflexion sur le développement durable, outre la mise en place d’actions
rappelées dans les pages qui suivent, s’est efforcé de poser les premiers jalons d’une politique de
développement durable. Le pré-rapport présenté au CA en octobre 2008 avait défini les grands
objectifs de cette politique : maîtriser la politique énergétique ; réduire l’empreinte écologique ;
améliorer la mobilité ; construire une université durable et citoyenne.
Ce rapport final se compose de trois parties
- une présentation générale du cadre juridique et des outils disponibles pour élaborer et
piloter une stratégie de développement durable
- une proposition de système de gouvernance permettant de placer le développement
durable au cœur de l’action de l’université
- une présentation des actions en cours et à développer pour chaque objectif.

Cadre et outils
RAPPORT DD 4
PREMIERE PARTIE
CADRE ET OUTILS POUR UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
La stratégie de développement durable de l’université s’inscrit dans un système complexe
dont le cadre est en cours d’écriture et les éléments sont divers, depuis l’autorité de tutelle
jusqu’aux collectivités locales, en passant par l’environnement économique et social, et sans
oublier les universités partenaires, notamment au sein du PRES.
Comme tout paradigme nouveau, le développement durable implique créativité, innovation
et expérimentation. Des outils existent qui permettent de partager les bonnes pratiques ou de
piloter des opérations coûteuses, notamment en mettant en œuvre des initiatives communes avec
les collectivités territoriales et l’université d’Orléans.
1. Le cadre juridique actuellement en construction nécessite une veille constante
1.1. Les lois du Grenelle de l’environnement sont créatrices de contraintes nouvelles mais
aussi de pistes de réflexion
1.1.1. Les textes juridiques mettent en place des délais contraignants
La loi Grenelle I précise quelques délais :
- plan vert des Universités pour la rentrée 2009 (cf. infra) ;
- fin 2009, bilan de la consommation énergétique et de la consommation des GES [art. 48]
- audit des bâtiments pour 2010 [art. 5] ;
- réduire d’au moins 40% les consommations et 50% les GES d’ici 2020, en entreprenant des travaux
de rénovation dès 2012 [art. 5]
- dès 2010, toutes les constructions doivent être « basse consommation » (50 kWh/m2/an et 5t
CO2/m2/an) [art. 4]
- pour 2015, le recyclage de déchets matière et organique doit atteindre 45% [art. 46], ce qui
conduira sans doute à un relèvement des redevances pour l’enlèvement des ordures
- dès 2009, mise en place de « l’État exemplaire »
• 2009 : achat de véhicules pour l’administration éligibles au bonus écologique
• 2009 : développer TIC et visio-conférences
• 2010 : achat de bois issus de forêts gérées de manière durable
• d’ici 2012 : abaisser la consommation de papier et passer au papier recyclé
- d’ici 2012, la formation initiale et continue des agents de l’État devra comporter des
enseignements sur le développement durable
1.1.2. Les principales mesures obligent à évoluer dans la prise de décision
Ces délais s’imposeront rapidement dans les choix concernant :
- les bâtiments : le coût induit par les normes basse consommation énergétique conduira sans
doute à diminuer la taille de certains locaux, du moins pour les premières années en tenant compte
d’une baisse progressive de ces coûts HQE au fur et à mesure de l’évolution technique ;

Cadre et outils
RAPPORT DD 5
- l’alimentation : l’ouverture éventuelle de cafeterias à l’université, gérée par des associations
ou par l’université, devra tenir compte des règles d’approvisionnement fixées par le Grenelle, ainsi
que des impératifs liés au recyclage (et notamment compostage). Sur ce dernier point, la cafeteria
de Grandmont mettra en œuvre dès la rentrée 2009 une expérimentation sur le compostage des
déchets alimentaires (cf. fiche action).
1.2. Ce cadre juridique reste limité, puisque les lois, qui concernent essentiellement les
aspects environnementaux, sont encore en discussion et que les décrets n’en sont toujours pas
paru
1.2.1. La loi Grenelle I est une loi d’orientation qui sera complétée par la loi Grenelle II et
par des décrets d’application
Le projet de la loi Grenelle II portant engagement national pour l’environnement a été
adopté par le Sénat le 9 octobre 2009 ; il est actuellement en discussion devant l’Assemblée
nationale (procédure accélérée).
Cette loi fixe les conditions d’exercice de la loi Grenelle I. Les points intéressant
l’université sont :
- l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (modifications du code de la
construction et de l’habitation et du code de l’environnement
• contrôle de prise en compte de la réglementation thermique (nouvelle réglementation
thermique : RT 2012) ;
• diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments avec système de
chauffage/refroidissement collectif ;
• travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à
usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de huit
ans à compter du 1er janvier 2012 ;
• bilan des émissions à effets de serre pour les personnes morales de droit public employant
plus de 250 personnes, mis à jour tous les cinq ans [art.26] ;
• installation de systèmes de comptage de l’énergie dans les réseaux de distribution de
chaleur :
• toute personne morale propriétaire de ses bâtiments peut exploiter une installation de
production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, par le biais de générateurs fixés
ou intégrés aux bâtiments [art. 33].
- l’amélioration de la mobilité
• les constructions de bâtiments tertiaires doivent intégrer des prises électriques pour
rechargement des véhicules au niveau des parkings (post 2012)
- la prise en compte de l’environnement dans l’urbanisme
• étude d’impact préalable pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements
publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions, leur localisation, sont susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine [art. 96]
• élaboration de « directives territoriales d’aménagement et de développement durable »,
de « documents d’orientation et d’objectifs » [art. 5], de schémas régionaux du climat, de l’air
et de l’énergie [art.23], et de schémas régionaux de cohérence écologique [art. 45], élaborés
par l’État/les préfets avec les collectivités territoriales
Au vu de la place de l’université François Rabelais dans son environnement urbain,
celle-ci aurait tout intérêt à collaborer à l’élaboration de ces documents.
- la biodiversité :
• plans nationaux d’action pour la conservation et le rétablissement des insectes
pollinisateurs [art. 48]
- le recyclage et la gestion des déchets
• possibilité d’utilisation à des fins domestiques d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment
alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine, à
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%