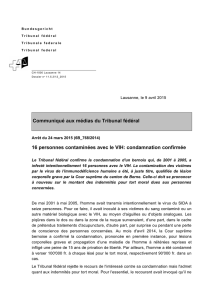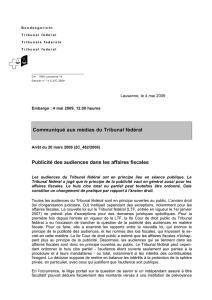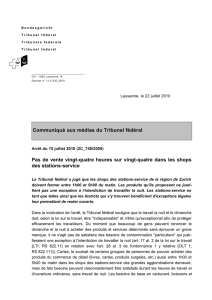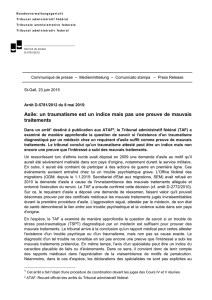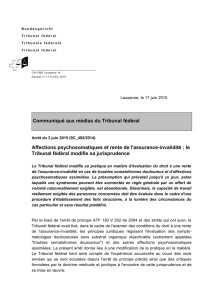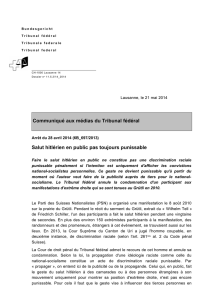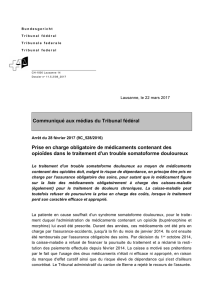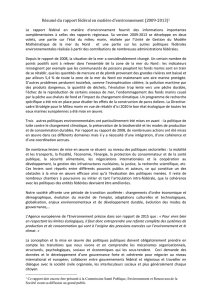Bertil Cottier

Les droits des médias
Bertil Cottier
I. Remarques liminaires
Le présent support de cours ne se veut pas exhaustif ; ainsi il ne traite pas toutes les
questions relatives au droit de la communication, mais se concentre sur celles qui
impactent directement les activités des médias de masse que sont la presse écrite, la
radio et la télévision.
Après une introduction générale consacrée au cadre constitutionnel du droit de la
communication (en particulier la liberté de l’information et ses principales exceptions),
on abordera d’abord les règles qui gouvernent la recherche d’informations (lois sur
l’accès à l’information, secret rédactionnel notamment), puis celles qui visent leur
publication, à commencer par le régime juridique de la protection de la vie privée et
de l’honneur. Le droit commun des médias ainsi exposé, on se penchera ensuite sur le
statut de la radiodiffusion, et plus spécialement sur l’obligation de diligence accrue qui
s’impose aux journalistes de radio et de télévision.
La communication en ligne aurait elle aussi pu faire l’objet d’un chapitre distinct. Il
n’en sera rien. En effet la plupart des règles pertinentes sont technologiquement
neutres, autrement dit s’appliquent tant aux vecteurs de communication classiques
qu’aux nouvelles technologies (plateformes internet, réseaux sociaux, forums de
discussion ou blogs). Dès lors les particularités de la communication en ligne seront
évoquées ponctuellement, au sein des différentes sections du présent support.
Il convient en outre de relever que le régime juridique que nous décrirons ne résulte
pas d’un seul et unique texte de loi ; au contraire des règles sur le trafic automobile qui
ressortissent toutes à la seule loi fédérale sur la circulation routière, celles qui régissent
les médias sont éparpillées dans plusieurs textes légaux allant de la constitution
fédérale au code pénal, en passant, entre autres, par le code civil, la loi sur les
télécommunications, la loi sur la radio et la télévision et la loi sur la concurrence
déloyale
1
. A ces règles émanant du souverain, s’ajoutent celles dites déontologiques
qui gouvernent la profession de journaliste, telle la Déclarations des droits et devoirs
du journaliste. En dépit de leur importance pratique, ces normes autorégulatrices ne
seront que rarement abordées ici, car elles sont dénuées de toute force contraignante.
Dernière remarque: tant que faire se peut, la présentation du contenu des règles
pertinentes sera illustrée d’exemples tirés de la jurisprudence du Tribunal fédéral –
1
A quoi il faut ajouter la loi sur le droit d’auteur qui ne sera pas traitée dans le présent support de
cours.

Bertil Cottier Les droits des médias CFJM
2
l’autorité judiciaire suprême de notre pays – et de la Cour européenne des droits de
l’Homme. Ces exemples concrets permettront au lecteur de « digérer » plus facilement
une matière qui, de par sa nature juridique, demeure des plus sèches. Cela dit, la
vocation du présent condensé n’est pas de se suffire à lui-même, mais de servir d’appui
à des cours-séminaires destinés à l’étude de cas pratiques.
II. Le cadre constitutionnel : la liberté de l’information
II.1. Généralités
Fruit des révolutions américaine et française, à la fin du XVIIIème siècle, les libertés
fondamentales du citoyen (liberté de l’information, liberté d’association, liberté du
commerce et de l’industrie, liberté de religion, etc.) ont pour objectif de garantir aux
citoyens une sphère d’autonomie, sphère que les autorités publiques se doivent de
respecter. Ces libertés individuelles sont aujourd’hui ancrées dans les constitutions de
tous les Etats modernes (ce qui ne veut pas dire qu’elles sont partout prises au
sérieux…) ; elles sont aussi consacrées par deux traités internationaux importants : le
premier est global, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le second
est régional, la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH). L’un
et l’autre texte ont été ratifiés par la Suisse.
Aucune liberté n’est absolue : des impératifs prépondérants, telle la sécurité extérieure
ou la moralité publique, peuvent justifier des restrictions ponctuelles. Ces restrictions
ne sauraient être décrétées à la légère : elles doivent être prévues par un texte légal (en
règle générale une loi adoptée par le parlement), répondre à un intérêt public avéré et
être proportionnelle au but poursuivi (autrement dit, la restriction ne doit pas être
excessive). Le contrôle du respect de ces trois conditions est l’affaire des tribunaux, sur
plainte de citoyens lésés.
Il importe de souligner que, dans leur conception classique, les libertés fondamentales
ne protègent le citoyen que contre les ingérences émanant d’autorités publiques ; elles
sont en revanche inopérantes à l’encontre des atteintes commises par des privés (p. ex.
l’employeur peut à sa guise interdire à un employé de s’exprimer sur un sujet
déterminé). Qui plus est, les libertés n’imposent à l’Etat qu’un devoir d’abstention ;
elles ne fondent pas de quelconques revendications à la fourniture de prestations
concrètes (p. ex., l’Etat ne peut être contraint, au nom de la liberté d’association, de
mettre à disposition une salle de réunion pour l’assemblée d’un parti politique).
II.2. La liberté de l’information
Au sein du catalogue des libertés, il en est une qui joue un rôle déterminant dans un
régime démocratique : la liberté de l’information, aussi appelée liberté d’expression ou
liberté de communication. La démocratie se nourrit en effet du débat des idées : elle
ne peut exister sans possibilité de communiquer, de discuter et de critiquer sans
entraves. Comme l’a souligné le Tribunal fédéral
2
: « La liberté d'expression n'est pas
2
ATF 96 I 52.

Bertil Cottier Les droits des médias CFJM
3
seulement, (…), une condition de l'exercice de la liberté individuelle et un élément
indispensable à l'épanouissement de la personne humaine; elle est encore le fondement
de tout Etat démocratique: permettant la libre formation de l'opinion, notamment de
l'opinion politique, elle est indispensable au plein exercice de la démocratie. Elle mérite
dès lors une place à part dans le catalogue des droits individuels garantis par la
constitution et un traitement privilégié de la part des autorités ».
Le terme générique de liberté de l’information recouvre diverses libertés plus
spécifiques telles la liberté de l’art, la liberté de la langue ou la liberté des médias. Cette
dernière expression a aujourd’hui supplanté celle de liberté de la presse, tombée en
désuétude en raison de la diversification des moyens de communication de masse.
Alors que la CEDH traite de la liberté de l’information dans une seule disposition (l’art.
10), la Constitution suisse lui en consacre deux: l’art. 16, intitulé liberté d’opinion et
d’information, et l’art. 17, appelé liberté des médias. Cette différence est cependant
plus formelle que substantielle, ces dispositions tendant toutes à assurer une
communication plurale et indépendante. La Constitution suisse a toutefois l’avantage
de préciser quelques éléments importants.
D’abord, elle interdit expressément l’arme des tyrans qu’est la censure
(art. 17. al. 2). L’interdiction ne vise toutefois que la censure dite
préalable ; autrement dit, l’Etat n’est pas en droit de contrôler (ni de
bloquer) les produits médiatiques avant leur publication (sauf mesures
provisionnelles ; voir page 35, lettre D) ou leur diffusion. En revanche,
s’il s’avère ensuite qu’un article de presse ou une émission télévisée était
illicite (p. ex. parce que son contenu était diffamatoire ou
pornographique), les autorités sont en droit d’intervenir.
Ensuite, l’art. 17 al. 3 reconnaît expressément le secret rédactionnel, soit
le privilège des journalistes de refuser de témoigner sur les sources d’une
information confidentielle. Nous détaillerons plus avant les modalités
d’exercice de ce privilège (cf. III.21) ; à ce stade, on se contentera de
souligner que la consécration constitutionnelle du secret rédactionnel est
un signal fort, qui met en exergue le rôle primordial de cette institution
dans un régime démocratique.
Enfin, l’art. 16 al. 1 garantit la libre formation des opinions. En
conséquence, l’Etat doit s’abstenir de toute forme de propagande. Plus
concrètement, l’activité journalistique n’est pas de son ressort ; ainsi, il
n’est pas en droit d’éditer un quotidien d’information générale ou
d’exploiter une station de radiodiffusion.
On notera finalement que notre constitution ne prévoit aucune mesure concrète
tendant à assurer le pluralisme des médias, quand bien même celui-ci est toujours plus
menacé par la concentration des organes de presse et la disparition de nombreux titres
en manque de ressources financières. Plusieurs propositions de norme
constitutionnelle tendant à octroyer à la Confédération la compétence de réguler le

Bertil Cottier Les droits des médias CFJM
4
marché de l’information, notamment par le biais d’interdictions d’acquisition ou de
fusion, ou encore par l’allocation de subsides aux médias en difficultés, ont échoué. La
seule mesure interventionniste en vigueur dans notre pays est une aide à la
distribution des publications : quelque 150 journaux et magazines, locaux ou
régionaux, bénéficient d’un rabais substantiel sur les tarifs postaux (art. 16 de la loi
fédérale sur la poste).
II.3 Les restrictions à la liberté de l’information
Comme toutes les libertés fondamentales, la liberté de l’information peut être
restreinte en cas de nécessité. Les motifs de restriction de cette liberté sont avant tout
la sécurité extérieure ou intérieure (ainsi p. ex. toute propagande en faveur d’Al-Qaïda
ou de l’Etat islamique est interdite
3
), la santé et la moralité publiques, la dignité
humaine, ainsi que la vie privée et le droit à l’honneur. Cette dernière catégorie de
restrictions faisant l’objet d’un chapitre spécifique (cf. IV), les lignes qui suivent seront
consacrées à la présentation de trois importantes restrictions, fondées sur la protection
des bonnes mœurs : les interdictions de la pornographie, de l’atteinte aux sentiments
religieux et du discours raciste. S’il est rare que des journalistes enfreignent
directement l’une ou l’autre de ces trois interdictions, cela ne veut pas dire qu’elles ne
concernent pas les médias.
Cela dit, il importe de relever d’emblée que la Cour européenne des droits de l’Homme
a, à de multiples reprises, insisté sur le fait que les restrictions à la liberté de
l’information doivent demeurer exceptionnelles ; il est hors de question de réprimer
des informations qui simplement « heurtent, choquent ou inquiètent » la population
4
.
Ces informations, pour dérangeantes soient-elles, doivent être tolérées dans un régime
démocratique et pluraliste.
II.31 La pornographie
La pornographie est régie par l’art. 197 du Code pénal. Cette disposition, longue et
complexe, distingue la pornographie dure de la pornographie douce : en bref, la
première est absolument interdite ; la seconde ne l’est que dans certains cas.
Par pornographie dure, on entend la représentation crue des organes génitaux ou de
l’acte sexuel impliquant des enfants, des violences, des excréments ou des animaux.
Sauf motif culturel, ces représentations sont toujours punissables. Est considéré
comme pornographie douce, toute autre représentation des organes génitaux ou de
l’acte sexuel. La pornographie douce n’est punissable que dans deux cas :
premièrement si la représentation est accessible aux mineurs de moins de 16 ans et/ou
à des adultes qui n’en veulent pas ; deuxièmement, si elle est radiodiffusée.
3
Voir l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les
organisations apparentées (2014).
4
Voir pour la première fois, l’arrêt Handyside c./ Grande-Bretagne (CEDH 7 décembre 1976).

Bertil Cottier Les droits des médias CFJM
5
On notera que toute personne qui, le sachant et le voulant, participe à la production et
à la diffusion de pornographie dure (ou douce, si illicite) peut être sanctionné.
II.32 L’atteinte aux sentiments religieux
Contrairement à de nombreux pays (la France en particulier), la Suisse sanctionne les
propos et les représentations blasphématoires, à l’art. 261 du Code pénal. Cette
disposition n’a pas pour but de protéger les croyances en tant que telles, mais la paix
publique. On rappellera que, par le passé, les conflits religieux (guerre de religions,
Sonderbund) n’ont pas épargné notre pays.
Resté pendant des décennies quasiment lettre morte, l’art 261 CP connaît aujourd’hui
un regain d’actualité. La recrudescence des attaques, verbales ou écrites, contre les
convictions religieuses des uns et des autres (notamment contre celles des minorités
ou des étrangers) en est la cause.
L’art. 261 ne réprime pas n’importe quelle plaisanterie, provocation ou insulte
désobligeante, susceptible de heurter les sentiments des croyants. Pour être
punissable, l’attaque doit revêtir un caractère délibérément crasse et offensant. En
conséquence, la critique ou la satire des croyances, même de mauvais goût, doivent
être tolérée.
II.33 Les propos racistes
Après bien des tergiversations (et suite à un vote populaire en 1994), la Suisse s’est
finalement dotée d’une norme dite antiraciste, l’art. 261bis. Notre pays fut l’un des
derniers d’Europe à prendre des mesures contre le discours haineux et la propagande
raciale.
L’art. 261bis n’entend pas censurer le débat politique sur les étrangers ou les
minorités ; ainsi, même s’il est peu sympathique, un appel à renvoyer tous les réfugiés
tamouls dans leur pays n’a rien de répréhensible. Ce que le législateur a voulu
sanctionner, c’est le dérapage verbal, à savoir les propos dégradants qui tendent à
dénigrer une race ou une ethnie ou à inciter à la haine contre leur appartenance, telle
l’insulte « sales noirs » ou l’assertion vile « les Juifs sont d’une cupidité satanique ». Est
également réprimée, la propagation d’une idéologie rabaissant systématiquement une
race ou une ethnie.
Toute forme de communication haineuse - la parole, l’écrit ou l’image – tombe sous le
coup de la norme antiraciste. En outre, contrairement à la disposition sanctionnant la
pornographie, un quelconque objectif culturel n’est pas une excuse.
On relèvera enfin que l’art. 261bis réprime aussi le négationnisme, par quoi il faut
entendre la mise en doute d’un génocide (notamment, mais uniquement, l’holocauste
des juifs commis par l’Allemagne nazie). La disposition vise également la
minimisation ou la justification d’un génocide.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
1
/
45
100%