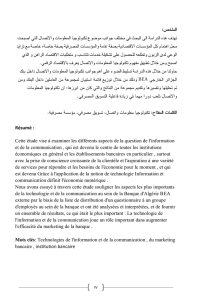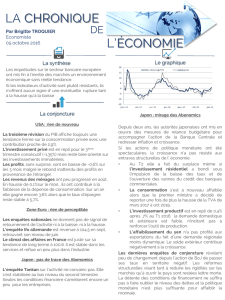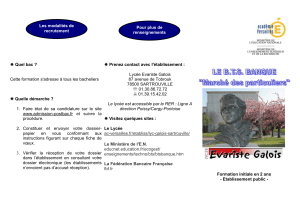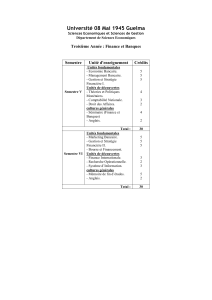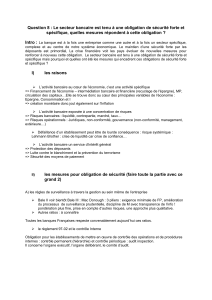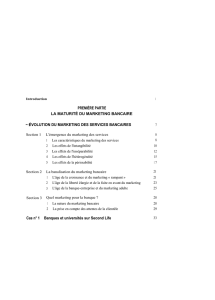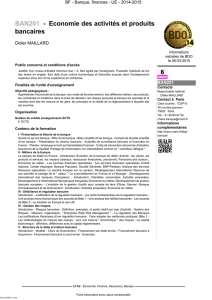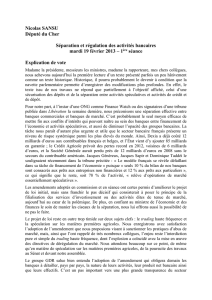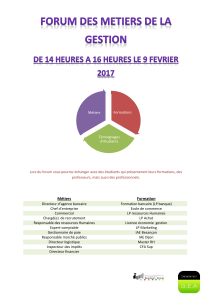La zone euro scelle l`union bancaire

Actu SES © Hatier – Joëlle Bails
Fiche d’exploitation pédagogique
1
La zone euro scelle l’union bancaire
Jean Quatremer, Libération, 17 décembre 2013.
Avec le projet d’union bancaire, la résolution des crises relèvera, à terme, des
institutions européennes, et non plus des États.
C’est une révolution qui s’annonce : la création d’une union bancaire au sein de la zone euro
qui fera sortir les banques du giron des États. Dès le 1er novembre 2014, la surveillance des
6 000 banques de la zone sera confiée à la Banque centrale européenne (BCE) et, en 2016 au
plus tard, la résolution des crises bancaires reviendra aussi aux autorités communautaires. Il
s’agit du plus grand saut fédéral depuis la création de la monnaie unique, un partage de
souveraineté qui était encore inimaginable il y a deux ans. […]
Pourquoi une union bancaire ?
La zone euro poursuit plusieurs objectifs. D’abord, briser le cercle vicieux entre dette bancaire
et dette publique, l’intervention des États pour sauver leurs banques mal surveillées par leur
autorité nationale (les banques centrales dans la plupart des cas) s’étant traduit par un apport
massif de fonds publics et, donc, par un accroissement insupportable de l’endettement.
Ensuite, rétablir la stabilité financière, et donc la confiance entre les banques afin qu’elles se
prêtent à nouveau entre elles. Et ce, en les assurant que la supervision sera vraiment efficace
et permettra de débusquer les canards boiteux. Enfin, lutter contre la fragmentation du marché
bancaire consécutif à la crise. Actuellement, lorsqu’une PME demande un crédit
en Allemagne, elle obtient satisfaction dans 85 % des cas, en Italie et en Espagne, dans 45 %
des cas, et en Grèce, dans 21 %. Surtout, les taux d’intérêt sont nettement plus lourds dans les
pays en difficulté financière, ce qui accroît les déséquilibres internes à la zone euro.
Comment fonctionnera l’union bancaire ?
Elle comportera deux piliers : un mécanisme de supervision unique (présidé pour cinq ans par
la Française Danièle Nouy), placé sous l’autorité de la BCE, chargé de surveiller directement
les 250 principaux établissements représentant 85 % des actifs bancaires. Ce principe de la
surveillance unique a été acté en décembre 2012 et entrera en vigueur le 1er novembre 2014,
lorsque la BCE aura achevé de recruter les quelque 1 000 « surveillants ». Le second pilier, la
résolution des crises bancaires, est en cours de négociation. En effet, même si la vigilance est
fortement renforcée, un problème pourra toujours surgir. La Commission propose que ce soit
elle-même qui décide « d’appuyer sur le bouton » qui déclenchera la restructuration, celle-ci
étant préparée en amont par un « conseil de résolution » composé d’experts et de
représentants des autorités nationales concernées. Ensuite, le coût de la résolution ne serait
supporté par les contribuables qu’en dernier ressort. À l’avenir, la hiérarchie de ceux qui se
prendront une taule sera la suivante : dans l’ordre, les actionnaires, les créanciers obligataires
des banques et, éventuellement, les déposants détenant des comptes de plus de 100 000 euros.
Enfin, si tout cela ne suffit pas, un fonds de résolution bancaire, alimenté par des taxes sur les
banques, d’environ 50 ou 60 milliards d’euros, interviendra pour aider à la restructuration.
Enfin, en cas de gros pépin, le Mécanisme européen de stabilité (MES), doté de 750 milliards
d’euros, pourrait être appelé en renfort, ce qu’on appelle un backstop (« filet de sécurité »).
C’est lui qui garantira la crédibilité de l’ensemble du mécanisme de résolution, à l’image de
ce qui se passe aux États-Unis où c’est le budget américain qui sert de garantie.

Actu SES © Hatier – Joëlle Bails
Fiche d’exploitation pédagogique
2
Les objections allemandes ?
Même si elle a accepté le projet d’union bancaire à la suite des pressions de François
Hollande et de Mario Monti, Angela Merkel a essayé d’en limiter la portée. Ainsi, elle a
réussi à faire échapper ses caisses d’épargne et ses Landesbanken à la supervision directe de
la BCE. Maintenant, elle essaye de retarder la mutualisation des pertes bancaires et se montre
réticente face à un mécanisme trop fédéral. Il est certes déjà acquis que le fonds de résolution
ne sera totalement mutualisé qu’au terme d’une période de dix ans. Mais si un problème
survient avant 2026, il faudra que les États interviennent sur fonds publics. D’où l’importance
de permettre au MES de prêter main-forte aux autorités européennes de résolution le plus tôt
possible : or les Allemands le refusent fermement pour l’instant. « Si le souverain européen
ne garantit pas le risque, on refragmente le risque bancaire selon la qualité du souverain
national », met en garde l’Élysée. Dans la même veine, Berlin exige que le Conseil des
ministres des Finances partage avec la Commission le pouvoir de décider ou non d’une
résolution bancaire, et qu’au sein du « conseil de résolution », les voix soient pondérées en
fonction de l’importance de chaque pays… Une usine à gaz que le Parlement européen rejette
par avance, mais aussi la BCE.
Exploitation pédagogique
Objectif de méthode : repérer la structuration d’un document
Objectif de contenu : comprendre le projet d’union bancaire
Montrer comment la clarté de la structuration facilite la compréhension.
1. Repérer la structure de l’article
a. Quel est l’objet du premier paragraphe du document ?
b. Pour chacun des paragraphes suivants, surlignez (ou soulignez) avec des couleurs
différentes :
- L’idée générale du paragraphe,
- Chacun des éléments de réponse à la question posée par l’intertitre,
- Les mots de liaison qui indiquent la progression de l’argumentation.
2. Comprendre l’union bancaire
a. Quel est le nouveau mode de supervision des banques mis en place dans la zone euro ?
b. Quelles sont les nouvelles règles prévues pour renflouer les banques en cas de crise
bancaire ?
c. Expliquez pourquoi le document qualifie le projet d’union bancaire de « saut fédéral ».
d. Pourquoi l’union bancaire devrait-elle permettre de limiter les risques pour les budgets
publics ?
e. Pourquoi l’union bancaire devrait-elle améliorer la confiance ?
f. Montrez que le projet d’union bancaire comprend cependant des limites.

Actu SES © Hatier – Joëlle Bails
Fiche d’exploitation pédagogique
3
Corrigé
1. Repérer la structure de l’article
a. Le premier paragraphe introduit le thème de l’article : le projet européen d’union bancaire. Il
en précise le calendrier et la portée générale.
b. Chacun des paragraphes débute par un intertitre posant une question : Pourquoi ?
Comment ? Quelles limites ? Puis une phrase introductive annonce l’idée générale, qui est
ensuite déclinée en éléments de réponse.
Pourquoi une union bancaire ?
Plusieurs objectifs.
D’abord, briser le cercle vicieux entre dette bancaire et dette publique.
Ensuite, rétablir la stabilité financière.
Enfin, lutter contre la fragmentation du marché bancaire consécutif à la crise.
Comment fonctionnera l’union bancaire ?
Deux piliers :
- un mécanisme de supervision unique,
- le second pilier, la résolution des crises bancaires.
Les objections allemandes ?
Angela Merkel a essayé d’en limiter la portée.
Ainsi, elle a réussi à faire échapper ses caisses d’épargne et ses Landesbanken à la supervision directe
de la BCE.
Maintenant, elle essaye de retarder la mutualisation des pertes bancaires et se montre réticente face
à un mécanisme trop fédéral.
2. Comprendre l’union bancaire
a. La surveillance des banques sera effectuée par la BCE et non par chacune des banques
centrales nationales.
b. Le principe est de privilégier un renflouement interne (« bail-in ») par les actionnaires et les
créanciers des établissements bancaires plutôt qu’un renflouement externe (« bail-out ») par
l’argent public. Les premiers à payer seront les actionnaires, puis les détenteurs d’obligations
et enfin les gros déposants (comptes supérieurs à 100 000 euros). Si cela ne suffit pas, il sera
fait appel à un fonds de résolution bancaire alimenté par les contributions des banques. Et
enfin, en dernier recours, un filet de sécurité public, l’appel au Mécanisme européen de
stabilité.
c. On observe un transfert de souveraineté de l’échelle nationale à l’échelle communautaire :
un mécanisme de supervision unique à l’échelle européenne se substitue aux autorités
nationales à compter du 1er novembre 2014 ; la résolution des crises doit aussi être confiée
aux autorités communautaires avec la création d’un fonds mutualisé financé par le secteur
bancaire (mise en place progressive de 2016 à 2026).

Actu SES © Hatier – Joëlle Bails
Fiche d’exploitation pédagogique
4
d. En 2008, le sauvetage des banques par les États a considérablement dégradé les finances
publiques dans la plupart des pays européens. L’union bancaire devrait permettre de briser
le lien entre dette bancaire et dette publique, d’une part en rendant la surveillance plus
efficace, ce qui limite les risques de crise bancaire, d’autre part, en faisant supporter le coût
des restructurations d’abord aux banques elles-mêmes.
e. La surveillance par la BCE est plus crédible que celle opérée par les autorités nationales. En
effet, il devenait urgent d’adapter le niveau de surveillance des banques à l’échelle de leurs
activités (européenne et même au-delà). On peut aussi penser que les banques, rassurées
sur la solidité du système bancaire, accepteront plus facilement de se refinancer
mutuellement. Ou encore que les investisseurs dans le système bancaire (actionnaires,
détenteurs d’obligations) davantage responsabilisés, ne sous-évalueront pas les risques.
f. Limites imposées notamment par les réticences allemandes à aller vers davantage de
fédéralisme, à la fois du côté de la supervision et du côté de la résolution des crises.
Ainsi, la supervision unique ne s’appliquera qu’aux très grandes banques de la zone euro
(environ 85 % des actifs bancaires). Quant au mécanisme de résolution, la mutualisation du
fonds financé par les banques sera très progressive, étalée sur dix ans. D’ici là, ce fonds
européen sera composé de compartiments nationaux, chaque pays intervenant pour ses
propres banques. Enfin, les modes de décision prévus en cas de crise bancaire sont très
complexes (« usine à gaz ») alors même qu’une faillite bancaire exige une réaction très
rapide des autorités.
1
/
4
100%