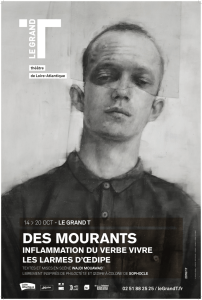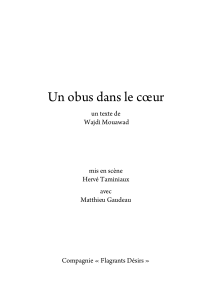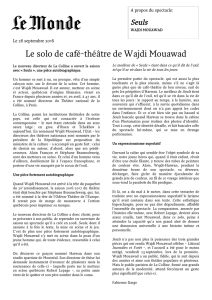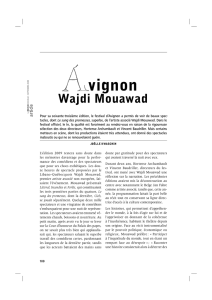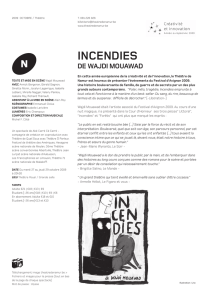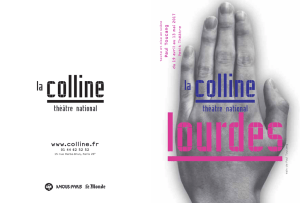Visage retrouvé

Visage retrouvé
D’après le roman de Wajdi Mouawad
Leméac / Actes Sud, 2002
«
On est de son enfance comme on est d’un pays
»,
a dit Antoine de Saint-Exupéry.
Il a dit aussi : «
L’enfance, heureuse ou malheureuse, on ne s’en remet
pas
».

L’histoire
Pour son quatorzième anniversaire, Wahab a reçu la clef de la porte d’entrée de
l’appartement familial. A l’intérieur, il n’y reconnaît plus sa mère, affublée d’une
longue perruque blonde, elle d’ordinaire si brune…
Cinq ans plus tard, la sonnerie du téléphone retentit en pleine nuit : « Allo, Wahab,
viens vite ! ». Sur le chemin qui le conduit à l’hôpital, l’adolescent, devenu étudiant
aux Beaux-arts, reconstruit le puzzle de sa vie.
Première adaptation théâtrale du seul roman écrit par Wajdi Mouawad, en accord
avec celui-ci la compagnie La Nuit Venue propose une rencontre entre différents
univers artistiques. Sur le plateau, comédiens et danseurs cohabitent pour faire
émerger les images fortes de cette histoire et les démons de l’enfance.
La dramaturgie
Tout part de souvenirs épars d’une enfance déjà lointaine.
Rentrant chez lui le jour de ses quatorze ans, Wahab ne reconnaît plus les membres
de sa famille, spécialement sa mère, à la chevelure brune inexplicablement
devenue blonde.
Le lecteur de ce roman, qui a un certain surplomb, ne tarde pas à s’expliquer les
choses de la façon suivante : cette mère est gravement malade, cette perruque
blonde est le stigmate d’une chimiothérapie, cela explique aussi un changement
d’ambiance dans ce foyer. Mais l’accent n’est pas mis sur cet indice.
L’adolescence est l’époque à laquelle se produisent les « premières fois » qui font
que le monde est métamorphosé. Par qui, comment ? Voilà la question à laquelle le
texte tente de répondre.
C’est le regard perturbé de l’enfant qui nous est donné en partage. D’autant plus
qu’il choisit de parler de lui à la troisième personne du singulier, accentuant encore
le côté schizophrénique de son histoire : privé des liens normaux avec sa famille,
baigné dans l’ambiance délétère d’un foyer où règne les préoccupations de la
maladie, il se raccroche de plus en plus aux individus externes, n’importe lesquels,
dont il extrapole les dires et les gestes : clochard qui lui offre le mot « pervenche »,
copains à l’extraordinaire loyauté, usager du métro étrangement prophétique,
vieillard mourant, voisine compréhensive, fillette muette, adultes bons parents,
policiers grotesques. Chacun des personnages rencontrés est caractérisé au moyen
d’archétypes propres aux contes, mais point de fées dans ce récit. On se situerait
plutôt dans un monde kafkaïen.
Econduit par les événements qui s’enchaînent et se bousculent depuis que le visage
de sa mère s’est perdu dans les méandres de sa mémoire, Wahab fait une fugue.

A aucun moment on ne peut conclure de la véracité du récit qui, s’il s’appuie sur
une véritable fugue, est aussi une fugue dans l’imaginaire, ce qu’on appelle une
fuite en avant. Cette fugue est un retour au point de départ, mais elle a permis au
locuteur de s’expliquer le monde et ses mutations au moyen d’éléments
mythologiques à peine déguisés.
Flash back : le locuteur a 4 ans. Il se souvient que l’on s’inquiétait de son caractère
rêveur, de son mutisme, qu’il aimait rêvasser et jouer, comme tant d’autres enfants
de son âge.
Le locuteur a 7 ans et la guerre frappe son pays, sa ville et sa vie : sa famille
s’expatrie. Il est fasciné par les feux d’artifice de la guerre, comme tant d’autres
enfants de son âge. Il crée un lien amical fugace avec un autre enfant installé dans
un bus. Le bus prend feu. Il voit apparaître pour la première fois le spectre de la mort
sous la forme d’une femme aux membres de bois et à la chevelure blonde.
Dans une dernière partie, le locuteur a 19 ans, il a une petite amie comme tant
d’autres à son âge. Il a choisi sa voie (il est artiste peintre), mais il a conservé son
caractère frondeur, son langage s’est durci. C’’est ce qui fait de cette dernière
partie celle qui admet le mieux un passage en scène : il y a un langage.
Retour à la première personne du singulier et explication du choix qui avait été fait
de parler à la troisième personne. Désormais, le locuteur peut dire « avant » et
s’expliquer à lui-même un certain nombre de choses relatives à son passé. Cela
aussi rend ce chapitre plus théâtral. Il y a théâtre lorsqu’il y a un « avant » et que cet
« avant » est mis en regard avec l’ici et maintenant du théâtre.
C’est la nuit. Le téléphone retentit. Wahab décroche : « Allo Wahab, viens
vite ! Schlack. » C’est tout. C’est comme ça que Wahab apprend que sa mère est à
l’agonie.
Cette dernière partie rapporte une nouvelle errance, plus courte en apparence que
la fugue des quatorze ans, géographiquement tout au moins, mais tout aussi nantie
de lignes de fuite imaginaires.
Le monde de l’enfance refait surface avec un épisode le confrontant à un vrai-faux
Père Noël, mais l’esprit cartésien et les fantasmes du monde des adultes s’imposent
face à la tentation d’une régression.
Le livre s’achève sur la mort de la mère, une ultime confrontation avec la femme
aux membres de bois (la mort de la mort donc, la disparition des peurs de
l’enfance). Le locuteur est devenu un adulte, comme les autres.
On le voit, ce récit est régi par le mythe de la mort, seule chose que ni l’enfant ni
l’adulte ne parviennent à s’expliquer par aucun recours à la mythologie enfantine
ou autre. Il prend la forme fiévreuse du rêve, ou du cauchemar, parfois en un
enchaînement très serré. L’adaptation scénique de ce texte pouvait se résumer à
un découpage choral, à une représentation de chaque personnage avec, à sa
charge, une partie de ce vaste monologue rêvé. Mais le roman donne au lecteur
d’innombrables fenêtres sur son propre imaginaire, que le théâtre bouscule et
conditionne parfois, le spectateur ne pouvant interrompre le spectacle pour le rêver
un peu.

C’est la raison pour laquelle nous aimerions interpréter ce texte au moyen d’un
groupe composé d’acteurs (de théâtre) et d’« acteurs gestuels » (danseurs…), de
sorte à privilégier le fort contenu visuel et onirique du texte que l’on ferait entendre,
et à créer des extensions de jeu qui ménageraient peu ou prou les mêmes fenêtres
sur l’imaginaire du spectateur. S’il est certain qu’un acteur doit proférer, dire,
défendre, jouer ce texte, un pool d’artistes gestuels serait nécessaire pour donner à
voir et à sentir les énormes potentialités alternatives de ce texte.
Wajdi Mouawad a eu connaissance du projet, l’approuve, d’autant plus que c’est
encore lui-même qui monte ses propres textes dont beaucoup hésitent à s’emparer
de son vivant (!). Cette relecture par le geste est totalement inédite sur un de ses
textes, comme est inédite une version théâtrale de ce roman, son seul roman à ce
jour.

Pourquoi ce choix…
« Il y a plus de dix ans, je me trouvais à Montréal pour jouer un spectacle de la compagnie.
J'allais par hasard assister à une représentation au Théâtre des Quatre Sous, "Le mouton et
la baleine", un texte d'Ahmed Ghazali mis en scène par Wajdi Mouawad.
Ce qui m'avait surtout séduit à l'époque c'était cette mise en scène si différente des autres.
A la sortie de la pièce, je déposais à l'accueil un petit mot avec mon numéro de téléphone à
l'attention du metteur en scène. Sait-on jamais ? J'aurais peut-être un rendez-vous ?
Depuis ces 10 dernières années, des discussions animées, des mails, des engueulades, des
silences ont construit la relation que j'ai aujourd'hui avec Wajdi Mouawad et ce fameux
rendez-vous que j'espérais à Montréal, s’est enfin concrétisé. J'adapte son roman "Visage
Retrouvé".
Pourquoi son roman plutôt qu'une de ses pièces ?
Tout d'abord, il a mis 14 ans à l'écrire et je pense que ces pièces de théâtre, même si elles
sont plus abouties que le roman, ne sont que le prolongement des idées développées dans
celui-ci. Il y a quelque chose qu'on peut lier à l'origine. On y trouve les mêmes fractures,
failles, obsessions. La maladie, la guerre au Liban, la quête d'identité, le parcours initiatique
font déjà partie des thèmes présents dans le roman.
Cette adaptation me laisse beaucoup de souplesse, je ne suis pas tenu, comme lorsqu'on
monte une pièce, de suivre une logique. Là, je m'attaque à un matériau brut et je dois
couper, arranger, déplacer, organiser. Wajdi a bien compris que j'avais besoin de cet espace
car il m'a donné une totale liberté sur tous ses écrits, aussi bien ses pièces que ses réflexions
sur le théâtre. "Tu es libre, fais le spectacle dont tu rêves".
Il m'a offert ses mots, qui sont comme des notes, et je dois maintenant composer ma
partition. Il y a un côté artisanal qui me convient bien.
Aujourd'hui monter "Visage Retrouvé", c'est redécouvrir la joie, l'audace, la curiosité que
j'avais à Montréal. C'est aussi, après dix ans de mise en scène, l'occasion de convoquer des
artistes d'horizons différents et de me retrouver ».
Gil Lefeuvre
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%