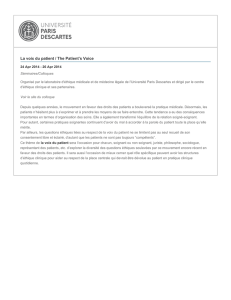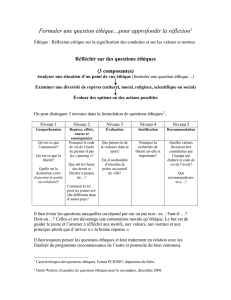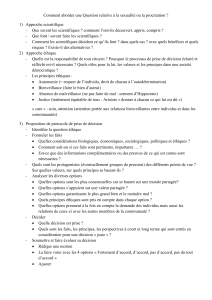Le DRH face à la pression non éthique de son

Le DRH face à la pression non éthique de son employeur : se soumettre ou se démettre ?
Anne Sachet-Milliat
Professeur de GRH et Ethique des Affaires, Institut Supérieur du Commerce de Paris
Chercheur associé au Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC)
Yvan Loufrani
Professeur de droit social, Institut Supérieur du Commerce de Paris
Consultant en stratégie sociale – Président fondateur de TRiPALiUM
1

Introduction
Les entreprises occidentales sont de plus en plus nombreuses à communiquer sur leurs
initiatives éthiques à grand renfort de codes d’éthique et de rapports de responsabilité sociale,
pour répondre à la pression croissante de la société civile. Néanmoins, se pose la question du
réel engagement des firmes capitalistes en matière de RSE, à savoir l’adoption véritable
d’actions volontaristes dans les domaines social et environnemental, allant au-delà des
exigences légales, conformément à la définition que donne livre vert de l’Union Européenne
de la RSE (2001).
En effet, les organisations, soumises à des attentes contradictoires de la part de leur
environnement institutionnel, avec d’un côté des citoyens de plus en plus sensibilisés aux
dérives de la mondialisation et des législations plus sévères, de l’autre des actionnaires aux
fortes exigences de rentabilité à court terme, sont souvent ambivalentes face aux enjeux
éthiques (Sachet-Milliat 2003). Certaines entreprises peuvent être tentées d’alléger ou de
contourner la contrainte légale
1
, voire d’enfreindre la législation pour atteindre leurs objectifs
de rentabilité, du moins à court terme. Elles font alors peser leur propre ambivalence sur leurs
cadres en les conduisant à se comporter de façon non éthique pour le compte de
l’organisation.
Plusieurs études empiriques, menées à différentes époques et dans des zones géographiques
variées, mettent en évidence le fait que l’adoption de comportements non éthiques par les
salariés sous la contrainte est loin d’être un phénomène marginal dans les organisations.
Ainsi, 73% des 6000 managers interrogés par Posner et Schmidt (1984), estiment que les
pressions émanant de l’organisation pour se conformer à ses standards de comportement sont
fortes. 20% des hauts dirigeants, 27% des cadres intermédiaires et 41% des exécutifs
reconnaissent avoir été amenés à parfois compromettre leurs propres principes éthiques pour
répondre aux attentes de leur organisation. Plus le manager est situé bas dans la chaîne
hiérarchique plus il subit les contraintes organisationnelles.
Selon une étude intitulée « Sources and consequence of workplace pressures : increasing the
risk of unethical and illegal business practice » menée en avril 1997 par la American Society
of chartered life underwriters & Chartered Financial consultant et l’Ethics Officer
Association, 48 % des salariés admettent avoir commis au moins un acte non éthique ou
illégal au cours de la dernière année, et 56 % affirment avoir subi des pressions pour se
comporter de cette façon (Greengard 1997).
Enfin, d’après le baromètre stress mis en place par la CFE-CGC (Confédération Française de
l’Encadrement -Confédération Générale des Cadres) en septembre 2003, à la question posée à
un échantillon de 539 cadres français « vous arrive-il d’avoir à exécuter des actions qui ne
correspondent à votre éthique ? », 7% répondent « souvent », 23 % « de temps en temps » et
31% « rarement », seuls 39% affirment ne pas avoir été confrontés à cette situation.
Finalement, la perception qu’ont les salariés de ce phénomène reste relativement proche et
constante dans les trois enquêtes.
La fonction Ressources Humaines semble particulièrement exposée au risque de dérive non
éthique car la législation sociale est complexe, son strict respect source de rigidité
organisationnelle et les charges salariales et sociales représentent une part importante des
coûts des entreprises occidentales, notamment européennes, de plus en plus exposées à la
concurrence de firmes implantées dans des pays à législations sociales beaucoup plus souples
et à coût de main d’œuvre très faible.
2

L’objectif de cette recherche est d’analyser, à la lumière des concepts de la psychologie
sociale et de la législation française en droit social, les pressions auxquels le Responsable des
Ressources Humaines (RRH) peut être soumis par son employeur pour se comporter de façon
non éthique dans l’exercice de leur fonction.
Cet article vise également, après avoir tenté de cerner les phénomènes de déviance en matière
de droit social, à identifier les risques juridiques et psychologiques auxquels le RRH s’expose
lorsqu’il viole la législation sociale pour le compte de son employeur.
Enfin, il s’attache à apporter des pistes de réflexion sur la façon dont le RRH peut réagir et se
protéger face à la pression non éthique.
1. Normes et déviances dans les pratiques de GRH
1.1 Les concepts de comportement non éthique et de délit
L’étude des phénomènes de déviance au sein des organisations se heurte à la difficulté du
choix de la norme à retenir pour déterminer s’il y a déviance.
Deux principaux critères peuvent être retenus : la légalité et la légitimité d’une action (Verna
2002). La légalité est définie comme le « caractère de ce qui est légal, conforme au droit, à la
loi », cette dernière étant elle-même une « règle ou un ensemble de règles obligatoires
établies par l’autorité souveraine d’une société et sanctionnée par la force publique »
(dictionnaire Robert). La légitimité, « qualité de ce qui est juste, équitable, raisonnable »
(ibid.) fait référence au respect ou non des règles de la morale sociale (Lascoumes 1999).
De façon très générale, l’éthique peut être définie comme un ensemble de principes moraux
ou de valeurs qui guident les comportements en indiquant ce qu’il est juste d’accomplir au-
delà même des exigences légales (Steiner et Steiner 1980, Louks 1987). Les réflexions des
philosophes sur l’éthique (Métayer 2003) permettent un questionnement sur nos actes dans les
sphères privées et professionnelles et une meilleure compréhension de ce qu’est un
comportement juste. L’approche déontologique, dans la lignée de la philosophie kantienne
conduira le RRH à ne pas considérer les salariés comme de simples outils de production à
optimiser mais comme des individus, fins en soi. L’approche téléologique encouragera la
recherche du bonheur pour le plus grand nombre et fera donc émerger la conscience des
conséquences de ses actes pour l’ensemble des parties prenantes, actionnaires, salariés, y
compris ceux des sous-traitants, société civile…L’éthique des droits sensibilisera le praticien
des RH à la défense des droits fondamentaux des salariés, se traduisant par le respect du
principe de non-discrimination, de la vie privée, de l’équité en terme de
rémunération…L’éthique de la responsabilité (Jonas) amènera le DRH à réfléchir à l’impact
de ses actes passés et futurs sur les personnes se trouvant dans sa sphère d’influence et à
prendre les mesures nécessaires pour faire face à ses responsabilités notamment dans le
domaine de la sécurité et de la santé au travail et celui de l’employabilité des salariés.
Les critères de légalité et de légitimité se recoupent partiellement mais ne se confondent pas,
certains actes pouvant être légaux mais non légitimes, comme par exemple les délocalisations
d’usines, l’exportation de déchets toxiques dans des pays en autorisant l’importation, le
lobbying, tandis que d’autres, tels que la fraude fiscale ou le travail au noir, apparaissent
légitimes bien qu’illégaux. Les premiers pourront être qualifiés de violence légale, les second
d’activité informelle (Verna, op.cit.).
3

Le concept de comportement non éthique est plus large que celui de délit puisque la norme de
référence permettant de repérer s’il y a violation, à savoir la notion de bien ou de mal, est plus
exigeante que les règles légales.
Le concept de délit offre l’avantage d’être plus opérationnel car les normes juridiques
présentent un caractère moins équivoque, que les normes et valeurs éthiques qui se fondent en
grande partie sur une conviction intime susceptible de varier en fonction des individus.
Néanmoins, la loi ne permet pas toujours de rendre compte de l’ensemble des actes déviants
commis par les délinquants en col blanc car ces derniers sont généralement des individus très
bien socialisés qui savent jouer avec les règles du système et donner l’apparence de la légalité
à leurs actes illégitimes. Par exemple, dans le cas de la corruption, la loi ne condamne que les
formes les plus évidentes où la contrepartie de la transaction apparaît clairement, tandis que
les échanges de faveurs plus subtiles et dématérialisées échappent aux poursuites (Lowenstein
1989, Padioleau 1982, Mény 1992).
Dans le domaine du droit social, nombreuses sont les situations où la frontière entre le
comportement non éthique et le délit est ténue, comme l’illustre le marchandage et le prêt de
main d’œuvre.
Si la meilleure utilisation du cadre réglementaire (« effet d’aubaine ») n’est pas illicite, le
détournement du cadre réglementaire dans le seul but d’abaisser le coût de la main d’œuvre
pose problème. Le détournement direct étant risqué du fait de la législation sur le travail
dissimulé, le recours à la sous-traitance se généralise, en dépit de la responsabilité solidaire
du donneur d’ordre et du sous-traitant.
Le cadre légal de la sous-traitance peut devenir une opération illégitime et prohibée de prêt de
main d'oeuvre à but lucratif.
Il peut sembler opportun, dans un cadre légal de sous-traitance, de faire supporter par le sous
traitant le travail dissimulé comme le montre le cas suivant. Une société
Dome X’Pats, met à la disposition de la société Ameco, un salarié qu'elle a engagé à cet effet
pour la durée déterminée d'un chantier en Arabie Saoudite. Non réglée, Dome X'Pats assigne
la société Ameco en paiement de factures relatives à la "sous-traitance" de ce salarié. Ameco,
qui a bénéficié de la main d'oeuvre invoque l'illicéité de l'opération de sous-traitance dont elle
était bénéficiaire pour ne pas régler le sous-traitant.
Pour la cour d'appel, il s'agit d'un prêt de main d'œuvre prohibé, d'une sous-traitance illicite,
puisque le salarié obéissait aux ordres de l'entreprise utilisatrice.
Les juges relèvent en premier lieu que l’opération a un but lucratif : les prix facturés à Ameco
étaient fonction des jours de présence sur le chantier et la comparaison entre facture et
bulletins de paie faisait apparaître une marge bénéficiaire au profit de la société prêteuse.
En deuxième lieu, le salarié était sous l’autorité de la société constructrice, la société prêteuse
étant absente du chantier sans pouvoir de contrôle ou de direction sur le salarié.
L’opération étant interdite, Ameco n’avait pas à régler ces prestations ! : « Mais attendu que
la cour d'appel a d'abord relevé que le prix facturé par la société Dome X'Pats à la société
Ameco était fonction des jours de présence du salarié sur le chantier et que la comparaison
entre les facture et les bulletins de paie faisait apparaître, au profit de la société prêteuse, une
marge bénéficiaire ; qu'elle a ensuite constaté que le personnel de la société Dome X'Pats
était placé sous l'autorité de la société constructrice Mitsubischi, ou d'autres entreprises, et
que, n'étant ni présente ni représentée sur le chantier, la société prêteuse n'avait aucun
pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié qu'elle avait embauché, qu'étant ainsi établi
que le contrat litigieux avait pour unique objet la mise à disposition, à but lucratif, d'un
salarié pour une durée déterminée, la cour d'appel en a exactement déduit que cette
opération, interdite par l'article L. 122-3 du Code du travail, était illicite ; que le moyen n'est
4

pas fondé ». ( Cass.soc., 17 juin 2005 N° 03-13707 ).
Pour échapper à la norme, des pratiques illicites de sous-traitance se sont développées.
Il suffit de se rappeler les ouvriers polonais de St Nazaire qui ont défrayé la chronique de l’été
2005. Prêtés par Kliper (entreprise polonaise ) à Gestal ( entreprise française ) sous traitante
des Chantiers de l’Atlantique, leur « employeur » était défaillant dans le paiement des
salaires.
Que penser de la pratique d’une grande surface, qui, afin d’optimiser le coût du personnel
affecté à l’achalandage des rayons, n’hésite pas à en faire supporter le coût par les
fournisseurs ? La technique est connue, pour placer en tête de gondole ses produits, le
fournisseur « détache » du personnel qui assure ce travail. Rien que de très normal. Dans le
cadre de la promotion d’un produit, la présence de représentants des fournisseurs
(merchandiser) n’est-elle pas admise dans un magasin ? Là où la dérive commence, c’est
lorsque que l’on demande à ce personnel de placer outre les produits de son employeurs
d’autres produits au seul bénéfice de la grande surface qui profite ainsi d’une main d’œuvre
gratuite sur la base d’un rapport de force commercial.
La pratique peut être délibérée et donc délictueuse, comme le montre le cas suivant. Le 18
juin 2001, un inspecteur du travail dénonce au procureur de la République les pratiques du
Carrefour de perpignan en citant le cas d’une femme employée de 1983 à 2002 et payée par
32 sociétés prestataires de service pour des contrats d’une demi-heure hebdomadaire …
Pour l’Inspection du travail, l’écart de rémunération pour des fonctions égales entre un salarié
« Carrefour » et un merchandiser est de 37% entre 1999 et 2001 …
Pour le juge d’instruction, ce système était centralisé au siège parisien de Carrefour et de sa
centrale d’achats Interdis. « Interdis fixait aux fournisseurs le montant de la contrepartie
exigée pour que leurs produits soient bien présentés. A charge pour eux, ensuite, de se mettre
en contact avec les magasins Carrefour et de faire sous-traiter par des sociétés prestataires de
service la gestion de ce personnel »
2
Bien entendu, des formes moins sophistiquées de travail dissimulé existent, l’auto exonération
de toutes déclarations du sous-traitant suffit.
Après avoir montré la pertinence des concepts de comportements non éthique et de délit pour
saisir les phénomènes de déviance dans le domaine social, il convient maintenant de délimiter
plus précisément le type de comportements déviants qui feront l’objet de notre étude.
1.2 Délinquance personnelle et organisationnelle
Les travaux pionniers de Sutherland (1940, 1983) et ceux de ses disciples Cressey (1986) et
Baucus (1989) sur les activités illégales mettent en évidence le fait que les actes
répréhensibles peuvent être perpétrés pour le bénéfice personnel du délinquant d’affaire
(personal crimes), au détriment de l’organisation dont il est membre (détournement de fonds,
vente d’informations confidentielles), mais également au profit de l’organisation (illegal
corporate behavior). Clinard et Yeager (1980) proposent une typologie plus fine de ce dernier
type de comportements en distinguant trois formes principales de délits commis pour le
compte de l’organisation : les violations administratives (falsification de comptes, fausses
factures…), les violations concernant la production ou l’environnement (non-respect des
normes de sécurité en matière de pollution, dumping, corruption…) et les violations dans le
domaine social (discrimination, licenciement abusif…).
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%