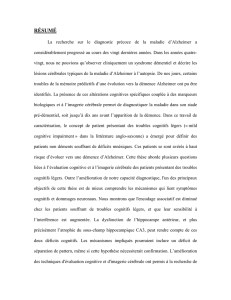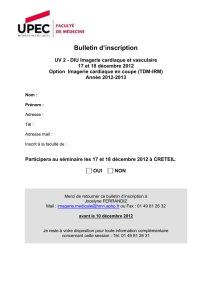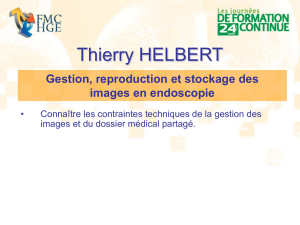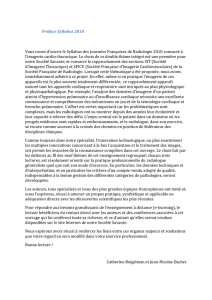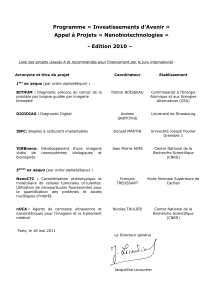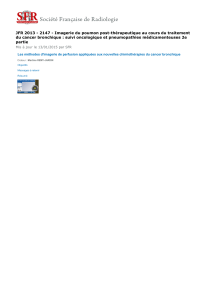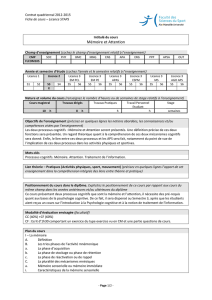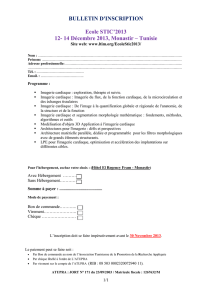troubles cognitifs chroniques

EN PRATIQUE
218Neurologies • Mai 2012 • vol. 15 • numéro 148
INTRODUCTION
La question de la prescription d’un
bilan biologique en Consultation
Mémoire revient à celle de l’iden-
tification de troubles cognitifs
chroniques curables - du moins
améliorables - dus à des aections
métaboliques, carentielles, endo-
criniennes, infectieuses et inflam-
matoires. Ces pathologies sont
classiquement associées à la pré-
sence d’un syndrome démentiel
(1), donc à un stade tardif d’alté-
ration cognitive. En conséquence
elles sont rapidement survolées
dans les ouvrages dédiés aux dé-
mences tant il apparaît clair - à
ce stade de dégradation intellec-
tuelle - qu’elles sont associées à un
contexte clinique évident.
Cela est assurément vrai. Par
exemple, en cas d’insusance
cardiaque sévère les troubles co-
gnitifs sont patents, et combinés
à une sémiologie d’insusance
congestive du ventricule gauche
qui ne peut être manquée par le
clinicien (2). Il en va de même
pour l’insusance respiratoire sé-
vère. Le prélèvement sanguin ne
sert ici seulement qu’à corroborer
*Centre Mémoire, de Ressources et de Recherche d’Alsace
(Strasbourg-Colmar)
un diagnostic étiologique déjà cli-
niquement manifeste.
De façon plus pertinente, un bi-
lan biologique peut être ordonné
à titre de dépistage de troubles
curables face à une plainte cogni-
tive isolée ou un MCI débutant,
non associée à une sémiologie ex-
traneurologique bruyante. C’est à
ce stade que l’on peut finalement
espérer une réversion rapide et
complète après traitement (3).
Après un bref rappel étiologique,
nous illustrerons par des cas cli-
niques l’intérêt du bilan biolo-
gique pour des troubles modérés
rencontrés en Consultation Mé-
moire.
RAPPELS
ÉTIOLOGIQUES
Les aections dépistables par des
dosages sanguins et potentielle-
ment responsables d’un trouble
cognitif chronique (de gravité va-
riable) sont :
• métaboliques : hyponatrémie,
hyper- et hypocalcémie, insu-
sance rénale, insusance hépato-
cellulaire (4) ;
• endocriniennes : hypo- ou hy-
perthyroïdie (4), insusance sur-
rénalienne, syndrome de Cushing,
panhypopituitarisme, acroméga-
lie exceptionnellement ;
• carentielles : carence en folates
et/ou B12 (1, 4) classique mais
d’imputabilité discutable (5), ca-
rences en autres vitamines du
groupe B (6) (B1, B6, PP ), habi-
tuellement responsables d’alté-
ration cognitive dans un contexte
subaigu à aigu, qui peut néan-
moins manquer ;
• infectieuses : syphilis, VIH, bru-
cellose et maladie de Lyme (7-9) ;
l’imagerie est alors souvent anor-
male mais peut être particulière-
ment trompeuse
(Observation n° 1)
;
noter que la maladie de Whipple
ne peut être dépistée sur une bio-
logie sanguine avec fiabilité (10) ;
• inflammatoires : LEAD, Sjögren,
syndrome des antiphospholipides
(11-13).
Pour toutes ces étiologies, il
n’existe pas de bilan strictement
standard, c’est-à-dire peu coûteux
et parfaitement rentable. L’orien-
tation du diagnostic par certains
dosages spécifiques dépendra de la
rapidité d’installation du trouble,
du contexte (éthylisme, diabète,
prises médicamenteuses favori-
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
Troubles cognitifs chroniques
Pourquoi faut-il faire un bilan biologique ?
n
Dans l’approche diagnostique des troubles cognitifs, l’imagerie cérébrale joue un rôle majeur
et non discutable. Mais un bilan biologique minimal et systématique peut avoir de l’intérêt, en
venant compléter la démarche clinique et les informations radiologiques. Il permettra de ne pas
retarder l’identification d’affections curables qui restent de reconnaissance difficile en dépit de
la rigueur de chacun.
Benjamin Cretin, Frédéric Blanc, Nathalie Philippi et François Sellal*

TROUBLES COGNITIFS CHRONIQUES
Neurologies • Mai 2012 • vol. 15 • numéro 148 219
santes…), des signes associés et
aussi des données d’imagerie.
C’est dans cet esprit que la Haute Au-
torité de Santé avait émis (en 2008)
certaines suggestions à propos de
l’usage du bilan biologique ; elles
figuraient parmi ses recommanda-
tions pour le diagnostic et la prise
en charge de la maladie d’Alzhei-
mer (15). Elles sont résumées dans
le
tableau 1
. Ces recommandations
diagnostiques, contrairement aux
recommandations thérapeutiques,
apparaissent moins polémiques du
fait de leur moindre intrication avec
de potentiels conflits d’intérêt. De
fait, elles ne nous semblent pas frap-
pées de la même caducité.
SITUATIONS EN
LIEN AVEC LE BILAN
BIOLOGIQUE PROPOSÉ
EN CONSULTATION
MÉMOIRE
Deux grandes situations peuvent
être dégagées, où le bilan biolo-
gique de 1re intention est décisif
dans les 2 cas.
LE BILAN BIOLOGIQUE RÉVÈLE LA
CAUSE DU TROUBLE COGNITIF
Ici, la contribution du bilan bio-
logique de 1re intention est ma-
jeure puisqu’il révèle l’étiologie
de la plainte cognitive. Il permet
le diagnostic d’emblée si les pré-
lèvements plasmatiques ont été
proposés dès le début de la prise en
charge, ou secondairement si l’en-
quête étiologique est reprise du
fait de la normalité de l’imagerie.
Comme nous l’avons déjà dit en in-
troduction, ce n’est certainement
pas au stade de démence que le bi-
lan est le plus intéressant, puisque
le contexte clinique et les données
d’imagerie auront été préalable-
ment contributifs, et puisque des
séquelles peuvent persister mal-
gré la classique réversibilité des
troubles mis en évidence (7).
ObservatiOn n° 1
Mme P.A., 44 ans, originaire du Sénégal, consulte
pour des troubles patents de la mémoire antérograde
installés progressivement depuis 5 ans. Les dicultés
sont alléguées précisément et très vivement ressen-
ties. Le contexte est marqué par des troubles dépres-
sifs réactionnels aux troubles mnésiques et de mul-
tiples FRCV. Les antécédents familiaux sont inconnus.
Le MMS est “limite”, compte tenu de l’âge, à 27/30
(pentagones échoués) et le test des 5 mots montre
des troubles nets du stockage avec un score à 7/10
(5+0 ; 2+0). Les autres évaluations neuropsycholo-
giques sont refusées par la patiente.
L’IRM est strictement normale. La ponction lombaire
réalisée ne montre pas d’hyperprotéinorachie, ni de
cellularité ou d’anomalies des biomarqueurs de la
maladie d’Alzheimer. Le bilan HAS est par ailleurs nor-
mal, en dehors d’une sérologie VIH positive ; la PCR
dans le LCR est également positive pour le VIH.
La patiente est perdue de vue après la mise en place
d’un traitement par trithérapie (passant la barrière
hémato-encéphalique) mais le suivi médical assuré
par le médecin généraliste fait état d’une remarquable
amélioration des plaintes mémorielles.
Cette observation indique que l’infection par le VIH ne
doit pas uniquement être évoquée en cas d’anomalies
à l’IRM (en lien avec des infections opportunistes)
puisque l’infection par le virus du VIH lui-même peut
s’accompagner d’une imagerie parfaitement normale
(14). Ici l’origine africaine était un élément d’orienta-
tion.
Tableau 1 - Bilan biologique recommandé en Consultation Mémoire
face à des troubles cognitifs chroniques (HAS 2008) (15).
Examens biologiques
systématiques (1re intention)
Examens biologiques selon le
contexte (2e intention)
d NFS†
d Glycémie à jeun
d Ionogramme, urée et créatinine
(avec évaluation du DFG par la for-
mule de Cockcroft-Gault ou MDRD)†
d Calcémie totale et albuminémie†
d Enzymes hépatiques (ASAT, ALAT,
GGT)†
d Crase (TP-TCA-fibrinogène)
d TSH†
d B12 et folates†
d Vitamines B1 et B6, pyruvicémie
d Sérologies de Lyme†*, syphilitique
(TPHA-VDRL)†, brucella et VIH†*
d ACAN, antiphospholipides**
d VS et CRP
d Cortisol libre urinaire
et cycle cortisol 8h-20h
d IGF-1
* Ces examens doivent être systématiques chez des patients provenant de zones d’endémie ;
** A réserver à une suspicion de connectivite (lupus et Gougerot-Sjögren notamment) étayée par des argu-
ments cliniques ou d’imagerie ; † Examens apparaissant dans les recommandations de la HAS 2008.

220Neurologies • Mai 2012 • vol. 15 • numéro 148
EN PRATIQUE
Au stade de plainte cognitive iso-
lée ou de MCI, les dosages suggé-
rés dans le
tableau 1
nous semblent
avoir bien plus d’intérêt. C’est
d’ailleurs à ce stade que la nor-
malité de l’imagerie permet aussi
d’escompter une régression signi-
ficative des dicultés du patient,
après traitement adapté. Les don-
nées de la littérature sur le sujet
restent néanmoins parcellaires
(16, 17). L’
observation n° 2
illustre ces
considérations.
LE BILAN BIOLOGIQUE N’EST PAS
PROPOSÉ DEVANT L’APPARENTE
ÉVIDENCE DU TABLEAU CLINIQUE
Cette circonstance clinique n’est
pas possible si l’on propose les
prélèvements sanguins systéma-
tiquement, ou si l’on s’est assuré
qu’ils ont été réalisés antérieure-
ment. Mais, comme nous venons
de le voir, il n’est pas rare que les
dosages soient prescrits quand la
démarche clinique piétine à l’issue
d’une imagerie normale.
C’est ici qu’émerge un piège cli-
nique : les données radiologiques
peuvent montrer des anomalies
patentes et écarter le clinicien des
considérations biologiques. Un
premier exemple est donné par
l’
observation n° 3
.
Un autre apparaît dans L’
observation
n° 4
: face à un tableau manifeste-
ment neurodégénératif, il devient
aisé d’oublier de vérifier certains
éléments biologiques fondamen-
taux et donc de priver le patient
d’un réel bénéfice clinique. En cas
de démence primitive d’évolution
rapidement progressive, nous re-
commandons ainsi de s’assurer
de l’absence de troubles carentiel,
endocrinien, métabolique, inflam-
matoire ou infectieux dont la mé-
connaissance viendrait aggraver le
tableau (19).
CONCLUSION
Les cas cliniques ici présentés
permettent d’armer qu’un bilan
biologique simple (dit de 1re in-
tention), tel qu’il avait été proposé
par la Haute Autorité de Santé en
2008, a une valeur opératoire et
permet de dépister facilement des
aections chroniques dont le dia-
gnostic peut s’avérer par ailleurs
ardu. Il est important de retenir
que les examens de 2e intention
(Tab. 1)
ne doivent pas être systé-
matiques mais guidés par les élé-
ments anamnestiques, cliniques
et radiologiques à la disposition du
praticien. Les examens de 1re in-
tention s’imposent s’ils n’ont pas
été préalablement réalisés.
Nos observations rappellent que
les anomalies sanguines peuvent
être révélées par des plaintes cogni-
tives subjectives ou un MCI et pas
seulement par un syndrome dé-
mentiel. Ainsi, le bilan de 1re inten-
tion nous semble devoir être systé-
matiquement proposé (ou vérifié)
en Consultation Mémoire, quel
que soit le niveau de gravité des
ObservatiOn n° 2
Mme D.G, 74 ans consulte pour des troubles cognitifs
apparus progressivement depuis 5 ans, se dévelop-
pant dans un contexte vasculaire (angor stenté),
dysimmunitaire (hépatite auto-immune) et dépressif
(dicultés familiales et conjugales) ancien. La plainte
est clairement alléguée par la patiente (dicultés
d’orientation topographique, troubles en mémoire à
court terme et en attention soutenue, oublis épars) et
vivement ressentie. L’examen neurologique est sans
particularité en dehors d’une hyporéflexie diuse.
Le bilan cognitif révèle un MMS à 28/30 associé à un
syndrome dysexécutif débutant.
L’imagerie est normale, éliminant l’hypothèse vas-
culaire des troubles. Le bilan biologique (selon la
HAS) révèle une hypercalcémie totale à 2,85 mmol/l
(N=2,2-2,4) confirmée par une hypercalcémie ionisée à
1,47 mmol/l (N = 1,15-1,37). Le complément d’investiga-
tion montre une hyperparathyroïdie (PTH augmentée,
non adaptée à la calcémie).
L’imagerie échographique confirme la présence d’un
adénome parathyroïdien G réséqué chirurgicalement.
A 3 mois postopératoire : MMS à 30/30 et disparition
de la plainte cognitive subjective. La famille signale
aussi des changements comportementaux importants
(reprise de nombreuses activités, moindre émousse-
ment aectif, moindre dysphorie)
Les tests de contrôle révèlent une amélioration du
statut cognitif puisque les troubles dysexécutifs ont
régressé et qu’il ne persiste qu’un trouble attentionnel
modéré.
Cette observation est en accord avec les données
classiques sur les adénomes parathyroïdiens (18)
et rappelle qu’il faut exiger la calcémie sur le bilan
biologique minimal à réaliser face à des troubles
cognitifs modérés et d’ancienneté variable. L’hypo-
réflexie était un petit indice en faveur du trouble
hypercalcémique.

TROUBLES COGNITIFS CHRONIQUES
Neurologies • Mai 2012 • vol. 15 • numéro 148 221
ObservatiOn n° 3
ObservatiOn n° 4
Mr E.A., 83 ans, consulte pour des troubles principa-
lement mnésiques évoluant depuis environ 2 ans et
dont il est partiellement conscient (minimisations
nombreuses au moment de la consultation). Les IADL
sont préservées, l’humeur est bonne et le MMS est à
23/30 (perte des points en rappel des 3 mots, écriture
et dessin des pentagones). L’examen clinique confirme
la présence de troubles praxiques idéo-moteurs et
mélokinétiques. Le bilan neuropsychologique révèle un
MCI amnésique multi-domaine (troubles mnésiques
hippocampiques + troubles exécutifs et langagiers).
L’imagerie est clairement en faveur d’une étiologie
neurodégénérative en montrant une importante
atrophie pariétale
(figures)
. Le reste des investigations
est en faveur d’une maladie d’Alzheimer débutante
(PL et scintigraphie).
A l’occasion d’une hospitalisation pour infection
urinaire haute, un bilan biologique est réalisé : la TSH
s’avère très élevée à 73 (N = 0,4-4) avec T4 basse à 1,7
(N = 8,3-14,6). Le patient est en fait aecté d’une hy-
pothyroïdie périphérique faisant suite à un traitement
par Cordarone. La supplémentation en L-thyroxine
permet une correction du profil thyroïdien et aussi
du MMS, qui passe à 29/30 avec un bénéfice psycho-
comportemental net d’après la famille.
Cette observation illustre l’importance de toujours vé-
rifier que le bilan HAS a été réalisé malgré l’évidence
parfois “aveuglante” du tableau dégénératif. Ici l’IRM
a finalement été aussi piégeuse que contributive…
Mme N.M.L, 84 ans, consulte pour des troubles cogni-
tifs évoluant depuis 5 ans, installés progressivement
et aggravés depuis 1 an. Le contexte est marqué par
des facteurs de risque cardiovasculaires. L’humeur
est variablement altérée chez cette patiente veuve,
qui reste autonome pour les activités courantes et la
conduite automobile. La plainte, vive, porte sur la mé-
moire à court terme, l’attention et un manque du mot
fréquent (avec récupération habituelle mais diérée).
Le niveau cognitif global est modérément aecté :
MMS = 24/30 et MMPark = 24/32 (N > 28/30). Le bilan
neuropsychologique complémentaire révèle un MCI
amnésique multi-domaine (troubles de la récupération
en mémoire verbale + syndrome dysexécutif).
L’IRM met en évidence des lésions vasculaires alors
que le bilan HAS de première intention est normal
(figures)
, de même que le dosage des biomarqueurs de
la maladie d’Alzheimer dans le LCR (Tau, P-Tau, A-beta
et IATI sont en eet dans les normes). Le tableau de la
patiente aurait pu être qualifié de trouble cognitif léger
d’origine vasculaire, mais la sérologie plasmatique et
l’analyse du LCR (index de synthèse intrathécal à 14 ; N
< 1,5) ont révélé une maladie de Lyme tertiaire.
Après traitement par ceftriaxone, le bénéfice subjectif
est net dans les semaines qui suivent. A 1 an, le MMS
est à 27/30 alors que la MMPark est à 29/32
Cette observation souligne encore combien les aspects
d’imagerie morphologique doivent être interprétés
avec prudence, et à quel point la maladie de Lyme doit
être systématiquement évoquée et recherchée en
zones d’endémie (20, 21).

222Neurologies • Mai 2012 • vol. 15 • numéro 148
EN PRATIQUE
dicultés cognitives chroniques
rencontrées par les sujets. Il n’est
pas excessif de rappeler encore une
fois que ce bilan doit être fait mal-
gré les données de l’imagerie, aussi
évocatrices ou typiques soient-
elles. En fait, il ne se situe pas en
opposition à ces dernières mais en
complément. Les résultats de l’une
et de l’autre doivent être confrontés
avant de produire une conclusion
diagnostique et pronostique indivi-
duelle, comme nous l’avons vu dans
les
observations n° 3 et 4
.
Enfin, le bilan biologique a d’autres
intérêts que l’identification de
causes curables de troubles cogni-
tifs : il constitue un bilan préthé-
rapeutique indispensable avant
l’introduction de certaines médi-
cations (interférant avec les fonc-
tions intellectuelles : antalgiques,
hypnotiques, inhibiteurs d’acétyl-
choline-estérase…) et donne des in-
dices en faveur de causes “occultes”
ou peu fréquentes de dégradation
cognitive (troubles hématolo-
giques en cas de pathologies lysoso-
males, perturbations hépatiques en
cas d’éthylisme, hypoglycémie en
cas d’insusance surrénalienne,
diabète des aections mitochon-
driales, syndrome inflammatoire
des connectivites, hypothyroïdie
en cas de pathologie hypothalamo-
hypophysaire rare ou de thyroïdite
de Hashimoto…). n
Correspondance :
Dr Benjamin CRETIN
Service de Neurophysiologie
CMRR Strasbourg-Colmar
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
1 avenue Molière
67200 Strasbourg-Hautepierre
E-mail : benjamin.cretin
@chru-strasbourg.fr
1. Démences et confusion mentale. In : Abrégé de Neurologie, 12e édition.
Cambier J et al., eds. Paris : Editions Masson, 2008 : 462.
2. Caplan LR. Cardiac encephalopathy and congestive heart failure: a hy-
pothesis about the relationship. Neurology 2006 ; 66 : 99-101.
3. Sellal F, Becker H. Potentially reversible dementia. Presse Med 2007 ; 36
(2 Pt 2) : 289-98.
4. Gil R. Abrégé de Neuropsychologie, 3e édition. Paris : Editions Masson,
2003 : 231-5.
5. Lachner C, Steinle NI, Regenold W. The neuropsychiatry of vitamin B12
deficiency in eldely patients. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2012 ; 24 : 5-15.
6. Panza F, Capurso C, Solfrizzi V. Alcohol use, thiamine deficiency, and co-
gnitive impairment. JAMA 2008 ; 299 : 2853-4.
7. Michel JM, Sellal F. “Reversible” dementia in 2011. Geriatr Psychol Neuro-
psychiatr Vieil 2011 ; 9 : 211-25.
8. Bahemuka M, Shemena AR, Panayiotopoulos CP et al. Neurological syn-
dromes of brucellosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1988 ; 51 : 1017-21.
9. Blanc F, Kleitz C, Longato N et al. Lyme dementia. Neurology 2009 ; 72
(Suppl AAN) : A162.
10. Blanc F, Ben Abdelghani K, Schramm F et al. Whipple limbic encephali-
tis. Arch Neurol 2011 ; 68 : 1471-3.
11. Berlit P. Neuropsychiatric disease in collagen vascular diseases and vas-
culitis. J Neurol 2007 ; 254 (Suppl 2) : II87-9.
12. Tektonidou MG, Varsou N, Kotoulas G et al. Cognitive deficits in patients
with antiphospholipid syndrome: association with clinical, laboratory, and
brain magnetic resonance imaging findings. Arch Intern Med 2006 ; 166 :
2278-84.
13. Blanc F, Longato N, Jung B et al. Cognitive impairment and dementia in
primary Sjögren’s syndrome. BMC Medicine 2012, submitted, in revision.
14. Tate DF, Khedraki R, McCaffrey D et al. The role of medical imaging in
defining CNS abnormalities associated with HIV-infection and opportu-
nistic infections. Neurotherapeutics 2011 ; 8 : 103-16.
15. Haute Autorité de Santé. Recommandations pour le diagnostic et la
prise en charge de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Mars
2008.
16. Knopman DS, Petersen RC, Cha RH et al. Incidence and causes of non-
degenerative nonvascular dementia: a population-based study. Arch Neu-
rol 2006 ; 63 : 218-21.
17. Petersen RC, Roberts RO, Knopman DS et al. Mild cognitive impairment:
ten years later. Arch Neurol 2009 ; 66 : 1447-55.
18. Walker MD, McMahon DJ, Inabnet WB et al. Neuropsychological fea-
tures in primary hyperparathyroidism: a prospective study. J Clin Endocri-
nol Metab 2009 ; 94 : 1951-8.
19. Kelley BJ, Boeve BF, Josephs KA. Rapidly progressive young-onset de-
mentia. Cogn Behav Neurol 2009 ; 22 : 22-7.
20. Sparsa L, Blanc F, Lauer V et al. Recurrent ischemic strokes revealing
Lyme meningovascularitis. Rev Neurol (Paris) 2009 ; 165 : 273-7.
21. Almeida OP, Lautenschlager NT. Dementia associated with infectious
diseases. Int Psychogeriatr 2005 ;17 (Suppl 1) : S65-77.
BiBliographie
Mots-clés :
Troubles cognitifs, Consultation
mémoire, Biologie, IRM, Maladie
d’Alzheimer, MCI, Recommandations,
Pathologies métaboliques, Patho-
logies endocriniennes, Pathologies
carencielles, Pathologies infectieuses,
Pathologies inflammatoires
1
/
5
100%