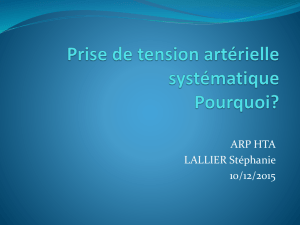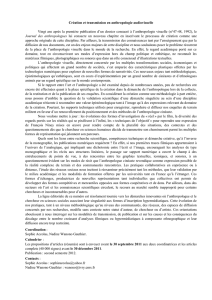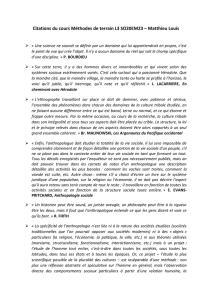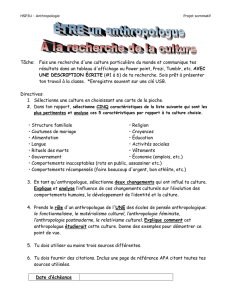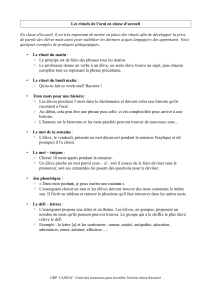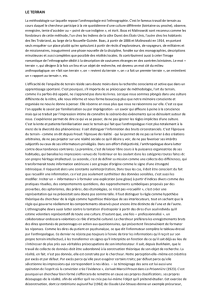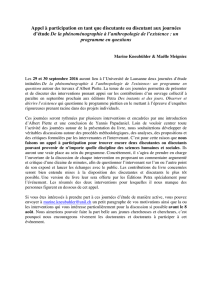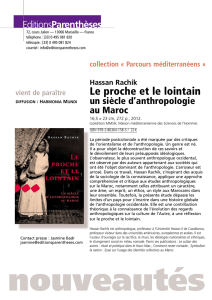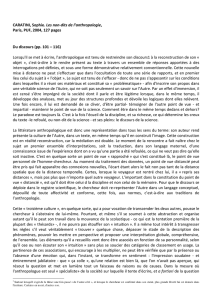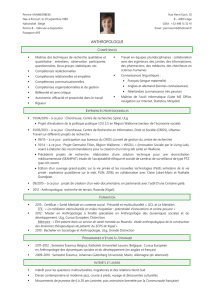lire le compte rendu exhaustif de Fatiha Kaoues sur l`apport du Pr

Albert Piette s’intéresse au religieux, en tant qu’il s’agit d’un laboratoire idéal pour
l’observation anthropologique. Dans son analyse des modalités de présence de la divinité,
Albert Piette décrit une forme de controverse jamais close et un déplacement permanent de
l’enjeu. L’anthropologue promeut une analyse hyper détailliste de son objet, appuyée si possible
d’un travail filmique. Polymorphe et labile, le divin donne à voir une présence ambiguë car
toujours mâtinée d’absence. Le rituel, autre objet d’observation de l’anthropologue désigne un
espace-temps également caractéristique de cette présence paradoxale, qui s’exprime sur le mode
de la négation partielle. C’est dans cette faille négative, cet espace médiant qu’Albert Piette
situe le surgissement de la croyance, elle aussi oscillante et d’intensité variable. Le croire
nécessite l’oblitération du caractère fictionnel du rituel.
Les travaux et techniques d’observation d’Albert Piette révèlent le regard que porte le chercheur
sur la discipline anthropologique. Il s’agit de privilégier l’individu au détriment de l’action et
de l’expérience. Albert Piette se fait le promoteur d’une anthropologie « amoureuse »,
maintenant une forme d’allégresse et d’étonnement constant face à ce qui est. Loin de tout
collectivisme, il s’agit de maintenir la singularité irréductible de l’individu.
Albert Piette décrit étonnamment le culte comme une « scène d’amour » qui met en situation
des individus qui s’aiment (tout en se disputant) à travers la divinité qui les réunit. L’observation
de ces « scènes d’amour » est utile pour cerner les modalités de présence de la divinité. Elle est
le théâtre d’une sorte de controverse qui ne parvient jamais à son terme. A. Piette décrit ainsi
un déplacement permanent de l’enjeu. L’anthropologue insiste sur cette idée de déplacement,
essentielle. Tout se passe comme s’il fallait toujours reporter, suspendre la définition. C’est là
à son avis une caractéristique humaine centrale.
L’anthropologue recommande un exercice singulier. Il s’agit pour le chercheur de suivre heure
par heure et jour après jour un individu qu’il veut étudier. Lui-même a passé une semaine entière
à suivre un prêtre. Cette pratique, peu courante car très lourde constitue selon les mots du
chercheur, une anthropographie. Il s’agit de réaliser des graphies d’individus. Si le chercheur
parvient à en réaliser plusieurs puis à les comparer, cela est d’une grande richesse.
Lors de son expérience, l’anthropologue a tenté de mettre à l’épreuve la catégorie de l’idéaltype
empruntée à Weber pour examiner si cela peut fonctionner dans un tel cadre. Il en conclut que
cela n’est d’aucune utilité. A son avis, cela s’explique aisément du fait même que l’idéaltype
est un tableau de pensée, qui n’existe donc pas en tant que tel, alors que l’anthropologue
ambitionne précisément, à partir de ses observations, d’en déployer les contingences. Le
« prêtre » qu’A. Piette étudiait se voulait « prophète » désireux dans le même temps de
s’engager dans son temps. Ce que l’anthropologue trouve fort intéressant, c’est la capacité du

prêtre à exercer différents rôles et à ne pas les exprimer sur le mode de l’exclusion : il est prêtre
lorsqu’il s’occupe de l’hostie, se meut en prophète lorsqu’il déroule son discours sur les
pauvres, etc, tout en… Mais ce qui retient l’intérêt du chercheur est que l’acteur exprime ces
états successifs sur le mode de la négation, « je ne suis pas prêtre, je ne suis pas magicien, je
suis ceci mais pas cela ». Il y a là un déplacement, on est toujours renvoyé à autre chose. Pour
l’anthropologue, c’est peut-être là que se situe l’essence du
discours religieux. L’ambition poursuivie par A. Piette est de réaliser une anthropologie de
l’individu plus que de l’action. L’idée est simple, au plan méthodologique; l’anthropologue la
compare à une conversation téléphonique à laquelle on assisterait et dont on entendrait le propos
d’un seul acteur. Sans entendre les propos de l’interlocuteur à l’autre bout du fil, on peut déduire
ce qu’il dit de ce que l’on entend. De la même façon, l’anthropologue déduit, à partir de qu’il
entend et voit tous les détails de la présence de la divinité. Il qualifie cet exercice de théographie,
une graphie de l’être divin. Un tel exercice est malaisé s’agissant d’une entité invisible. Il est
question d’une présence ambiguë, diffuse, plus ou moins forte selon les moments. Il s’agit d’une
présence étonnante. Ainsi, lors du culte, le prêtre parle de la divinité à la 3e personne alors
qu’elle est supposée présente. Le chercheur observe qu’une grille d’analyse interactionniste de
type goffmanienne ne fonctionne pas davantage pour rendre l’observation intelligible.
L’anthropologue parvient à établir une liste de caractéristiques des modes de présence de la
divinité. En premier lieu, elle apparait comme un existant d’un monde invisible présent dans le
monde humain. Elle est perçue, directement ou indirectement, par une série de médiations. Par
ailleurs, la présence divine dispose d’un aspect polymorphique. Elle manifeste une capacité de
présence et d’absence extraordinaire. Elle apparaît fluide, labile, hybride, et n’implique pas de
face à face. Paradoxalement, cette présence est liée à une absence, mais sur un mode ambigu.
Cette présence dispose d’une capacité d’action (bénir, pardonner) et est l’objet d’une perception
par les humains. L’anthropologue observe que les individus se montrent peu exigeants vis-à-
vis des non-humains. Le chercheur recourt à l’image du feu rouge pour illustrer son propos. On
passe au feu vert, on s’arrête au feu rouge, sans y penser, ni s’interroger par exemple sur la
nécessité de la couleur rouge. De la même façon, Albert Piette considère qu’une décrispation
est nécessaire face à la divinité. Il est important de suspendre, d’opérer un laisser-faire, pour
que cela fonctionne. La divinité manifeste une présence en pointillés, virtuelle, en toile de fond,
qui peut s’intensifier par instants. La virtualité de cette présence a pour effet de décrisper les
humains, car il s’agit d’une présence qui n’est pas très densifiée.
On retrouve là encore une forme de négation. Nous ne sommes pas dans la fiction et pas
davantage dans la réalité. Il convient, aux yeux d’A. Piette, de prendre la mesure de cette double
caractéristique, cette présence concomitante de l’homme et de la divinité où la négation tient
une place très importante. Il y a là une hésitation essentielle, une ambiguïté que l’anthropologue
considère « d’une beauté exceptionnelle », et d’un haut niveau cognitif en termes de capacité.
On est là sans être là, Dieu est là sans être là.
Ce qui distingue l’anthropologie et la sociologie tient dans le fait que l’anthropologie dit
quelque chose sur les hommes et non pas sur une société. L’anthropologue se fait hyper
détailliste et tend (« le plus tard possible », affirme A. Piette) vers des théorisations risquées.
L’anthropologue évoque les pensées vagabondes, l’état d’hypo-lucidité qui constitue un état
habituel chez l’humain. Il associe cet état à une forme de réserve négative dans notre manière
d’être présent, une sorte de réversibilité.

Définir le croire
Quelle place tient le croire dans une telle configuration ? Le chercheur suppose que les sapiens
se singularisent du point de vue du croire. Si nous regardons un film d’horreur ou lisons une
bande dessinée de Tintin, nous savons qu’il s’agit là de personnages de fiction. Mais tous les
croyants diront : « Dieu existe », même s’ils n’ont pas participé à un rituel. En quoi consiste ce
croire ? C’est le caractère ponctuel et éphémère du croire qui intéresse le chercheur. Le fait
d’affirmer qu’un mort vit est un énoncé contradictoire, qui défie la logique. Les énoncés
religieux sont contre-intuitifs et génèrent des interprétations mystérieuses, non closes. Cela a
été déjà amplement démontré par les anthropologues cognitivistes. Il ne s’agit pas là d’idées
fortes mais floues, hésitantes, oscillantes. Comment aller plus loin dans la description ? Même
si le chercheur est impliqué dans une observation participante, il ne lui est pas possible de penser
à la place d’un autre, aussi lui faut-il recourir à d’autres outils de recherche. Albert Piette a
connu une période où il a cru en Dieu, après la mort de son père. Il a soigneusement consigné
ses impressions d’alors, se décrivant « en train de croire ». L’anthropologue a recouru au stock
d’énoncés qu’il tenait de son enfance. Il décrit ses pensées d’alors comme quelque chose de
diffus, de moments brefs suscitant un assentiment lui aussi flou, furtif. Il était alors loin
d’acquiescer totalement, comme si son désir de croire se heurtait à la probabilité difficile de la
résurrection. Chaque soir, il écrivait des moments passés avec son père en détail, comme un
rituel. Le chercheur a classé différents moments par lesquels un individu donne un sens à une
divinité. Le premier niveau du croire consiste par exemple à dire une prière, c’est l’individu «
en train de croire ». Le second moment désigne le sentiment d’une présence intime du divin.
Le 3e niveau est celui de la vision directe, telle qu’une apparition de la Vierge. L’individu croit
en la présence effective de l’être surnaturel. Le 4e cas de figure s’illustre dans un lien à une
émotion. Par exemple, je peux craindre de subir les conséquences d’une mauvaise action. Le
5e moment désigne des gestes en lien avec ce croire, comme le fait de glisser quelque chose
dans un cercueil. Enfin, le 6e et dernier niveau arrêté par le chercheur consiste en une connexion
mentale positive. Il s’agit d’avoir une représentation mentale d’un Dieu vivant. C’est le moment
où l’on se donne son assentiment. L’anthropologue se souvient avoir demandé à une amie si
elle pensait que son père décédé serait informé du fait qu’il avait changé d’université. L’amie
lui répondit que cela était possible, sans donner de réponse catégorique. Dans une telle
séquence, explique A. Piette, l’individu ne donne pas son assentiment entier à tout moment ; il
existe ainsi des modulations, des basculements possibles, variables entre 100% à 0%.
L’anthropologue met en évidence une autre catégorie : la léthargie, qu’il définit comme la
capacité de ne pas penser jusqu’au fond des choses, une manière d’intériorisation minimale.
Une autre façon de « basculer » consisterait à devenir critique, exercer une forme d’ironie sur
soi-même.
Une autre posture consiste à intellectualiser, dogmatiser l’affaire, se poser en théologien.
L’anthropologue introduit alors l’idée de réverbération : selon leur intensité, ces moments vécus
auront des effets dans le quotidien de l’individu. Par exemple, il pourra donner de l’argent à un
clochard en sortant de la messe. Un individu décide d’emprunter une route parce qu’il croit
qu’elle est praticable. En matière de croire religieux, rappelle l’anthropologue, c’est le contraire
qui est : je crois parce que c’est incroyable. Le croire implique ainsi des oscillations. Je crois
pendant un temps donné, je crois moins à un autre ; des variations d’intensités sont à l’œuvre.
On constate en outre une co-existence d’émotions, entre indifférence, doute, critique et
assentiment. Lors de ses travaux dans une paroisse, le chercheur a demandé à ses interlocuteurs
de lui parler de la résurrection. Il a mis en évidence une forme de réserve fondamentale, de
restriction mentale, dans la mesure où les personnes interrogées ne maintenaient pas longtemps
une posture littéraliste. Or, Jésus n’est pas une métaphore ; les énoncés faisant référence au
Christ ne peuvent être tenus pour faux mais ils ne peuvent davantage être considérés

littéralement. Deux pôles opposés peuvent être mis en évidence, entre la métaphore et
l’interprétation littéraliste.
Aux origines du croire
Le chercheur s’est demandé quand l’homme a cru pour la première fois. L’anthropologue se
réfère aux études sur les sépultures néandertaliennes organisées datant d’il y a quelque 150 000
ans. On constate une forme de respect pour le cadavre ; il ne s’agit pas d’une simulation. On se
réfère à lui comme le vivant qu’on a connu. Mais il n’y aurait pas là croyance. Les préhistoriens
ne sont pas unanimes pour défendre une telle théorie. A. Piette s’intéresse à cette dispute. Dans
cette polémique, il adopte le point de vue de ceux qui considèrent qu’il n’existait pas
d’offrandes avant le sapiens. Aux yeux de l’anthropologue, le sapiens innove en introduisant
l’offrande, inaugurant l’entrée dans un nouveau monde. Pour Albert Piette, croire, c’est penser
que le mort existe et est toujours vivant. Le sapiens considère alors que le défunt va retrouver
la vie. Une telle posture a changé le monde. Cette nouvelle attitude cognitive fait apparaître une
part d’indiscuté, la volonté de ne pas pousser la justification à son terme. Pour A. Piette, c’est
alors que les hommes ont inventé l’invérifiable, le flou. Peut-être même, avance le chercheur,
est-ce là une raison expliquant que l’homme a survécu. Il rappelle que des considérations
climatiques expliquent la disparition des néandertaliens mais qu’il ne s’agit pas de raisons
exclusives. En d’autres mots, le fait d’accepter le flou fournit un moyen extraordinaire pour
survivre.
Cet apprentissage de l’invérifiable, cette nouvelle approche cognitive marque ainsi la rupture
par rapport aux néandertaliens. Le chercheur suggère que ces derniers ont pu s’éteindre car ils
étaient trop lucides par rapport aux sapiens. Une telle acceptation de l’invérifiable s’est installée
progressivement. A. Piette avance deux possibilités. Le néandertalien était lucide et a pu, dès
lors, adopter deux attitudes : demeurer malheureux et malade ; ou encore, il a pu rester bloqué,
passif et dans l’incapacité de créer. Une telle posture hypolucide, caractéristique de l’humain
selon l’anthropologue a diverses implications ; elle peut conduire l’homme à se comporter de
façon docile, passive, en « dormeur ». Ou encore, l’homme peut choisir de se situer dans
l’affermant, le militantisme effréné, ce qui suppose pour A. Piette une non-lucidité. A. Piette
suggère le bonheur du premier croyant qui savait l’incertitude.
La place du rituel
Albert Piette s’est par ailleurs intéressé aux rituels. Le rituel, mot polysémique, peut avoir de
nombreuses significations. On l’emploie dans le contexte d’une cérémonie religieuse ou non-
religieuse comme une fête nationale, une cérémonie plus ou moins codifiée. Le rituel désigne
des gestes, une séquence d’actions d’un prêtre ou d’un quelconque acteur. Un autre sens associé
au rituel se réfère à ce qui est plus ou moins réglé, dans des proportions variables (comme la
poignée de main). L’éthologie peut parler de rituel dans l’observation d’une parade amoureuse
animale, la psychiatrie pour désigner des comportements répétitifs. Le terme de rituel peut être
employé pour dévaloriser une attitude routinière, ou au contraire pour la valoriser : le rituel est
alors associé à ce qui est important, sacré. En vérité, le rituel peut désigner tout et son contraire.
Dans les ouvrages de sciences sociales des religions, les rituels sont assimilés à des conduites
collectives codifiées mobilisées pour exprimer des valeurs, des croyances, et des choix de
société. Dans sa définition minimale, le rituel désigne une cérémonie, religieuse ou non. Une
littérature abondante s’intéresse au rituel mais a tendance à l’associer à une fonction. A cet
égard, le rituel est censé servir à quelque chose.
Le rituel est central chez Durkheim qui valorise une approche fonctionnaliste. Dans son ouvrage

de référence, Les formes élémentaires de la vie religieuse (page 312), Durkheim associe le
surgissement de l’idée religieuse à une « effervescence croissante » qu’il met en lien avec le
«pouvoir social ». Selon A. Piette, Durkheim verse dans une forme de surinterprétation, en
n’accordant pas de place spécifique à la divinité, mais aussi à l’humain, en faveur de la société,
qui apparaît dans le pouvoir ressenti par les acteurs.
Pour sa part, Victor Turner, ethnologue spécialiste des rituels africains a travaillé sur la période
d’initiation des jeunes et distingue plusieurs séquences rituelles. Il insiste sur l’importance
fonctionnelle, dynamique et transformationelle du rituel. Le rituel transforme l’enfant en
homme. On insiste dans ces recherches sur la valorisation des gestes et l’importance des
symboles dans les rituels ; l’obligatoire devient désiré. Le rituel est en outre évocateur de
drames sociaux. On repère ainsi des moments rituels qui résolvent des crises. L’analyse des
rituels comme solution à des moments critiques est classique ; il s’agit de gérer
l’indétermination.
Négation partielle et ambiguïté essentielle
Bourdieu s’intéresse au rituel comme acte d’institution. Le chercheur est moins intéressé par la
transition que par la transformation que permet le rite. Le rituel permet la consécration magique
d’une différence. Ainsi, les rituels permettent de créer un groupe par rapport à un autre ; ils
sanctionnent en transformant, c’est la « magie performative » du rite. Dans cette perspective, le
rituel fonctionne sous réserve d’une croyance partagée ; dans cette perspective, le rituel semble
moins intéressant pour lui-même, il ne peut agir que si les individus pensent qu’il agit.
Il convient de s’interroger sur la nécessité du rite dans certains contextes particuliers, comme
l’inhumation, le mariage.
En quoi consiste cette mise en scène rituelle ? Dans ses observations, A. Piette parvient à une
conclusion inverse par rapport aux chercheurs tels que Turner, Bourdieu, etc. Loin de faire le
constat de transformations, il n’observe qu’inconsistance, des gens hésitants. Il met en évidence
un « air de rien » extraordinaire. Le contexte rituel secondarise en fait par rapport à l’acte
irréversible qui est en jeu. Albert Piette convoque en outre les travaux de Gregory Bateson. Cet
Américain qui a travaillé en Nouvelle Guinée, a collaboré avec Margaret Mead. Bien que moins
connu que cette dernière, ses travaux manifestent une forte hétérogénéité. Bateson affirmait, à
l’issue de la cérémonie du Naven, en 1936 que sans technique, la description des gestes humains
demeure impressionniste. Aux yeux d’A. Piette, la seule façon d’éviter de verser dans cet
impressionnisme est d’utiliser une caméra. En 1942, Bateson a réalisé des photos avec M.
Mead, pour étudier la façon dont un enfant balinais est socialisé. Il s’est en outre intéressé à
l’observation d’animaux (des loutres) en train de faire semblant de se battre. Aux environs de
1950, Bateson a analysé de façon remarquable ces données, faisant apparaître cette capacité
animale à faire mine (ne pas vraiment) de se disputer.
Dans son exposé, A. Piette introduit alors la notion de double contrainte que décrit bien
l’injonction contradictoire « sois spontané ». Le rituel nous dit « sois spontané », exprimant une
sorte d’auto-négation, comme une impossibilité de mener à bien les choses. Albert Piette
rappelle que Bateson a beaucoup critiqué Durkheim. L’enjeu tient dans le fait de saisir le sens
de la négation, à partir du fait que les animaux se montrent capables de ne pas se disputer.
Pour Bateson, le jeu désigne le contexte dans lequel les actes prennent un sens différent. Le
rituel constitue le cadre particulier qui transforme les actes et les paroles qui s’expriment. Il
s’agit d’un moment qui introduit une sorte de négation. Par exemple, l’enfant qui joue au
cowboy sait qu’en réalité, il n’est pas un cowboy, mais il joue bien ce rôle précis (il ne joue pas
à la poupée). Le comportement du cowboy n’est donc joué que partiellement. L’enfant n’est
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%