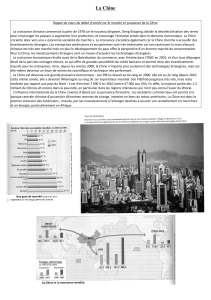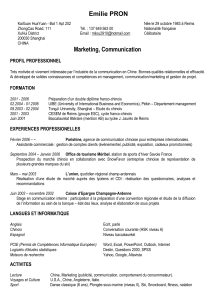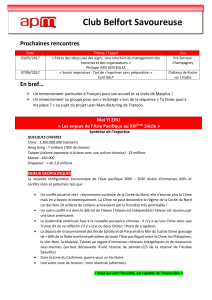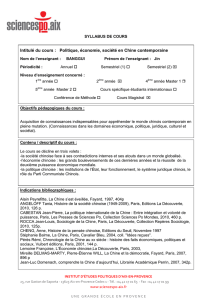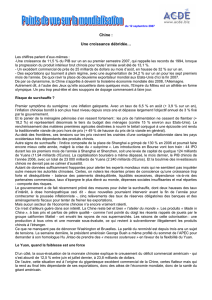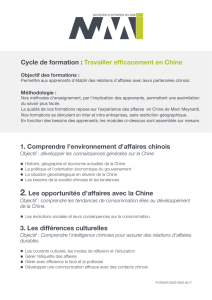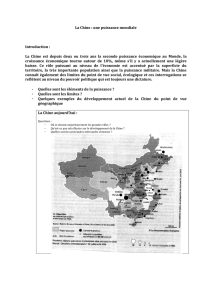comptes rendus
publicité

COMPTES RENDUS Jacques Guillermaz, Une vie pour la Chine. Mémoires, 1937-1989.Paris, Robert Laffont, 1989. 452 pages Voilà un ouvrage plein de charme, doué de qualités uniques, et propre à intéresser plusieurs types de lecteurs. Sorti de Saint-Cyr en 1932, arrivé à Pékin en 1937 comme étudiant en langues et attaché militaire adjoint, le général Guillermaz aura passé en tout une quinzaine d'années directement au contact de la Chine et de ses habitants ;il peut. à ce titre, se prévaloir d'une expérience incomparable de résident et de voyageur, tant avant qu'après l'arrivée des communistes au pouvoir. Son installation dans l'ancienne capitale en compagnie de sa femme et de sa fille intervient juste à temps pour le faire assister aux débuts de l'invasion japonaise, en juillet 1937. En l'absence d'attaché militaire en titre, Guillermaz est pratiquement seul à rendre compte de la guerre depuis le milieu de 1938jusqu'à son transfert à Chongqing en 1941. Il passe deux ans à Chongqing avant de rejoindre la France libre à Alger et de participer à la reconquête du midi de la France à la tête d'une compagnie et d'un bataillon. C'est au cours de ces opérations qu'il reprend son village natal, où sa mère, sans nouvelles de lui depuis des années, avait eu la prémonition de son retour. Ce spécialisteaux compétencesdémontréesdans les fonctions d'attaché militaire ne devait bien entendu pas tarder à être renvoyé en Chine. Il va Comptes rendus y observer cinq années durant les progrès communistes dans la guerre civile. Il réside environ un an et demi à Nankin après 1949, ce qui lui donne l'occasion de vivre la prise en main d'une grande ville par le nouveau pouvoir. Après six mois passés à Hong Kong en 1951, il est stationné à Bangkok pour quatre ans (1952-1956), d'où il peut suivre de près la deroute progressive des Français en Indochine. Il est présent à la conférence de Genève en 1954, dont les participants tentent de résoudre la qucstion vietnamienne, et on le retrouve plus tard dans les réunions de l'organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE) et dans les négociations de 19611962 sur le Laos. Ainsi donc, après avoir été le témoin immédiat des bouleversements en Chine pendant les années où l'armée française connaissait la défaite en Europe avant de se reconstituer et de rentrer en scène sous l'égide du mouvement gaulliste, Jacques Guillermaz aura été le témoin quasi immédiat du retrait de cette même armée en Indochine. Au moment de la reconnaissance diplomatique de la Chine par de Gaulle, il peut se vanter d'avoir tenu pour ses supérieurs hiérarchiques la chronique de la montée et de la chute des empires dans la plus grande partie de l'Asie orientale. À cette longue expérience va s'ajouter un séjour de deux ans à Pékin (1964- 1966),auquel les premiers épisodes de la Révolution culturelle coupent court. On ne s'avancera guère en affirmant qu'aucun autre citoyen d'une nation occidentale n'a autant vu et Ctudié de l'histoire de la Chine pendant les trente années qui s'étendent de 1937 à 1967. Ce parcours que j'ai évoqué en le comprimant beaucoup est la plus belle référence de celui qui a aussi été un grand historien de la révolution chinoise. Au milieu de toutes ces activités le général Guillermaz trouve en effet le temps de passer, en 1957, son diplôme de chinois à l'École des Langues Orientales ; dès 1968 il publie son Histoire du Parti communiste chinois, 1921-1949, qui connaîtra une seconde édition en deux volumes en 1975; et en 1972 paraît Le Parti communiste chinois au pouvoir, 19491972, dont la seconde édition, également en deux volumes, est de 1979. En dépit des travaux qui ont depuis modifié ou complété certaines parties de son récit, le K Guillermaz demeure un ouvrage fondamentalsur le sujet. L'un des grands intérêts d'Une vie pour la Chine réside dans les brefs croquis donnés par l'auteur des innombrables personnalités qu'un attaché Comptes rendus militaire était amené à rencontrer, et, plus encore, dans les descriptionsfrappantes et concises des multiples endroits où il est passé, ne fût-ce qu'une seule fois, au cours d'une carrière incroyablement active. Voilà un des meilleurs livres de voyage que je connaisse sur la Chine, à commencer par le vieux Pékin. Il se trouve que la partie orientale de Pékin où la famille Guillermaz s'icptalle dans une maison chinoise en 1937 est aussi le quartier où mon épouse Wilma et moi-même avions passé trois ans et demi jusqu'à la fin de 1935. La maison n'était apparemment pas la même, mais la description pourrait exactement s'y appliquer. Elle se trouvait, dit Guillermaz, dans un hutung de la ville de l'Est, entre l'avenue de Hatamen et la muraille, au bout de la rue du Wai Kiao Pu. Ses tuiles colorées. sa véranda aux colonnes laquées dc rouge, ses deux petits jardins aux allées de briques, saporte vermillon aux larges disques de cuivre, nous enchantèrent tous trois. .. (p. 23) comme notre maison nous avait nous-mêmes enchantés. Le général Guillermaz, comme l'auteur de ces lignes, appartient à cette génération sinophile qui a rencontré la Chine à l'époque où les traités protégeaient encore les étrangers et où les seigneursde la guerre continuaient de dominer l'arrihe-pays. Les cinquante ans qui se sont écoulés depuis ont apporté aux Chinois,jusqu'ik satiété, l'invasion étrangère et la guerre civile, sans parler de la croissance et des changements prodigieux apportés par le nouveau régime et ponctués par les erreurs monumentales des chefs révolutionnaires. Je remarque que, lorsqu'il voyageait, Guillemaz était accueilli et hébergé par les missionnaires catholiques, tout comme nous l'avions été par les missionnairesprotestants. Jusqu'ik un certain point, nous étions nous-mêmes des << missionnaires civils B.Avant son arrivée en Chine, Guillermaz avait servi trois ans à Madagascar, une de ces colonies qu'il appelle << nos terres promises >> et dont il dit : Nous y trouvions de grands espaces, des peuples neufs à aider, des tâches qui nous grandissaient et nous justifiaient dans notre mission tutélaire. t d i que l'isolement, la vie de brousse, les dangers même. autorisaient nos initiatives, avivaient notre sens des responsabilités. (p. 16) - Comptes rendus Dans lecas présent, comme on sait, le sentimentaméricain d'être responsable envers un peuple que les États-unis avaient aidé conduisit à notre refus de nous résigner à la << perte 2 de la Chine, thème dont les républicains surent user avec succès dans le jeu politique intérieur, d'autant mieux que la Chine s'avérait efféctivement a perdue » sans rémission. Deux choses m'ont particulièrementfrappé dans Une vie pour la Chine. D'abord, une sensibilitéesthétiqueethistoriquequiconduitl'auteur àpartout visiter monuments et musées, révélant un intérêt intellectuel et artistique qui n'est pas si répandu parmi les attachés militaires très occupés. Et ensuite, une extrême sensibilitéaux souffrances du peuple chinois révélées à chaque moment par le cours des événements. Guillermaz manifeste l'objectivité et le réalisme d'un observateur averti et perd rarement son temps à dénoncer le communisme en tant que système abstrait. C'est pour les victimes de la guerre et des bouleversements révolutionnaires qu'il exprime à maintes reprises sa sympathie. Je n'ai trouvé qu'un endroit où il me semble se faire indubitablement sentimental, et peut-être est-ce en partie dû à son pouvoir de description. Durant l'un des tours arrangés par la République populaire pour le personnel diplomatique de Pékin, il visite à Wuhan un énorme abattoir où l'on tue les porcs destinés à l'exportation : Hallucinant spectacle. En quelques minutes et par centaines, les pauvres bêtes sont poussées en avant malgré leurs cris perçants, électrocutées,suspendues par les pieds. égorgées dans un flot de sang, vidées de leurs entrailles. et leurs quartiers, raidis de gel, pendent en un instant en longues rangées dans les salles figonfiques. Le personnage le plus terrible de ce sacrifice est un petit homme maigre qui se tient dans une fosse au milieu du troupeau grognant et gémissant, ses électrodes dans une main, cherchant des yeux la bête à laquelle il va appliquer le courant derrière les oreilles. Apeurées, toutes tournent autour de lui qui, indifférent et sans haine. accomplit des centaines de fois par jour le geste mortel tandis que. sans cesse, d'autres victimes, poussées par leurs gardiens, << tsou ! tsou ! ». montent vers leur misérable fin. (pp. 322-323) Ce n'étaient après tout que des cochons comme ceux que nous consommons une fois abattus et préparés. Je me souviens que l'abattoir de Sioux Falls, il y a soixante-dix ans, ne pratiquait pas l'électrocution, mais qu'on y hissait les bêtes agoniser en poussant ces mêmes hurlements Comptes rendus qu'on pouvait entendre à l'aube à Pékin dans les annécs trente. La description de Guillermaz n'aaucune intention ironique ;elle s'insère au milieu de paragraphes consacrés au sort des intellectuels et des Chinois ordinaires à la veille de la Révolution culturelie. La souffrancedes animaux est rendue de façon plus concrète et visuelle, mais elle n'est pas si différente de ce qu'enduraient les hommes et les femmes dans leurs pensées et leurs sentiments. À considérer la défaite humiliante subie par la France au début de la seconde guerre mondiale et la perte de son statut de grande puissance en Asie orientale,noue Saint-cyrien et attaché militaire reste remarquablement impartial et objectif lorsqu'il évoque l'effort de guerre passablement irréfléchi des Américains en Chine. Il était facile, dès l'époque, de se désoler du fossé intellectuel entre les fonctionnaires des Affaires étrangères américaines placés aux premières loges pour observer les événements de Chine et l'égocentrisme obtus de l'émissaire de Roosevelt, l'ambassadeur Patrick J. Hurley. Pourtant, Guillermaz se garde de sauter dans le train des innombrables critiques. américains et autres, qui ont censuré tant d'aspects de l'intervention militaire américaine en Chine -la rivalité entre les chefs de l'infanterie et ceux de l'aviation, celle entre la marine et tout le reste, l'incapacité «cuiturelie» à se passer des fournituresde l'intendance militaire américaine, le mépris bien informé du général Joseph Stilwell pour le corps des officiers chinois et sa sympathie pour les malheureuses recrues... Il va de soi que l'auteur aurait pu nous en dire beaucoup plus sur l'indifférence et l'inexpérience des Américains en matière de lutte pour le pouvoir et de jeu politique. En deux endroits, pourtant, le général Guillermaz, s'appuyant probablement sur ses notes, exprime des critiques à l'encontre de la stratégie américaine qui étaient courantes à l'époque mais dont l'histoire a démenti, je crois, la validité. Il s'agit d'abord de l'idée de « gouvernement de coalition » -le slogan et l'objectif proclamé des négociations de 1946-à laquelle communistes, nationalistes et Américains affectaient semblablement de souscrire pour répondre aux aspirations du peuple chinois à la paix. Pour l'auteur, les Américains étaient au plus haut point irréalistes en attendant des communistes et des nationalistes qu'ils partageassent effectivement le pouvoir au -- Comptes rendus sein d'un gouvernement de coalition, comme essayait de les y encourager le général Marshall, l'envoyé du présidcnt Truman, pendant l'hiver cl au début du printemps 1946. Guillermaz qualifie Marshall de « grand soldat mais médiocre politique » (p. 155), et il est hors de doute que, vu sous l'angle de l'histoire chinoise, les Américains se laissaient bercer d'illusions libérales. Il n'en importe pas moins de noter que, politiquement, Truman et Marshall ne se situaient pas à proprement parler entre nationalistes et communistes en Chine, mais bien plutôt entre républicains et démocrates aux USA ; entre la perception populaire américaine des maux infligés par le communisme à la Chine et la lucidité des services spéciaux concernant I'inévitabilité d'une défaite nationaliste. Le gouvernement américain ne pouvait s'offrir le luxe d'une politique d'abandon des nationalistes;en même temps, il eût été inconscient de se précipiter corps et biens à leurs côtés pour perdre avec eux une guerre civile promettant d'être au bas mot dix fois aussi difficile et désastreuse que devait l'être l'engagement américain au Vietnam une douzaine d'années plus tard. Autrement dit, ce me semble, le jeu de Washington ne pouvait qu'être le suivant : produire un effort américain pour soutenir le bon côté, dans les deux sens du terme. sans pour autant se retrouver piégé dans un super-super-Vietnam. Le gouvernement de coalition s'avérait donc une fiction utile aux trois parties,et par la suite le général Marshall, devenu secrétaire d'État, réussit à maintenir les ÉtatsUnis à l'abri d'une intervention dans la guerre civile chinoise. Je crois que, loin de se faire des illusions sur la nature irréconciliable du conflit, l'administration Truman avait eu tout loisir de se convaincre, sur la base des renseignementsaccumulés par un réseau très étendu de consulats, d'équipes de conseillers militaires, de missionnaires, etc., de ce que la cause nationaliste était essentiellement désespérée. Second point de désaccord :le général Guillermaz laisse entendre qu'en 1945 les Américains auraient empêché Chiang Kai-shek de prendre immédiatement i'offensive pour rétablir son contrôle sur la Chine centrale ; et il suggè.re à ce point (p. 156) que, comme à l'époque des seigneurs de la guerre, la Chine de la fin des années quarante aurait pu être divisCe en deux à l'instar de l'Allemagne, de la Corée et plus tard du Vielnarn, le gouvernement nationaliste abandonnant aux communistes les provinces Comptes rendus situées au nord du Yangzi. Dans ce scénario, la Sixième Flotte américaine aurait certainement empêché les communistes de franchir le Yangzi, un peu comme la flotte des Song avait su contenir les Mongols pendant les décennies médianes du xmc siècle. Mais, sans même se demander si les guerres qui ont ravagé la Corée et le Vietnam divisés, et plus tard la confrontation nucléaire entre les super-puissances autour d'une Allemagne elle aussi divisée, ont constitué un quelconque << succès », un tel partage de la Chine aurait supposé que l'on pût empêcher les communistes d'infiltrer en totalité le Sud et d'y organiser une guérilla de résistance. En même temps, l'intervention américaine aurait été prétexte à une mobilisation de tous les Chinois contre une Amérique perçue comme le successeur de l'envahisseur japonais. En bref, les vues exprimées ici par le général Guillermaz n'ont été à l'époque qu'une passade dans le milieu des géo-stratèges et des spécialistes de la logistique et de la puissance de feu ;mais, politiquement, elles étaient de peu de substance. Les trois paragraphes que l'on vient de lire portent sur un texte plus court encore, ce qui est assurkment peu dans un livre gros de 450 pages ! 11 m'a simplement semblé que le recenseur se doit d'exprimer des réserves là où il le peut, ne serait-ce que pour prouver sa sincérité... Pour revenir à un plan plus personnel, l'auteur nous parle de sa séparation d'avec sa première femme en 1943 :elle avait alors préféré rester à Hanoï, du côté du régime de Vichy. En décembre 1949. à Pékin, Jacques Guillermaz épouse Mlle Hu P'ing-ch'ing. La jeune femme a été formée dans les disciplines chinoises classiques et en anglais. Sa famille a compté des fonctionnaires impériaux, et on y trouve des dignitaires du régime nationaliste, notamment des généraux ; l'une de ses sœurs réside déjà à Taiwan. Elle a été journaliste et a travaillé comme traductrice pour le ministère des Affaires étrangères. À ces divers titres,elle risque le jour venu d'être une victime désignée du mouvement révolutionnaire. Son mari approfondira en sa compagnie son intérêt pour la poésie chinoise et, plus tard, Paris, l'aidera à publier deux volumes de traductions (Pairicia Guillermaz, La poésie chinoise, anthologie des origines d nos jours, 1957, et La poésie chinoise contemporaine, 1962). Mais. de retour en France, elle glisse dans une longue dépression dont elle n'arrive à se protéger qu'en se réfugiant dans l'univers de la littérature chinoise. Les exigences de la Comptes rendus vie occidentale semblcnt l'avoir maintenue dans un état de choc culturel permanent, et en fin de compte elle recherchera un poste d'enseignement à Taiwan pourpouvoir seconsacrerentièrementà ses études. Ce dénouement est, on l'imagine, source de tristesse pour l'auteur. Un an et demi après le départ de son épouse pour Taiwan, il l'y retrouve entièrement absorbée par son enseignementet par ses travaux de traduction, incapabled'envisager un quelconque retour à Paris. Encore une année et demie, et Guillermaz épouse à Pékin la charmante et talentueuse Kirsti Ritopeura, attachée d'administration à l'ambassade de Finlande. Ils fêtent leurs noces en dansant sur le toit du vieux bâtiment de l'Hôtel de Pékin, comme les impérialistes du temps passé ! Expert reconnu dans le domaine militaire et diplomatique, doué de surcroît d'une vaste culture, le général Guillermaz avait depuis longtemps essayé d'obtenir que les études sur la Chine contemporainebénéficient du même soutien institutionnel que la sinologie classique, plus prestigieuse. Ainsi aurait-il souhaité que les jeunes officiers pussent recevoir une formation à la langue et à la culture chinoises. Mais ses efforts n'avaient rencontré que des obstacles :querelles territorialesentre bureaucraties,refus de se rendre à la nécessité d'agir, rivalités personnelles et institutionnelles, manque de moyens - tout cela aboutissant à un état de léthargie tout à fait préjudiciable. Le bref chapitre intitulé Misères de la sinologie française >> démit une situation dont les collègues étrangers de l'auteur étaient conscients, mais dont nul ne pouvait rendre compte avec plus de compétence que lui. Ayant quitté le service actif, le général Guillermaz va devenir un universitaire dont l'enseignement et l'administration seront tout entiers consacrésau domainecontemporain. Le résultat est la création d'un «Centre de recherche et de documentation D toujours en activité. C'est sur ce terreau qu'a pu se développer une nouvelle branche de la sinologie française dont l'existence même rend hommage à cet homme exceptionnel par l'ampleur de sa vision, par la qualité de ses compétences et par sa fidélité à sa patrie. John K. Fairbank Comptes rendus Dominique Liabeuf et Jorge Svartzman (éds.), L'œil du consul. Auguste François en Chine (1896-1904). Paris, Chênemusée Guimet, 1989. 215 pages, 163 photographies Dans la photothèque du musée Guimet a été retrouvée une caisse contenant des plaques de verre sur la Chine cn 1903, soigneusement rangées et légendées. mais sans nom d'auteur. C'est grâce à un bout de carton jauni que les éditeurs du présent recueil ont pu non seulement retrouver le nom du photographe, Auguste François, mais aussi son joumal et sa correspondance, conservés par sa famille. La premihre partie de l'ouvrage retrace la carrière d'Auguste François, né à Lunéville, en Lorraine, le 20 août 1857. Entré dans la diplomatie, François occupe plusieurs postes en Extrême-Orient.Premier résident àSonTay en 1886, il doit réduire les dernières bandes de Pavillons Noirs, ces pirates vietnamiens qui s'étaient iilustrés dans la guerre franco-chinoise de 1884-1885. En décembre 1895, il est nommé Consul de France à Longtheou (Longzhou), où il a pour mission de préparer la construction du futur chemin de fer du Tonkin au Yunnan et de négocier avec les autorités chinoises les affaires de la frontière indochinoise. À la fin de l'année 1899 il est nommé consul honoraire à Yunnanfou (Kunming) afin de mener les négociationspour l'ouverture du chemin de fer. Sa mission achevée, il rentre définitivement en France en 1904. Entre temps, il a voyagé à travers le sud de la Chine, pris de nombreuses photographies, rédigé un journal et envoyé force lettres à ses amis. Les éditeurs de L'œil du consul ont sélectionné un certain nombre des clichés légendés par Auguste François et, dans la dernière partie de I'ouvrage, intitulée Souvenirs d'Indochine et de Chine », présenté des extraits du joumal et de la correspondance. Les réflexions suivantes, rédigées à Yunnanfou, ne sauraient mieux résumer l'attitude du consul face à ce qu'il a pu observer et photographier : Je m'emplis les yeux de scènes et de décors étrangers, et puis j'ai cette chance de vivre dans une ville non ouverte. non encore contaminée par l'Europe autrement que par ce que j'en apporte et que par conséquent, je ne vois pas ; je suis un spectateur de l'existence chinoise dans ce qu'elle peut avoir de plus parfait. Je tâche d'y pénétrer un peu et de recueilli quelques idées. Je crois Comptes rendus qu'il n'y aura pas eu d'empire ayant duré aussi longtemps et demeurant moins connu. Je ne vois aucune publication qui me satisfasse pour représenter ce pays sous son véritable jour ... Tous ceux qui ont écrit, même après avoir résidé longtemps dans les villes ouvertes, n'ont rien pénétré de ce monde. (p. 209) Témoin privilégié d'un monde qui disparaît, Auguste François a laissé des documents photographiques irremplaçables : vues de Kunming entourée de ses remparts, scènes de marché et de rue où se mêlent gens du commun, mandarins, mendiants et condamnés, soldats à l'exercice, mais aussi paysages des alentours de Kunming, routes, vues du Yangzi, etc. François se montre plein de verve et de hargne lorsqu'il parle de ses concitoyens. Ainsi la « mission » Paul Bert sur le paquebot Melbourne : On eût dit une troupe d'acrobates faméliques exportés et voyageant avec billets de faveur en première classe. Ils prirent possession du bateau entier, écrasant, brimant les passagerspayants. en grandnombreétrangers, surtout des Hollandais pacifiques... qui débarquant à Singapour jurèrent de ne jamais remonter sur pareille galère. et de reporter leur clientèle à la marine anglaise. Ou la société coloniale de Saigon : Une soci6téen toc dans laquelle des plumitifs de l'ordre le plus modeste tiennent un rang marquant ;où des commis comptables ou gabelous tiennent un état de maison, possèdent une victoria avec des saïs à leurs couleurs... Cette population ne peut exister qu'à Saigon et rien n'existe plus pour elle que Saigon. Ces gens-là ne connaissent pas l'intérieur de la colonie et ne se soucient même pas de le connaître. Paradoxalement, le consul chargé de négocier l'implantation d'un chemin de fer et depréparer la pénétration françaiseen Chine est hostile3ces projets : Ii n'est pas possible de se moquer plus agréablement du monde, en soutirant au bon contribuable 100millions pour la constmction d'une pareille voie fenée. C'est ça la pénbtration de la France au-dehors ! (p. 134) Son témoignage sur la vie en C h i e nous vaut des portraits et des descriptions pleins de charme : ainsi le dernier examen de la licence dont il fut le témoin à Yunnanfou,ou leportrait du maréchal Sou, son interlocuteur au Guangxi, qui comme lui devait se débattre entre des mots d'ordre Comptes rendus contradictoires et avec de faibles moyens. Mais il nous vaut aussi des descriptions pathétiques, comme celle de ces jeunes missionnaires envoyés au fin fond de la Chine, dans des régions inhospitalières même pour les autochtones, et qui ne peuvent que finir en martyrs, ou celle de ce couple de Français apeurés réfugiés dans une pagode sous la double menace des pirates et des soldats de leur employeur le maréchal Sou... Et ce sont l'humour et la dérision qui l'emportent dans le portrait du père Bailly, un missionnaire qui se contentait de paresser au soleil sans s'occuper de convertir les païens et qui pour cette raison ne causait de souci à personne, et surtout pas au consul... Ces témoignages nous renseignent autant sur ce qui est observé que sur l'observateur lui-même, qui fait preuve d'une ouverture d'esprit remarquable pour l'époque. On ne peut demander à ce recueil d'être plus que ce qu'il prétend être : une collection de photographies, en elles-mêmes autant de documents historiques précieux, agrémentée de quelques textes de la main du photographe. Ces textesontpour seul défautd'être trop brefs, mais suffisamment parlants pour nous donner envie d'en lire plus. La publication intégrale du journal d'Auguste François est annoncée pour le mois de septembre 1990, mais quelle maison d'édition osera s'engager dans la publication exhaustive des récits des voyageurs, diplomates et autres commerçants français ayant abordé la Chine au wc" et au début du & siècle, à l'image de ce qu'ont fait les éditions Yuelu du Hunan pour les écrits des voyageurs chinois en Occident avant 1911 ? Christine Nguyen Jacqueline Thévenet, Le lama d'occident. Évariste Huc,de la France en Tartarie et du Tibet en Chine, 1813-1860.Paris, Seghers, 1989.305 pages, illus. (Coll. « Étonnants voyageurs ») Les premières pages de cette biogmphie du P. Huc paraissent nous convier à de l'histoire missionnaire fort plaisante : études au petit séminaire de Toulouse. naissance d'une vocation religieuse en réponse à un vœu secret de la mère, séjour au grand séminaire lazariste de la rue de Sèvres, voyage en diligence puis, en 1839, sur un trois-mâts à destination de Macao. Les Comptes rend us activitésdans la mission de Mongolie chinoise et, en 1844-1846, le voyage aventureux à Lhasa en compagnie du P. Joseph Gabet, se présentent ensuilc sous la forme d'un « digest » des fameux Souvenirs d'un voyage h n s la Tartarie et le Thiber de 1851 (selon l'édition commentée qu'en a donnée à Pékin en 1924 le P. Planchet, cm, M i t é e en deux volumes, AstrolabePeuples du Monde, 1987). Voilà un honnête ouvragede vulgarisation, propre à instruire tout en distrayant. Mais Mme Thévenet, qui a conduit ses recherches dans les archives de la famille Huc, de la Congrégation des Missions (ou Lazaristes), du musée de la Marine, et en divers autres lieux, semble viser plus haut. Il est toujours difficile pour le recenseur de juger à l'aune de l'exactitude scientifique ce qui pourrait n'être qu'aimable récit. Bien qu'auteur d'une petite histoire mongole (Les Mongols de Gengis-khan et d'aujourd'hui, Paris,Armand Colin, Civilisations », 1986,224p.), MmeThévenetn'est pas orientaliste ; elle n'est donc pas en mesure de restituter, ni de commenter, les termes et noms mongols et tibétains dont Huc est prodigue (ainsi, les « Katchi » qu'elle cite pp. 162 et 165 sont des musulmans cachemiriens installés à Lhasa), ni de comprendre les institutions locales (il faudrait par exemple expliquer, p. 95, que les « Vierges » sont des religieuses chinoises à veux simples). Son seul effort d'actualisation dans le mode d'expression, une transcription des mots chinois selon le pinyin, est, somme toute, assez contestable, car le plus souvent lecteur ne peut de la sorte distinguer ce qui est authentiquement chinois et tibétain et ce qui est simples approximations chinoises de termes autochtones (ainsi, pp. 105 et 110, Duolun représente la forme chinoise du mongol Dolôn, « Sept [lacs] B). Elle n'est pas historienne non plus :les dates et faits historiques ne sont visiblement pour elle qu'un décor de faible encombrement. Pourtant, point n'est besoin d'être tibétologue de haute érudition pour consulter les lravaux fondamentaux et bien connus, quoique non cités dans la bibliographie, de L. Petech (1 Missionan italiani ne1 Tibet e ne1 Nepal, Rome, 7 vol., 19521956), F. de Filippi (An Account of Tibet. The Travels of lppolito Desideri of Pistoia SJ., 1712-1727, Londres, 1937), C. Wessels (Early Jesuit Travellers in Central Asia, 1603-1721, La Haye, 1924). et s'assurer, si l'on veut comger seulement quatre lignes de la p. 157, que le décret de la S.C. de la Propagande confmnt le Tibet aux soins des capucins italiens date de , Comptes rendus 1703 (et non de 1656) ; que les capucins ont ouvert une première mission à Lhasa de 1707 à 1711 ; qu'Ippolito Desideri, sj, passé par cette ville en 1676 sur le chemin du Cachemire à Pékin, y missionna à son tour de 1716 à 1721, et qu'il laissa alors la place aux capucins, installés là de 1716 à 1733puis, de nouveau, en 1741jusqu'à la fermeture définitive de la mission en 1745. Autant qu'on le sache, Odoric de Pordeno~e(celui que Mme Thévenet nomme Odoric de Frioul, p. 157 encore) n'est, au XIV siècle, jamais allé jusqu'au Tibet et n'en a parlé que par ouïdire ; l'Autrichien Johann Grueber, sj, et le belge Albert d'Orville (ou Le Comte), sj, ont gagné Lhasa en passant en 1661 par Xining, de sorte que les PP. Huc et Gabet n'étaient pas, fin 1845, les premiers Européens 21 gagner le Tibet par le nord-est, comme veut nous le faire croire Mme Thévenet (p. 144). De surcroît, les épreuves ont été mal relues (ainsi Lagrené devient « une diplomate française », p. 168). Enfin, critique plus sérieuse, la dite biographie n'est en fait qu'une hagiographie déguisée. Tout ce qui pourrait ternir la gloire du héros est soit traité à la légère (les critiques lancées contre ses mœurs une première fois au moment de l'ordination en 1838, p. 36, et de nouveau en 1854, lorsqu'il sollicite la charge de chanoine, p. 253), soit passé sous silence (le problème de ses rapports avec Gabet, son supérieur immédiat durant l'expédition au Tibet ; le niveau de ses connaissances réelles en mongol, en t i W n et en chinois écrit ;ses emprunts littéraires à ses prédécesseurs ; ses rodomontades ;la désobéissanceaux ordres supérieurs que représentait la décision consciente de s'avancer vers l'ouest et le Tibet, alors que les instructions de mission indiquaient le plein nord et les steppes mongoles ; etc.). Rien non plus sur les options politiques de Huc, qui rêve de voir les droits de l'homme se répandre en compagnie de l'évangile et « l'arbre de la liberté grandir à côté de la croix » (Souvenirs, éd. 1924, 1, p. 289), et qui justifie la r6voli.e des opprimés par leur u haine bien légitime de tout joug étranger » (Souvenirs,II, p. 449 ;cf. Hubert Durt, exotisme, religion, politique », Cultures et développement, 17 (4), 1985, pp. 660663). Si Son veut une opinion sérieuse sur le P. Huc et son œuvre, mieux vaut encore se reporter 2I ce qu'en écrivait Paul PeUiot (Toung Pao, 19%. pp. 133-178, et introduction à l'édition anglaise de Huc et Gabef Travels in Tartary. Thibet and China, 1844-1846,hndres, 1928, pp. v-xxxv), en Comptes rendus attendant que l'édition des lettres du voyageur, qu'annonce Mme Thévenet, ne nous apporte clairement des éléments nouveaux. Françoise Aubin Pierre-Antoine Donnet, Tibet, mort ou vif, préface d'Élisabeth Badinter. Paris, Gallimard, 1990. 352 pages, illus. (Coll. << Au vif du sujet ») Pierre-Antoine Donnet, journaliste de l'AFP à Pékin, s'en va un jour se promener au Tibet en passant par la frontière népalaise. Son enthousiasme d'atteindre le Toit du Monde et de s'y trouver en liberté, sans accompagnateur chinois, est vite contrebalancépar son indignation devant l'ampleur des destructions infligées par la Révolution culturelleaux beaux monastères tibétains, par son angoisse aux récits de persécutions et de tortures qu'il recueille (en chinois) partout où il passe, en cette époque où les camps de travail viennent de rejeter une partie de leurs occupants et où l'interdit frappant les religions s'est desserré. Dès lors, investi par une cause qu'il a fait sienne, il visite tous les lieux de la présence tibétaine dans l'ouest de la Chine propre et en exil, dans l'extrême nord de l'Inde, à Dhararnsala (au Cachemire), au Ladakh, au Zanskar. Le présent ouvrage est le cri d'un cœur à vif, appuyé sur les déclarations de la presse officielle chinoise, sur celles des services de documentation du gouvernement tibétain en exil et, abondamment, sur l'enquête orale auprès des émigrés. Il interviewe, entre autres, le Dalaï-lama, lequel, né en 1935, raconte comment, adolescent au moment de l'implantation communiste, il a été manœuvré par un Mao tout en gentillesses (p. 48). Le constat final est écrasant pour le gouvernement de PCkin et balaie tous les doutes qu'on pouhait encore entretenir en Occident, après la répression du dernier soulèvementde mars 1989, sur les intentions du régime populaire à l'égard de sa colonie tibétaine et du lamaïsme. Des annexes donnent l'accord en dix-sept points légalisant, en mai 1951,la << libération pacifique du Tibet », le plan en cinq points du Dalaï-lama de septembre 1987, et son discours au Parlement européen de juin 1988 (pp. 329-342). Il est cependant dommage pour les historiens des régimes communistes que l'auteur n'ait pas montré une rigueur plus stricte dans la conduite de Comptes rendus son propos (qui aurait aussi gagné à être plus condensé) et dans le choix de ses arguments, et qu'il n'ait pas su éviter l'écueil du sensationnel journalistique. Pourquoi, par exemple, annoncer initialement que les Tibétains sont traditionnellement pacifistes, confondant par là théorie religieuse et réalit6 sociologique, alors que tout le livre est parcouru par des récits d'actes violents. dus notamment aux guerriers Khampa ? Pourquoi accorder constamment valeur probante aux seules statistiques du gouvernement en exil et rejeter en bloc celles de Pékin ? Donner, à l'unité près, tels qu'avancés par le bureau de Dharamsala, des chiffres de pertes en vies humaines par la répression paraît irréaliste, d'autant que le total dépasse largement le million d'individus (p. 144), pour unc population notoirement peu fournie. Le sort des Tibétains a été très cruel depuis 1950 : la réalité des faits se suffit bien assez à elle-même. sans qu'il soit besoin d'assombrir encore le tableau en parlant. par exemple, de génocide, alors qu'iI s'agit plutôt d'une entreprisede dépersonnalisationculturelle. S'il était possible d'établir une graduation dans le martyre, nous dirions que les Tibétains y sont probablement enfoncés un degré plus profondément que les autres citoyens de RPC ;mais que, s'ils sont, selon la formule de l'auteur, « le quart monde du tiers monde » (p. 220), ils se trouvent en cet état dans la compagnie des Mongols de Mongolie Intérieure, des turcophones du Xinjiang, sans parler des Zhuang,des Miao,des Loloet autres ethnies du Sud-Ouest chinois, qui, elles, ne disposentpas d'un gouvernement en exil pour alerter l'opinion publique. Ce ne serait pourtant pas démobiliser les amis du Tibet que de replacer clairement, à chaque époque donnée, les persécutions dans le climat politique général. Ce n'est pas au Tibet seulement que les lieux de culte ont été désacralisés durant laRévolutionculturelle et plus ou moins détruits ; et la triste pratique des stérilisations, avortementsforcéset injectionsléthales aux nouveaux-nésest attestéeen bien d'autres régions excentréesde Ia RPC. Les statistiques chinoises ne sont pas d'une exactitude absolue, le gouvernement de P6kin est bien contraint d'en convenir, au vu d'une explosion démographique qui dépasse les pronostics issus du dernier recensement de 1982. Elles ont toutefois l'intérêt de fournir des ordres de grandeur relative, puisque les motifs de distorsion avancés par l'auteur (p. 158 par exemple) sont identiques dans toutes ces régions de la Chine Comptes rendus cxtérieurc, qui étaient en 1950 majoritairement peuplées de non-Chinois devenus depuis lors des minoritaires chez eux. Selon le Statistical Yearbook of China, 1986 (p. 77), la population tibétaine a connu, entre 1964 et 1982, date du dernier recensement, une expansion de 54 %, soit une croissance annuelle de 24 p. mille, alors que la croissance démographique globale de la RPC est de l'ordre de 21 p. mille. Selon la même source (p. 64), fin 1985, les non-Chinois formaient au Tibet 96,44 % de la population, au Xinjiang 60,70 %, au Qinghai 53,42 %, en Mongolie Intérieure 16,43 %. La présence chinoise est, au Tibet, sans doute à son niveau le plus faible en RPC ;elle paraît cependant écrasante au visiteur de passage, parce que concentrée dans le cœur de Lhasa et de quelques villes, et beaucoup plus mal tolérk par les Tibétains que par les autres autochtones de la Chine extérieure. Mais la dureté de son climat protege le Tibet, de nos jours comme jadis, de la colonisation massive qui a affecté, par exemple, la Mongolie Intérieure depuis la fin du siècle dernier ;et le temps des grandes migrations internes est maintenant heureusement clos. Les chiffres qu'avance l'auteur, sur la foi du gouvernement tibétain en exil, de 600 000 Chinois installés au Tibet entre 1975 et 1980, dont 100 000 à Lhasa, outre 300 000 soldats (pp. 140-141),puis, à la fin des années quatre-vingt, pas moins de 7 millions et demi dans le Tibet propre et le Tibet extérieur (p. 157), ne s'appuient que sur des hypothèses imaginatives. Même si le passif du régime populaire est lourd, les tares de la colonisation ne doivent pas lui être imputées à lui seul. Ainsi, la séparation de la région la plus orientaleest une vieille histoire :c'est en 1724que la Chine, à ia suite d'une révolte du prince mongol qui y régnait, s'adjuge 1'Amdo ; c'est en 1928que le régime républicain I'intégre dans une nouvelle province, le Qinghai:Le Qinghai n'est donc pas une création du régime populaire (comme iI est dit p. 113) ; et lorsque le gouvernement en exil en réclame le rattachement au Tibet propre, il omet de parler des populations autres que tibétaines qui en partagent le territoire depuis plusieurs siècles : Mongols, musulmans d'ethnies diverses, Chinois installés ià bien avant l'arrivée du communisme, et toute une gamme de métissages. Les violations des droits de l'homme engendn5es par le communisme ne sont pas uniquement le fait de la Chine, est-il besoin de le rappeler ? Les Mongols de la République populaire de Mongolie ont souffert, dans Comptes rendus I'orbitedu stalinismedurantles annéestrenteet qumnte, d'unepolitique d'éradication de la religionet descaractéristiques plusdrastique nationales encorequecelleimposéepar la ChineauTibet: presquetousleurstemples ont étérasésau niveaudu sol et ceuxqui subsistentencore et.monastères de nosjours, en nombrebeaucoupplus restreintqu'au Tibet, ne sont, à I'exceptiondu monastèred'Ulan Baûor,quedesmuséesou desbâtiments à I'abandon,et non des lieux de culte commeau Tibet. Néanmoins,les traditionsculturelleset religieusesde la Mongoliene se sontp:tséteintes pourautant,commele montreI'explosionnationaliste du débutde I'année 1990. L'auteurn'est jamaisen terrainsûr lorsqu'il s'engagedansI'histoire. que le Potalane datepasdu uf siècle(8.237), Rappelonsincidemment, maisduxvrf ; quelesMongolsn'ont pasdonnéle bouddhisme auxTibétains (p. 98), mais I'ont. reçu d'eux, une premièrefois au xf siècle,puis, définitivement,au xvf, et quec'estalors(et nonau xf siècle)quele titre de Dalai'-lama a êtécreépar un grandkhanmongolau bénéficed'un haut, dignitairereligieux de ce temps. L'auteurpensait,en 1985,êEe un pionnierde la découvertedu Tibet depuissa réouverture.Ceræs! Il n'est cependantpas le seul.Parmi les témoinsayantpublié,signalonslepèreJean Charbonnier, MEP,qui,àLhasa enoctobre1984commetourisæindépendant parlantchinois,neréussitpas à trouverun plan de la ville ni quelquelivre quece soit en chinois,signe quele paysn'était"à cetæépoqueau moins,pasaussisiniséqu'on le dit (Laforêt desstèles,1989,p. 76).Katia Buffetrille,elle,à la différencede Pierre-AntoineDonnet.et du pèreCharbonnier,ne parleque tibétainet pas du toutchinois; elleestethnologueet spécialisæ desphénomères religieux chezles Tibéhins. Elle effectuaitson premiervoyageà I'automne1985, parcouranten camion avec despelerins2 500 km de Chengduà Lhasa à tmvers le Kham, ttréoriquementinterdit aux étrangers,puis rejoignait Golmud,dansI'ouest,du Qinghai,et Xining.Elle estdepuislors retournée chaqueannéeau Tibet et rapporte,dansun article érudit, les conditions de la restaurationdu célèbre monâstèrede Samye(ou bSamyas) au sud deLhasa: selonelle, la relationtraditionnelledite <dechapelainà donaûeur> s'estrétabliesousune cer[aineformeentrela communauté monastiqueet le gouvernement dePékin (cf. K. Bufferille, << lâ restaurationdu monastère L67 Comptes rendus de bSam yas :un exemple de continuité dans la relation chapelain-donateur au Tibet ? ».Journal Asiatique, 277 (3-4), 1989, pp. 363-41 1). De même, Melvyn C. Goldstein, auteur remarqué d'une volumineuse histoire du Tibet durant la République de Chine (M.C. Goldstein, A history of modern Tibet, 1913-1951. The demise of the Lamaist State, Berkeley, University of California Press, 1989, xxv + 898 pp.), ethno-tibétologue lui aussi, commençait ses enquêtes sur le terrain tibétain en mai 1985 et Ics poursuivait en 1986-87,avec l'assistance de l'ethnologue Cynthia M. Beall, sous la forme d'un séjour d'un an et demi chez les nomades du Tibet occidental (cf. China Exchange News, 14 (4), déc. 1986, pp. 1-7) : ses observations sur le mode de vie nomade et les interactions avec la politique de Pékin paraissent harmonieusementéquilibrées et solidement fondées (cf. M.C. Goldstein et C.M. Beal, « The impact of China's reform policy on the nomads of Western Tibet », Asian Survey, 29 (6). 1989, pp. 619-641). La longueur de cette recension et l'attention portée à la lecture de Tibet, mort ou vifsuffisent à indiquer l'intérêt intrinsèque du livre. Outre la chaleur et l'urgence de l'appel qu'il lance à l'opinion publique internationale, l'ouvrage abonde en menues révélations qui peuvent enchanter l'historien des religions. Le Panchen-lama (1938-1989), second personnage de la théocratie tibétaine, resté fidèle à Pékin malgré dix ans d'emprisonnement, aurait, disent les Tibétains, choisi lui-même le moment de sa fin prématurée, le 28 janvier 1989, lorsqu'il fut autorisé pour la première fois depuis 1960 àrevenirdans son propre monastère,le Tashi-lhunpo,où il avaitété proclamé Réincarnation sacrée avant l'arrivée des communistes @. 302) ;la recherche d'un bébé réiicarnant son successeur est entamée depuis lors. Il avait une compagne depuis 1983 @p. 303-304) - le fait n'est d'ailleurs pas exceptionnel dans le lamaïsme, ni scandaleux pour les fidèles :,mentionnons à ce propos que le dernier Bouddha Vivant d'Urga, mort en 1924, partageait aussi la vie d'une pseudo-déesse bien terrestre. Dans le grand monastère lamaïque du Qinghai, le Kumbum, les autorités chinoises ont installé, au milieu des objets de culteautochtone,des reproductionsdes fameuses statues de guerriers et de chevaux découverts dans la tombe de Qin Shihuangdi (p. 239), dans un but évident de syncrétisme cultuel sino-tibétain. Et, dans l'autre lieu saint du bouddhisme tibétain, au Labrang du Gansu, on peut admirer, au nombre des sculptures traditionnelles en beurre de yak, des Comptes rendus représentations de Mao et des dirigeants actuels du régime (p. 233). On ne manquera pas d'être frappé par une information essentielle :la Fédération pour la démocratie en Chine. installée à Paris comme on le sait, a ouvert depuis l'automne 1989 des pourparlers avec le Dalaï-lama et ses représentants (p. 307). Plus grand encore aurait été l'intérêt documentaire du témoignage de Pierre-Antoine Donnet si, profitant de ses entrées auprès de l'émigration tibétaine, il avait décrit le système d'organisation et d'action du gouvernement en exil à Dhararnsala et en Europe, et analysé plus clairement les tendances qui le traversent et le divisent. Mais foin des critiques ! Tel quel, Tibet, mort ou vifdoit être lu si l'on veut connaître la Chine dans tous ses états. Française Aubin Janice Stockard, Daughters of the Canton delta :marriage patlerns and economic strategies in South China, 1860-1930. Stanford, Stanford University Press, 1989. 221 pages En 1975, un article de Marjorie Topley (a Marriage resistance in rural Kwangtung », in Margery Wolf et Roxane Witke [eds.], Women in Chinese sociery, Stanford, 1975, pp. 67-88) faisait accéder à la célébrité un phénomène social passé jusqu'alors inaperçu :l'adoption de certaines stratégies de résistance au mariage par les paysannes du delta de la Rivière des Perles à la fin du XWsiècle et au début du W. Appuyé sur des entretiens avec cent cinquante femmes âgées résidant à Hong Kong, l'ouvrage de Janice Stockard apportedes informationsinédites et très détaillées surces pratiques, et tente de réfuter dans le même temps l'une des conclusions de Marjox-ie Topley :en s'en retournant chez leurs parents dès les noces célébrées pour ne s'installer de façon définitive dans leur belle-famille que trois ou quatre ans plus tard, ou au moment de la naissance d'un premier enfant, ce n'est pas un refus du mariage que manifestaient les jeunes épousées. Loin de transgresser les normes locales, cette pratique leur était conforme :ce type de mariage, appelé par Janice Stockard << mariage avec transfert différé de l'épouse », constituait en fait le modèle dominant dans une région du delta de la rivière des Perles comprenant l'ensemble de la sous-préfecture de Shunde et certaines parties des six sous-préfecturesadjacentes. (Seules les Comptes rendus épouses de qualité inférieure, telles les servantesou les femmes secondaires, adoptaient dès le mariage le lieu de résidence de leur époux). La jeune mariée effectuait plusieurs visites dans sa belle-famille pendant ces années de séparation, mais ses parents n'en continuaient pas moins de contrôler le produit de son travail. Le mariage avec transfert différé de l'épouse s'est en effet surtout développédans une région vouée à la sériciculture,valorisant donc le travail féminin et offrant souvent des emplois rémunérés aux femmes - même si l'agriculture restait dominante dans certains villages. L'existence de ce modèle matrimonial et le développement de la sériciculture n'en ont pas moins favorisé l'émergence de trois stratégies de résistance au mariage vers la fin du xW siècle. Certaines épousées prolongent leur séjour dans leur famille natale au delà du nombre d'années prévu par la coutume, puis versent une compensation à leur mari afin que celui-ci acquière une seconde épouse. Ces femmes, appelées buluojia («celles qui neprennentjamaisrésidencedans leur belle-famille »),sont particulièrement nombreuses entre 1890 et 1910. Au cours des deux décennies suivantes, les paysannes refusant le mariage adoptent volontiers une position plus extrêmeen choisissantde fairevceu de célibat. Elles habitent dans les grands centres de filature ou restent au village, et résident en communauté dans des habitations distinctes. La troisième stratégie consiste à procéder à un mariage posthume, choix qui garantit aux « épouses » un lieu de repos pour leur âme après leur mort. Janice Stockard apporte donc une contribution précieuse à la connaissance des structures de parenté et des systèmes matrimoniaux chinois. Elle jette un jour nouveau sur leur diversité et leur complexité et encourage le lecteur à se méfier des généralisations hâtives sur ce qui constitue la norme et ce qui relève de pratiques déviantes dans la société chinoise. Une question demeure néanmoins : quelle est l'origine du « mariage avec transfert différd de l'épouse » ? Il faudrait en effet en connaître la gen6se pour savoir si Janice Stockard a raison d'affirmer qu'il ne s'agit pas normalement d'un acte de résistance au mariage. Or, les données dont on dispose aujourd'hui restent trop floues pour qu'on puisse trancher. L'auteur montre de façon convaincanteque pendant la période évoquée par ses interlocutrices, soit à partir de 1860, ce type de mariage constitue dans la région considérée le modèle dominant pour toutes les couches sociales. Comptesrendus Mais qu'en était-il avutt cettsdaæ? Quandla pratiqueest-elleévoquée pour la premièrefois ? Constitue-t-elled'emblée la forme majeurede mariagedansla région,ou est-elled'abordreservéeà certainesfamilles? Marjorie Topley en datait I'apparitionau début du xr siècle.Janice Stockardsuggèreunehistoircbcaucoupplusancienne,puisqu'elleévoque I'hypottrèse selonlaquellecetypedemariageseraitun héritagede minorités ethniquescomme les Puyi, les Zhuangou les Li. I-e problèmeposéestceluiduchangement social,dela dated'appariton Tant et du sensà donnerà leur développement. de certainscomportements, que cesquestionsresterontsansréponsele lecteurne poura qu'apprécier la descriptionproposéepar JaniceStockardpour la périodeétudiée,tout en estimantque I'hypothèsede MarjorieTopley, mêmesi elle devaitun jour se révélerfausse,n'a pasétéréellementréfutéepuisqueI'origine du modèleen questiondemeureinconnue. quela preeminence Il seraiten tout étratde causesurprenant du mariage avectransfertdifféréde l'épousedansunerégionaussiclairementcirconscrite ne découlequed'une influenceculturelle.La comparaison avecdes voisinescommeTaishan,où ce typede mariagen'ajamais sous-préfectures existé,montreà quelpoint les femmesqui ne s'installaientchezleur mari qu'à I'approched'unepremièrenaissance amélioraientainsi leur sorl I€s annéesentre le mariageet la naissancedu premier enfant étaienten effet les plus durespour lajeune épouseallantrésiderd'embléedanssabellefamille. Sa famille natâleessayait de confortersapositionsociale,à peine supérieureà celle d'une seryante,en envoyantparexempleàdatefixedes pendanttrois ou six annéesconsécutives. cadeauxaux beaux-parents La possibilitéofferte auxjeunespaysannes de Shundeet desalentoursderester sousle oit paternelpendantcettepériodedifficile atténuaità un tel point les rigueursde la conditionde jeunemariéequ'il est difficile de ne pas voir dansle développement de cettepratiqueun effort pour améliorerla positionde la femmedansun contextesocio-économique privilégié. de souleverces questionsde L'intérêt du livre est incontestablement façon vivante et bien documentée, tout en fournissantdes informations nouvellesetdétaillées individuelles surlesstructures socialesetlesstratégies dans une région particulièredu Guangdong. Isabelle Thireau L7T - Comptes rendus Marie-Claire Bergère, Lucien Bianco, J ü r g n Domes (éds.), La Chine au xu' siècle, Première Partie: D'une révolution à l'autre (1895-1949).Paris, Fayard, 1989. 441 pages Ce livre répond à trois défis, dont un seul aurait suffi à rendre l'entreprise perilleuse et qui, pourtant, ont été relevés pour l'essentiel avec brio. Le défi de l'ouvrage collectif, tout d'abord : ce volume est I'aeuvre de neuf auteurs, auxquels le second volume, qui doit sortir sous peu, en ajoutera sept autres. Le second défi, qui aggrave le précédent, a consisté à faire collaborer à la même œuvre des historiens français et allemands. On sait, notamment par la mise au point présentée dans cette revue au printemps études républicainesen RFA »,Études 1987par Christian Henriot (cf. <<Les chinoises, 6 (l), pp. 125-144), que l'école allemande diffère sensiblement de la française, celle-là étant beaucoup plus portée que celle-ci sur l'histoire des idées ou l'analyse institutionnelle et beaucoup moins sur l'histoire économique et sociale. Ce double défi est louable, et opportun. Mais, comme le dit Lucien Bianco (pp. 383-384), il n'est ni aisé ni toujours souhaitable d'accorder les points de vue des collaborateurs d'une œuvre collective B. À lire certains passages et à constater certaines contradictions (ainsi entre l'analyse de la guerre civile faite par Lucien Bianco en épilogue et celle rédigée par Marie-Luise Nath dans le chapitre 7), on constate que ce toujours >> en dit plus qu'il n'est long. On a d'ailleurs l'impression que la totalité des auteurs français et deux des auteurs allemands (Werner Meissner et Brunhild Staiger) écrivent pour un public de lecteurs déjà fort avertis, alors que le reste des auteurs allemands écrivent pour un public beaucoup plus large, ce qui nuit à l'unité de l'ensemble. C'était le prix à payer : il l'a ét6. Le troisième défi est, me semble-t-il,beaucoup plus hardi. Il a été relevé avec un plein succès et justifiait à lui seul l'entreprise tout entière. Il ne porte pas sur la forme, mais sur le fond. Il prend l'allure d'une provocation, mais d'une provocation féconde et légitime : une provocation à réfléchir, à rechercher par soi-même, à remettre en question les idées toutes faites que l'on a prises pour des certitudes et répétées à satiété comme autant de donnkes immédiates de noee connaissance de la Chine. Il fallait,en effet, prendre en compte près de deux décennies de remise sur l'ouvrage de Comptes rendus dizaines de ces certitudes admirables que nous apprîmes et enseignâmes, ou répandîmes autour de nous au gré de nos interventions auprès des uns et des autres. On ne peut plus s'en tenir au Chow Tse-tsung (The May Fourlh movernent) pour parler du mouvement qui, en 1919, fonda les temps modernes. Il faut connaître les remises en question de l'effondrement supposé du courant conservateur opérées par divers chercheurs comme, par exemple, Charlotte Furth (The limits of change :essays on conservative alternatives in Republican China). On ne peut ignorer le bouleversement des idéesreçues sur les rapports entre la révolution d'octobre 1917en Russie et la fondation du PCC que l'on découvre à lue Anf Dirlik (The origins of Chinese communism) : la révolution d'octobre a Cté tardivement connue en Chine et prise par beaucoup des meilleurs auteurs chinois du temps pour un mouvement anarchiste. La réinterprétation proposée du fameux texte rédigé par Li Dazhao en novembre 1918, N La victoire du bolchévisme », est particulièrement éclairante et invite à pratiquer davantage l'explication de texte. De même, depuis les travaux de Lynda Schaffer, Gai1 Hershatter ou Emily Honig, on ne peut plus s'en tenir au Chesneaux (Le mouvement ouvrier chinois de 1919 à 1927)pour parler du prolétariat et de ses grèves. On ne peut plus s'en tenir à Benjamin Schwartz pour parler de Mao et des origines de Ia révolution chinoise, et la tragédie de ceue révolution ne fut sans doute pas tout à fait celle que décrivit avec talent Harold Isaacs et mit en scène avec génie André Malraux. Sur tous ces points. la lecture des chapitres rédigés par Yves Chevner («Des réformes à la révolution, 18951913 D) et Lucien Bianco (a Seigneursde la guerre et révolution nationaliste, 1913-1927 >>) est particulièrement satisfaisante. Certes, ce dépoussiérage des connaissances, ce décapage de concepts ritualisés, ce remue-ménage qui est remue-méninges, entraîne, comme il était inévitable, quelques incidents de parcours. Ainsi, ce fléau majeur de la Chine qu'est la famine ne fait l'objet d'aucune étude d'ensemble et se trouve réduit à des allusions (pp. 14'77,254,278). Il en est de même pour l'économie : une bonne mise au point générale eut été fort utile, alors que le sujet est éclaté entre divers chapitres. L'effort pour concilier le nécessaire plan chronologique avec une étude thématique n'est pas toujours sans poser des problèmes. C'est ainsi que la pénétration du marxisme en Chine et ses rapports avec la fondation du Parti communiste chinois sont écartelés entre Comptes rendus deux chapitres, celui de Lucien Bianco sur l'histoire politique (pp. 146147) et celui de Werner Meissner sur l'histoire des idées (pp. 344-354) : 1'Ctude des << petits groupes marxistes >> en souffre quelque peu. Plus généralement, les chapitres de la première partie (a L'héritage ») et de la troisièmepartie (<< Sociétéetculture »)sont plus sereins,plus achevés, destinés à durer davantage que ceux de la deuxième partie (« La Chine en révolutions : 1895-1949 D) : inscrits dans le temps long de la tendance ou du cycle, ils ne subissent pas les soubresauts de l'histoire ou très peu, à la différence de ceux qui s'inscrivent dans le temps court de l'événement. Le choix de la date de départ - 1895, le traité de Shimonoseki, qui met fin Ci la désastreuse guerre sino-japonaise, ouvre la Chine aux entreprises étrangères et met un terme aux illusions de la première modernisation chinoise, celle du yangwu -est parfaitement significatif des intentions des auteurs,d'autant que les deux premiers chapitrespxmettent à~ierre-Étienne Will d'opérer une brillante remontée de l'histoire jusqu'en 1770:on échappe autant que faire se peut à l'analyse classique des causes des révolutions de 1911 et de 1949, et on prend de la distance. Lucien Bianco reconnaît même avec honnêtete ce que tous les spécialistes de l'époque n'osent pas s'avouer : << L'historien en est encore à s'interroger sur les raisons de [la] naissance [du régime communiste en Chine] >> (p. 383). 11 est clair que, comme le suggère Marie-Claire Bergère dans sa préface, l'interprétation du << temps des troubles » que traverse la Chine au xx" siècle comme une crise pré-révolutionnaire précipitée par l'agression impérialiste et par I'efficacitépolitique et militaire des communistes tend actuellementà céder lepas à une réflexion sur le long terme, faisantapparaître cette même période comme une phase transitoire entre l'équilibre rompu de l'ancien ordre impérial et la constitution d'un nouvel équilibre que l'on a cru, trop tôt, déjà réalid par le pouvoir communiste sous le règne de Mao Zedong. Si l'on examine ainsi les tendances qui, très lentement, restructurent la société et la culture dans le cadre d'une transition longue qui est un apprentissage de la modernité >>, on sera moins surpris de trouver une actualité aux articles angoissés de La Jeunesse (Xin qingnian) du temps du 4 mai 1919 où Chen Duxiu insistait sur le risque mortel couru par une Chine incapablede changer son rapport au monde et de faire sa révolution culturelle. Vu à distance, ce temps des troubles dure un siècle et évolue à la vitesse d'un glacier. Comptes rendus On parcourt les chapitres qui cherchentà crever cette surface quasi immobile avec une impression de sécurité que l'on ressent moins quand on est rejoint par le flot des événements. C'est très net avec les deux chapitres écrits par pierre-Étienne Will (pp. 8-86), respectivement intitulés « De l'ère des certitudes à la crise du système » et « L'ère des rébellions et la modernisation avortée ».L'Empire y paraît comme un étonnant équilibre, dans son contexte géopolitique, avec son « gouvernement à l'économie » (l'auteur parle, p. 20, d'« État-minimum »), sa cohésion sociale et culturelle, sa vie intellectuelle intense : on tord enfin le cou à la thèse éculée sur les letués incompétents et ignorants. La crise de la fin du xwr" siècle est due, en partie, au succès de cette construction - qui n'est certainement pas un « empire immobile » -, notamment dans le domaine démographique, qui avait inspiré un discours clairement malthusien à un Hong Liangji (1746-1809). Les guerres de l'opium et le système des traités, présentés dans l'optique chinoise d'alors, prennent un relief fort différent de la classique « Question d'ExtrêmeOrient ». Les réflexions relatives à l'échec de cette première modernisation, dû à l'absence d'une société civile capable de la porter, rencontrent un évident écho un siècle plus tard, alors que la réforme lancée durant l'hiver 1978-1979(le gaige) piétine, prise dans les contradictionsd'une Chine dont les dirigeants veulent une nouvelle fois défendre on ne sait quelle essence chinoise tout en empruntant à l'Occident ses machines et son crédit. Avec les « Quaue principes fondamentaux » de Deng Xiaoping on n'est pas si loin qu'il n'y paraît du fi ( l ' a essence ») de Zhang Zhidong. On retrouve ce problème de l'improbable société civile dans le chapitre consacré par Marie-Claire Bergère à « La modernisation économique et la sociCté urbaine » : on y reconnaît, bien Cvidemment, l'essentiel de ce qu'on avait découvert dans le livre novateur du même auteur, L'âge d'or de la bourgeoisie chinoise, déjà présenté dans cette revue (vol. 5 [ln], printemps-automne 1986). et dans le chapitre 12 du volume XII de la Cambridge History of China, consacré lui aussi à la bourgeoisie. Mais l'élargissement du champ d'observation à la ville tout entière (« Le petit peuple, les intellectuels, la classe ouvrière, les gangsterset les prostituées », pourreprendreles sous-titresintermédiaires), l'étude des liens sociaux tissés entre les divers groupes, aident à mieux situer le monde complexe des Comptes rendus entrepreneurs (qiyejia)et donnent ainsi une nouvelle profondeur à une élude déjà fort nchc. Là aussi on atteint à une dimension d'ouvrage classique donton voit mai comment lesconclusionspourraientêtreremisesen question avant longtemps. Avec le chapitre sur c La société rurale a, on retrouve les idées que Lucien Bianco a plus longuement développées dans le chapitre 6 du volume XII1 de la Cambridge Hislory of China, complétées par une synthèse claire sur la question agraire. Sur ce plan aussi, le long débat entre l'auteur, qui a une connaissance exceptionnelle de la documentation disponible sur cette immense question, et divers chercheurs qui, comme lui, ont brisé les certitudes mais, à sa différence, ont limité l'étendue géographique de leur enquête-ainsi Elisabeth Peny (Rebels and revolutionaries in North China 1845-1945) -, permet d'atteindre à des conclusions quasi définitives sur les rapports contradictoiresentre la paysannerie et l'encadrement communiste. Commel'écrit Bianco (p. 293), << du minerai paysan, [les communistes] ont extrait ou plutôt fabriqué [sur cette nuance je ne rejoins pas l'auteur] la piétaille de la révolution : c'est à peu près tout, et c'est déjà beaucoup ». Le chapitre consacré par Brunhild Staiger à La littérature et l'art » débarrasse d'un ceriain nombre d'erreurs d'interprétation ce secteur naguère encombré d'idéologie et de fausses certitudes, et établit raisonnablement un premier bilan. Werner Meissner, traitant du << Mouvement des idées politiques et l'influence de l'occident », est moins pondéré et attaque avec vigueur les idées rques à propos de la « sinisation du marxisme » par Mao Zedong, qu'il réduit à une « sinisation du stalinisme D @p. 31 1-314) forgée à grands coups de plagiats de l'Encyclopédie soviétique et des articles de l'obscur Mitin, compilés par le << théoricien P Ai Siqi. C'est assez réjouissant, fort convaincant, et... rassurant pour les mânes de M m , qui méritait assurément mieux que cette adaptation calamiteuse. L'ensemble de ce chapitre est d'ailleurs passionnant, notamment sur les idées de Sun Yatsen, bien distinguées de celles du courant occidentaliste libéral, finalement bien peu représenté. On attend le second volume de cette Chine au XYsiècle comme une seconde occasion de se libérer de ce qui subsiste en soi des vieux démons et de se confronter avec la dure épreuve de la vérité. La liste des colla- Comptes rendus borateurs de l'ouvrage, qui clôt le premier volume, permet de penser que tel sera le cas. Alain Roux Patrice de Beer, La Chine, le réveil du dragon. Paris. Centurion, 1989. 384 pages Correspondantdu Monde à Pékin de 1984 à 1987, Patrice de Beer a occupé, au cours des années peut-être les plus intéressantes de la décennie, un poste d'observation privilégié. En effet, la réforme agricole achevée - et réussie pour l'essentiel le PC chinois se consacra à partir de 1984à des réformes (la réforme urbaine, puis la réforme politique) beaucoup plus ardues, car s'attaquant aux stmctures mêmes du régime. Ce livre est donc le bilan à la fois des apports indéniables des années Deng, mais aussi des contradictions d'un processus de réforme qui portait en lui-même, dés son déclenchement, les germes de son échec et de la catastrophe humaine et sociale à laquelle cette politique inconséquente conduisit : le massacre du 4 juin 1989. Un tel échec étaitil évitable ? Une démocratisation est-elle aujourd'hui possible ? Patrice de Beer analyse parfaitement. dans les premiers chapitres, la stratégie pragmatique et indirecte de Deng Xiaoping. « L'encerclement économique des villes par les campagnes » @, 58) et l'ouverture sur l'étranger ont profondément bouleversé l'économie et la société chinoises. Les chapitres consacrés, par exemple, au K retour des capitalistes à visage humain a, aux << étrangers admirés et jalousés », ou au << mal de vivre de la jeunesse », sont à cet égard particuli5rement éloquents. Or, ces changementsmajeurs n'ont pas été accompagnés d'uneévolution parallèle des structures politiques. Comme le rappelle fort à propos l'auteur, et ceci contrairement à ce qu'ont cru et diffusé de nombreux observateurs, entre 1979 et 1989 la Chine n'a pas connu la moindre démocratisation. Certes, l'on assista alors à une certaine libéralisation, très bien décrite, avec force anecdotes, notamment dans des chapitres aux titres évocateurs tels qu'u Opium du peuple, à consommer avec modération sous le contrôle du - Comptes rendus Parti >> ou Qui a peur de Lady Chatterley ? >>. Mais le processus même de réforme a été limité et fragile dans bien des domaines. Par son contrôle des entreprises d'État, des matières premières et du système bancaire, K l'État reste lc seul maître de l'économie >> (p. 85). Les intérêts des partenaires étrangers, en particulier de ceux qui ont investi dans les joint ventures, ne sont souvent protégés que grâce à des interventions in extremis de très hauts dirigeants (p. 133). Tout paraît donc pouvoir être remis en cause à tout instant ; et surtout, aucun système légal digne de ce nom ne vient garantir l'irréversibilité des nouveaux droits octroyés à la société (p. 205 et suiv.). Mais la << démocratie socialiste B que souhaitaient établir Hu Yaobang et ZhaoZiyang,les deux victimes les plus célèbres de ceprocessus cahotique de réforme, pouvait-elle favoriser l'établissement de cet État de droit dont rêvent Mikhail Gorbatchev et ses amis ? Patrice de Beer souligne avec la même justesse les ambiguïtés d'un tel projet @p. 220 et suiv.). Rien n'y permettait de penser que les réformistes du PC fussent favorables à une démocratisation du régime. Certains conseillers de Hu comme de Zhao, aujourd'hui réfugiés en Occident (Su Shaozhi, Liu Binyan, Yan Jiaqi, Chen Yizi) ou emprisonnés (Bao Tong), n'ont-ils pourtant pas milité pour une dCmocratisation pragmatique et détournée du système ? N'ont-ils pas cherché à transposer dans la sphère politique la stratégie que Deng Xiaoping avait appliquée dans l'agriculture, en mettant en particulier en place une fonction publique recrutée sur concours et en séparant plus nettement les attributions du Parti et de l'État ? Un tel parallèle aurait permis à l'auteur de mieux marquer la rupture qu'a été pour ces communistes réformateurs le massacre du 4 juin. Ceue date est pour eux la fin de tout espoir de changement en douceur - d'« évolution pacifique >) - du régime qui les a poussés à entrer en rébellion ouverte contre les conservateurs du PC.Si Son ne peut exclure le retour de ces intellectuels A Pékin après la mort de Deng, il n'en demeure pas moins qu'une partie de l'intelligentsia chinoise paraît avoir franchi le pas que l'intelligentsia tchécoslovaque, par exemple, avait franchi après l'écrasement du Printemps de Prague par les chars de l'Armée rouge en 1968. Comptes rendus Ce rapprochement me conduit à émettre une deuxième réserve. Le << pessimisme culturaliste » qui transparaît tout au long du Réveil du dragon me semble quelque peu excessif. Il est clair que la société chinoise. comme le montre parfaitement Patrice de Beer, est grosse de tendances égalitaristes et xénophobes qui se rattachent à une tradition politique profonde et ancienne, et qui en cas de démocratisation du régime prendront inévitablement, de même que l'antisémitisme en Europe de l'Est ou Pamiat en Russie (toutes proportions gardées), une forme politique organisée. Mais la Chine peutelle encore s'isoler ? L'ouverture sur l'étranger, la porosité des frontières chinoises, l'impact de la démocratisation des pays de l'Est et de l'Union soviétique sont autant d'éléments qui rapprochent à grande vitesse le débat chinois sur le système politique des discussions que l'on connaît en Europe occidentale et orientale. Il va sans dire que la société chinoise continuera d'adhérer à des valeurs (largement) différentes des nôtres. Mais, politiquement, quarante ans de régime communiste n'ont pas laissé qu'un « vernis » (p. 364). Le régime a imposé des structures politiques (le rôle dirigeant du PC)et économiques (le plan, les entreprises d'État) qu'il est difficile, comme le montre l'expérience Gorbatchev, de modifier du jour au lendemain. En outre, ces quatre décennies de communisme ont profondément modifié les mentalités :elles ont transformé une grande partie de la société urbaine en une société de fonctionnaires assistés réunis dans d'étouffantes danwei, renforcé le sentiment d'altérité du zhong (chinois) par rapport au wai (étranger), et bridé l'émergence de catégories de pende comme le «politique » ou le « droit » en tant que cristallisations de l'intérêt général et du consensus social. L'on voit bien les difficultés qu'ont les sociétés hier communistes d'Europe à sortir des habitus de l'homo sovieticus. Autant de questions qui méritaient d'être évoquées plus longuement, et qui me paraissent constituer des obstacles autrement plus importants à la démocratisation et au développement que certaines traditions nationales (Taiwan est le meilleur des contre-exemples). Il n'en demeure pas moins que ce Réveildu dragon est un ouvrage vivant et utile pour tous ceux qui veulent comprendre l'évolution de la politique, de l'économie et de la société chinoises au cours de ce qui restera probablement « l'ère Deng Xiaoping B. Jean-Pierre Cabestan -- Comptes rendus Pierre Gentelle (sous la direction de), L'état de la Chine. Paris, Éditions La Découverte, 1989. 454 pages L'état de la Chine se présente comme une véritable petite encyclopédie de la Chine d'aujourd'hui liée à son passé. Sous la direction de Pierre Gentelle, sinologue et géographe de formation, mais aussi spécialiste des problèmes les plus généraux de la Chine contemporaine,elle regroupe cent trente-deux collaborateurs confirmés dans les disciplines les plus variées et rassemble plus de deux cents articles aux approches nombreuses et aux regards croisés », comme le dit justement le présentateur. Mis à jour à l'automne 1989, l'ouvrage consacre d'abord un quart de ses454 pages au territoire, aux hommes, àla civilisation,à l'histoire. Suivent des séries d'articles qui, tout en se suffisant à eux-mêmes, sont regroupés en grandes divisions : vie quotidienne, arts et culture, pouvoir et société, économie, Chine extérieure et Chinois d'outre-mer, politique étrangére. Cette disposition permet au lecteur de consulter directement, à la manière d'un dictionnaire thématique,les rubriques qui l'intéressent, sans avoir pour autant une impression d'tmiettement s'il désire faire une lecture continue. Dans le même souci,presque chaquearticleest accompagné et encadré d'une brève mais récente bibliographie,en français et en anglais, sur le sujet traité. Une sélection bibliographique plus générale figure en fin de volume, accompagnée de schémas, repères chronologiques, index, informations pratiques (guides, revues spécialisées, institutions, bibliothèques). Un regret, celui de ne pas voir ajoutée dans l'index, à côté des noms chinois transcrits en pinyin, une transcription Wade-Giles à laquelle un grand nombre de lecteurs français sont habitués et qui comporte moins de conventionsdeprononciationque la première. Un tableau de correspondance entre les romanisations EFEO (École Française d'Extrême-Orient), pinyin, Wade-Giles, aurait aussi pu être utile pour l'intelligence des ouvrages et articles anciens ou touchant à la Chine ancienne. Enfin, pour la commodité des lecteurs, il eût t t t bon de regrouper à nouveau en fin de volume, sous forme de tableaux, quelques statistiques essentielles figurant déjà dans le corps de l'ouvrage. Par les remarques qui précèdent, on voit combien ce livre, utile aux spécialistes auxquels il servira d'aide-mémoire, le sera davantage encore Comptes rendus aux lccteurs moins bien préparés qu'il guidera dans la quête d'une information immédiate. Le nombre des sujets, celui des collaborateurs, excluent les commentaires détaillés, et il y aurait quelque injustice à privilégier dans l'analyse telle ou telle contribution. On relèvera que, malgr6 l'émotion causée par les tragiques événements de Tian'anmen en juin 1989, l'objectivité des rédacteurs a été la règle générale, donnant son unité profonde à un livre qui ne comporteni doublons ni chevauchements.Une grandepartie du mérite en revient naturellement à Pierre Gentelle,le maître d'œuvre, et à son comité de rédaction. On remarquera aussi que, tout en restant dans leur domaine propre, les auteurs ne se sont pas interdit d'intégrer dans leurs articles quelques éléments d'une réflexion plus large. C'est d'abord le cas de Pierre Gentelle lui-même, dont l'avant-propos analyse les causes et les effets de la crise du « Printemps de Pékin », qui ouvre peut-être une nouvelle phase dans l'histoire d'une Chine que la répression d'aujourd'hui n'empêchera pas d'être de plus en plus liée au monde extérieur. Avec une écriture très accessible au grand public, la sûreté de I'information était la première exigence de cet ouvrage de référence. Il est à cet égard irréprochable, et cela suffit à justifier la place qu'il doit tenir. non seulement dans les bibliothèques des sinologues, mais dans toutes celles qui touchent à la science politique et à la connaissancedu monde en gCnéral. Son succès sera d'autant plus durable qu'il fera l'objet de fréquentes mises à jour, comme le veut l'esprit de la collection dans laquelle il s'inscrit. Jacques Guillermaz Wu Hung, The Wu Liang Shrine :the ideology of early Chinese pictorial art. Stanford, Stanford University Press, 1989. 412 pages, 151 fig. Comme son titre le laisse présumer, cette étude très riche ne s'adresse pas aux seuls historiens de l'art Han. Elle intéressera tout autant les spécialistes de l'idéologie confucéenne. Situé dans le district de Jiaxiang au Shandong, le Wu Liang ci est une chambre d'offrandes qui fut construite pour un lettré retiré, Wu Liang (78- Comptes rendus 151 ap. J.-C.). et utilisée par ses descendants pour y célébrer des sacrifices familiaux. C'est non seulement la seule chambre d'offrandes, à l'intérieur du cimetière des Wu, à pouvoir être reconstituée totalement, mais aussi la seule structure en pierre de ce type datant du IF siècle de notre ère qui ait survécu dans son intégralité. Qui plus est, les bas-reliefs qui décorent son espace intérieur forment un ensemble iconographique d'une richesse et d'une cohérence exceptionnelles. Le Wu Liang ci (ci-dessous WLC) a suscité, depuis le XI" siècle, des recherches et des essais d'interprétation passionnés, mais aussi, pour le meilleur et pour le pire, une frénésie d'estampages. Ces derniers ont peu il peu efface les décors au point que les études iconographiques acluelles ne peuvent se fonder que sur les meilleurs des estampages anciens. Cette difficulté n'est que la première des embûches qui attendent le chercheur. Trois siècles (répartis sur près d'un millénaire) de travaux non coordonnés, d'études partielles, de r6sultats contradictoires, aboutissent à un foisonnement difficile à maîtriser. Le premier mérite de l'auteur est d'avoir, avant d'avancer sa propre lecture du monument, retracé l'histoire des études sur le WLC et mis de l'ordre dans l'énorme littérature qui y est consacrée. Le livre s'ouvre donc, après une préface de Wilma Fairbank, dont la restitution publiée en 1941 avait constitué un travail de pionnier, et une courte introduction, sur une approche 6pistémologique (première partie, pp. 1-70). L'auteur reprend d'abord l'étude des vestiges matériels, depuis la première mention dans leJigulu de Ouyang Xiu (1061), puis la redécouverte du site, enseveli sous les alluvions du fleuve Jaune, en 1786, jusqu'aux restitutions actuelles. II discute les attributions qui ont été avancées pour les quatre chambres d'offrandes du cimetière à partir des quatre stèles retrouvées, et propose de dissocier chambres et stéles et d'attribuer les chambres à chacun des quatre frères Wu1. Puis il aborde l'histoire de l'interprétation des chambreset des méthodes mises en œuvre, retraçant par la même occasion les grandes lignes de 1. Un article de Fan Bangjin, publié en 1987 dans le volume 4 @p. 377-383) du Shanghaibowuguanjikan.comge et complète les informations sur la famille Wu données par Wu Hung. Comptes rendus l'histoire de l'art pictural Han. À l'issue d'une analyse soigneuse des différentes grilles d'interprétation qui ont été appliquées aux dalles ciselées des Han, Wu Hung rappelle qu'il s'agit là d'un art dans lequel les motifs n'ont pas d'existence indépendante mais sont toujours juxtaposCs entre eux pour décorer une structure funéraue ; la première tâche de l'historien est donc d'explorer la logique de cette décoration. C'est à ce décryptage et à cette analyse que s'attache Wu Hung dans lasecondepartie @p.71-230), sous-titrée «Un universen images ».D'entrée de jeu, il pose comme principe qu'au W C les trois ensembles de décor - le plafond, les pignons et les parois - correspondent aux trois parties intégrantes de l'univers dans la pensée Han : le ciel, le paradis et le monde humain, et les représentent (p. 74). Nous discuterons plus loin certaines assertions, préférant présenter d'abord, sans la fragmenter, sa thèse fort cohérente. Première section à être étudiée, le plafond @p. 73-107). Celui-ci est couvert d'images indépendantes figurant des signes célestes, chaque image étant accompagnéed'une inscription dans un cartouche qui identifie le signe du Ciel évoqué et spécifie les conditions de son apparition. L'auteur analyse la place de ces signes, en particulier les xiangrui, signes d'approbation envoyés par le Ciel au souverain, dans la pensée et la politique des Han. Il montre bien que, tout intermédiaires de la communication entre le Ciel et l'homme qu'ils soient,ces signes fonctionnent en réalité comme véhicule du dialogue entre les hommes ; ce sont à la fois des figures du discours politique (preuves de la légitimité de la maison impériale, de la vertu de tel empereur), et un produit de la toute-puissante propagande du pouvoir, toujours prête à alimenter le goût populaire pour les rnirabilia. La vogue des repr6sentationsde signes célestes atteint son apogée au rP siècle de notre ère. Au WLC, de même que dans la tombe de Helingeer en Mongolie intérieure, quarante à cinquante xiangrui devaient originellement être représentés. Ces images fastes étaient copiées à partir de répertoires (ruitu), vraisemblablement peints sur soie, et très répandus à l'époque des Han post6rieurs. De même, Wu Hung montre que le Shanhaijingétait alors utilisé comme un répertoire de signes néfastes. A en croire l'auteur, le choix des signes gravés au WLC serait lié à l'attitude politique de Wu Liang, lettré retiré appartenant au courantjinwen - Comptes rendus (des « Textes modernes ») : à travers leur représentation - les xiangrui devant dès lors être pris ironiquement -, il aurait porté des jugements critiques sur le gouvernement du temps. C'est, il me semble, aller un peu loin dans une in~rprétationpar ailleurs convaincante. Sous le plafond, symbole du Ciel, les pignons évoquent le royaume de l'immortalité, avec Xiwangmu à l'ouest et Dongwanggong à l'est @p. 108141). Wu Hung rkcapitule l'imagerie de la Reine Mère de l'occident, sa genèse, son évolution à l'époque des Han, son intégration dans l'opposition Yinnang, enfin l'adéquation qui s'opère au Ii" siècle entre sa légende et le mythe du Kunlun. Parallèlement, il éclaire l'idéologie qui sous- end l'image de la divinité à l'époque des Han postérieurs. Xiwangmu n'est plus seulement dispensatrice d'immortalité, elle est aussi celle qui apporte le bonheur sur terre ; elle est objet de culte et figure messianique. Wu Hung fait remarquer que, dans l'art des Han postérieurs, les représentationsde Xiwangmu et de sa contrepartie masculine (Dongwanggong) sont toujours séparées des scènes évoquant le Ciel. Par ailleurs, les deux divinités sont figurées de face, assises à la façon d'un buddha, au centre de la composition et entourées de leur cour. L'auteur en conclut à une influence de l'imagerie bouddhique sur l'iconographie de Xiwangmu au siècle de notre 8re, ainsi qu'à une sorte d'équivalence entre les deux divinités protectrices associées à l'occident (Xiwangmu et le Buddha Sâkyamuni). L'hypothèse, stimulante, s'inscrit dans le cadre de ses recherches et de sa réflexion sur les premières représentations bouddhiques en Chine2. Si les figurations des pignons évoquent l'au-delà, un éternel bonheur et l'immortalité, les scènes des parois @p. 142-217)nous ramènent sur terre et aux règles qui doivent présider à la conduite de tout bon confucéen et, plus largement, dans la lecture de Wu Hung, à l'histoire humaine. La décoration des murs du WLC est divisée en deux grands registres, supérieur et inférieur. Le registre supérieur voit se succéder, de droite à gauche et sur deux niveaux, onze souverains de l'Antiquité, puis sept histoires de femmes illustres, enfin dix-sept histoires d'hommes vertueux. 2. Cf. son remarquable article, « Buddhist elements in early Chiiese art », Artibus Asiae. 47 (3/4), 1986, pp. 263-352. Comptes rendus L'auteur interprète ces trois séries, qui suivent un ordre approximativement chronologique,comme symbolisant le flux continu de l'histoire. Le registre inférieur est centré autour d'un pavillon à l'intérieur duquel un personnage important donne audience. Toutes les scènes enlourant le pavillon seraient liées au thème central du registre, celui de la souveraineté. Enfin, dans la partie inférieure gauche de la paroi orientale, un fonctionnaire se prosterne devant une voiture tirée par un bcuf, identifiée dans un cartouche comme la voiture d'un K sage retiré D. Wu Liang apparaîtrait ainsi observateur et interprète de l'histoire humaine mise en images sur les parois de sa chambre d'offrandes. Wu Hung développe un parallèle intéressant entre le Shiji de Sima Qian et le W C . Dans les deux cas, l'histoire serait incarnée par une sélection de personnages groupés en catégories, le manque d'espace au WLC ayant contraint à un choix plus limité de types et d'épisodes. Si l'influence de lacomposition du Shijisurle WLC estplausible,jen'irais pas jusqu'àplacer, comme le fait l'auteur, les deux œuvres sur un pied d'égalité. En effet, l'une, le WLC, n'est originale que dans son agencement, les différents éléments du programme se retrouvant quasiment à l'identique dans d'autres ensembles ;dans l'autre en revanche, le Shiji, Sima Qian a totalement refaçonné la matière à partir de laquelle il travaillait. Il y aurait dans le WLC à la fois un schéma de la civilisation humaine et une leçon de morale en images, les figures historiques représentées exemplifiantles trois vertus fondamentales que sont la loyauté, la piété filiale et la chasteté. Comme dans le cas des signes célestes, les scènes sont très certainement copiées à partir de recueils, tel le Lienüzhuan de Liu Xiang pour les femmes éminentes. Le pavillon au centre du registre inférieur, point vers lequel semblent converger les différents éléments de la composition, avait jusqu'à présent été interprété par de nombreux spécialistes comme évoquant une scène de banquet et un hommage au défunt. Ici encore, Wu Hung propose une lecture nouvelle et fort bien argumentée. D'après lui ces scènes d'hommage, qu'on ne trouve dans l'art des Han qu'au Shandong et à Nanyang au Henan, figurent une audience à la cour, et le modèle suivi serait un portrait standard de Gaozu, le fondateur de la dynastie. On peut se demander pourquoi ce motif a été populaire dans le sud-ouest du Shandong au P et au 11" siècle de notre Comptes rendus ère. Comme le rappelle Wu Hung. il s'agit de la région natale de Gaozu, donc du berceau de la famille impériale. Le temple ancesual dédié au fondateur de la dynastie à Peixian, le Yuanmiao, construit en 195 av. J.C., reconstruit au début des Han postérieurs, recevait régulièrement des sacrifices impériaux. De plus, autour de Peixian, le culte rendu à Gaozu n'était pas confiné au Yuanmiao mais était également pratiqué dans des temples plus modestes. Selon Wu Hung, l'iconographie de la scène d'hommage figurée au WLC dérivetrès vraisemblablement du portrait du fondateur des Han exposé dans le Yuanmiao de Peixian. la scène symbolisant le thème de la souveraineté. La thèse est séduisante, mais laisse inexpliqués certains éléments pourtant classiques des compositions de ce type au Shandong, par exemple l'arbre furang. Fait plus troublant, pourquoi ne retrouve-t-on pas la même iconographie dans les tombes décorées de dalles ciselées de la région de Xuzhou, pourtant plus proche de Peixian ? L'autre thèse de l'auteur est que Wu Liang aurait lui-même conçu la chambre dédiée à sa m6moire, et l'aurait conçue pour être une Histoire en images,s'ouvrant sur l'aubedel'humanitéet serefermant sur la << signature » symbolique du lettré lui-même. Cette thèse suppose, d'une part, l'unicité de la composition, et d'autre part un dessein histonographique et philosophique personnel et cohérent. Or, il se trouve que les mêmes scènes apparaissent sur les dalles ciselées d'autres chambres d'offrandes de la famille Wu. Par ailleurs, plusieurs tombes contemporaines de ces chambres d'offrandes et découvertes récemment au Shandong3sont décorées de dalles ciselées adoptant le même type d'iconographie qu'au WLC, et souvent le même style. Ces découvertes, mais aussi les dalles de réemploi trouvées dans des tombes plus tardives de la région de Jiaxiang4, incitent à la prudence en ce qui concerne l'originalité de conception du WLC. En bref, la comparaison de tous ces décors en gros contemporains inviteà uneappréciation plus nuancée, plusconforme peut-être à la façon dont fonctionnait l'art funéraire des Han postérieurs, 3. Je ne citerai que la tombe de Dawenkou (cf. Wenwu, 1989 (1). pp. 48-58), et les deux tombes deBalimiaodans ledistrict de Yanggu (cf. Wenwu. 1989 (8), pp. 4856). 4. Cf. Wenwu, 1979 (9). pp. 1-6 ; 1982 (S), pp. 60-70. Comptes rendus une appréciation à laquelle semble d'ailleurs se rallier Wu Hung dans son épilogue (p. 230). En fait, il a très vraisemblablement existé, dans le district de Jiaxiang pendant la seconde moitié du rf siècle, un atelier unique qui travaillait à partir d'illustrations servant de modèles. Les relations de cet atelier avec d'autres officines dans et hors de la province restent à étudier, mais la plupart semblent avoir utilisé des recueils d'images (quand elles n'employaient pas carrément des poncifs, comme le faisaient celles de la région de Suide au Shaanxi). Le commanditaire sélectionnait les motifs qui orneraient sa tombe ou sa chambre d'offrandes (ou celles d'un parent), selon ses goûts et selon les idées qu'il souhaitait privilégier. En outre, certains thèmes et symboles extrêmement populaires à l'époque s'exprimaient à travers différentsmotifs, ce qui démultipliait les combinaisons d'images. Dans cette optique,la part de Wu Liang (ou de ses fils) dans le programme iconographique mis en œuvre au WLC et dans l'idéologie qui le sous-tend pourrait être beaucoup plus modeste que ce que Wu Hung, entraîné par la cohérence de sa relecture, laisse supposer. De même, on peut se demander si l'art confucianistetel qu'il s'exprime dans le WLC et, plus largement, au Shandong, a une portée universelle en Chine au ~ r "siècle. Les recherches actuelles, qui montrent une beaucoup plus grande diversité régionale qu'on n'aurait pu le penser, permettent d'en douter. Il est également peu probable que les croyances dans l'au-delà et les pratiques funéraires qui les accompagnent aient été unifiées en Chine à cette époques. Avancer que le WLC e l plus généralement, les chambres d'offrandes Han ont été conçus comme une image réduite de l'univers, comme l'habitat de l'âme hun du défunt (p. 218 et 221)' me semble donc être une généralisation un peu hâtive. Ces réserves faites, l'interprétation que propose Wu Hung de l'idéologie et de l'univers mental exprimés au WLC est certainement la plus achevée et la mieux argumentée présentée à ce jour. Elle offre nombre de clés pour une meilleure compréhension du WLC, étant entendu qu'il n'y a pas une 5. Pour une conception assez différente&celle présenthe par Wu Hung. voir Yingshih YU, "O Soul. Corne Back !"A study inthechanging conceptionsof the sou1 and afterlife in pre-Buddhist Chia m. Harvard JournalofAsiaficStudies,47 (2). 1987.pp. 363-395. Conzptes rendus seule, mais de multiples manières, et très différentes,de comprendrel'ocuvre d'art6. La troisième partie de l'ouvrage (annexe A, pp. 233-327) constitue l'étude épigraphique et iconographique sur laquelle est fondée l'interprétation. Elle peut également être consultée indépendamment, comme un répertoire d'histoires et de thèmes illustrés à l'époque des Han, avec une analyse de leurs sources littéraires. Là encore, Wu Hung corrige et parfait les travaux de ses prédécesseurs, concernant surtout la traduction des inscriptions et des sources. Enfin, viennent compléter cette somme : une chronologie des études sur le WLC (annexe B, pp. 329-334), un inventaire des pierres ciselées du site (annexe C, pp. 335-338), une table chronologique des règnes des empereurs Han (annexe D, pp. 339-341), des notes @p.345370), une trèsriche bibliographie @p. 371-392), un glossaire des caractères (pp. 393-400) et un index @p. 401-412). Le soin apporté à ces outils, les analyses pertinentes sur nombre de problèmes débordant le cadre du WLC -ainsi la structure des cimetikres ou l'iconographie de Xiwangmu - font de cette étude le point de départ solide et stimulant de multiples recherches à venir. Souhaitonsque l'auteur, après avoir abordé le Sichuan7et à présent le Wu Liang ci, tente une étude comparative de cet art funéraire qui, tout en oscillant entre les stéréotypes et les choix personnels ou locaux, éclaire le vécu, le rêvé et les idées reçues de ceux qui possédaient quelques biens à l'ombre de l'establishment en cette seconde moitié du 11" siècle de notre ère. Michèle Pirazzoli-tySerstevens Fan Bangjin fusang ruitu $1 3% WU Liang ci xiangrui * 4-# $4 4~ 6. La formulationest empruntée à Raymond Klibansky dans son avant-proposà R. Klibansky. E. Panofsky et F. Saxl Saturne et la Mélancolie, Paris, Gallimard, 1989. 7. Cf. en particulier a Myths and legends in Han funerary art W . in L. Lim (ed.). Storiesfiom China'spast, San Francisco. Chinese Culture Center, 1987. pp. 7281. Comptes rendus Jean-François Billeter, L'art chinois de l'écriture. Genève, Skira, 1989. 319 pages, ill. Sur l'art chinois de l'écriture, J.-F. Billeter nous offre, avec le concours des éditions Skira pour de magnifiques illustrations, à la fois un traité et un essai. Le traité - clair, précis, appuyé sur une solide érudition qui cependant n'alourdit jamais l'aisance d'un discours limpide se jouant des difficultés que lui oppose une terminologie chinoise terriblement technique -, présente tout ce qu'il faut savoir sur l'appareil, les principes, l'histoire de la calligraphie en Chine. On y apprendra ce qu'est un pinceau chinois, ce que sont l'encre de Chine et l'encrier du calligraphe, le papier de Xuanzhou ;on y verra comment la calligraphiese commande du poignet, de l'épaule, du corps tout entier ;de quelle façon, de l'attaque sur le papier au relevé de la pointe des poils, se tire le trait de pinceau, et en combien de variétés il se différencie, quels peuvent en être les défauts. On s'y familiarisera avec les plus grands noms de tous :Zhang Xu (env. 658-748), le maître de la cursive folle ;Huai Su (737- ?), l'extravagance faite moine... Sur tous ces aspects de la calligraphie chinoise, que faire d'autre que de renvoyer à cet ouvrage où ils sont excellemment exposés ? Venons-en donc tout de suite à l'essai d'interprétation qui, constamment associé aux descriptions techniques, se développe tout au long du livre en donnant à celuici sa profonde originalité. La ligne de force qui sous-tend l'essai à travers les commentaires personnels de l'auteur, nourris à toutes les sources possibles, littéraires et documentaires, est que les Chinois, dans l'art de l'écriture, ont trouvé la plus remarquable expression visuelle qui se puisse imaginer du dynamisme des êtres : « La calligraphie », écrit J.-F.Billeter, « est fondée toute entière sur l'appréhension dynamique du réel par le corps actif. Elle rend visible ce que nous ressentons en agissant et en voyant agir ». À quoi cela tientil ? À ce que dans la calligraphie,les graphismes, puisqu'ils sont entièrement dépourvus de tout caractère figuratif, ne peuvent représenter que le mouvement même qui leur a donné naissance. Et en effet, tout repose dans cet art sur la dynamique du mouvement du pinceau, depuis l'accent du trait jusqu'au parcours rythmé de l'espace de la feuille de papier dans lequel s'inscrit la composition, en passant par la tension qui équilibre organique- Comptes rendus ment toutes les parties composantes de chaque caractErc. Mais le mouvement physique transcrit à travers la page de calligraphie ne saurait être lui-même que l'expression d'un mouvement spirituel qui fait naître I'ceuvre, et dans lequel se marque le génie de l'artiste. Le grand calligraphe est celui qui est à la fois capable d'une intense émotion qui l'élève dans une communion avec le réel au point où s'efface l'opposition entre la subjectivité et l'objectivité, et d'une sublimation de cette émotion dans lc calme des mouvements parfaitement maîtrisés du pinceau : « L'affectivité du calligraphe est toujours engagée dans l'acte d'écrire, mais (...) son affectivité est transformée par cet acte. S'il écrit sous le coup d'une forte émotion, le désordre de l'émotion est transformé par l'écriture en une activité orientée et organisée ». D'où vient l'extraordinaire puissance de la pratique de la calligraphie comme ascèse conduisant à la sérénité. À cela répond dans l'autre sens le ravissement de celui qui contemple une page d'artiste : « Si j'ai la sensibilité en éveil, l'œuvre induit en moi un dépassementcomparable à celui qui s'est produit chez le calligraphe. S'ordonnant et s'intensifiant, sous l'effet de l'œuvre, mon activité se mue en pure jouissance. Mes émotions s'unifient dans uneexpérience qui les dépasseet qui dure, soutenue par les formes ». Aussi bien chez l'artiste créateur que chez le spectateur ravi, le ressort esthétique de la calligraphie,pour J.-F. Billeter, est le sens du corpspropre, autrement dit la conscience profonde du rapport d'interdépendance active entre le sujet et le monde, qui se noue au niveau où c'est mon corps qui me fait exister au monde et qui fait exister le monde pour moi. Le sens du corps propre ne s'exprime nulle part aussi parfaitement que dans les formes calligraphiques, où s'inscrivent indissociablement l'affectivité du sujet qui se projette dans le réel extérieur, et la réalité externe fusionnée par empathie avec cette affectivité. C'est pourquoi J.-F. Billeter, pour analyser la calligraphie, fait largement appel à une série de notions qu'il extrait lui-même de l'expérience introspective du corps propre. Il parle d'« imagination corporelle », de « mobilité intérieure », de « création de l'espace extérieur par la spatialité du corps propre », d'« écoute intérieure de l'activité corporelle », de « regard conscient du rapport que se crée avec le réel le sujet qui s'y projette B... Et il est vrai que la nouveauté de ce langage, mariée à l'allégresse de la délectation esthétique. porte avec Comptes rendus bonheur le lecteur à la découverted'un art entièrement étranger à la tradition occidentale. Pourquoi cette tradition est-elle restée fermée à la calligraphie ? C'est que, nous dit l'auteur, les peinires occidentaux se sont placés eux-mêmes à l'opposé de l'esthétique chinoise, en s'attachant à la représentation de l'objet extérieur et en perdant le sens du corps propre, du moins depuis la Renaissance et jusqu'à l'impressionnisme. À l'appui de cette interprétation est présentéetoute une gammed'iliustrations-superbes d'ailleurs tendant à faire ressortir la distance qui sépare de l'élan intérieur des graphismes du calligraphechinois le statismedu tableau occidental lorsqu'il obéit aux canons de la tradition classique. Par contre, J.-F. Billeter retrouve quelque chose du dynamisme émanant du sens du corps propre dans les dessins d'enfant ou dans l'alacrité des formes impressionnistes, libérées du parti pris de réalisme. Peut-on le suivre sur cette voie, de comparaisons assurément fascinantes au premier abord, mais qui pourraient bien ne mettre en parallèle que superficiellement des formes d'art en réalité profondément différentes ? Même si le calligrapheutilise le pinceau, la calligraphien'est pas la peinture. Elle crée des formes, non pas à partir de la réalité sensible, mais à partir de signes purement conventionnelsqui sont ceux du langage. Le calligraphe n'a pas à s'émanciper de la vision factice de l'objet que surimpose à la sensibilité le parti pris réaliste, puisque ce n'est pas de l'univers sensible qu'il part, mais de l'univers du discours. C'est sur le texte qu'il travaille, comme le peintre sur le motif. Et si la calligraphie est d'emblée beaucoup plus dynamique que le tableau. ce n'est pas parce que l'esthétique chinoise en général favoriserait la sincérité du mouvement intérieur - Dieu sait combien l'académisme a pu subvertir l'art chinois ! -, mais parce que l'art singulierde l'écriture participe du mouvement qui est propre au déroulement discursif de la textualité. Meme si le texte n'est qu'un prétexte pour le calligraphe, la composition calligraphique ne se contemple que sur un substratde lecture. Eile suit nécessairement le rythme des mots dans le texte en se déroulant de haut en bas et de droite à gauche. Elle scande les mots graphiques tels qu'ils sont eux-mêmes rythmés par l'ordre des traits et la composition balancée de leur structure lexicale. Un tableau, en revanche, Comptes rendus ne se lit pas comme un texte. On ne peut y trouver de rythme que inétaphoriquement. Telle qu'elle existe en Chine, la calligraphie est fille de la littérature bien plus que de la peinture : il ne saurait d'ailleurs y avoir de calligraphe illettré. C'est pourquoi on ne peut comparer qu'en surface un tableau et une calligraphie. L'art chinois de l'écriture est bien moins un art plastique qu'un art lyrique. Sans doute se distingue-t-ilde l'art littéraire en ceci qu'il laisse plus ou moins tomber le sens des mots pour jouer surtout sur leur image. Mais n'est-ce pas là exactement le propre du chant : traiter les mots sur leur image ? Image sonore pour le chanteur, bien sûr, alors que le calligraphejoue sur l'image visuelleque donne des mots l'idéographie chinoise. À juste raison, J.-F. Billeter évoque volontiers la musiqueàpropos de la calligraphie.Mais c'est encore plus précisément de chant qu'il faudrait parler : sous le pinceau du calligraphe, les ciwactères chinois deviennent en quelque sorte des vocalises graphiques, qui se composent en mélodie harmonisée. Pourquoi n'y a-t-il d'art de l'écriture que chinois ? Parce que seule l'écriture chinoise a la puissance d'une véritable langue graphique. Les signes de l'écriture alphalAtique ne sont pas des signifiants linguistiques, mais seulement des signes de ces signifiants tels qu'il n'existent que dans la forme vocale que leur donne la parole. Aussi, lorsque l'émotion nous saisit à la lecture du texte alphabétique d'une poésie, nous ne sommes pas portés à le calligraphier, mais à le déclamer ou à le chanter. Dans l'idéographie chinoise, les graphies d'un texte sont pleinement signifiantes. Du coup, c'est 3 les déclamer ou à les chanter pour ainsi due graphiquement queporte l'émotion. Et si la peinture chinoise est si loin du tableau occidental, c'est qu'à son tour. fortement influencéeparlacalligraphie,elle est beaucoup plus lyrique et littéraire que plastique. Qu'il soit peintre ou caliigraphe, le lettré chinois joue en effet du même pinceau, avec la même encre et sur le même papier, moins comme le paysagiste occidental de sa brosse et de ses couleurs sur la toile que comme le musicien de son archet sur les cordes, suivant les notes inscrites en mots graphiques dans le texte du poète. Léon Vandermeersch Comptes rendus Siiuen-fu Lin et Stephen Owen (éds.), The vitality of the lyric voice :shih poetry from the late Han to the Tang. Princeton, Princeton University Press, 1986. xiv + 405 pages Ce recueil de douze articles est le produit d'un symposium tenu dans l'État du Maine en 1982. Il est divisé en trois parties : arrière-plan théorique, concepts et contextes, formes et genres. Le premier essai, de Tu Wei-ming, est une promenade brumeuse dans la métaphysique des grands penseurs des Wei et des Jin, Wang Bi, Guo Xiang, etc., qui ont eu selon l'auteur une influence prédominante sur les poètes de l'époque. L'article est rempli de néologismes et de mots dans le vent : « epistemic », « ontic », « generativity », « experiential », « centeredness », « pragmatics », et de phrases dont la profondeur dépend du polysyllabisme de leurs mots : The synchronic structure of the discourse shared by thinkers of the same epistemic era » ; « At this fundamental discoursive level, the so-called "personality appraisal" [pinti renwu]... can also be construed as part of the same isomorphic system ».La conclusion (p. 31):«The paradigmaticWei-Chin poet prefers an ontological unearuiing to a cosmological constructing...The perennial human dilernma of affective surplus and cognitive deficit is particularly pronounced in the Wei-Chin poet. >> Le deuxième article est un résumé par l'auteur lui-même, François Cheng, des cent premières pages de son livre L'écriture poétique chinoise (Paris, Seuil, 1977). James J.Y. Liu (1926-1986). dans un article enjoué. décrit le « paradoxe du langage » :la réalité ultime, l'émotion la plus profonde, la beauté sublime dépassent les mots. Il décrit ce paradoxe tel qu'il est présenté par les penseurs de l'Antiquité, Laozi et Zhuangzi surtout, puis chez Yang Xiong, Ouyang Jian, Lu Ji, Tao Qian, Liu Xie, Wang Wei, Li Bai, Jiao Ran et Sikong Tu. Contrairement à Tu Wei-rning, qui ne cite que des traductions anglaises déjà existantes, celles de Liu sont toutes originales. Stephen Owen nous ferait croire que « Poetic autobiography arises from the fear of k i n g misprized » (p. 73). Il ne nous dit pas où il a appris cette vérité, et il me semble, au contraire,qu'il existe toutes sortes d'autres raisons pour écrire son autobiographie,en vers ou en prose. Cette assertion gratuite Comptes rendus est suivie par de nombreuses déclarations du même genre concernant Tao Qian et Du Fu. Les personnalités de ces deux grands poètes ne recèlent aucun secret pour Owen. On ne peut qu'admirer, ou se demander sur quoi il se fonde pour dire tout ce qu'il dit. Sur quelle base croit-il, par exemple, que les contradictions qui remplissent la poésie de Tao Qian « come from a sophisticated, seif-conscious man who yearns to be unsophisticated, and unself-conscious » (p. 83) ? Il semble que cette théorie provienne de l'interprétation des deux premiers caractères, ye wai, du poème 2 de la série « Retour aux champs » ;ce sont deux mots bien attestés (Zhouli, Liji, Shiji, etc.), qui signifient K à h campagne», « en dehorsdes villes et des banlieues >> (et aujourd'hui « dehors », « en plein air »). Pour Owen il faut comprendre « "deep in the wildemess", often suggesting an immortal world ».Et dans une note il ajoute que ces caractères sont souvent utilisés pour dire « beyond this world ».Où a-t-il trouvé tout ceh ? Que Tao Qian soit « sophisticated », c'est-à-dire « raffiné, un homme du monde », on en peut discuter ; mais pour nous faire croire qu'il meurt d'envie d'être naïf (« yearns to be unsophisticated ») il faudrait des preuves appuyées sur une philologie plus solide que ce qui nous est fourni ici. Kang-i Sun Chang ouvre la deuxiEme partie du livre avec un article intitulé « Description of landscape in early Six Dynasties poetry ».Comme à l'accoutumée chez cet auteur, il y a beaucoup à apprendre, mais aussi un certain nombre d'erreurs. Elle insiste, avec raison je crois, et aussi avec une grande onginalit6, sur l'importance de Zhang Xie (mort vers 307) dans le développement de la poésie paysagiste. Mais elle explique mal une allusion, p. 113, note 19, et elle a tort de dire que « Al1 Chang Hsieh's tsa-shih poems, with the single exception of Poem no 1, are characterized by detailed descriptions of mountain scenes, and concluded with statements of spiritual realization » (p. 118). Des dix poèmes zashi dans son œuvre, les na 5, 7, 8 et 10, c'est-à-dire, avec le no 1. la moitiC. sont totalement dépourvus de descriptions de montagnes. La deuxième partie de l'article est consacrée à Xie Lingyun. Lin Wen-yüeh, dont les travaux sur la poésie de cette période sont bien connuset justement admirés,a choisi de décrire I'évolution du style poétique de la fin du n' siècle jusqu'aux Tang, Elle articule sa description autour du terme fenggu, utilisé pour décrire une poésie pleine d'émotion et de Comptes rendus vigueur, mais qu'elle refuse, sans doute avec raison, de définir précidment (p. 134). Sa description de la décadence du fenggu, de la naissance de la poésie métaphysique (xuanyan) et paysagiste (shanshui), suivie par une poésie de cour qui se cantonne dans la description d'objets (yongwu) ou dans celle de la beauté féminine (gongti), avant la renaissance, chez Chen Zi'ang et Li Bai, du fenggu, est assez traditionnelle, mais démontre une fine appréciation de la littérature en question. Paul W. Kroll traduit des poèmes sur leMont Tai dus àLu Ji, XieLingyun, Xie Daoyun, Du Fu, Cao Zhi et Li Bai (un groupe de six poèmes pour ce dernier). Il ouvre son article par une citation d'Édouard Chavannes :« Les montagnes sont, en Chine, des divinités » (p. 167). et enrichit ses traductions de précieux renseignements sur la place des montagnes dans la religion chinoise. Il est surtout intéressant quand il cite des textes du taoïsme religieux, pour la plupart ignorés jusqu'ici dans les études de l'œuvre de Li Bai. Cet article a déjà été publié dans T oung Pao, 69 (1983). pp. 223260. Ching-hsien Wang donne, dans le dernier article de cette partie du livre, une discussion de la « nature du narratif dans la poésie des Tang B. Il semble avoir de la peine à définir le narratif - ce qu'il appelle. en inventant un mot, « narrativity » (p. 229) -, à le distinguer de la poésie lyrique, ou à suivre son évolution (« Tang narrative poeuy possesses almost al1 the distinct stylistic and thematic features found in the poetq of the Shih ching and the Ch'u tz'u », p. 251). La troisième et dernière partie du livre commence par un article dû au dédicataire du volume, Hans H. Frankel, sur les premières baiiades yuefu écrites par des auteurs dont on connaît les noms. L'auteur traduit et commente quatorze ballades, commençant par la chanson que Li Yannian écrivit pour l'empereur Wu des Han et terminant par deux ballades de Cao Zhi. Ce qui l'intéresse n'est pas, comme on aurait pu le croire, de montrer l'évolution de cette forme des origines aux premiers poètes qui l'ont exploitée systématiquement(Cao Cao, Cao Pi et Cao Zhi), mais de décrire les vingt-cinq thèmes qui inspirent ce type de poème :u climbing up high and looking down B. « nature and its relation to human affairs », « exotic places and thei. inhabitants », etc. Les traductions sont exactes et les commentaires éclairants. Comptes rendus Zhou Zhenfu poursuit l'étude de la ballade dans un court article (huit pages) qui oppose lcs ballades des trois périodes des Tang à celles des Han aux Sui. L'article est beaucoup trop bref pour que l'auteur puisse développer ses idées de façon convaincante. Shuen-fu Lin nous décrit l'évolution du quatrain Gueju) de ses origines sous les Han postérieurs jusqu'à Du Fu. L'article abonde en traductions de quatrains assorties de commentaires très détaillés essayant de faire ressortir les émotions des auteurs (souvent anonymes). La plupart de ces traductions sont des premières dans une langue occidentale, et les commentaires comportent souvent de précieux renseignements (cf. les explications de calembours dans les quatrainsdes Six Dynasties). Je me demande pourtant si I'évolution de cette forme prosodique peut être décrite à partir du concept baptisé par l'auteur « dynamic continuity », autrement dit le sentiment éprouvé par le lecteur que les vers se suivent sans heurts. Le dernier article, de Yu-kung Kao, s'intitule « L'esthétique des vers codifiés » [lürhi].Le titre décrit mal ce qui est en fait une longue discussion à bâtons rompus sur la poésie chinoise de la fin du 11" siècle jusqu'à Du Fu. Lebut est dedécrire1'« underlyingæsthetics»des vers chinois. Certaines idées sont discutables. Pourquoi Yu-kung Kao dit-il que l'arrivée des pentamètres sur la scène poétique à la fin des Han fait rétrograder le genre narratif (p. 341). alors que les plus beaux poèmes narratifs, « Kongque dongnan fei »,« Richu dongnan yu »,etc., sont en pentamètres et datent de cette époque ? L'article contient aussi de nombreuses phrases assez insondables : « The bipartite structure of couplets encouraged the use of parallelism not only within couplets but as a macrostructure of poetic amplification...» @. 34 1). Sij'ai bien compris, les « "beginning" and "ending" of a lyric poem » (les guillemets sont de l'auteur) sont décrits comme « two forma1 structural devices » (pp. 343-344) ! Les considérations sur l'évolution de la « tonalité » dans la poésie pendant cette longue période sont souvent intéressantes, comme le sont les explications de poèmes des auteurs du début des Tang. J'aurais de la peine à traduire, sans rougir, le titre du livre :« La vitalité de la voix lyrique » sonne creux en français, alors qu'en anglais ce n'est qu'un tantinet prétentieux. L'ouvrage contient, malgré tout, des aperçus Comptes rendus intéressants sur la littérature chinoise du Haut Moyen Âge, et témoigne de l'extraordinaire vitalité des études sur la poésie chinoise aux États-unis. Donald Holzman fenggu @ gongti %& jueju 4 lüshi d$ # pinti renwu Q & shanshui -i7f: xuanyan x -6 ye wai q?' &b yongwu zih) Ca jfi) Anne D. Birdwhistell, Transirion to neo-Confucianism : Shao Yung on knowledge andsymbolsof realify. Stanford.StanfordUniversityPress, 1989. viii + 317 pages A. Birdwhistell nous fournit avec ce livre la première monographie importante en langueoccidentaleconsacréeà ShaoYong, l'un des grands noms du néo-confucianisme des Song. Shao a fait l'objet de nombreux travaux à Taiwan et au Japon, mais a peu été étudié en Chine continentale. sans doute parce qu'il y est classé parmi les penseurs K idéalistes >> et << divuigateurs de superstitions ».C'est, de fait, un auteur réputé difficile, dont la pensée foisonnante et complexe est représentée dans son œuvre philosophique majeure, le Huangii jingshi (Des principes suprêmes qui gouvernent le monde). Les deux premiers chapitres du livre sont consacrés au contexte historique et philosophique et à la personnalité de Shao Yong, dont l'originalité est à l'image de celle de sa pensée. Car c'est d'abord par son comportement et son style de vie que Shao Yong se fait remarquer. Son milieu familial ne l'orientait pas vers des études confucianistes visant à la réussite aux examens. Tout au long de sa vie, il déclina les charges administratives et vécut en << reclus de la ville >> à Luoyang, ce qui ne l'empêcha pas de mener une vie sociale fort active (il fut l'ami de nombreux grands esprits de - Comptes rendus l'époque, des frères Cheng entre autres) et de manifester un intérêt marqué pour les affaires politiques (de tendance conservatrice, il fut de ceux qui s'opposèrent aux réformes de Wang Anshi). Intellectuellement,Shao Yong, comme beaucoup de ses contemporains, cherchait à se référer à un héritage antérieur au bouddhisme, c'esl-à-dire essentiellement à celui des Han. Il s'intéressait plus particulièrement à la tradition numérologique (voire ésotérique) basée sur le Yijing, ce qui, si l'on considère la prédominance de la tendance moralisante dans les études sur le Yi représentée par Cheng Yi et Cheng Hao, ne pouvait manquer de le faire apparaître comme relativement isolé et original. A. Birdwhistell aborde ensuite la pensée de Shao Yong proprement dite en prenant le parti de la traiter comme une « theorie explicative ». Elle montre comment cette pensée est de nature essentiellement théorique, et non empirique ou descriptive, les diagrammes associes au Yi constituant déjà un niveau de théorisation au double plan ontologique et épistémologique. Plus précisément, la théorie de la connaissance a chez lui pour finalité une connaissanced'ordre immédiat, ontologique, voire mystique (connaissance du Sage), telle qu'on la trouve dans le bouddhisme. Dans le chapitre 3, l'auteur procède à une mise en place préalable de ce qu'elle appelle les « outils conceptuels », en l'occurrence les notions fondamentales de la cosmologie chinoise : qi (souffle vital), dao (Voie), xin (cœur/esprit), etc., auxquelles s'ajoutent des « concepts » (comme elle persiste à les dénommer) relevant plus spécifiquement de la tradition sur le Yi : le taiji (Faîte suprême), les deux forces, les quatre images, les huit trigrammes et les soixante-quatre hexagrammes. Dans le chapitre 4, A. Birdwhistell montre comment la tradition des « images et nombres » (xiangshu xue) issue du Yi constitue un niveau de théorisation et d'abstraction (xian tian xue) dérivé de l'expérience (hou tian xue) mais distinct de celle-ci. Au domaine du xian tian ressortent des catégories qui, selon Shao, tombent « naturellement » en deux séries corrélatives de quatre entités chacune : les quatre images du Ciel (soleil, lune, étoiles, espace zodiacal) et les quatre images de la Terre (eau, feu, terre, pierre). Chacune de ces images représente un type de comportement ou d'activité du monde phénoménal, et ces différents types permettent de classifier les expériences et les événements particuliers. Les images sont Comptes rendus donc des catégories qui représentent des relations et non des instances concrètes ; elles fonctionnent par conséquent comme le fi ( a pattern D, ou structure profonde des choses). Ce sont les types de qi qui déterminent les catégories : les choses et leur comportement sont classées dans le système des images selon leur catégorie de qi. Outre les images, les nombres contribuent aussi à doter la réalité d'une structure théorique, car ils sont les signes d'une régularité et d'une structure déterminée de l'univers : l'applicabilité des schèmes numériques aux processus universels de mutation montre que ces derniers sont réguliers et stmcturés. De toute évidence, Shao s'intéresse en tout premier lieu à la réalité comme structure. et c'est en cela qu'il donne une place privilégiée aux nombres et aux images par rapport même au langage discursif, jusqu'à leur attribuer un rôle identique au li en tant que principes structurants. Les deux chapitres suivants développent les six a concepts » qui, selon A. Birdwhistell, articulent la pensée de Shao Yong sur la mutation. Le chapitre 5 porte sur les trois << concepts » cosmologiques (formes et activités du Ciel-Terre, mutations et transformations du Ciel-Terre, mouvements et réponses des Dix mille êtres). et le chapitre 6 sur les trois autres, qui mettent en rapport l'Homme et le cosmos (conscience des hommes et autres êtres vivants, tenants et aboutissants du Ciel et de la Terre, devoirs et accomplissements des Sages et des hommes de valeur). Ce qui ressort de cet ensemble dc << concepts », c'est que Shao, de façon traditionnelle. replace toujours un événement dans un ensemble conçu comme un réseau et offrant une certaine régularité. laquelle permet la mise en correspondance à l'intérieur des catégories et la description en termes de nombres. Mais ce qui est peut-être plus original, et sans doute inspiré du bouddhisme, c'est l'idée qu'il existe différents niveaux de réalité et que, par conséquent, le point de vue, l'angle d'observation, doit être mobile. La notion de ling (conscience ou reconnaissance des Dix mille êtres), qui correspond au premier concept concernant les rapports de l'Homme et du cosmos, intsoduit, outre la dimension cosmologico-ontologique développée par la série des trois premiers concepts, la dimension épistémologique. C'est le point où Shao Yong s'arrête pour se demander : voilà donc ce que nous connaissons. Mais comment le connaissons-nous ? Comptes rendus Il existe un niveau de réalité connaissable à la conscience par les sens. Mais ce qui existe en soi, sans dépendre de la perception humaine, c'est le qi. Les caractéristiques et les activités du qi sont connaissables du fait que la conscience humaine peut en abstraire des modèlcs (« patterns »), lesquels sont symbolisés par les trigrammes et les images, ainsi que par leurs interactions. Il existe donc un niveau de réalité relative >> où les phénomènes appellent la perception pour exister (par exemple, il ne peut y avoir de son sans quelqu'un pour l'entendre), alors que le qi relève d'une réalité << absolue >> qui ne dépend pas de la perception. Incontestablement, la notion de Ling introduit un Clément épistémologique fortement influencé par le bouddhisme. En résumé, les six << concepts >> dkveloppés dans ces deux chapitres sont ceux par lesquels Shao rend compte de la nature de la réalité et de la mutation. Shao conçoit l'univers comme étant foncièrement structuré selon certains modèles fondamentaux : en particulier, les modeles binaire et quaternaire. Les structures se situent à deux niveaux : la structure au niveau des phénomènesmanifestes reKete uneautre structure, plus profonde, au niveau sub-sensoriel, celui du qi,niveau caractérisé par l'unité primordiale de laquelle toutes choses procèdent, dans un sens ontologique, et à laquelle toutes choses retournent, au sens épistémologique, dans l'esprit du Sage. Le chapitre7 montre comment l'épistémologie débouche sur l'ontologie -comment, chez Shao Yong, la recherche de l'unité originelle se traduit par une réflexion sur le Sage et sur son type de connaissance, la seule qui permette le retour à l'Un. Le Sage est celui qui, par sa connaissance, est capable d'induire Sexistencedestructureset de modèles sous-jacents à partir des phénomènes particuliers, par le processus du guan (observer, contempler, à la fois percevoir et comprendre). Ce qui lui permet d'accéder à cette connaissance exceptionnelle, c'est qu'il n'est pas limité à un point de vue spécifique, il perçoit toutes choses du point de vue << panoramique >> du tout, c'est-à-dire du dao ou du taiji. Sa compréhension >> de l'univers revient finalement à une communion d'ordre mystique avec celui-ci. L'objet de la connaissancedu Sage est l'Absolu, quel que soit son nom. L'Absolu est indicible, et la connaissancequi porte sur lui l'est tout autant : Comptes rendus c'est un certain type d'activité épistémologique (différente de celle qui fonctionne par la conscience ling et les sens) qui permet au Sagederetoumer à la totalité ontologique dc la réalité. Ce retour s'opère en inversant le mouvement de développement cosmologique qui procédait de l'Un au multiple. Il s'agit ici de revenir du multiple à l'Un en « remontant >> les processus de la mutation. Après avoir défini l'objet de la connaissance du Sage, A. Birdwhistell s'attache à analyser, dans le chapitre 8, le comment d'une telle connaissance. Il s'agit en effet d'un certain type de conscience ou état d'esprit, différent du ling puisqu'il n'est pas atteint par le moyen de la perception sensorielle ordinaire et qu'il tend à abolir la distinction sujet/objet. C'est un état d'esprit par lequel on perçoit et comprend une chose du point de vue de la chose et non de son propre point de vue Vanguan, a perception réflexive >>, terme emprunté à la terminologie bouddhiste). Dans l'esprit du Sage, limpide comme un miroir (la métaphore est reprise des taoïstes et des bouddhistes), viennent ainsi se refléter sans obstacles les choses dans leur réalité absolue, autrement dit leur li. Dans lefanguan, le soi du Sage est transparentjusqu'à s'abolir totalement et ne plus faire obstacle à la fusion sujetlobjet, laquelle permet de réaliser l'intuition parfaite, de voir les choses en elles-mêmes, et non d'un point de vue particulier et donc relatif, partiel et partial. Shao a montré que, sur le plan épistémologique, il existe une unité du tout dans le qi. L'épistémologique rejoint désormais l'ontologique dans la capacité du Sage de fusionner avec ce tout, forme suprême de connaissance. Cette structurede pensée rappelle le bouddhisme, mais elle évoqueaussi et surtout des références propres à tradition chinoise (Zhuangziet Xunzi, entre autres). A. Birdwhistell termine en nous livrant quelques jugements contemporains et postérieurs sur Shao Yong, qui le font apparaître comme un penseur qui dérange ».Ses contemporains étaient embarrassés par l'abscnce de considérationspratiques dans sa pensée -condition sine qua non de l'obtention du label confucéen - et par une difficulté d'accès qui la faisait parfois confiner à l'ésotérisme. Un siècle plus tard, le grand ordonnateur de l'orthodoxie néo-confucéenne, Zhu Xi, exprime des sentiments mêlés sur Shao Yong : tout en reconnaissant son importance, jusqu'à s'en inspirer lui-même dans ses études sur le Yi, il n'échappe pas à la tendance Comptes rendus générale, qui est de limiter la perspective de Shao Yong à la numérologie et à la cosmologie, laissant quelque peu dans l'ombre sa réflexion sur la connaissance du Sage. À toutes les époques, Shao apparaît comme un penseur controversé sur lequel il n'existe pas de consensus, ce qui est exceptionnel dans la tradition chinoise. Ces dissensions, qui se prolongent au xx' siècle, témoignent de la complexité de sa pensée. Pour y mettre un peu d'ordre, A. Birdwhistell a pris le parti de réassembler des éléments épars de la pensée de Shao Yong et d'expliciter ce qui, dans ses écrits, reste implicite. En d'autres termes, elle s'emploie à fournir ce qu'elle appeile le << contexte théorique » ou le a métalangage » indispensables, à son avis, au lecteur occidentai qui ne connaît pas tout le référent implicite dans lequel Shao Yong s'exprimait et qu'il tenait pour acquis. Au bout du compte, la pensée de Shao Yong, présentée à l'origine à travers des notions, diagrammes, etc., sans logique interne apparente, se retrouve refondue en un système de pensée tel que les aiment les esprits occidentaux. L'auteur affectionne tout particulièrement des termes comme K concept », << outils conceptuels », etc., au moyen desquels elle essaie de reconstituer une démarche philosophique typiquement occidentale qu'elle a dès lors tendance à surimposer à la pensée de Shao Yong. Cette étude sérieuse, très fouillée, bien documentée (voir en particulier l'abondante bibliographie), n'échappe pourtant pas à une présentation assez plate et à un style répétitif et insistant qui n'est pas pour autant toujours très éclairant. On eût peut-être préféré un plus grand effort de synthèse. De plus, répétitivid n'est pas synonyme d'exhaustivité :certainsproblèmes, importants ou à tout le moins intéressants, ne sont pas abordés ou sont simplementeffleurés,laissantlelecteur sur sa faim. Ainsi en va-t-il, par exemple, des références de Shao Yong à la tradition du Chunqiu (chap. 2), du rapport de la conscience et de la notion de résonance (ganying) (chap. 6), ou des origines bouddhiques de certaines idées de Shao Yong. Cela dit, l'auteur a eu le mérite de s'être attaquée à une pensée réputée obscure et difficile à comprendre, et de l'avoir exposée dans des termes qui se veulent les plus clairs possible. Anne Clieng Comptes rendus Claudine Salmon (éd.), Literary migrations. Traditional Chinese fiction in Asia (1 7-20th centuries). Beijing, International Culture Publishing Corporation, 1987. 661 pages, ill. Le comparatisme est d'ordinaire, hors du champ linguistique, un art bien décevant, tant son maniement est délicat : ses écueils usuels viennent, on le sait, soit de l'incompétence d'auteurs qui seplaisentà parler de problèmes qu'ils ne connaissentpas directement, soit de l'inconscience de spécialistes aux horizons variés qui, mis face à face, conduisent des dialogues de sourds. Il faut s'en souvenir pour pouvoir apprécier dans tout son mérite l'entreprise conduite par Claudine Salmon. Les facteurs de la comparaison sont ici homogènes et, thématiquement, bien délimités. 11 s'agit de la liui5ratiue mmanesque chinoisedans sa diffusionà travers 1'Asieorientaleetméridionale, depuis sa pleine floraison au xvrr" siècle. Traductions dans les langues littéraires et vernaculaires, libre recréation, inspiration de sujets et d'ambiance, démarquages et copies : chaque auteur fait, selon ses goûts et ses connaissances propres, le point de la question telle qu'il la voit dans l'aire linguistico-culturelle qu'il maîtrise personnellement. Et, comme I'éditeur du recueil est, par chance, une spécialiste éprouvée de ce type de littérature dans l'Insulinde, elle peut en traiter de première main, 2i la fois dans les chapitres régionaux et dans une copieuse synthèse initiale. La Corée a été le premier pays atteint par l'engouement que la littérature romanesque chinoise suscite sur son parcours. Avant la création d'une écriturenationale en 1446, des imitationsdu Taiping guangiiou du Jiandeng xinhua, notamment, ont été composéesen chinois classique, pour le bénéfice d'une société confucianisée. À partir du milieu du xv" siècle, malgré les anathèmesde la classelettréedirigeante,les romans chinois en langueparlée se répandent dans le sillage des fréquentes ambassades auprès des Ming et des Qing. Sous leur influence se crée une littérature coréenne de fiction, offrant, dans un cadre Tang, Song ou Ming (mais jamais Qing) et sur des thèmes chinois retravaillés, la peinture d'une société coréenne idéalisée, tout empreinte d'harmonie et de moralité, à l'intention d'un public féminin reclus (Kim Dong-uk, de Séoul, pp. 53-84, et Adelaida F. Trotcevich, de Uningrad, pp. 85-105). Comptes rendus Au Japon, la seule littérature étrangèreayant pénétré avant le xw€ siècle était en langue chinoise ;aussi les romans chinois en langue parlée importés à l'époque d'Edo (1603-1867) ont-ils rencontré un accueil favorable, préparé par l'introduction préaiable de romans en langue écrite, le Jiandeng xinhua entre autres. Cependant, la technique dite kundoku de lecture du chinois (par interversion de l'ordre des caractères) était insuffisante pour maîtriser la syntaxe et le vocabulaire propres aux romans rédigés en chinois parlé. Ceux-ci ne pénètrent vraiment la culture japonaise qu'après leur traduction par des auteurs de talent. tels Okajima Kanzan (1674-1728), Okada Hakku (1692-1767), ou Sawada Issai (1701-1782). Le plein essor de ce type littéraire se situe entre le milieu du xwrr"siècle et l'enlrée en lice de la littérature européenne à l'époque de Meiji, après 1867. (Oki Yasushi et Otsuka Hidetaka, de Tôkyô, pp. 106-139). Chez les Mandchous, les traductions d'ouvrages chinois ont commencé avant la prise de Pékin en 1644. Elles étaient à l'origine destinées à difruser un savoir technique, spécialement en matière de stratégie militaire. Puis l'exactitude et l'érudition ont été recherchées dans des éditions bilingues utilisées comme manuels d'enseignement du chinois. Le Sanguo yanyi a été le premier roman traduit, grâce à un lettré renommé, Dahai (1599-1632), qui pensait y trouver la justification des conquêtes menées par son ethnie. Plus tard, les critères de choix ont été à la fois la pédagogie morale ct la distraction des classes populaires. Mais le régime absolutiste mandchou, nourri de pruderie confucéenne. a fini par interdire ce genre littéraire, de sorte que celui-ci n'est guère connu que par des manuscrits épars. On relève au Xinjiang, chez les Sibe (chin. Xibo) de l'Ili, une activité de traduction fort mal connue, indépendante de celle des Mandchous. (Martin Gimm, de Cologne, pp. 143-208). Chez les Mongols, où l'imprimerie était le monopole des monastères lamaïques, même le premier roman traduit (en 1721), le Xiyouji, pourtant considéré comme le récit d'une révélation bouddhique, n'a pu bénéficier des possibilités d'édition à l'époque prémodeme. Les lignées de traductions et de réécritures d'œuvres romanesques (il en est ici identifié 57) se sont maintenues sous la forme de manuscrits divergents, répandus surtout en Mongolie intérieure, à Urga (act. Ulan-Bator), au Xinjiang. Comme les traductions étaient souvent faites A partir du mandchou plutôt que du chinois, Comptes rendus il faudrait pouvoir les étudier simultanément dans les trois langues. La difficulté de leur identification est compliquée par l'existence de genres autochtones inspirés par elles : les bengsen (ou bensen, du chin. benzi, « livre ») - üliger, des chantefables perpétuks oralement par des qurci ou chantres ;et des romans mongols dont l'intrigue est placée dans un cadre sinisé. L'édition de ces diverses œuvres a commencé en 1925,avec leXihan yanyi, suivi en 1928 par le Sanguo yanyi et le Liaozhai zhiyi, grâce à un érudit de Mongolie intérieure, Temgetü (ca. 1887-1939). qui, préoccupé par l'ampleur de la sinisation de ses compatriotes, ouvrit à Pékin une maison d'édition mongole dans le but de leur rendre le goût de leur littérature. (Boris Riftin, de Moscou, pp. 213-262). Au Vietnam, l'indigénisation du genre romanesque chinois a pris trois formes. La diffusion de romans historiques, situés dans un contexte vietnamien mais rédigés en prose chinoise, s'explique par la position exclusive du chinois comme langue écrite officielle et du confucianisme comme idéologie d'État. Populaire aux XWIP-XIX siècles, le genre truyên (chin. zhuan), formé d'histoires ayant un lien plus ou moins lâche avec la civilisation chinoise, est conté en vers et noté en écriture nôm (dérivée des caractères chinois). Enfin, à partir de la romanisation en écriture qu'ôc ngu introduitepar le colonisateur français au XIXsiècle, la vogue des traductions de romans chinois (316 sont recensés) s'explique par l'essor de l'alphabétisation en latinisation, l'expansion d'une population urbaine friande de romans de cape et d'épée, le développement de l'imprimerie moderne et de la presse h feuilletons. (Yan Bao, de Pékin, pp. 265-316). En Thaiîande, l'introduction de la littérature romanesque chinoise s'est aussi faite en trois étapes. Du roi Rama 1" à Rama V (1782-1910). trente romans, surtout historiques-et en premier le Sanguo yanyi -font l'objet de traductions soignées, plus interprétatives que littérales, résultant d'une collaboration entre un patron officiel, un traducteur chinois et un poèteéditeur thaï.De Rama VI à Rama VI11 (1910-1946), l'activité de traduction est une entreprise commerciale aux mains des propriétaires de maisons d'édition et des directeurs de journaux. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les traductions appréciées viennent de l'anglais (succès de Pearl Buck et de romans chinois retraduits de l'anglais) ou sont des romans Comptes rendus d'aventure du genre w u i a . (Prapin Manomaivibool, de Bangkok, pp. 3 17320). Au Cambodge, l'interrogation que suscite le thème du présent recueil invite à remettre en question la vision simplificatrice de l'histoire du pays telle qu'elle a cours en Occident. L'on voit, en effet, les communautés chinoises mettre en marche un processus de modernisation des la première moitié du xrX siècle, soit avant l'arrivée de la colonisation française, contrairement à l'idée répandue. Parallklement à l'implantation d'une agriculture commerciale (le poivre, entre autres) et d'un réseau marchand centré à Phnom Penh, loin de la capitale d'oudong, l'influence culturelle chinoise en milieu cambodgien est réactivée durant le xW siècle. Y contribuent des individus d'origine mixte hokkieno-cambodgienne, et des troupes de théâtre chinoises qui propagent, par exemple,à la cour d'oudong, où elles sont invitées à l'occasion de cérémonies rituelles. l'idéologie impériale chinoise. Dans l'état actuel des connaissances, il n'a pas été possible de localiser vers la mi-XIPsiècle plus de quatre traductions et adaptationsdu chinois, dont l'histoire de la princesse Zhaojun. La recherche des influences litteraireschinoises au xpsiècle, venues par une double voie, vietnamienne et thailandaise, débouche sur une appréciation de la littérature cambodgienneplus nuancée qu'il n'est decoutume ;car elle oblige à prendre en compte, à côté de la tradition royale, cultivée et écrite, une tradition populaire et orale. Le goût du public cambodgien pour les romans chinois s'accentue paradoxalement dans la seconde moitié de notre siècle, lorsque la minorité chinoise, intégrée administrativement à la suite d'accords avec la RPC, ne craint plus d'afficher sa spécificité culturelle. Les supports de l'influence chinoise à la fin des années soixante, et même après les mesures discriminatoires suivant le coup d'État de 1970, sont les films de cape et d'épée de Hong Kong, les romans feuilletons et bandes dessinées traduits les uns et les autres du chinois, une littérature prochinoise en français dont Pékin inonde à cette époque les bouquinistes chinois. (Très riche article, où les notes sont aussi instructivesque le texte, par Jacques Nepote et Khing Hoc-dy, tous deux de Paris, pp. 321-372). Dans la mosaïque de l'Insulinde, la multiplicité des langues et une disparition probable d'anciens manuscrits à l'avènement de l'imprimerie moderne rendent aléatoire la détection de la première traduction d'un roman Comptes rendus chinois. Il semble que ce soit, en javanais, le Xue Rengui zheng xi en 1859. À ce propos, la question se pose de savoir pourquoi les Chinois javanisés, qui ont joué un rôle marqué dans l'art javanais, par exemple, n'ont éprouvé qu'au milieu du xW siècle le besoin de traductions de romans chinois (peutêtre est-ce l'effet de la vague d'émigration chinoise postérieure aux Taiping ?). Le mouvement de transposition de romans chinois a d'ailleurs été des plus limités (seulement dix œuvres javanaises, en quelques versions différentes, sont décelées, dont la dernière date de 1913). Car le malais, langue des citadins, des rapports inter-îles et de la majorité des Chinois inculturés en Indonésie -les PeranaGan (caractérisés par leur absence de connaissance de la langue de leurs ancêtres, alors que les Totok, émigrés plus récents, parlent encore le chinois) - devient spontanément la Iangue de la nouvelle vague d'immigration chinoise à partir de la seconde moitié du XI* siècle. Finalement, la littérature javanaise destinée aux Chinois est étouffée. Un examen du récit des célèbres amours de Liang Shanbo et Zhu Yingtai montre le cheminement des œuvres chinoises en Insulinde et leur popularité. Parvenue en Asie du Sud-Est par l'entremise d'émigrés Hokkien du Fujian, l'histoire paraît pour la première fois dans le monde insulindien selon une version javanaisede 1873,produite directement,cela ne fait guère de doute, à partir d'un original chinois (la version malaise, issue, semblet-il, du mêmeoriginalchinois,est postérieurede plus d'une dizained'années, précédée cependant, peut-on penser, de versions orales). Les versions javanaises postérieures dérivent par contre des versions préexistantes en javanais ou en malais, et ont pour auteurs des Javanais qui javanisent (ou balinisent selon les lieux) certains éléments du récit. Quant aux versions orales, bien antérieures à la premike version écrite, elles ont prospéré jusqu'au milieu des années 1930 sous la forme théâtrale locale dite stambul (en partie des improvisations, avec des intermèdes chantés et dansés) ;puis sous des formes théâtrales plus modernes, appréciées dans les milieux populaires urbains. Les rapports que les versions orales et les versions écrites de l'histoire ici considéréeentretenaiententre elles au XP? siècle disparaissiècle. Mais le développement de la culture de masse, depuis sent au l'indépendance de l'Indonésie, a encouragé la vulgarisation des versions écrites correspondantà des pièces à succès : les productions de la télévision reflètent ainsi, dans le cas présent, une certaine recherche d'exactitude * - Comptes rendus historique. Et si les représentations populaires de l'histoire de Liang et Zhu tournent souvent à la farce daubant vicieusement les Chinois, il ne faut pas y voir seulement l'expression d'un ressentiment contre une minorilé qui tient entre ses mains le commerce urbain, mais plutôt le détournement,aux dépens d'éléments lointains et considérés comme étrangers, d'un humour qui ne peut s'exprimer contre l'élite autochtone et sa sous-culture identifiée à l'expression culturellenationale. (Claudine Salmon,pp. 375-394 ;George Quinn, de Sydney, pp. 530-568). En Indonésie toujours, les œuvres d'origine chinoise en leur forme malaise - des romans et dcits en grande majorité - ont pris pied d'une manière exceptionnellement solide : Claudine Salmon en a recensé, dans un travail antérieur,759 entre 1870 et 1960 :ainsi, 40 traductions de romans sont publiées entre 1883et 1886. Une analyse thématique de six traductions du Xiyouji montre qu'il ne s'agit pas ià de reproductions pures et simples du modèle original, mais de transpositions de types divers, de réécritures comportant notamment des explications qui fournissent matière à des éléments narratifs nouveaux. Cette littérature de traduction, abondante et diversifiée, qui uansmet à son public une idéologie confucianisée conservatrice, a aidé les Peranakan à ne pas se sentir coupés de leur culture d'origine. En outre, certaines œuvres chinoisessont entréesdans la littérature malaise sous la forme autochtone du syair (un poème de longueur indéterminée, où les strophes sont de quatre vers rimés et les vers de quatre mots). Depuis le milieu des années vingt, les romans de cape et d'épée répondent si bien aux goûts du public qu'ils ne laissent guère de place pour la nouvelle littérature chinoise et qu'ils ont réussi à survivre tant à I'occupation japonaise qu'à la campagne antichinoise de la fin des années cinquanteet du débutdes annéessoixante :ainsi, lorsque lesjournaux chinois de tendance taïwanaise, grands pourvoyeurs de kung-fu en feuilletons, sont interdits en 1958, la publication des romans de cape et d'épée se poursuit en livres de poche. (Claudine Salmon, pp. 395-440 ; Eric M. Oey, de Berkeley, pp. 497-529 ; Leo Suryadinata, de Singapour, pp. 623-654). En Malaisie, les Baba, ou citoyens malais d'origine chinoise, ont cultivé leur littbrature propre en langue malaise à partir de 1889. À cette date en effet, neuf traductions en malais romanisé, dont celle du Sanguo yanyi, sont publiées à Singapour. peut-être en liaison avec le vif mouvement de Comptes rendus traductions des Peranakan d'Indonésie. Au total, en un demi-siècle, la liste dcs traductions de romans chinois dont disposent les Chinois de Malaisie s'élève à 94 titres. (Claudine Salmon, pp. 441-496). Dans les Célèbes, les traductions d'aeuvres chinoises ne commencent en makasarais qu'à la fin des années vingt de notre siècle, pour satisfaire un public essentiellement féminin, et elles restent en manuscrits, les jeunes générations ayant oublié leur écriture traditionnelle. (Gilbert Hamonic, de Paris, et Claudine Salmon, pp. 569-592). À Madura, une version autochtone de l'histoire de Liang Shanbo et Zhu Yingtai, traduite d'une version javanaise,rajoute de lacouleur locale. @cdi Oetomo, de Surabaya, pp. 593-622). Enfin, le bilan actuel paraît négatif aux Philippines, malgré la place tenue par les Chinois dans l'édition à la fin du XWsiècle ; la raison en est peutêtre que le succès de l'espagnol comme langue de l'intelligentsia locale à détourné les Chinois d'écrire dans les langues locales ;et il n'est pas exclu que l'on ne découvre un jour des traductions espagnoles de romans chinois dues à des Chinois de souche. De même que dans la presqu'île de Malacca, comme en Birmanie, les quelques traductions de romans chinois dues à des Chinois au xD<c siècle sont en angIais. (Note de Claudine Salmon, pp. 8-9). Et pour finir, le travail de prospection devrait se poursuivre. souligne Claudine Salmon (p. 9), chez les minorités nationales de la RPC - les Bai, les Zhuang, les Yao notamment -, dont on sait, grâce à de récents travaux chinois, qu'ils ont, eux aussi, emprunté au fonds romanesque chinois. En émergeant de cet ouvragedense. touffu parfois même, et passionnant, le lecteur réalise que le thème n'en est pas aussi simpleet facilementdélimité qu'il l'imaginait a priori. Stupéfmnte est l'ampleur du mouvement de diffusion et d'absorption de la littérature romanesque chinoise à travers l'Asie orientale et méridionale, où elle est devenue, en tous lieux, partie intégrantedes héritages culturels locaux :telle est la première leçon àretirer du présent recueil. La seconde étant que son étude n'a pas dépassé le stade du recensement, chaque collaborateur prenant soin de souligner le caractère pionnier et temporaire du bilan qu'il dresse. De fait, le phénomène à cerner paraît en chaque aire linguistico-culturelle une hydre aux avatars multiples, selon le milieu récepteur : milieux chinois inculturés à la société d'accueil, milieux étrangers sensibles de longue &te aux influenceschinoises, milieux Comptes rendus autochtones de pays à peuplement chinois ;selon le mode d'expression de l'ceuvre originale :langueécrite, langue parlée des siècles passés, simplisme des kung-fu à la fois guimauve et sanguinolents, bandes dessinées ;et selon le mode d'expression de la traduction :des formes écrites adoptant diférents niveaux linguistiques et littéraires en prose ou en vers, restées en manuscrits ou éditées, des formes orales et populaires propagées par des conteurs et le théâtre. Il faudrait ajouter, pour être complet, les formes picturales visibles dans les temples de structure chinoise (on se souvient de l'étude pionnière de Wolfram Eberhard. « Topics and moral values in Chinese temple decorations », Journal of the American Oriental Society, 87 (l), 1967, pp. 22-32 ; et de l'allusion que Claudine Salmon fait, de son côté, à la mise en imagesdes romanshistoriques les plus populaires dans les templeschinois d'Asie du Sud-Est, « Une morale en images : les peintures murales du Xietian-gong de Bandung », Archipel. 11,1976. pp. 167-176,et dans le présent recueil, p. 34). A Ulan Bator, par exemple, on peut apprécier de délicieuses petites bandes dessinées qui courent le long des solivettes soutenant à l'extérieur les avant-toits des palais-monastères que le dernier théocrate de la Mongolie extérieure, le 8" Bogdo-gegen (1870-1924), avait fait édifier et décorer pour lui et son frère, Coijin-lama, dans la première décennie de notre siècle. La variation la plus lancinante provient du niveau de réinvention que comporte la traduction en une langue étrangère : tout un éventail de possibilités est ouvert, allant de la traduction littérale, assez rare semblet-il, jusqu'à la création d'œuvres pseudo-chinoises, en passant par un jeu varié d'indigénisation des motifs. Pour Claudine Salmon et ses colhborateurs, la difficulté principale a résidé dans l'identification des pièces. Et un résultat paradoxal de leur défrichageest de suggérer l'existence d'ccuvres originales chinoises insoupçonnéesjusqu'alors. Un autre thème à variations est celui du but recherché par l'agent transmeuant l'œuvre -mécène, traducteur, adaptateur indigène, éditeur ;des effets ludiques et éducatifs qu'en espèrent et qu'en recueillent les publics visés, selon qu'ils sont chinois ou non-chinois -milieux féminins reclus et milieux populaires analphabètes en particulier ; de la réutilisation, consciente ou inconsciente, de l'œuvre dans un but Ctranger à la société chinoise, voire opposé à elle, tel ce retour aux traditions de ses ancêtres qu'un nationaliste de Mongolie intérieure Comptes rendus escomptait, dans les années vingt, tirer de la popularisation de la littérature chinoise en traduction mongole, ainsi qu'il a été dit plus haut. Le travail d'analyse interne qu'on attend maintenant des comparatistes, par lignée d'ceuvres et par genre, et celui des sociologues par aire linguistico-culturelle, apparaît considérable :le présent ouvrage en pose les fondements tout à fait nouveaux ; et, heureusement exempt de théories prématurées, il va rester, sans nul doute, l'outil de référence par excellence. Les quelques inconvénients inhérents à sa confection disparaîtront, souhaitons-le, dans les travaux futurs. Quatorze des seize collaborateurs ne sont pas anglophones :on peut se représenterle casse-tête qu'a été pour l'éditeur, qui n'estpas anglophone non plus, la mise en formeanglaisede contributions venues d'horizons aussi variés que l'Institut des littératures mondiales de Moscou, l'Institut Oriental de Uningrad. l'université de Beijing et celle de Séoul. Rien d'ttonnant donc si un certain flottement se remarque dans le maniement des termes fondamentaux, tels que « novel », « romance », « fiction », « tale ».Le spécialiste n'en sera d'ailleurs guère affecté, n'en doutons pas. C'est pourquoi. au dam de l'utilisateur, il n'a pu être ajouté d'index des œuvres chinoises. Plutôt que de le déplorer disgracieusement, admirons que la qualité matérielle de l'ensemble soit aussi convenable ; et qu'en prime, il nous soit offert deux xu à la manière traditionnelle des congshu chinois, une aubaine vraiment inattendue pour le sociologue : une préface personnalisée de Ji Xianlin, éminent sanscritiste de l'université de Beijing, et un émouvant « Dr Salmon as 1 know her » par Ge Baoquan de l'Académie des littératures étrangères près l'Académie chinoise des Sciences sociales, qui situe l'éditeur dans son cadre parisien et rappelle son expérience scientifique antérieure. Les bonnes vieilles traditions littéraires chinoises ne sont, heureusement, pas mortes en Chine ! Françoise Aubin Patrick Carre, Le Palais des nuages. Paris, Phébus. 1989. 644 pages. Jean Levi, Le rêve de Confucius. Paris, Albin Michel, 1989. 320 pages Ces deux ouvrages ont paru non seulement la même année, mais le même mois et relèvent du même genre, l'histoire romancée. Tous deux ont préféré Comptes rendus au pinyin notre vieille transcription de I'EFEO. Il ne semble donc pas déplacé de les réunir ici, si différents soient-ils par le mode de la narration, le s~ylc, la sensibilité,la matière traitée, sans parler de Yau-delà du récit que chacun de nos auteurs entend viser. Jean Levi, le traducteur des Trois Royaumes, est fort peu redevable à la tradition romanesque chinoise. Patrick Carré ne l'est pas du tout dans ce roman qui use du procédé exploité par Marguerite Yourcenar avec tant de bonheur : ses Mémoires d'Hadrien (1951) sont traduites, me dit-on, en vingt-huit langues, un succès qui a quelque peu éclipsé la réussite de Robert Graves, I , Claudius et sa suite, Claudius, the god (1934), couronnée par deux prix littéraires et rendue en dix-sept langues. Ces mémoires à la première personne sont d'évidentes conventions qui permettent à la fiction d'épouser le point de vue du personnage central. Nul ne saurait s'y tromper et, pas plus que ses prédécesseurs, Patrick Carré n'a cherché à les rendre crédibles. Peut-être est-il plus proche de Yourcenar que de Graves, en ce sens que l'être et le devenir de Huizong (Zhao Ji, 1082-1135, qui régna de 1100 à 1126) l'intéressent plus que les événements de son règne. Le prologue qui le campe dans son exil, prisonnier des << barbares >> djurchets (sic), fait de la pseudo-autobiographie une méditation sur la vie manquée d'un tyran esthète. Aussi la phrase d'Alain mise en exergue, a Le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou »,pourrait-elle conduire à se méprendre sur le theme central de ce gros livre mené avec brio. Pour Patrick Carré, cet empereur calligraphe, poète, peintre et fervent collectionneur, tyran malgr6 lui, rêvant de l'ailleurs de la barbarie, tant qu'il ne l'a rencontrée, semble un frère. Il serait vain de discuter des sources de l'auteur et de la vision qu'il nous en donne. La jaquette exprimeon ne peut mieux le propos du traducteur de Hanshan et de Huangbo : << Fasciné par les mystères de l'esprit plutôt que par les douteuses clartés de l'Histoire, il a passé plusieurs années à dépouiller les annales du règne de Houei Tsong... à seule fin de nous en proposer une lecture qui fût conforme à la logique du rêve. >> Patrick Carré, à la différence de Yourcenar ou Graves, ne se soucie guère d'assurer le lecteur de sa fidélité à l'Histoire. Il n'en suit pas moins la trame de bout en bout, mais, il est vrai, sur un ton qui frise l'onirisme, tant il Comptes rendus se veut à la fois précieux et impérial, subtil et glissant. Le titre souligne la volonté poétique de l'ouvrage : -Nuages... chantonnais-je rêvcusemcnt. Les poètes ne parlent que de nuages. -Quelestjustement, m'intenompitlemaître [Su Shi. 1036-1101, a Sou Versant Est » ou K Tong-p'o »], le poète qui vous a dom6 sa maladie ? -Quelie maladie ?... Ah, mon oncle Kiun me parlait toujours de l'Ailleurs ... Ailleurs, tel est le titre du second des douze chapitres sans chiffre qui se partagent la matière du récit. Est-ce une nouvelle version de Hanshan dont nous régale le traducteur du Mangeur de brumes ? << Allongé seul sous un douteux surplomb / De toute la journée les nues ne m'ont quitté... >> ; ce que Burton Watson rend plus littéralement par : << 1 lie alone by folded cliffs, / Where churning mists even at midday do not part » (Cf. Cold Mountain, 42 ; Iriya, 43). << Soyffrir et jouir », lui souffle son mentor taoïsant Guo Tianxin. Et de rappeler une version inversée du Langqiao shui où c'est l'amante et non plus l'amoureux qui se laisse submerger par les flots. De Nuages et pluie -autres nuages -à Femme pure. l'érotisme se dégrade en << parties fines » où l'empereur, a au cœur de son trente-neuvième printemps », se laisse prendre : « Li Petite Maîtresse incarnait-elle ma fameuse introuvable féminité, cette qualité majeure de l'étonnant Tao, qu'un Barbare d'occident me révélait ? >> Guo Tianxin l'avait alors quitté et Huizong Ctait revenu de son escapade mystique auprès de Mi Fu (1052-1107), narrée au chapitre intitulé Eaux profondes. Avant de sombrer dans les horreurs de la défaite. la fin du roman s'engage dans la longue description de Supplices hexagrammiques, auxquels Octave Mirbeau n'avait pas songé dans son Jardin, qui paraît bien pâle en comparaison. Laissons, sans lui avoir rendu pleinement justice, ce roman foisonnant qui appartient, malgré son nouveau réalisme poétique, à la tradition du rêve occidental de la Chine, pour aborder l'ouvrage de Jean Levi, lui aussi << hexagrammique », mais de tout autre façon. C'est, en quelque sorte, le conlrepoint de son roman précédent, Le grand Empereur et sesautomates, déjà traduiten une douzainede langues. L'auteur expIique sans détours sa démarche insolite dans une utile postface qui éclaire - Comptes rendus sa vision pessimiste d'une sociétéenracinée dans le « mensonge P.La inarge irrationnelle de l'histoire lui a semblé mieux se plier au destin annoncé par près de la moitié des soixante-quatre hexagrainmes ; ils figurent en tête des chapitres, ici aussi non chiffrés, suivis d'un élégant commentaire sous des titres lourdement évocateurs que ne reprend aucune table en fin de volume. Le style, sobre sans être dépouillé, ne se laisse le plus souvent aller au lyrisme que pour donner dans l'ironie d'un pastiche : « C'était le plus ravissant minois qu'il lui eût jamais été donné de contempler : un visage rond et blanc comme une pleine lune, des yeux brillants surmontés de deux sourcils minces incurvés en antennes de papillon, et une petite bouche aux lèvres de cerise », est-il dit de Qi la future concubine de Liu Bang, appelé Taillefer en vertu d'une décomposition graphique du patronyme Liu. Il y a plus de subtilités qu'il n'y paraît aussi bien dans la construction que dans le style du roman. au point que d'aucuns hésiteraient à qualifier de romanesque une matière aussi imbibée de philosophie politique. Prenons pour exemple le chapitre, p. 210, coiffé du vingt-et-unième hexagramme appelé Shihe et traduit RUMINATIONS. Jean Levi rend ainsi le « jugement » : « Il est bon de ruminer. / Cela résoud favorablement les conflits » (chez Wilhelrn-Baynes cela devient : « BmNG THROUGH - Biting Through has success / It is favorable to let justice be administered »).L'hexagramme commande une description quasi surréaliste : Un intense bruit de mâchoires, produit par la rumination des Grands Hommes aux abois, s'élevait de laconfigurationdumoment et dominait deses grincements jusqu'au fracas des armes. C'était sur un morceau coriace de volaille boucanée que s'exerçait l'action masticatoire de Taillefer,ses dents mordaient précautionneusementdans la chair filandreuse. s'arrêtaient bien avant l'os, autour duquel la viande était avariée, et broyaient avec une lente application cette pauvre nourriture dont chaque bouchée. par la résistance qu'elle lui opposait, lui faisait sentir sa détresse... Tout en cherchant I? chasser la vision des crânes de son père et de sa mère le regardant de leurs yeux cuits au fond d'une grande soupière de métal, à demi enfouis sous une garniture de navets, il renifla un autre morceau de viande et l'introduisit avec méfiance dans sa bouche... L'entrée en matière réunit les incarnationsdes huit trigrammes présidant à une puissante société secrète qui ne servira qu'à dérouler cette vision Comptes rendus désespérée et décapante d'événements qui amèneront une tyrannie brouillonne à remplacer une tyrannie transparente : « Le véritable Grand Homme sait faire taire son orgueil et se conduire en lâche pour réaliser ses vastes desseins, w la fin et elle seule subIime les moyens... » (p. 280). Le rêve de Confucius, qui constitue, somme toute, le prologue du récit, est un cauchemar : Cependant, audeià du déchiffrement métaphorique, [Confucius] découvrit d'autres implications, comme ces coffres à secrets emboîtés. Il était aussi le Dragon Noir. L'eau dont il était issu l'y appariait. Et certains de ses admirateurs lui donnaient le nom de Roi-sans-Royaume. Tout comme l'autre. son double et son corilraire. bien qu'incapable d'incarner un moment de l'Histoire. il concourait néanmoins à sa marche parce que la Loi n'était que la force obscure du Rite...Ami, opérateur d'une transmutation, il sublimerait la dure réalité des supplices par l'apaisante justification de la morale et la forme harmonieuse du rite. Mais le feu est aussi par son éclat parure ; toute parure est un voile jeté sur la réalité. elle s'identifie au mensonge... Il s'émerveilla de l'agencement subtil de son rêve... (p. 18). Bref, voici un livre fascinant et repoussant qui ne se démonte pas à la première lecture, ni à la seconde :en rendre compte est une tâche redoutable. La traduction des prénoms, voire des patronymes, ajoute à l'embarras du lecteur déconcerté, un embarras qui mérite d'être suxmonté. À ce prix, il découvrira une œuvre désespérément subtile, fort loin, par son originalité, de tout ce qui a été produit jusqu'à présent sur une matière chinoise. On ne peut que se féliciter que la sinologie se soit égarée dans le romanesque, lorsqu'il s'agit d'ouvrages aussi exceptionnels que ceux de Patrick Carré et de Jean Levi. André Levy A. Giacomi et al., Lexique français-chinois de la physique. Aix-en-Provence, Université de Provence. 1988. 422 pages Saluons la réalisation d'un lexique français-chinois de physique. Les ouvrages récents de lexicographie spécialisée impliquant ces deux langues restent en effet trop peu nombreux, surtout si l'on considère l'abondance Comptes rendus de dictionnaires anglais-chinois publiés depuis moins de dix ans en Chine même. Réalisé en France et composé, semble-t-il, à l'aide d'un équipement informatique, c'est certainement une première. Chaque terme formant une entrée française du lexique (il y en a environ six mille) est accompagné dc sa transcription phonétique, de sa classe grammaticale, puis d'une ou plusieurs traductions en chinois. Une entrée peut être complétée d'exemples, chacun formant un « ensemble de suites lexicales où le terme est susceptible d'être attesté ». La lecture attentive de l'ouvrage conduit à formuler un certain nombres de remarques, tant sur la forme que sur la démarche lexicographique. Si le texte comprend peu de coquilles, on est en revanche gêné par une absence d'homogénéité à divers niveaux. Les noms de personnes apparaissent tantôt avec leur seule transcription phonétique, tantôt accompagnés d'indications sur la nationalité et la spécialité scientifique, occasionnellement des dates de naissance et de décès. Pour les entrées françaises, c'est souvent un terme du vocabulaire général (sans doute provenant du Vocabulaire Général d'orientation Scientifique)qui est retenu, qui ne prend de valeur spécifique que dans les « suites lexicales P. La plupart de ces dernières forment des lexies complexes, des syntagmes lexicalisés ou des mots composés : telles devraient être, me semble-t-il, les véritables entrées principales d'un lexique spécialil. Le souci de didactique du français à l'usage des étudiants étrangers qui anime les auteurs les conduit en outre à introduire dans ces « suites », à côté de la terminologie spécifique, des phrases exemples souvent assez loin du domaine de rérérence (pour « éjecter », par exemple :« La mitrailleuse éjecte les douilles vides au cours du tir »). Les rares cas où l'article est utilisé me paraissent contestables : par exemple, on trouvera, sous « saturation », « la courbe de saturation » à côté de « point de saturation ».Sous l'entrée « potentiel, le », nom et adjectif sont traités simultanément, ce qui peut être contesté au vu des intentions didactiques de i'ouvrage ;et dans cette même entrée, pourquoi « le potentiel électrique » à côté de nombreux autres exemples tels que « potentiel électrostatique », « potentiel chimique » ? Même manque de cohérence en cequi concerne le féminin des adjectifs :aucune indicationpour « abélien », Comptes rendus mais quelques pages plus loin, aérien, enne », et plus loin encore, << képlérien, ne ». Si les abréviations sont fréquentes pour les unités de mesure, elles n'apparaissent pas en entrées mais sont seulement signalées en complément du terme sous sa forme longue. Quant aux synonymes, il font l'objet de très peu de renvois, et jamais dans les deux sens. Ainsi, dynamique des fIuides = hydrodynamique », mais le second ne peut renvoyer au premier puisque celui-ci n'apparaît pas en entrée principale. Les antonymes sont très fréquents dans les << suites lexicales >> ; ils font parfois l'objet de rubriques séparées, mais ne sont souvent marqués que par l'emploi de parenthèses. Un certain nombre de symboles désignant des domaines de référence sont indiqués au début de l'ouvrage, mais peu d'entrées en définitive en bénéficient, sans doute parce qu'en tant que telles ces informations appartiennent au vocabulaire général et, à ce titre, ne devraient pas figurer. En ce qui concerne les termes de physique chinois, la plupart apparaissent comme traductions de suites lexicales », ce qui pose des problèmes complexes. En effet, tantôt nous trouvons de << vrais » termes en traduction de l'entrée française, tantôt il s'agit de définitions en chinois ; et je me demande parfois si l'exemple français n'est pas simplement une traduction du chinois (comme << un satellite qui gravite autour de la lune »). Enfin, certaines traductions sont inexactes, par exemple pour « des cristaux en cours de formation ». Notons encore que la fonction des parenthèses dans les énoncés est multipIe : elles peuvent noter une explication, mais aussi signifier que l'élément qu'elles isolentest facultatif,ou encadrer l'antonyme d'un terme. Le public auquel ce travail est destiné en priorité est celui a des élèves sinophones de l'enseignement secondaire et des étudiants de premier cycle universitaire scientifique désirant employer le français comme koîné scientifique S. Ce choix justifie sans doute l'absence de toute romanisation des termes chinois, alors que les entrées françaises sont pourvues de transcriptions phonétiques. On regrettera à tout le moins qu'il n'y ait pas d'index des termes chinois renvoyant aux pages du dictionnaire. Tel quel, ce livre aurait mérité un sérieux travail d'harmonisation et de finition. Georges Métailié NOTES BRÈVES LaoShe, Unfîlstombéduciel.Traduitduchinoispar Lu Fujun etChristine Mel. Paris. Arléa, 1989. 363 pages On peut évidemment se demander s'il s'agit là du meilleur Lao She. Les remarques que le romancier a faites a posteriori sur son œuvre sont parfois négligeables. Mais, dans le cas de Niu Tianci zhuan, les circonstances décrites dans La vieille carriole (<< Chaleur, embarras, précipitation D) ne sont pas entièrement de fausses excuses. Il faut bien avouer que, dans cette histoire d'enfant trouvé et élevé par un couple âgé au milieu des valeurs contradictoires du commerce et du mandarinat, l'écrivain donne quelquefois l'impression de tirer un peu à la ligne. Paru en feuilletondans la revuelunyu, le roman ne permettait guère << le développement normal des épisodes et des personnages B. On s'en aperçoit notamment dans la dernière partie où le jeune homme, qui a interrompu ses études, perd successivement sa mère et son père adoptifs. C'est donc à la pointe du pinceau, par la force de son humour, que Lao She est le plus convaincant dans cette œuvre. À cet égard. les deux traductrices ont su trouver, pour chaque phrase, le bon rythme et découper comme il convenait les paragraphes trop longs du texte original. En revanche, faute de notes suffisantes, les sous-entendus des expressions ou les jeux de mots ne sont pas toujours exploités. Une erreur (p. 8) situe à Pékin l'intrigue, alors qu'il s'agit. en réalité. d'une petite ville du nom de Yuncheng. Enfin, une suite de ce roman, publiée en 1937 et redécouverte cinquante ans après, doit être signalée au lecteur1. Paul Bady 1. On notera par ailleurs la traduction << remani6e » du Pousse-pousse(par François et Anne Cheng, Paris, Picquier. 1990, 221 pp.), en regrettant, une nouvelle fois. Notes brèves Pa Kin, Automne. Traduit du chinois par Édith Simar-Dauverd. Paris, Flammarion, 1989. 677 pages Déjà traductricedudeuxième volet (Printemps,cf. ktudes chinoises, 2,1983, pp. 64-65) de la grande saga de la famille Gao, Édith Simar-Dauverd fait preuve d'une remarquable constance en venant à bout du troisième. Certes, Ba Jin est un témoin passionné de son temps, mais ses chroniques romanesques, même si elles se concentrent sur le cercle familial, sont d'une ampleur qui peut sembler démesurée. Le romancier restant fidèle à ses personnages, le lecteur retrouve ici ceux qu'il avait aimés antérieurement, comme s'il suffisait de prendre les mêmes et de recommencer. Mais le clan des Gao est sur le point de se désagréger : la maison du vieux patriarche sera vendue, ses biens partagés, et dans ce monde qui se défait on ne compte plus les intrigues. les disputes et les tragédies. De nature autobiographique, comme on le sait, le roman se termine en fait un peu moins mal que dans la réalité : le frère aîné Juexin reste hanté par le passé mais il ne met pas fin à sesjours. Quant au cadet Juemin, il épouse finalement Qin, sa jolie cousine. D'une grande justesse de ton et suffisamment précise, à l'exception de quelques erreurs (le datuanyuan de l'épilogue. p. 669, aurait pu être mieux rendu), la traduction traite particulièrement bien les dialogues, lesquels forment, plus encore que dans les volumes précédents, la part prépondérante du roman. Paul Bady Zhang Jie, Galére. Traduit du chinois par Michel Cartier avec la collaboration de Zhitang Drocourt. Paris, E. Maren Sell, 1989. 169 pages Zhang Jie est un auteur celèbre en Chine (eue l'est aussi à l'étranger : elle a récemment reçu en Italie le prix Moravia), et il est devenu coutumier de voir ses romans susciter des débats enflammés au sein du public chinois. Se situant au cœur de la société, elle affronte délibérément le monde que le texte original (reproduit dans Lao She wenji, Pékin, Renmin wenxue chubanshe, torneiii, 1982)n'aitpas servi de base àla version françaiseduroman. Notes brèves contemporain en abordant des sujets sensibles ou d7actualit6comme la réforme économique,dansAilesdeplomb,ou la vic des femmes dans Galère. Galère campe les retrouvailles dans un même appartement de trois femmes dans leur quarantaine, amies depuis l'école primaire, divorcées ou séparées,et s'attache à décrire leurs difficultés professionnelles et affectives. Trois femmes, trois directions proîessionnelles (menuisière-essayiste, scénariste de cinéma, interprète), avec pour chacune un parcours bouleversé, d'innombrables difficultés, des peines et des joies. Trois femmes, mais une même lutte pour l'indépendance, passant pour chacune par la séparation ou par un divorce qu'il n'est pas facile d'obtenir. La vie sexuelle est perçue dans l'amertume, tant dans les relations avec les maris qu'à travers les assauts dont on est parfois l'objet, en particulier au travail. Bref, trois femmes seules, en butte la curiosité oppressante du voisinage. Empruntant le truchement de ces trois perceptions féminines, le roman procède par cercles concentriques pour analyser les divers obstacles qui s'opposent à la réalisation des idéaux de ses héroïnes : les maris, le uavail, les voisins, et aussi les pères, dont la position dominante détermine maints traits de leur vie. Elles ont beau combattre infatigablement pour leur autonomie, il semble n'y avoir aucune chance d'échapper à des destins scellés. Les enfants. enjeu de luttes entre époux, ne modifient guère le tableau, à la conclusion près du roman, teintée d'ironie sinon de naïveté, qui fait porter à l'un d'eux l'espoir que les garçons de sa généralion comprendront plus tard << comme c'est dur d'être femme ».Le livre procure une indéniable impression d'étouffement, mais il fait aussi passer un sens aigu de la volonté :comme le dit bien le critique Li Tuo, Zhang Jie réalise des portraits « d'idéalistes en souffrance ». Le style met en Cvidence une grande technique du détail dans la relation de la vie sociale des personnages, sans pour autant chercher à occulter les sympathies de l'auteur. Avec le thème de la vie de femme divorcée, Zhang Jie aborde une réalité dont on sait qu'elle a longtemps été la sienne. Roman féministe ? Zhang, qui se méfie de ce genre d'étiquette, a récemment confié que, pour elle, l'important en matière de liberation de la femme ce sont les connaissances sociales, plus encore que l'égalité des salaires ou la position politique (cf. Wenxue bao, 10 août 1989). Notes brèves D'un ton amer et assez délicat à la fois, ce roman es1 un témoignage marquant, que rend avec vivacité une version française qui a souvent su trouver des formules pleines d'humour. Annie Curien Zhang Xinxin, Le courrier des bandifs. Traduction d'Emmanuelle Péclienart et Robin Setton. Arles, Actes Sud, 1989. 378 pages La ville de Pékin est comme prise dans un vent de mutations. De vieux habitants doivent quitter leur quartier en cours de démolition. De plusjeunes ont dû, eux, déserter leur ville et ne sont arrivés à y retrouver un travail qu'au terme d'un parcours de dix ans savamment dessiné à travers la Chine. Les valeurs sont instables. C'est la valse des prix : une folie s'empare du cours des denrées les plus élémentaires. L'ordre familial lui-même est ébranlé. Non seulement des conflits de générations surviennent, dans lesquels les filles (et les belles-filles) ne tiennent pas le plus petit rôle, mais encore on fait l'expérience de nouveaux genres de vie - célibat, divorce, et même remariage avec l'ancienne épouse. Dans ce tourbillon qui saisit la ville, la philatélie apparaît comme « une façon de conserver les valeurs, après tout ».Elle alimente, en tout cas, les passions. Aucune tranche d'âge n'y échappe, de la lycéenne qui se dispute avec son père (également collectionneur) au vieux retraité dont la collection a compté jusqu'à dix mille timbres, tous brûlés dans la cour pendant la Révolution culturelle. Il y a les faux érudits, qui ont appris à s'exprimer sur la philatélie en termes doctes. Il y a aussi les authentiques ignorants obligés de s'informerpour tenter de remplir leur tâche de membre du service d'ordre spécialement mis en place par les entreprises du quartier pour contenir ces activites. Les rues d'un quartier entier sont ainsi saisies par la fièvredes échanges. Des immeubles sont atteints du virus, étage par étage. De l'évocation des scènes de rue, le lecteur est progressivement conduit vers l'immeuble enfiévré où vit le vieux collectionneur esthète. Apaisé, détaché de tout, ce dernier doit bientôt fêter ses quatre-vingt-un ans et il promet que pour la circonstance il fera voir le clou de sa collection, un timbre d'une valeur inestimable. Lorsqu'amive enfin le jour tant attendu, Notes brèves c'est la consternation générale : le timbre a disparu, et avec lui toute la collection. Qui est le voleur? Se trouve-t-ilparmi l'assemblée ? Un véritable jeu de piste, d'analyse et de contre-analyse commence alors. Paru en 1985, le roman de Zhang Xinxin a pour fil conducteur, plutôt que la passion particulière des timbres, le thème de l'engouement. En cela il rappelle indubitablement Une folie d'orchidées (1983). texte plus court dans lequel l'auteur faisait la peinture d'une ville prise de passion pour ces fleurs. On retrouve dans Le courrier des bandits l'amorce d'une intrigue policière, bien qu'à mon sens le rythme même de l'enquête y soit moins convaincant que toute la mise en scène, laquelle occupe entièrement la première moitié du roman. Au nœud thématique et géographique (avec en son centre l'immeuble) viennent s'ajouter quantité de petits tableaux, souvent drôles, aussi vivants que brillamment brossés : des vieux qui prennent le soleil sur un banc ; un jeune homme amateur de moto ; le fngidaire Sharp voisinant avec une armoire Ming dans le salon du vieil esthète ;l'arrivée d'une jeune paysanne qui va devenir femme de ménage...Zhang Xinxin excelle à rendre l'aunosphère de changement qui touche, en premier lieu. la ville même. Le décor est campé dès la première page : << Au milieu de la vaste place, le mausolée du Président Mao... En toile de fond, deux affiches géantes célèbrent l'électronique Sharp et les Pétroles de Nanhai B. Puis vient l'évocation, par un de leurs habitants, de la démolition des vieux quartiers, et la nostalgie rejoint ici la satire sociale : << Debout sur le seuil de ce qui lui reste de maison, il contemple le quartier en ruine, exempt de surveillance,de comité de riverains et d'ailleurs de toute vie humaine, et il a le sentiment de régner sur ce bout de territoire. » De telles touches, qui procurent au lecteur une impression de fraîcheur et de liberté, ne produisent pas d'effet d'éparpillement tant est précis l'objet de la satire de Zhang Xinxin. C'est sans doute dans ces tableaux égrenés au fil du récit que l'imagination et la couleur de l'auteur trouvent leur meilleur terrain d'expression. Soulignons pour finir la qualité du travail des traducteurs, en particulier la façon dont ils ont su rendre certains passages assez techniques et le ton volontiers populaire du texte. Annie Curien